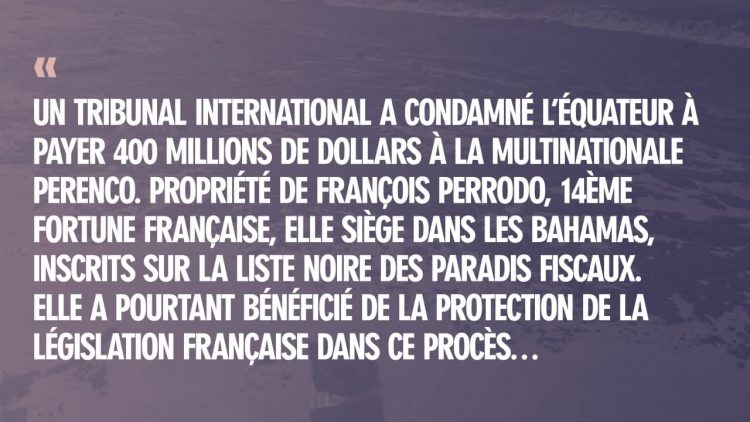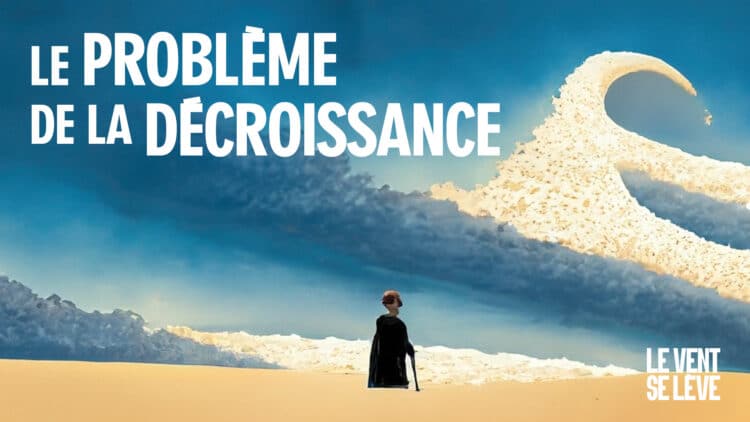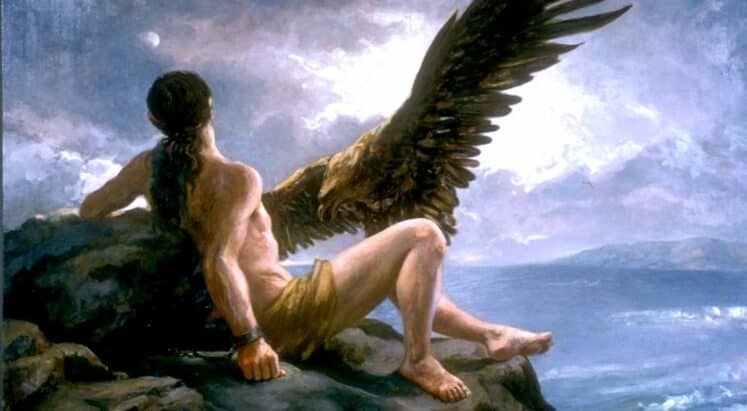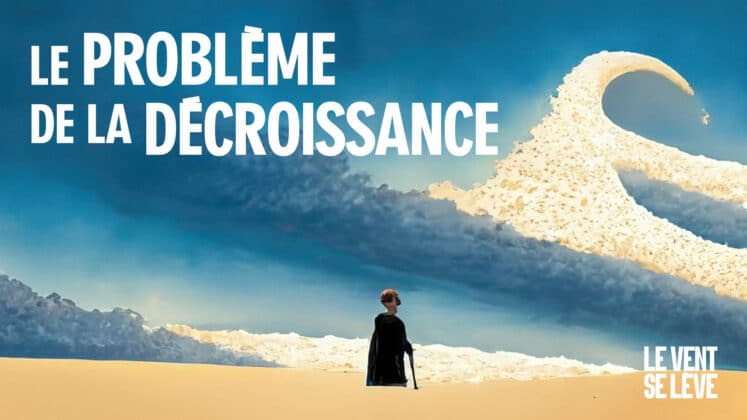Tel qu’il se présente aujourd’hui, le mouvement pour le climat n’est pas en mesure de lutter contre la classe possédante qui est à l’origine de la crise climatique. Pour gagner, les défenseurs du climat ont besoin d’une stratégie claire et s’appuyant sur la classe ouvrière. Entretien avec le géographe Matt T. Huber, réalisé par Wim Debucquoy, initialement publié par la revue Lava, notre partenaire belge.
Le mouvement pour le climat est en train de perdre la bataille. Dans le premier paragraphe de son livre Climate Change as Class War: Building socialism on a warming planet, Matt Huber, professeur de géographie à l’université de Syracuse, ne mâche pas ses mots. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter malgré une prise de conscience croissante de la crise climatique et une attention politique accrue en matière de climat. Il est grand temps que le mouvement pour le climat réfléchisse à sa stratégie et à ses tactiques. Comment pouvons-nous gagner la bataille du climat ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord savoir exactement contre qui lutter, qui combattre et qui convaincre. Le fil conducteur du livre de M. Huber est que la lutte contre le changement climatique est un enjeu de pouvoir. La crise climatique est fondamentalement liée à notre relation avec la nature. Il s’agit essentiellement d’une relation de production : comment produisons-nous les aliments, l’énergie, le logement et les autres biens et services de première nécessité ? Et qui contrôle et bénéficie de cette production ? Comment cela se répercute-t-il sur la stratégie du mouvement pour le climat ? Dans son ouvrage, M. Huber cherche une stratégie gagnante pour le mouvement climatique. Rencontre avec un auteur qui place la classe ouvrière au centre de sa réflexion.
Wim Debucquoy – Comment en êtes-vous venu à écrire un livre sur le changement climatique ?
Matt T. Huber – C’était en partie une réaction contre le mode de pensée qui considère le changement climatique comme un problème de consommation et d’inégalité. Ainsi, le rapport influent d’Oxfam Extreme Carbon Inequality, par exemple, conclut que les riches ont une empreinte carbone beaucoup plus importante et consomment beaucoup plus de ressources que les pauvres. Certes, mais cette façon de penser ne tient compte que de notre impact sur le climat par le biais de notre consommation et de notre mode de vie. Les marxistes, quant à eux, procèdent à une analyse de classe, soulignant le lien entre la production, la propriété et le pouvoir sur les ressources sociales, et la manière dont nous produisons notre existence matérielle. À partir du moment où j’ai commencé à envisager la classe sociale en relation avec le climat de cette manière, j’ai réalisé que le moindre de nos soucis était de savoir ce que les riches faisaient de leur argent et en quoi leur consommation avait un impact sur le climat. Ce dont nous devrions surtout nous préoccuper, c’est de savoir comment ils gagnent leur argent, comment ils génèrent leur richesse. Leur impact sur le climat pourrait alors être beaucoup plus important.
Je donne souvent l’exemple d’un PDG d’une entreprise de combustibles fossiles qui passe entre huit et douze heures par jour à organiser le réseau mondial d’extraction de combustibles fossiles et à injecter de l’argent dans l’accumulation de capital pour développer la production de combustibles fossiles dans le monde entier. Ce PDG peut être végétarien, se rendre au travail en transports publics, vivre dans une zone urbaine densément peuplée et avoir une empreinte carbone très faible. Si l’on ne considère que la consommation des personnes, on efface le rôle qu’elles jouent dans la production. On efface donc le rôle de la propriété et du profit. Aussi faut-il souligner que le système capitaliste est dirigé par une petite minorité de propriétaires qui possèdent les systèmes de production et produisent dans un but purement lucratif.
Wim Debucquoy – Vous écrivez que le mouvement pour le climat reste très confus quant à la question des responsabilités de la crise climatique.
Matt T. Huber – Nous devons arrêter de définir la responsabilité en termes de consommation et d’empreinte carbone et de rendre ainsi chacun plus ou moins responsable de la crise climatique. Nous devons procéder à une analyse de classe. Saviez-vous que la méthode de l’empreinte carbone a été inventée par British Petroleum ? Les multinationales pétrolières ne font rien d’autre que de reporter leur responsabilité sur nous tous. Alors que nous devrions nous poser la question : qui décide de l’organisation des systèmes de production et des infrastructures à l’origine de la crise climatique ? Car ce n’est certainement pas nous. Il ne s’agit pas des travailleurs qui consomment du carburant pour se rendre au boulot tous les jours.
Si l’on ne considère que la consommation des personnes, on efface le rôle qu’elles jouent dans la production, le rôle de la propriété et du profit.
Ceux qui ont le pouvoir sur les réseaux électriques, les stations de distribution de carburant et la production d’énergie sont un groupe de capitalistes qui possèdent et contrôlent ces systèmes et les organisent de manière à en tirer le plus de profit possible. Il s’agit d’un groupe restreint de propriétaires qui exercent une mainmise sur des modes de production à forte intensité de carbone, non seulement l’extraction des combustibles fossiles, mais aussi toute une série d’industries telles que l’acier, le ciment, les produits chimiques, l’électricité et ainsi de suite, lesquelles sont en réalité conçues pour consommer et brûler des quantités colossales de combustibles fossiles. Dix pour cent des riches contrôlent 84% des parts sur le marché boursier. Les décisions des multinationales, quant à elles, sont prises par un nombre très réduit de membres de conseil d’administration. Ainsi, la responsabilité de la crise climatique n’est pas dispersée, mais au contraire très concentrée.
En d’autres termes, ceux qui bénéficient des émissions de CO2 en sont responsables. Lorsque vous conduisez une voiture, vous émettez du carbone. C’est bien sûr vrai. Cependant, en raison de la façon dont la société est organisée, de nombreuses personnes se voient contraintes de consommer une quantité importante de carburant pour se rendre au travail, et simplement pour assurer la continuité de leur vie relativement modeste. Si vous attribuez 100% de la responsabilité au consommateur de combustibles, vous détournez de fait l’attention de celui qui l’a vendu et qui en a utilisé les bénéfices pour accroître la production de ces mêmes combustibles fossiles. Ce sont les propriétaires de la production qui devraient être la cible de nos campagnes et mouvements pour le climat. En résumé : le problème se situe au niveau d’une poignée de capitalistes et la solution se trouve au niveau des masses, de la classe ouvrière. Ils peuvent construire un puissant mouvement de masse pour s’attaquer au pouvoir de cette petite minorité qui possède les moyens de production et en tire profit.
Wim Debucquoy – Vous critiquez également l’idée selon laquelle les citoyens doivent croire au changement climatique avant de pouvoir s’attaquer à la crise.
Matt T. Huber – Le changement climatique est scientifiquement établi. Ainsi, les climatologues ont été parmi les principaux acteurs à faire bouger le monde. Or, si la lutte contre le changement climatique se cantonne à la science et aux connaissances, les travailleurs s’y intéresseront moins. Leur première préoccupation est la lutte matérielle à laquelle ils sont confrontés quotidiennement dans le cadre du capitalisme. D’aucuns concluent que la science du climat dépasse les travailleurs et que, par conséquent, nous ne pouvons pas compter sur eux. Or, la plupart des travailleurs comprennent très bien que quelque chose ne va pas du tout avec le climat et l’environnement et que des mesures doivent être prises pour y remédier.
Or, si l’on organise la lutte autour d’objectifs scientifiques, on fait fi des préoccupations des citoyens concernant leurs besoins quotidiens. En outre, ceux qui présentent la lutte contre le changement climatique comme une bataille pour la connaissance et non pour le pouvoir prétendent que le financement du déni de la science du climat est la pire chose que l’industrie des combustibles fossiles puisse faire. Il existe de nombreuses preuves que les entreprises de combustibles fossiles, telles qu’ExxonMobil, agissent effectivement de la sorte. Ils transfèrent des fonds à des scientifiques qui remettent en question la science du climat. C’est bien sûr terrible. Mais ce que l’industrie des combustibles fossiles recherche avant tout c’est le pouvoir politique. Elle dépense beaucoup plus d’argent en lobbying, en groupes de réflexion, etc. Si nous nous contentons de parler de science, nous nous laissons induire en erreur par une croyance libérale naïve sur la manière dont le changement social se produit, à savoir que la société agira si seulement les gens connaissent la vérité. La connaissance n’est pas encore un pouvoir. Ce n’est pas parce que nous connaissons la vérité que nous avons le pouvoir de nous attaquer à la crise climatique et de modifier notre utilisation des ressources matérielles. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont transformé la bataille climatique en une bataille idéaliste sur le terrain de la connaissance.
Wim Debucquoy – Comment résoudre la crise climatique ?
Matt T. Huber – Je ne vous apprends rien en vous disant que nous avons besoin de pouvoir, n’est-ce pas ? Nous aurons besoin de beaucoup de pouvoir social. La résolution de la crise climatique nécessite des investissements massifs et une planification centralisée. Cela signifie qu’il faut lutter contre la mainmise du secteur privé sur les investissements. Une grande partie du mouvement pour le climat adopte une position purement moraliste, sans se préoccuper du pouvoir et de la stratégie, de la manière dont nous pouvons construire le pouvoir nécessaire pour affronter cette classe de personnes qui s’accroche obstinément à ses investissements et à ses profits pendant que le monde brûle. L’ensemble de mon livre est donc une tentative de réflexion sur la manière de mettre en place le contre-pouvoir nécessaire.
Wim Debucquoy – Et selon vous, la solution se trouve du côté de la classe ouvrière ?
Matt T. Huber – Oui, même à une époque où il semble que tout le pouvoir soit entre les mains de la classe capitaliste, la classe ouvrière est en mesure de construire le type de pouvoir politique qui soit à même de contrer le pouvoir du capital. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, la classe ouvrière constitue la grande majorité de notre société. Son pouvoir réside dans son nombre. Si vous parvenez à exploiter massivement le pouvoir de la classe ouvrière, vous pouvez remporter la victoire, en dépit de ses divisions, au moins au sens démocratique le plus élémentaire. Comme l’a dit Lénine, la politique est une affaire de millions. La politique se trouve là où se trouvent les masses. Tout au long de l’histoire, qu’il s’agisse de périodes révolutionnaires ou de périodes plus calmes de redistribution des richesses et de démocratie sociale, la résistance a toujours émergé de la politique lorsque des masses de personnes s’unissaient autour d’une plate-forme et d’un programme politiques.
Un groupe restreint de propriétaires exercent une mainmise sur des modes de production à forte intensité de carbone.
Deuxièmement, la classe ouvrière a un intérêt matériel au changement parce qu’elle n’a plus aucun contrôle sur sa vie et qu’elle souffre d’un manque de sécurité matérielle. Même si elle n’en est pas toujours consciente ou si elle ne s’organise pas en fonction de cela. Le troisième point, le plus important, est que la classe ouvrière détient le pouvoir stratégique dans la mesure où c’est elle qui effectue le travail et produit donc la plus-value. Les travailleurs peuvent se mettre en grève, arrêter les systèmes de production et ainsi forcer les élites à répondre à leurs demandes. L’arme de la grève est son meilleur atout pour imposer un changement rapide. Aux États-Unis, il semble que la classe ouvrière ait oublié qu’elle a ce pouvoir. Le nombre de grèves a nettement diminué à partir de 1980. Le dirigeant syndical Jerry Brown déclare à ce sujet : les grèves sont comme les muscles, si vous ne les exercez pas régulièrement, ils se rabougrissent. Aujourd’hui encore, la grève reste l’arme la plus puissante dont disposent les travailleurs. En Virginie occidentale, aux États-Unis, les enseignants ont bloqué l’ensemble du système scolaire et ont obtenu gain de cause en quelques semaines, ce qui n’est pas négligeable dans un État de droite. Le pouvoir c’est ça, n’est-ce pas ?
En multipliant les grèves et en prenant conscience du pouvoir qu’ils détiennent, les travailleurs sont en mesure de construire un mouvement puissant. Nous avons besoin de mouvements suffisamment puissants pour formuler des demandes politiques fortes. Un programme qui vise à promouvoir une économie sans carbone requiert un pouvoir politique formidable. Et la voie vers ce pouvoir passe par la classe travailleuse organisée.
Wim Debucquoy – On entend souvent dire que la classe travailleuse a d’autres préoccupations que le climat.
Matt T. Huber – On a tendance à penser que les travailleurs ne s’intéressent à l’environnement que lorsqu’ils sont en contact direct avec lui, par exemple pour protéger un paysage dans leur quartier ou lutter contre la pollution sur leur lieu de travail. Cependant, sous le capitalisme, la plus grande menace qui pèse sur eux n’est pas nécessairement quelque chose que nous présentons comme un problème écologique, tel que la pollution, mais le fait que leur survie passe par le marché. Le capitalisme a arraché les gens à la terre, à leur lien avec la nature, et a créé une classe de personnes qui dépendent du marché pour survivre et qui luttent pour littéralement survivre en tant qu’êtres vivants. Ils peinent à payer pour leur logement, leurs soins de santé et leur nourriture. C’est cette insécurité économique, qui consiste à devoir survivre en dépendant du marché, qui est une source constante d’anxiété pour la classe ouvrière.
Lorsque le mouvement de protestation des Gilets jaunes a éclaté en réponse aux prétendues politiques environnementales, ils ont déclaré que les politiciens s’inquiétaient de la fin du monde, alors qu’eux essayaient simplement d’arriver à la fin du mois. Cela montre que de nombreuses politiques libérales en matière de climat présentent les questions environnementales comme des crises abstraites et existentielles pour la planète, sans pour autant tenir compte des luttes que mènent les travailleurs pour arriver à la fin du mois. Pourtant, ce combat est éminemment écologique dans la mesure où la classe ouvrière tente de vivre et de satisfaire ses besoins fondamentaux. Pour convaincre les travailleurs que la lutte contre le changement climatique est aussi dans leur intérêt et les rallier à un programme climatique, nous devons nous attaquer à l’insécurité qui découle de la lutte pour la survie par le biais du marché. Nous devons leur proposer un programme climatique qui leur apporte un peu plus d’assurance que leurs besoins fondamentaux seront satisfaits.
La femme ne constitue pas une classe en tant que telle, un monde sépare la femme de la bourgeoisie et celle des classes populaires.
Ces besoins ne sont d’ailleurs pas sans rapport avec la crise climatique. Si nous examinons les secteurs que nous devons décarboner de manière radicale, il s’agit notamment de l’énergie. Des choses dont les gens ont besoin tous les jours, mais qu’ils ont du mal à s’offrir : le logement, les transports, l’alimentation et l’agriculture. Ce sont ces secteurs que nous devons transformer radicalement. Malheureusement, de nombreux décideurs politiques affirment : oui, nous allons restructurer ces secteurs, mais nous allons le faire de manière à ce que les externalités des marchés soient internalisées et qu’elles coûtent donc encore plus cher. Bien sûr, les travailleurs réagissent négativement à cela. En comprenant mieux les intérêts de la classe ouvrière sous le capitalisme, nous voyons clairement comment nous pouvons lier ces intérêts à un programme climatique populaire et attrayant. Elle devrait être basée sur la démarchandisation [ndlr : c’est-à-dire, affranchir les personnes de leur dépendance au marché en découplant les services de base (logement, énergie, transports publics, etc.) des mécanismes de marché et en les intégrant dans le domaine public] et viser à améliorer les conditions de vie de la classe travailleuse.
Wim Debucquoy – Quelle est votre analyse du mouvement pour le climat tel qu’il se présente aujourd’hui ?
Matt T. Huber – Les personnes qui se trouvent à la tête du mouvement pour le climat sont issues de ce que j’appelle la « classe professionnelle et managériale » ou CPM, une strate professionnelle au sein de la classe travailleuse si l’on peut dire. En général, la politique climatique est pour eux une question de science et de connaissance. Sur le plan matériel, la CPM recherche le confort et la sécurité propres à la classe moyenne. Et comme cette sécurité de la classe moyenne s’accompagne souvent de niveaux de consommation relativement élevés, le problème climatique pour la CPM se rapporte à sa propre consommation.
Les personnes appartenant à ladite CPM se sentent coupables de leur complicité dans l’économie de consommation. Leur politique climatique prend donc trois formes. Le premier groupe est composé de ce que l’on pourrait appeler des éducateurs scientifiques, à savoir les climatologues eux-mêmes, les journalistes qui couvrent la science du climat et les activistes politiques qui diffusent la vérité scientifique. Et comme je l’ai expliqué précédemment, leur politique est axée sur la croyance et la connaissance, sur l’écoute de la science et sur la lutte contre le négationnisme climatique. Le deuxième groupe est formé par ce que je nomme les technocrates politiques : il s’agit principalement d’experts en économie ou en études politiques qui travaillent dans des universités ou au sein de groupes de réflexion. Ceux-ci sont apparus au cours de la période néolibérale, alors que tout le monde affirmait qu’il fallait se débarrasser de la réglementation et de la redistribution de l’État et adopter des politiques environnementales axées sur le marché. Ils soutiennent qu’il est possible de « déjouer » la crise climatique en adoptant certaines politiques telles que la taxe sur le carbone. Pour eux aussi, la lutte pour le climat est une lutte pour la connaissance plutôt qu’une lutte de pouvoir avec la classe possédante qui profite de la crise climatique. Par ailleurs, en déployant des mécanismes de marché pour résoudre la crise climatique, ils en reportent le coût sur la classe ouvrière.
Wim Debucquoy – La taxe carbone en est un exemple typique.
Matt T. Huber – Exactement. À cela, je réponds : nous ne devrions pas taxer les molécules, mais les riches. L’idée de taxer une molécule particulière occulte le fait que la lutte contre le changement climatique est une lutte des classes et que nous devons taxer les riches pour réaliser le programme de décarbonisation dans l’intérêt de tous. Le problème est également que nous utilisons tous du carbone. Si vous réclamez ensuite une taxe sur le carbone, la droite et ceux qui ne veulent pas que nous fassions quoi que ce soit pour lutter contre le changement climatique auront tôt fait de prétendre qu’il s’agira d’une taxe sur votre vie. Et une taxe sur le carbone entraîne des coûts plus élevés pour la classe ouvrière. De plus, c’est un cadeau pour la droite qui peut alors dire que la politique environnementale est une affaire d’élites de gauche qui veulent rendre la vie plus chère. De nombreux technocrates répondent même à cela par : « Oui, c’est exactement ce que nous essayons de faire. » Il est également frappant de constater que c’est souvent la droite qui s’organise autour d’une politique de classe dans la lutte pour le climat. C’est surtout la droite qui insiste sur les conséquences économiques de la politique climatique. Ils n’ont de cesse de parler des emplois perdus et de la hausse du coût de la vie pour les familles. Et ce faisant, ils contribuent à alimenter une réaction populiste à l’encontre de la politique climatique.
Wim Debucquoy – Comment gérer la contradiction entre l’emploi et l’environnement ?
Matt T. Huber – Tout d’abord, nous devons insister sur le fait que le changement climatique est une question d’emploi. Pour moi, il est évident qu’un programme de décarbonisation digne de ce nom exige la création d’un très grand nombre d’emplois, en particulier dans le secteur industriel. Pour poser des lignes de transmission, construire de nouveaux systèmes de transport en commun, rénover l’habitat… Il faut beaucoup d’électriciens, de soudeurs, de tuyauteurs, de travailleurs de la construction. Une deuxième question importante se pose : ces emplois seront-ils créés dans des lieux de travail syndiqués ? Aux États-Unis, nous allons produire beaucoup de voitures électriques, mais il n’est pas encore certain que cela soit favorable aux syndicats. Ainsi, le syndicat United Auto Workers ne soutiendra pas Joe Biden lors des prochaines élections présidentielles tant qu’il n’aura pas précisé que toute expansion de la production de voitures électriques se fera dans des usines dotées d’une représentation syndicale. En effet, les constructeurs automobiles exploitent aujourd’hui la production de voitures électriques pour briser les syndicats et créer de nouvelles usines sans syndicats.
Le mouvement pour le climat pense rarement au pouvoir et à la stratégie, à la construction d’un contre-pouvoir face à la classe dominante.
Un troisième groupe au sein du mouvement pour le climat est celui que l’on appelle les « radicaux anti-système ». Ceux-ci sont favorables à un changement de système, mais au lieu de transformer le système industriel et de le placer sous contrôle démocratique, ils veulent le démanteler complètement. Vous opposez à cela une citation de Jodi Dean : « Goldman Sachs se fiche de savoir si vous élevez des poulets. »
Ces radicaux se concentrent dans les milieux universitaires, les ONG ou les cercles militants plus radicaux. Parce qu’ils travaillent dans l’économie de la connaissance, ils n’ont aucun lien physique avec les systèmes de production industrielle qui sous-tendent nos vies et la reproduction sociale dans une société capitaliste. Deux choses sont importantes pour eux. Ils veulent réduire la consommation et concentrent une grande partie de leurs critiques sur la surconsommation et le consumérisme. Il y a une part de vérité dans cette affirmation – la société de consommation étasunienne présente des aspects délétères que je ne préconiserais d’aucune façon dans le cadre d’une société socialiste. Cependant, les radicaux continuent à se concentrer sur la consommation.
D’autre part, la crise écologique et climatique les ayant radicalisés à ce point, ils ne demandent qu’à démolir et à détruire complètement le système industriel, qui pour moi – pour citer Friedrich Engels – est une utopie. Une approche socialiste scientifique part du constat que nous vivons dans un système industriel. La question qui se pose est la suivante : comment pouvons-nous réellement prendre le contrôle de ce système et le changer, au lieu de le détruire et de créer des enclaves locales à petite échelle où nous reconstruisons la société à partir de zéro ?
La vision anarchiste selon laquelle nous pouvons simplement créer des communes agricoles et alimentaires locales peut s’avérer très excitante pour les participants, mais elle ne résoudra pas la crise climatique. Nous vivons dans une société capitaliste globale et intégrée qui mène la planète à sa perte. Et nous avons, dès lors, besoin de solutions globales. C’est là le sens qu’il faut donner à la citation de Jodi Dean. Peu importe que vous montiez votre petite coopérative alimentaire locale, mais la banque d’investissement, Goldman Sachs va continuer à organiser l’économie mondiale dans son propre intérêt. Cela signifie que le monde est toujours en feu et qu’il se dirige toujours vers une destruction totale. Nous devons donc réfléchir à une approche beaucoup plus large si nous tenons à contrer ce pouvoir.
Un autre problème avec les radicaux anti-système est qu’ils ne parlent souvent qu’entre eux. Permettez-moi de vous donner un exemple. J’étais récemment au Danemark pour les élections, qui se sont d’ailleurs très mal terminées pour la gauche. J’ai lu dans un rapport que de nombreux travailleurs de la célèbre industrie éolienne danoise sont passés aux partis de droite. J’ai parlé à de nombreux militants locaux partisans de la justice climatique. Ils sont très engagés et ont longuement évoqué l’importance de la solidarité avec les pays du Sud et avec les luttes des peuples autochtones à travers le monde, pourtant ils semblaient ignorer que cette même situation était également présente dans leur propre pays. Leur conception de la justice climatique est très moralisatrice. Ils n’ont pas de lien avec les travailleurs industriels et ne comprennent pas à quoi ressemblerait un programme de décarbonisation qui tiendrait compte de leurs intérêts et de leur point de vue. La décroissance en est un bon exemple. Les partisans de la décroissance affirment que l’idée devient de plus en plus populaire, mais si l’on regarde de plus près qui sont les partisans de la décroissance, on constate qu’il s’agit presque exclusivement d’un mouvement d’universitaires. Pour moi, ce n’est pas ainsi que l’on construit une large coalition de travailleurs qui réfléchissent à la manière d’organiser la solidarité au-delà des nombreuses différences au sein de la classe travailleuse. Comment pouvons-nous forger une coalition plus large ?
Wim Debucquoy – L’une des critiques intéressantes de la décroissance dans votre livre est que la décroissance se focalise sur l’idéologie de la croissance, toutefois sans se livrer à une analyse de classe. Et que pour le capitalisme dans son ensemble, l’économie ne devrait pas nécessairement croître, tant que le capital croît.
Matt T. Huber – Depuis que j’ai écrit ce livre, j’ai réfléchi davantage à ce sujet et j’ai constaté que le capitalisme n’est pas vraiment doué pour la croissance, même au cours des dernières décennies. Jack Copley a rédigé un excellent article sur la décarbonisation de la récession et sur la lutte contre la crise climatique dans une ère de stagnation. Il est clair que le capital n’est pas vraiment intéressé par l’investissement dans l’expansion matérielle ou la production. Elle cherche à maximiser les profits en pillant le secteur public et en recourant à la financiarisation. Et oui, comme d’autres le diront, le produit national brut (PNB) est une sorte d’invention statistique qui ne mesure pas le bien-être d’une société. Il s’agit d’une mesure indirecte de la croissance du capital privé. Le PNB occulte, cependant, également le fait que nous vivons dans une société capitaliste divisée et très inégale. Cet indicateur occulte les divisions de classe au sein de notre société et ce qui compte vraiment dans la vie des gens en matière de bien-être matériel. Or, en réaction à cette idéologie du PNB (« growthism »), la décroisssance se borne à la combattre et à l’inverser, plutôt que de procéder à une analyse de classe. En revanche, si l’on pousse la discussion avec les partisans de la décroissance, on se rend vite compte que ce qu’ils veulent, c’est permettre à de nombreux secteurs de l’économie de croître et de ne démanteler que les secteurs les moins performants. Une majorité d’entre eux s’accorde sur le fait que nous avons besoin de la lutte des classes pour y parvenir. Mais malheureusement, si vous organisez tout votre programme autour d’un terme comme la décroissance, vous risquez d’être accusé de promouvoir une politique d’austérité, même si vous rejetez cette caractérisation.
Wim Debucquoy – Dans son livre How to blow up a pipeline, le chercheur et activiste Andreas Malm préconise une tactique différente. Il privilégie les actions massives de désobéissance civile, une tactique que l’on retrouve également au sein du mouvement pour le climat en Belgique actuellement.
Matt T. Huber – Dans son livre, Malm se montre assez critique à l’égard de l’accent mis sur la désobéissance civile, en particulier dans des mouvements comme Extinction Rebellion et Just Stop Oil. Dans toute la stratégie qu’ils ont développée, ils se méprennent sur la manière dont la désobéissance civile conduit au changement social. Ils interprètent de façon erronée le rôle de personnalités telles que Martin Luther King et Gandhi. Dans son livre, Malm montre de manière convaincante que la plupart des mouvements qui ont connu le succès dans le passé, des suffragettes au mouvement anti-apartheid en passant par le mouvement des droits civiques, comportaient une frange radicale. Cette frange radicale a détruit des biens pour nourrir la lutte et inciter des millions de personnes à rejoindre le mouvement de masse. Si la plupart des mouvements qui ont réussi comportaient une telle composante radicale, le mouvement dans son ensemble n’a jamais été caractérisé par une telle radicalité. Malm insiste clairement sur le fait que la frange radicale ne représentera jamais qu’une partie du mouvement de masse. Toutefois, à nul moment dans son ouvrage nous prescrit-il la manière dont doit se construire le mouvement de masse lui-même.
Un véritable programme de décarbonisation nécessite un grand nombre d’emplois, en particulier dans l’industrie.
Dans son livre, Malm montre très clairement que cela fait des décennies que les militants environnementaux aux États-Unis se livrent à des destructions radicales de biens. Nous les appelons l’Earth Liberation Front (Front de libération de la Terre) et le mouvement « Earth First » (La Terre d’abord). Les initiatives de ce genre n’ont toutefois abouti à rien. Ces militants ont d’ailleurs été constamment surveillés et mis hors d’état de nuire par l’État sécuritaire, qui les a arrêtés et étiquetés comme éco-terroristes. Ces groupes n’ont pas réussi à s’intégrer au sein d’un mouvement de masse plus large, capable d’atteindre les objectifs pour lesquels ils luttaient. Malm cite à titre d’exemple les dégonfleurs de pneus (un groupe international d’action climatique qui dégonfle les pneus des SUV parce qu’ils ont un impact encore plus important sur la crise climatique que les autres voitures N.D.L.R.). Mais je ne vois nulle part cette action inspirer des millions de personnes à rejoindre le mouvement pour le climat.
Wim Debucquoy – Vous préconisez une stratégie s’appuyant sur la classe travailleuse et la construction d’un contre-pouvoir sur le lieu de travail à partir de la base.
Matt T. Huber – Pour moi, le principal défi est le suivant : comment construire ce mouvement de masse ? Dans l’histoire du capitalisme, les mouvements de masse couronnés de succès ont été largement menés par les organisations de la classe ouvrière. Par exemple, le mouvement des droits civiques aux États-Unis a été mené par des personnes comme Philip Randolph, un dirigeant syndical, et Bayard Rustin, un socialiste qui a tenté de créer un mouvement socialiste aux États-Unis. Ils ont organisé une marche sur Washington pour la justice raciale, mais aussi pour l’emploi et la liberté. Nous avons une longue histoire qui montre que la classe ouvrière a la capacité de construire un mouvement de masse, si elle s’organise, si elle construit une conscience de classe à grande échelle. La prise de conscience que nous partageons tous des intérêts matériels et que nous avons un ennemi commun, la classe capitaliste.
Wim Debucquoy – Comment transformer le mouvement pour le climat en un mouvement de masse ?
Matt T. Huber – Il n’y a pas vraiment d’alternative à la reconstruction des organisations de masse de la classe ouvrière, telles que, par exemple, les syndicats et les partis organisés ancrés dans les quartiers populaires qui apportent des changements matériels réels dans la vie quotidienne des travailleurs. Nous devons les convaincre qu’en adhérant au syndicat ou au parti, ils peuvent obtenir des avantages matériels concrets grâce à l’organisation et à l’utilisation de leur pouvoir collectif. On ne peut échapper à ce type de travail d’organisation.
En construisant une politique unie de la classe travailleuse et un contre-pouvoir capable de contrer le capital, nous pouvons lutter pour l’investissement et revendiquer le surplus social, prôner des politiques de redistribution à grande échelle et donc lutter pour l’investissement public dans de nombreux domaines, non seulement pour le climat, mais aussi pour la garde d’enfants, une meilleure éducation ou de meilleurs soins de santé. La seule façon de rallier les travailleurs à la cause du climat est de les convaincre que le changement climatique ne signifie pas que leur vie deviendra plus chère. Il s’agit de construire une société nouvelle, de nouvelles infrastructures, de nouveaux emplois où les gens puissent accomplir un travail utile. Il s’agit de renforcer le mouvement syndical.