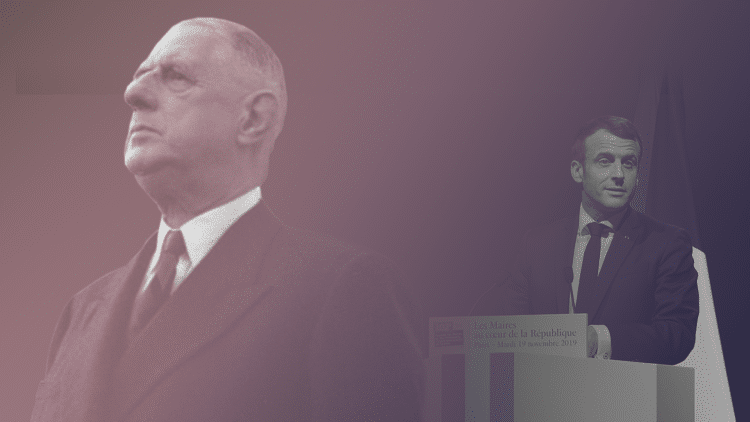L’Iran est secoué depuis un mois par une vague de manifestations de grande ampleur à tonalité insurrectionnelle. Elles s’inscrivent dans une série de protestations hétérogènes qui ébranlent la République islamique d’Iran depuis quelques années – et dans une tradition insurrectionnelle qui caractérise, plus largement, la culture politique iranienne. Par Max-Valentin Robert et Laura Chazel.
Tout a commencé le 15 novembre dernier, lorsque le président Hassan Rohani annonça une subvention réduite de l’essence[1] : cette décision devait conduire à une hausse de 50 % du prix des soixante premiers litres mensuels, précédant une augmentation de 300 % pour celui des litres suivants[2]. Une décision d’autant moins acceptée que l’Iran subit de plein fouet les répercussions économiques des sanctions américaines[3] : d’après le Fonds Monétaire International, l’inflation dépasserait les 37 % en 2019, contre seulement 9,6 % en 2017[4]. S’ensuivit une série de protestations dans différentes villes du pays, qui poussèrent le Conseil supérieur de la sécurité nationale à instituer un véritable black-out numérique – les connexions auraient d’ailleurs chuté dans une proportion inférieure à 5 % de leur nombre habituel[5]. Au-delà de l’expression d’un certain ras-le-bol à l’égard du marasme économique, cette insurrection prit rapidement une tonalité politique affirmée, allant jusqu’à la mise en cause de la République islamique elle-même.
En Iran, l’opposition au régime en place peine à s’organiser : le « mouvement vert » de 2009 avait avant tout été porté par les couches intellectuelles aisées et n’avait pas su mobiliser les classes les plus appauvries, alors que les manifestations de 2017-2018 étaient au contraire portées par les milieux modestes et traditionalistes. Les événements contestataires en cours marquent une inflexion importante car ils semblent mobiliser tout autant les classes moyennes des grandes métropoles (Téhéran, Chiraz, Ispahan) que les milieux populaires des villes de taille plus modeste. Autre nouveauté importante, on assiste aujourd’hui à une répression extrêmement féroce de la part des autorités, la plus importante « depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 1988 »[6] selon Thierry Coville, chercheur à l’IRIS, spécialiste de l’Iran. En effet, on compte « au moins 208 morts »[7] selon le dernier rapport d’Amnesty International publié début décembre 2019 (un chiffre parfois estimé à 900 décès), 4000 blessés[8] et « au moins 7000 » arrestations selon l’ONU[9]. Si la répression des protestations semble avoir pris une ampleur inédite, ce raidissement s’inscrit dans le cadre d’une incompréhension croissante entre des autorités politiques sclérosées et une population en proie à d’importants bouleversements sociaux, et encline à la contestation.
Une tradition insurrectionnelle ?
« Maintenant qu’un modèle de solidarité entre les déshérités s’est réalisé dans le monde islamique, il faut généraliser ce modèle entre les différentes catégories humaines sous le nom de “parti des déshérités”, qui est le parti de Dieu […]. Nous appelons tous les déshérités du monde à se rallier sous l’emblème du parti de Dieu et à triompher de leurs problèmes par l’union, la volonté, la détermination inébranlable et la résolution de tout problème qui pourrait survenir dans n’importe quel endroit et qui concerne n’importe quel peuple par l’intermédiaire du parti des déshérités.[10] » La tonalité insurrectionnelle caractérisant cette déclaration de l’ayatollah Khomeini pourrait étonner de prime abord, eu égard à l’image de conservatisme social et d’immobilisme politique à laquelle le sens commun rattache habituellement le régime iranien. Cette perception occulte cependant le fait que la République islamique est née d’un épisode révolutionnaire, et convoque fréquemment la mémoire de cet épisode pour entretenir sa légitimation, aussi bien en interne (en témoigne la délégitimation de toute force d’opposition comme « contre-révolutionnaire ») que dans le soft power qu’elle essaye de se construire (via la mobilisation d’une rhétorique se voulant anti-impérialiste et tiers-mondiste). À titre d’exemple, rappelons que le théoricien Ali Shariati (souvent considéré comme l’idéologue de la révolution islamique) décrivait le chiisme comme étant « une religion progressiste, libératrice », et assignait à chacun la responsabilité « de l’instauration du bonheur, de la justice et du progrès humain »[11]. La manifestation d’un phénomène révolutionnaire sous une forme religieuse pourrait sembler surprenante, mais ne constitue aucunement une spécificité iranienne ou moyen-orientale : après l’exécution de Charles Ier en 1649 et l’instauration du Commonwealth, l’Angleterre prit sous Cromwell une orientation sociétale nettement influencée par le puritanisme.
En Iran comme en France, contester radicalement le cadre politique existant peut être appréhendé comme un « ressourcement » auprès des dynamiques insurrectionnelles ayant donné naissance au régime lui-même
La révolution islamique constitue donc une véritable rupture fondatrice pour le régime iranien, et tend à irriguer fortement la culture politique locale. Si le pouvoir peut avoir recours à son souvenir pour tenter de marginaliser les forces protestataires, ces dernières peuvent également s’appuyer sur 1979 pour légitimer leurs modes d’action. Si les autorités se sont fondées sur la mémoire de cette insurrection (et ne cessent de la commémorer), alors le recours aux modes d’action contestataires s’en trouve d’autant plus légitimé au sein de la société elle-même. En ce sens, la révolution islamique semble occuper dans l’imaginaire collectif un espace similaire à la mémoire républicaine française : le processus de construction nationale en France s’est structuré autour du souvenir de 1789, et l’appui sur cet événement a été au cœur de l’entreprise de consolidation du nouveau pouvoir. Or, en se fondant à travers un épisode insurrectionnel, les autorités républicaines contribuèrent aussi à légitimer la mythologie révolutionnaire auprès de formations contestataires à l’égard du régime lui-même. Comme l’explique l’historien Marc Lazar[12], la longue période d’hégémonie électorale du PCF au sein de la gauche française ne s’expliquait pas seulement par une simple « transposition » du léninisme en contexte hexagonal : si la greffe communiste a pu prendre auprès d’une fraction non négligeable de l’électorat, c’est également en raison de la capacité qu’elle a eu à se fondre dans un discours national légitimant le recours aux ruptures révolutionnaires. En Iran comme en France, contester radicalement le cadre politique existant peut ne pas être perçu comme une totale incongruité, et peut même être appréhendé comme un « ressourcement » auprès des dynamiques insurrectionnelles ayant donné naissance au régime lui-même.
C’est en juin 2009 qu’éclate le plus grand mouvement contestataire qu’a connu l’Iran depuis la révolution de 1979. Ces protestations – connues sous le nom de « mouvement vert » – regroupent d’abord les partisans d’Hossein Massouvi, candidat réformiste face à Mahmoud Ahmadinejad lors de la présidentielle de 2009. De forts soupçons de fraude électorale sont exprimés face à l’annonce de la victoire du président sortant le 12 juin 2009, et des manifestations massives sont alors organisées pour remettre en cause le résultat du scrutin. Très vite, le mouvement élargit ses revendications : exigence du respect de la dignité des citoyens (droit des femmes, égalité, justice, liberté), refus des violences[13] et aspirations plus générales à une démocratisation du régime. Les mesures autoritaires prises par le gouvernement à l’encontre du mouvement – coupure de l’accès à internet, interdictions de manifester – sont accompagnées d’une répression féroce (au moins 150 morts et plus de 4000 arrestations sont recensés). Malgré l’interdiction de manifester, le mouvement prend une ampleur inédite mais sa force restera limitée pour deux raisons. D’une part, la protestation demeure majoritairement portée par les couches moyennes urbaines, malgré des tentatives d’élargissement de sa base en s’adressant aux classes populaires souffrant de la situation économique et aux minorités ethniques et religieuses via la revendication de la défense de leurs droits[14]. D’autre part, le mouvement a initialement été porté par les réformistes, un courant « docile » et « fidèle » au régime qui s’est structuré dans le cadre établi par la République islamique, et ne remet donc pas en cause les fondements mêmes de l’État mais « [se contente] d’en indiquer les “dérapages” »[15]. Seule une minorité des manifestants crient « mort au dictateur », que les réformistes tentent alors d’étouffer. En raison de sa capacité à créer une sorte d’opposition « sous contrôle », certains auteurs appellent alors à ne pas sous-estimer la résilience du régime[16].
D’autres analystes ont pourtant vu dans les manifestations de 2009 le « présage [d’]un séisme à venir »[17] qui témoignait de la fragilité du régime. Malgré son échec politique, son incapacité à rallier les classes ouvrières et ses difficultés à s’organiser, le mouvement vert a eu au moins deux répercussions non-négligeables sur le jeu politique iranien : 1) il a créé une « fracture profonde » au sein des élites et parmi les soutiens au régime[18] ; 2) il existe une forme de « résilience sociale » du mouvement maintenant inscrit dans « l’imaginaire collectif » des jeunes générations[19].
De nouvelles manifestations ont eu lieu fin 2017-début 2018 sous la présidence du “réformiste” Hassan Rohani. Les protestations débutent le 28 décembre 2017, à l’initiative du camp le plus conservateur, représenté notamment par les soutiens à l’ex-président Mahmoud Ahmadinejad, afin de protester contre « la politique d’ouverture vers le monde » de Rohani et contre « la perte de leurs avantages politiques et économiques »[20]. Très vite, le mouvement déborde les traditionalistes, et les milieux populaires s’en emparent afin de dénoncer la dégradation de leurs conditions économiques d’existence (mesures d’austérité, hausse du chômage, coupes budgétaires, corruption, augmentation du prix des denrées alimentaires, etc.). Contrairement au mouvement vert, qui peinait à élargir sa base au-delà des couches moyennes et intellectuelles urbaines, les manifestations de 2017-2018 sont donc menées par « des Iraniens de la petite classe moyenne », se considérant comme « victimes des mesures économiques »[21] libérales mises en place par le gouvernement de Hassan Rohani. Toutefois, de la même manière qu’en 2009, au-delà de simples revendications économiques, certaines franges des manifestants remettent en cause le régime dans son ensemble – aux cris de « Mort au Guide » et « Mort au régime »[22]– et des femmes enlèvent également leur voile (elles seront « rappelées à l’ordre et certaines mises en prison »[23]). Bilan des répressions : on compte au moins une vingtaine de morts, et des milliers d’arrestations.
En dépit de leurs causes diverses, les mouvements protestataires qui se sont succédé depuis 2009 furent chacun propices à l’irruption de mots d’ordre radicalement hostiles aux fondements mêmes de l’État. Les fréquentes revendications démocratiques pourraient surprendre de prime abord, si l’on ne gardait en tête les profondes mutations que connaît la société iranienne, et le fossé qu’elles tendent à accentuer entre la République islamique et la population qu’elle administre.
L’État et la société : « divorce à l’iranienne » ?
On remarque l’existence d’une profonde rupture entre la société civile iranienne et le régime des mollahs. Un « divorce à l’iranienne » entre la République islamique aux mains d’un pouvoir « [perçu] comme indélogeable »[24] et une partie de la société iranienne, plus jeune, plus éduquée, en quête de libertés individuelles, et accordant un rôle plus actif à sa population féminine.
Dans une veine provocatrice assumée, Youssef Courbage et Emmanuel Todd soulignaient, vers la fin des années 2000, la modernité démographique de la République islamique d’Iran[25] – alors présidée par l’ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad. Les données les plus récentes dont nous disposons tendent à confirmer ce constat : en 2018, le taux de fécondité iranien s’élevait à seulement 1,96 enfant par femme. Pour rappel, ce taux était de 6,4 enfants par femme en 1986. De plus, la proportion de femmes mariées (situées dans la tranche d’âge 15-49 ans) utilisant des moyens de contraception atteignait 74 % en 2000, alors que cette proportion n’était que de 11 % (pour les femmes âgées de 15 à 45 ans) en 1978. Le pourcentage de femmes alphabétisées âgées entre 15 et 49 ans est passé de 28 % en 1976 à 87,4 % en 2006. Durant la même période, la durée moyenne de leur scolarité a bondi de 1,9 à 8,9 ans. Aujourd’hui, les femmes sont d’ailleurs majoritaires au sein de la population estudiantine. D’après la journaliste Delphine Minoui, « l’instauration du port obligatoire du foulard a également contribué à donner une certaine impulsion à l’émancipation des femmes traditionnelles. Le hejab […] a, en effet, permis aux jeunes Iraniennes issues de familles conservatrices d’obtenir l’accord de leurs pères et frères pour aller étudier à l’université. […] Un “foulard passeport”, donc, qui leur permet de pénétrer plus facilement dans les sphères mixtes qui leur étaient jusqu’ici inconnues »[26] . Comme l’explique Laleh, Iranienne vivant à Lyon[27] : « Avant, [les femmes] avaient un rôle plus passif … […] Aujourd’hui, même dans les productions artistiques, par exemple dans les films, dans le cinéma iranien, ou dans les livres, dans la littérature iranienne, on voit que les femmes ont plus d’influence. C’est vrai qu’il y a le voile, mais elles ont accès à des professions comme avocates, juges, pilotes, policières … Ce n’était pas le cas avant, et maintenant pour les concours d’accès à l’université, il y a 70 % de femmes qui sont acceptées pour suivre une éducation supérieure […]. »
Une autre caractéristique fondamentale de la société locale est sa jeunesse : en 2018, 38,2 % des Iraniens étaient âgés de 0 à 24 ans, et l’âge médian était évalué à 30,8 ans. Selon Alfonso Giordano, « Le “baby boom” d’après la révolution qui s’est prolongé jusqu’au milieu des années 1980 a presque fait doubler la population de 34 à 62 millions en une seule première décennie. L’Iran est aujourd’hui une des sociétés les plus jeunes du monde et son évolution démographique est certainement le facteur le plus menaçant pour le statu quo[28] ». D’autres facteurs sociétaux contribuent également à ce changement progressif des mentalités : la population urbaine atteint une proportion de 75,4 % en 2019, et le taux d’alphabétisation s’élevait à 85,5 % en 2016. La progressive transformation de la religiosité est l’une des manifestations les plus emblématiques de cette évolution sociétale. Certes, 40 % des Iraniens estimaient en 2012 que les personnalités religieuses devaient exercer une « large influence » sur les questions politiques (26 % préférant une « certaine influence »), et 83 % se déclaraient favorables à l’application de la charia[29]. Toutefois, la rigidité des normes imposées par le régime semble avoir paradoxalement contribué à une amorce de sécularisation dans une partie de la société iranienne. Une dynamique constatée par Laleh : « Avec les règles religieuses, le gouvernement a imposé beaucoup de choses qui n’étaient pas agréables pour les gens. […] Ils voulaient, en surface, réaliser une société très musulmane, mais le résultat a été exactement l’inverse. […] Avant, quand j’étais petite, il y avait beaucoup de gens qui faisaient le ramadan. Mais maintenant, c’est vraiment une minorité qui suit les pratiques comme celles-là. ». Il n’est d’ailleurs pas exclu que ce début de sécularisation aille de pair avec une certaine résurgence du nationalisme iranien, historiquement construit par plusieurs de ses idéologues autour de la critique d’une islamisation perçue comme ayant conduit à une arabisation de la culture persane[30]. Un slogan particulièrement présent durant le mouvement vert (« Ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l’Iran ») illustre cette rupture d’une fraction de la population avec le discours panislamiste, ainsi qu’avec la diplomatie pro-arabe portée par le régime[31].
L’origine de la rupture entre la République islamique et la société peut être rattachée au conflit qui voyait, dès le XXème siècle, s’affronter deux traditions : l’iranisme (« modernisateur », « occidentalisant », voire « libéralisant ») et l’islamisme (« intraverti », « obsidional », « orientalisant »)[32]. Si la révolution de 1979 a indéniablement signifié la victoire politique de l’islamisme, elle n’a pourtant pas signé la mort de l’iranisme, qui perdure et résiste comme en témoigne l’apparition des multiples mouvements contestataires qui secouent l’Iran depuis 2009. Une ligne de continuité peut ainsi être tracée entre ces récents mouvements de protestation et « l’instabilité chronique » qui caractérise la vie politique iranienne depuis longtemps tiraillée entre ces deux forces antagonistes[33]. Cependant, une partie de la jeunesse iranienne contemporaine qui conteste et défie le pouvoir n’est pas simplement « libéralisante », elle est aussi « libertaire et passablement libertine »[34]; elle exprime dans le même temps une volonté d’ouverture du régime et ne s’enferme ainsi pas systématiquement dans les « errements nationalistes et xénophobes » caractéristiques de l’iranisme[35].
Cette génération contestataire est d’abord caractérisée par son rejet de deux idéologies holistes, qui mettent l’accent sur la totalité plutôt que sur l’individu, et ayant formé le cœur de la révolution de 1979 : l’islamisme et le marxisme[36]. La révolution ayant conduit au renversement de la dynastie Pahlavi a été menée par une alliance de différents groupes politiques hétérogènes – forces nationalistes laïques, marxistes, islamo-marxistes, partisans de l’ayatollah Khomeini – réunis autour de leur antioccidentalisme, de leur anti-impérialisme et de leur antisionisme. Nombre de marxistes iraniens voyaient dans l’islam une « avant-garde idéologique » et une « théorie révolutionnaire accomplie »; c’est ainsi que l’on comprend pourquoi au lendemain de la révolution de 1979 la plupart de ces « OGM islamo-marxistes » formeront « les cadres du nouveau régime »[37] . Mais c’est avant tout un rejet du chiisme politique, cœur du régime islamique, et idéologie du « renoncement de soi » au profit d’une « théocratie juste et intouchable »[38], que l’on perçoit au sein de cette génération contestataire. Au cours de la révolution de 1979, l’individu est relégué au second plan, et n’a de légitimité qu’en tant que martyr. L’idéologie du sacrifice – présenté comme « l’amour du groupe et des autres »[39] – est au centre du discours de l’ayatollah Khomeini, père de la révolution de 1979. Le sacrifice pour la communauté doit non seulement être « admiré » mais le martyre doit aussi être compris comme un « don de Dieu » car « être martyr, c’est la meilleure façon de passer vers l’éternité » [40] selon Hasan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah. Nasrallah raconte ainsi, lors d’un discours tenu en 2010, et mentionnant sa propre expérience : « En tant que père, j’ai perdu mon enfant, mais je ne suis pas triste, car mon fils est au paradis avec Dieu. Avant, la photo de Hadi était seulement dans ma maison ; maintenant, elle est partout et dans toutes les maisons »[41]. De son côté, l’ayatollah Khamenei, lorsqu’il commente le rôle des femmes dans la révolution de 1979, loue avant tout leurs qualités en tant que « mères » et « épouses » des martyrs et rappelle que leur tâche première, au cours de la révolution, fut d’« éduque[r] les martyrs »[42].
Prenant le contrepied de cette idéologie totalisante qui satanise la « passion de soi »[43], la génération contestataire met avant tout l’accent sur l’individu par la défense de l’accomplissement de soi, des libertés personnelles, et de la dignité des citoyens. Le slogan du mouvement vert – « où est passé mon vote ? » – illustre bien cette demande croissante de liberté et le refus de l’individu « de se laisser dissoudre dans la communauté religieuse […] sur laquelle se fonde la [République] islamique »[44]. Cette génération « sans mage, ni chah »[45] place ainsi l’individu au centre de ses revendications. Une étude réalisée à partir d’enquêtes effectuées en 2005 et en 2008 a ainsi montré que la religion se présente comme l’un des principaux clivages au sein de la société iranienne. Sans surprise, les enquêtes confirment que les individus les plus religieux (également les plus âgés et les moins éduqués) sont les plus satisfaits par le régime en place, alors que les moins religieux (ainsi que les plus jeunes et les plus éduqués) demandent davantage de démocratie ; une aspiration à la démocratie corrélée avec l’insatisfaction vis-à-vis du régime[46]. On peut également souligner qu’au sein de la jeune génération de « nouvelles formes de “religiosité” »[47]apparaissent, qui s’appuient sur une réinterprétation de l’islam et s’opposent aux dogmes imposés par le régime, notamment en repensant les relations entre religion et politique et en contestant les velléités étatiques de « justification religieuse » d’une législation temporelle[48].
En dépit des transformations sociétales profondes que connaît l’Iran, il serait pour le moins hâtif et imprudent d’enterrer la potentielle résilience de la République islamique. Analysant les différents facteurs ayant assuré la pérennité de ce régime, Farhad Khosrokhavar explique que « l’État théocratique a gardé les rênes du pouvoir, autant en apprivoisant l’opposition interne, en marginalisant l’opposition externe qu’en distribuant la rente pétrolière à sa clientèle afin de préserver ses prérogatives au besoin par l’intimidation et la répression, en dépit d’une nouvelle génération qui ne partage en rien ses credo politiques[49] ». En plus de cet alliage de clientélisme et de domestication des forces contestataires, le régime peut également s’appuyer – similairement à d’autres États de la région – sur un appareil sécuritaire relativement puissant (au point que l’on pourrait envisager de définir le régime iranien comme une forme particulière de « sécuritocratie »), incarné par les pasdaran et les bassidji, principaux groupes paramilitaires du pays. L’autre facteur de consolidation sur lequel peut compter le régime est son insertion dans le « club » des puissances émergentes autoritaires : « l’Iran gravite de plus en plus dans l’orbite des pays de cette fameuse « périphérie réaliste » et, en particulier, dans celles de la Chine et de la Russie avec lesquelles il partage des intérêts convergents (la promotion d’un monde multipolaire), des défis communs (émanant principalement des pressions économiques et idéologiques des pays occidentaux), ainsi qu’une tendance à les appréhender à travers une conception asymétrique et hybride de la politique internationale.[50] » Les modalités par lesquelles s’articule le soutien mutuel entre régimes autoritaires sont d’ailleurs l’objet de réflexions particulièrement stimulantes[51].
La République islamique présente toutes les ambiguïtés d’un régime autoritaire oscillant entre un raidissement répressif et la nécessaire prise en compte d’une société en changement. L’actuelle configuration politico-institutionnelle laisse envisager une timide préférence des dirigeants iraniens pour le passage progressif à une forme (restreinte) d’« hégémonie inclusive ». Le politiste Robert Dahl soulignait trois formes d’« assouplissement » possibles pour un État autoritaire : l’évolution vers une oligarchie compétitive (à travers l’acceptation de la contestation publique), une hégémonie inclusive (via un élargissement de la participation politique) ou une polyarchie (du fait d’une conjonction de ces deux processus). En institutionnalisant des procédures électorales (marquées certes par un pluralisme limité et contrôlé) tout en optant pour la répression de toute velléité contestataire, le régime semblerait donc s’orienter vers le deuxième type de scénario[52].
Toutefois, certains éléments laissent penser que l’hégémonie de la théocratie iranienne touche à sa fin. D’une part, si en 2009 le mouvement vert était d’abord porté par les couches moyennes supérieures, les derniers événements protestataires (2017-2018, 2019), rassemblant les classes populaires iraniennes touchées par les sanctions américaines et les mesures d’austérité mises en place par le gouvernement, démontrent que le mouvement contestataire gagne en transversalité, et donc en puissance. D’autre part, si l’on suit Antonio Gramsci, les systèmes hégémoniques les plus puissants sont caractérisés par la faiblesse de leurs moyens coercitifs, devenus accessoires devant la force du consentement, devant la puissance de la « collaboration pure [du] consentement actif et volontaire (libre) »[53] des citoyens. La répression de plus en plus violente exercée par le pouvoir iranien témoignerait donc de la faiblesse de son hégémonie. Ces deux évolutions valident ainsi l’idée selon laquelle la « perspective d’une chute […] du régime islamique » pourrait devenir une « hypothèse crédible »[54].
[1] « Reduction in Iran’s gasoline subsidy sparks anti-government protests », Al Monitor, 17 novembre 2019. Disponible sur : https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/11/iran-demonstrations-oil-prices-economy-rouhani.html
[2]PERRIN Jean-Pierre, « En proie aux émeutes, Téhéran ne répond plus », Mediapart, 19 novembre 2019. Disponible sur : https://www.mediapart.fr/journal/international/191119/en-proie-aux-emeutes-teheran-ne-repond-plus
[3] « Six charts that show how hard US sanctions have hit Iran », BBC, 2 mai 2019. Disponible sur : https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109
[4] Cité dans MARDAM BEY Soulayma, « Les enjeux de la contestation en Iran », L’Orient Le Jour, 18 novembre 2019. Disponible sur : https://www.lorientlejour.com/article/1195390/les-enjeux-de-la-contestation-en-iran.html
[5]PERRIN Jean-Pierre, « En proie aux émeutes, Téhéran ne répond plus », art. cit.
[6]Cité dans DE SAINT SAUVEUR Charles, « Iran : l’inquiétant durcissement du régime », Le Parisien, 10 décembre 2019. Disponible sur : http://www.leparisien.fr/international/iran-l-inquietant-durcissement-du-regime-10-12-2019-8213919.php
[7]Cité dans « Iran : “au moins 208 morts”, selon un nouveau bilan d’Amnesty International », L’Express, 2 décembre 2019. Disponible sur : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/iran-au-moins-208-morts-selon-un-nouveau-bilan-d-amnesty-international_2109688.html
[8]FASSIHI Farnaz, GLADSTONE Rick, « With Brutal Crackdown, Iran Is Convulsed by Worst Unrest in 40 Years », New York Times, 1er décembre 2019. Disponible sur :https://www.nytimes.com/2019/12/01/world/middleeast/iran-protests-deaths.html
[9]Cité dans « At least 7,000 people reportedly arrested in Iran protests, says UN », The Guardian, 6 décembre 2019. Disponible sur : https://www.theguardian.com/world/2019/dec/06/at-least-7000-people-reportedly-arrested-in-iran-protests-says-un
[10] Cité dans KHATCHADOURIAN Anaïs-Trissa, « Etude du discours des dirigeants de la République islamique. L’Iran entre ‘’lutte contre les complots impérialistes’’ et ‘’défense des droits des peuples opprimés’’ », Les Cahiers de l’Orient, Vol. 102, N°2, 2011, pp. 113-114.
[11] Cité dans DAYAN-HERZBRUN Sonia, « Utopies anti-autoritaires et projet démocratique en contexte musulman », Tumultes, Vol. 49, N°2, 2017, p. 111.
[12] LAZAR Marc, Le communisme, une passion française, Paris, Perrin (coll. « Tempus »), 2005 (1ère éd. : 2002), 272 p.
[13] KHOSROKHAVAR Farhad, « Le mouvement vert. Fin et suite », Vacarme, Vol. 68, N°3, 2014, pp. 199-209.
[14] COVILLE Thierry, « Le mouvement vert en Iran : de ‘’Where is my vote ?’’ à la demande de démocratie », Revue internationale et stratégique, Vol. 83, N°3, 2011, pp. 18-28.
[15]KHOSROKHAVAR Farhad, « La Révolution islamique de 1979 : mutation de l’opposition politique », Confluences Méditerranée, Vol. 88, N°1, 2014, p. 36.
[16]PAHLAVI Pierre, « Comprendre la résilience de la République islamique d’Iran », Politique étrangère, 2018/3 (Automne), pp. 63-74 ; KHOSROKHAVAR Farhad, « La Révolution islamique de 1979 », art. cit.
[17] PARHAM Ramin, « Révolution dans la révolution. De 1979 à 2009, de l’islamité à l’iranité », Outre-Terre, Vol. 28, N°2, 2011, p. 225.
[18]COVILLE Thierry, « Le mouvement vert en Iran », art. cit., p. 25.
[19]KHOSROKHAVAR Farhad, « Le mouvement vert », art. cit., p. 209.
[20] GOLSHIRI Ghazal, « Iran : Le président Rohani sur la corde raide face aux manifestations », Le Monde, 1er janvier 2018. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/01/01/iran-le-president-rohani-sur-la-corde-raide-face-aux-manifestations_5236395_3218.html
[21] GIBLIN Béatrice, « Éditorial. L’Iran : un acteur majeur au Moyen-Orient », Hérodote, Vol. 169, N°2, 2018, p. 10.
[22]PAHLAVI Pierre, « Comprendre la résilience de la République islamique d’Iran », art. cit., p.64.
[23] GIBLIN Béatrice, « Éditorial. L’Iran : un acteur majeur au Moyen-Orient », art. cit., p. 10.
[24]KHOSROKHAVAR Farhad, « La Révolution islamique de 1979 », art. cit., p. 44.
[25]COURBAGE Youssef, TODD Emmanuel, Le rendez-vous des civilisations, Paris, Seuil (coll. « La République des Idées »), 2007, pp. 93-103.
[26] MINOUI Delphine, « Iran : les femmes en mouvement », Les Cahiers de l’Orient, Vol. 99, N°3, 2010, p. 87.
[27] Par souci d’anonymat, le prénom et le lieu d’habitation de notre interviewéea été modifié.
[28] GIORDANO Alfonso, « Téhéran : démographie et géopolitique. Le rôle des jeunes générations », Outre-Terre, Vol. 28, N°2, 2011, p. 235.
[29] « Iranians’ Views Mixed on Political Role for Religious Figures », Pew Research Center, 11 juin 2013. Disponible sur : https://www.pewforum.org/2013/06/11/iranians-views-mixed-on-political-role-for-religious-figures/Bas du formulaire
[30]DIRENBERGER Lucia, « Faire naître une nation moderne. Genre, orientalisme et hétéronationalisme en Iran au 19e siècle », Raisons politiques, Vol. 69, N°1, 2018, pp. 101-127.
[31]Un nationalisme isolationniste d’autant plus fort que l’Iran fait face à des phénomènes régionalistes relativement vivaces : BROMBERGER Christian, « L’Effervescence ethnique et régionale en Iran. L’exemple du Gilân », pp. 45-66, in DORRONSORO Gilles, GROJEAN Olivier (dir.), Identités et politique. De la différenciation culturelle au conflit, Paris, Presses de Sciences Po (coll. « Académique »), 2014, 304 p. En témoignent les manifestations d’octobre dernier dans plusieurs villes kurdes du pays, en protestation contre l’opération militaire turqueen Syrie du Nord : DASTBAZ Jabar, « From Rojhalat to Rojava: Kurds in Iran protest Turkish operation in north Syria », Rudaw, 12 octobre 2019. Disponible sur : https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/12102019
[32] PARHAM Ramin, « Révolution dans la révolution. De 1979 à 2009, de l’islamité à l’iranité », Outre-Terre, Vol.28, N°2, p. 217.
[33]Ibid, p. 217.
[34]Ibid, p. 225.
[35]Ibid, p. 217.
[36] KHOSROKHAVAR Farhad, « Le mouvement vert », art. cit., p. 207.
[37] PARHAM Ramin, « Révolution dans la révolution », art. cit., p. 220.
[38] KHOSROKHAVAR Farhad, « La Révolution islamique de 1979 », art. cit., p. 37.
[39] CALABRESE Erminia Chiara, Militer au Hezbollah. Ethnographie d’un engagement dans la banlieue sud de Beyrouth, Paris/Beyrouth, Karthala/IFPO, 2016, p. 160.
[40]Cité dans Ibid, p. 161.
[41]Cité dans Ibid, p. 161.
[42]KHAMENEI Ali, La femme: instruction, travail et lutte (jihad), Paris, Albouraq (coll. « L’Islam autrement »), 2014,p. 49.
[43]PARHAM Ramin, « Révolution dans la révolution », art. cit., p. 223.
[44] KHOSROKHAVAR Farhad, « Le mouvement vert », art. cit., p. 206.
[45]PARHAM Ramin, « Révolution dans la révolution », art. cit., p. 225.
[46]TEZCÜR Güneş Murat, AZADARMAKI Taghi, BAHAR Mehri, NAYEBI Hooshang, « Support for Democracy in Iran », Political Research Quarterly , Vol. 65, N°2, 2012, pp. 235-247.
[47]KHOSROKHAVAR Farhad, « The New Religiosity in Iran », Social Compass, Vol. 54, N°3, 2007, p. 454.
[48]Ibid, p.455.
[49] KHOSROKHAVAR Farhad, « La Révolution islamique de 1979 », art. cit., p. 45.
[50] PAHLAVI Pierre, « Comprendre la résilience de la République islamique d’Iran », art. cit., p. 73.
[51] VON SOEST Christian, « Democracy prevention: The international collaboration of authoritarian regimes », European Journal of Political Research, Vol. 54, N°4, novembre 2015, pp. 623-638 ; TOLSTRUP Jakob, « Black knights and elections in authoritarian regimes: Why and how Russia supports authoritarian incumbents in post‐Soviet states », European Journal of Political Research, Vol. 54, N°4, novembre 2015, pp.673-690.
[52]DAHL Robert A., Polyarchie : participation et opposition, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles (coll. « UB Lire/Fondamentaux »), 2016 (1èreéd. : 1973), pp. 19-22 et 45-46.
[53]GRAMSCI Antonio, Cahiers de prison, Tome 1 : Cahiers 1, 2, 3, 4 et 5, Paris, Gallimard (coll. « Bibliothèque de philosophie »), 1996, p. 328.
[54]HOURCADE Bernard, « La République islamique entre protestation populaire et ouverture américaine », Les Cahiers de l’Orient, Vol.99, N°3, 2010, p. 18.