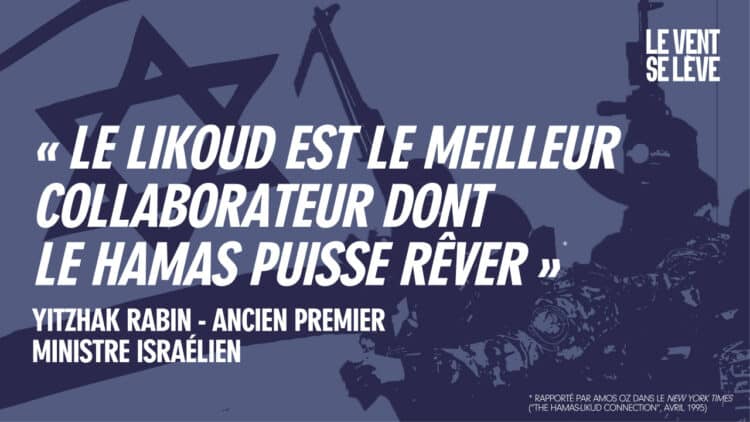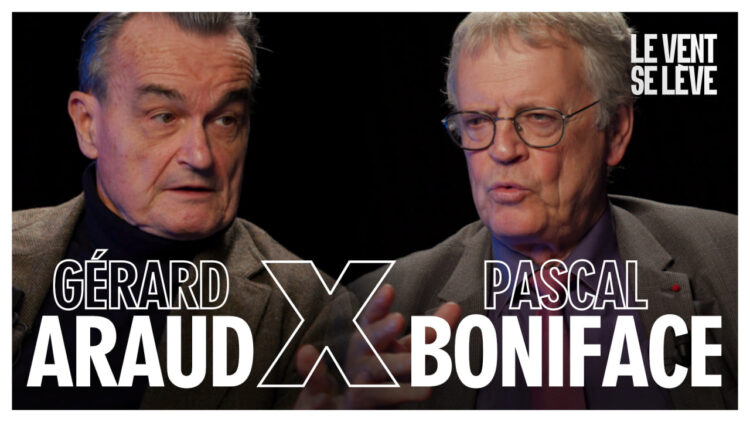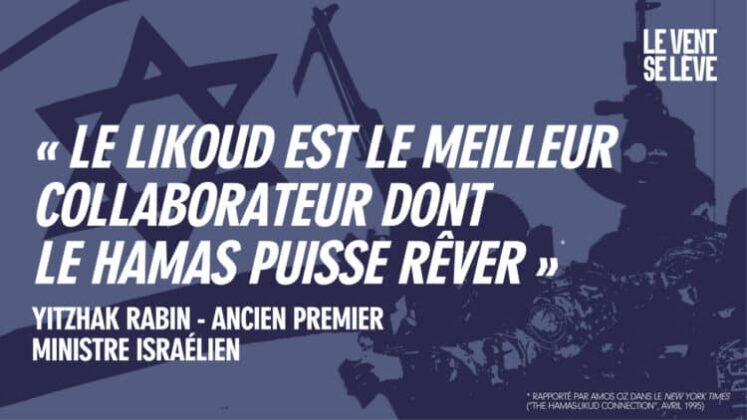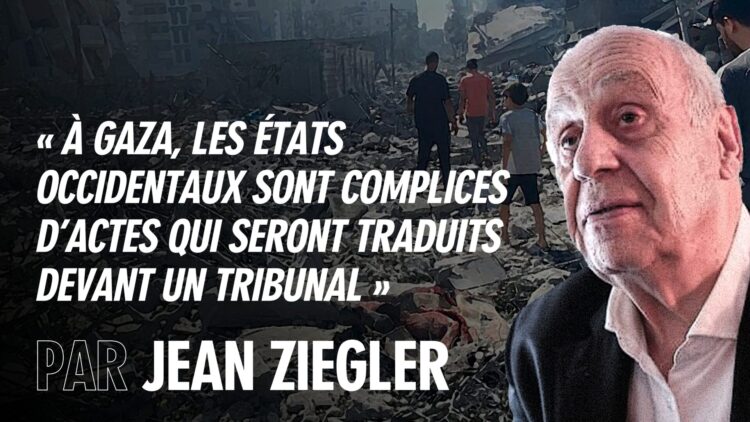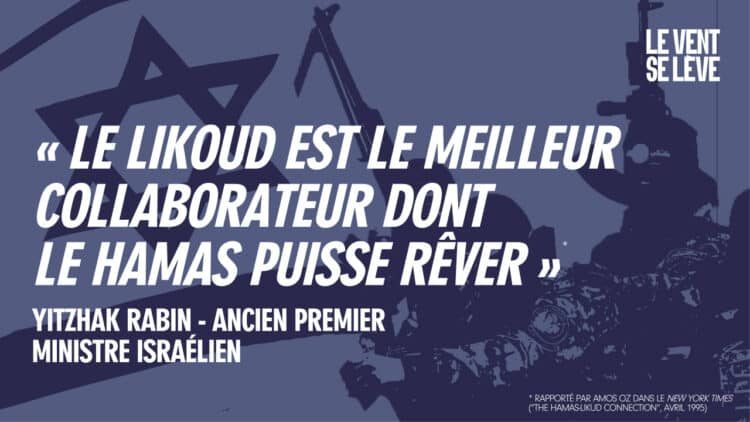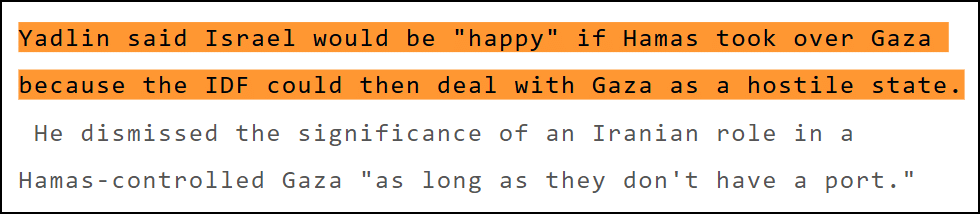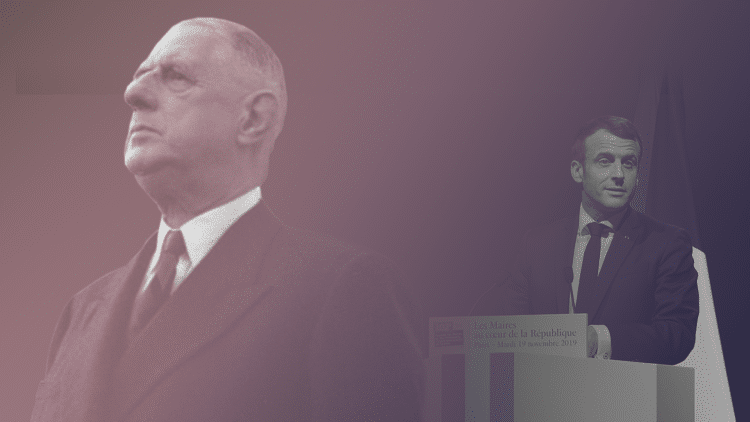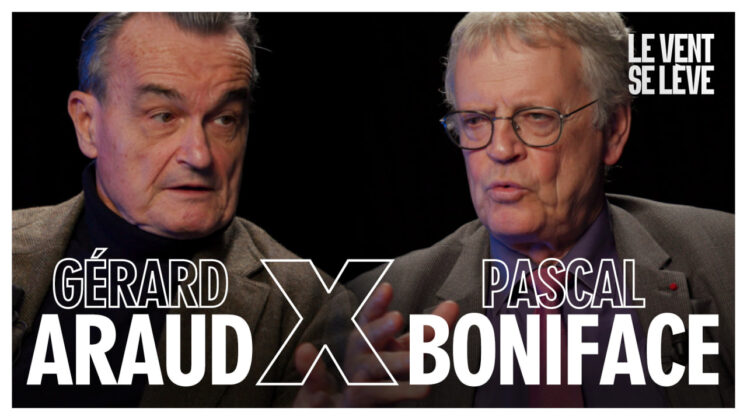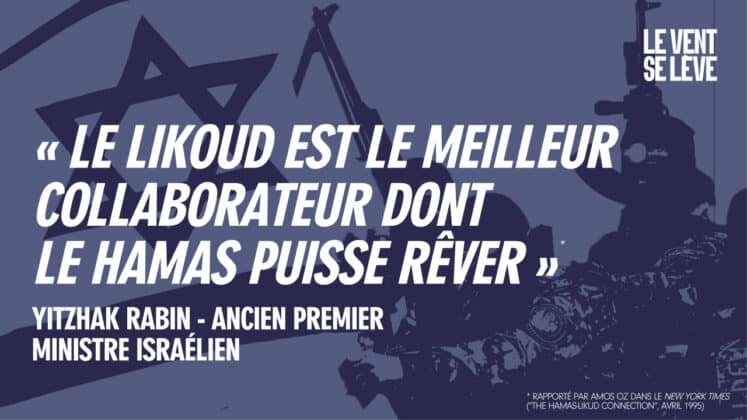Le Vent Se Lève publie une traduction partielle et commentée de l’analyse juridique de l’Euro-Med Human Rights Monitor relative au « plan de relocalisation » des Gazaouis promu par les responsables israéliens. Il inclut la mise en place de supposées « zones humanitaires » par la partie israélienne, qui sont au coeur des « négociations » avec la partie palestinienne sous médiation internationale. L’avis de cet organisme juridique indépendant a été émis le 9 juillet 2025. Le lendemain, Kaja Kallas, Haute Représentante des Affaires Étrangères de l’Union européenne (UE), déclarait que l’Union aiderait Israël dans la mise en place de ces « zones humanitaires » ; plus tard, elle réitérait son refus de placer Israël sous sanctions ou de rompre l’accord préférentiel qui lie ce pays à l’UE. Pour l’Euro-Med Human Rights Monitor, le confinement des Palestiniens dans ces « zones humanitaires » équivaudrait à des pratiques de déplacement forcé et de détention indiscriminée. L’organisation estime que par son inaction continue, mais aussi par les déclarations de ses responsables, l’Union européenne est passible de complicité pour crime de génocide1. Traduction et commentaire par Nicolas Destrée.
Le plan israélien, annoncé par le Ministre de la Défense Israël Katz, visant à déplacer la totalité de la population de la bande de Gaza dans une soi-disant « zone humanitaire » située dans les ruines d’une partie de Rafah, dénote une dangereuse escalade dans le génocide en cours. Ce plan reflète un effort délibéré de dépeuplement de la Bande et d’imposition d’une nouvelle norme démographique ayant pour finalité la mise en place d’un projet colonial d’effacement de toute présence palestinienne.
La coercition s’étend au-delà de l’usage direct de la force militaire pour inclure la création de conditions insupportables qui rendent le maintien sur place pratiquement impossible
Le plan proposé a pour but, dans sa phase initiale, de regrouper des centaines de milliers de civils palestiniens dans la Bande de Gaza comme prélude à leur confinement dans une « zone humanitaire » bâtie sur les ruines d’une ville détruite, à laquelle manque même les moyens de subsistance les plus fondamentaux. La zone sera sera soumise à un strict contrôle sécuritaire, incluant de sévères restrictions relatives à la liberté d’aller et venir, y compris une interdiction de sortie de la zone. Cela revient à l’établissement d’un camp de concentration forclos, dans lequel la population sera détenue de force, en dehors de tout cadre juridique légitime.
NDLR : Le média israélien de gauche Haaretz évoque dans son éditorial du 10 juillet le terme de « camp de concentration » pour décrire lesdites « zones d’aides humanitaires ». Il estime que le strict parallèle entre « politique de concentration » et utilisation de chambres à gaz par le IIIè Reich (qui se trouvaient dans les camps d’extermination nazis et non de concentration) vise à museler les critiques. Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien, utilise la même dénomination2.
Le danger que représente ce plan est aggravé par l’approbation de ce que le Ministre de la Défense Israël Katz nomme une « migration volontaire » des Palestiniens, désignant clairement une politique de déplacement visant la population de Gaza
NDLR : Les déclarations de dirigeants israéliens sur le fait que les Palestiniens devraient « quitter volontairement Gaza » sont innombrables, et ont également été reprises par le Président Trump, et ce depuis plusieurs mois maintenant3.
Ce fait confirme que la concentration des personnes dans le sud n’est pas une mesure humanitaire mais une phase transitoire d’un plan systématique de dépopulation de Gaza. Celui-ci constitue une claire violation du droit international humanitaire, en particulier de l’interdiction absolue du déplacement forcé et de détention indiscriminée de populations protégées par la Quatrième Convention de Genève [article 49 NDLR]. Ces faits tombent sous le coup des chefs de déplacement forcé, de persécution, et d’apartheid, qui sont des schémas de politiques et pratiques qui tombent à elles seules sous le coup de crimes contre l’humanité selon le droit international humanitaire.
Les déclarations du ministre de la Défense Israël Katz concernant l’exploitation du cessez-le-feu temporaire, actuellement en discussion, indiquent clairement qu’il n’aurait pas pour fonction de stopper le génocide mais de donner à l’armée israélienne le temps et les conditions logistiques pour établir des camps ayant pour fonction d’accueillir des centaines de milliers de civils, qui seront plus tard contraints de fuir sous la pression croissante des meurtres, de la famine, et du déplacement forcé. Selon le ministre israélien, le plan prévoit le transfert de 600 000 Palestiniens après les avoir assujettis à de soi-disant « contrôles de sécurité », leur imposant par là de sévères restrictions de mouvement et les empêchant de quitter la zone de sécurité [voir la déclaration initialement rapportée Haaretz NDLR]. Entre autres principes, le plan viole la norme impérative prohibant le génocide, qui ne peut être violée en aucune circonstance et impose des obligations légales immédiates à tous les États de prévention de ce crime, de mettre un terme à sa perpétration, et de tenir pour responsables les perpétrateurs de sa commission.
La contradiction entre l’annonce du Ministre de la Défense Israël Katz d’un plan de transfert forcé et de confinement des résidents de Gaza, avec celle du Chef de l’État Major de l’armée israélienne Eyal Zamir deux jours plus tôt arguant que le transfert de population n’est pas un objectif militaire, révèle une tentative de semer la confusion dans l’opinion publique et au sein de la communauté internationale. Alors que l’armée israélienne cherche à dénier de telles intentions, Israël Katz a révélé un plan détaillé qui concorde pleinement avec les agissements de l’armé israélienne sur le terrain : meurtres de masse, ordres d’évacuation forcées, ciblage délibéré des abris, confinement de centaines de milliers de personnes dans des zones assiégées.
NDLR : On en trouvera un compte-rendu dans le Times of Israel, qui note en introduction : « des universitaires israéliens de premier ordre ont averti que forcer les Palestiniens dans une aire confinée serait légalement injustifiable et constituerait un crime contre l’humanité ». Le plan vise, avec l’aide d’organisations « humanitaires » internationales privées, à l’image de la Gaza Humanitarian Foundation, à rassembler et concentrer la population de Gaza à Rafah, dans une zone dite « tampon », qui devrait s’étendre indéfiniment, avec des contrôles de sécurité biométriques à son entrée et l’interdiction d’en sortir par après, sous peine de déportation. Le ministre Israël Katz a affirmé que si la population palestinienne ne s’exécutait pas, ce serait « la ruine totale ou la destruction ».
Des preuves provenant du terrain démontrent que ces agissements constituent l’exécution d’un plan politique, et non le résultat d’opérations militaires d’urgence. Les déclarations de Katz, plus que le déni de l’armée, reflètent la véritable intention et la politique gouvernementale, ayant valeur de preuve conclusive d’un déplacement forcé mis en place sous couvert de prétexte militaire. L’utilisation de termes facteurs de confusion comme celui de « zone humanitaire » dans le contexte des crimes en cours, revient à tentative flagrante de dissimulation de ces crimes en tant que tel, et l’induction en erreur de la communauté internationale.
Les centres de distribution d’aide mis en place par la « Fondation Humanitaire de Gaza » [« Gaza Humanitarian Foundation »], située dans la soi-disant « zone humanitaire », est en effet devenue un lieu de pièges mortels, avec 758 Palestiniens tués et plus de 5000 blessés depuis l’ouverture du centre fin mai [Ce chiffre a entre-temps grimpé à mille selon l’ONU. La faim menace le personnel médical et les derniers journalistes sur place NDLR]. Ce fait constitue un avertissement de ce qui attend des centaines de milliers de civils si ces derniers étaient transférés de force dans cette zone sous un faux principe humanitaire.
Selon Reuters, le plan propose d’établir des « zones de transit » pour des Gazaouis qui y « résideraient temporairement », ouvrant potentiellement la voie à un transfert en dehors de la Bande. Ce modèle établit le déplacement forcé comme un objectif politique explicite ; des expressions comme « déradicaliser, ré-intégrer et préparer leur relocation s’ils le souhaitent » doivent être comprises comme autant d’outils rhétoriques visant à blanchir un processus pré-annoncé de nettoyage ethnique.
Le déplacement forcé constitue en tant que tel un crime selon le droit international, impliquant l’expulsion de personnes de zones où elles sont légalement présentes au moyen de la force, de la menace, et d’autres moyens coercitifs, et ce sans la moindre justification légale reconnue. La coercition, dans ce contexte, s’étend au-delà de l’usage direct de la force militaire pour inclure la création de conditions insupportables qui rendent le maintien sur place de la population pratiquement impossible et pose un risque grave à la vie, à la dignité, et aux conditions de subsistance. Cet environnement coercitif prend plusieurs formes : la peur de la violence, de la persécution, de la détention, de l’intimidation, de la famine, ou de n’importe quelle autre circonstance qui prive effectivement les individus de leur libre volonté et les oblige à partir.
Tout départ de la Bande de Gaza dans les conditions actuelles ne peut être considéré comme volontaire, du fait que la population est effectivement privée d’un choix libre et informé. Légalement, de tels départs constituent des déplacements forcés, ce qui est prohibé par le droit international.
L’indifférence des États parties et d’organisations des Nations Unies à l’encontre des politiques de déplacement forcé dans la Bande de Gaza ne peut être expliqué par leur inaptitude. Elle reflète le niveau de tolérance, et dans des cas particuliers, la complicité dans la mise en place de plans ayant pour but de dépeupler la Bande. Depuis l’émission du premier ordre d’évacuation massive par l’armée israélienne le 9 octobre 2023, des centaines d’autres ordres d’évacuation ont fait suite de manière continue, et ce sans la moindre pression effective pour stopper ce crime. Avec pour résultat que la majorité de la population de Gaza a été déplacée de force, laissée sans abri ni protection dans ce qui constitue l’un des cas les plus brutaux de déplacement forcé dans l’histoire contemporaine.
Cet article est une traduction partielle et commentée de l’Euro-Med Human Rights Monitor par Nicolas Destrée.
Note :
1 Une précision importante est nécessaire : selon les maigres informations disponibles à ce jour, la nécessité d’agir a fait consensus au sein des chancelleries européennes – ce qui semble confirmé par la déclaration du 21 juillet. Cependant, selon un article de Haaretz, un appel téléphonique entre Kaja Kallas, Haute Représentante des Affaires étrangères de la Commission et Gideon Sa’ar, Ministre des Affaires étrangères israélien, a permis de négocier le « soutien » à l’« aide humanitaire » en question, au mépris des règles démocratiques les plus élémentaires. Si des documents administratifs, comme le relevé d’appels téléphoniques, venaient confirmer ce fait, ce dernier tomberait sous plusieurs chefs d’accusations imprescriptibles : l’entente en vue de commettre le génocide – art. III b – et la complicité dans le génocide, en vertu de l’art. III e de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Organisation des Nations Unies, 9 décembre 1948, AGNU 260 A (III)).
2 Pour un aperçu historique plus général, on renverra à Aidan Forth, Camps, A Global History of Mass Confinment, (University Toronto Press, 2024), ainsi qu’à Julian Go, Policing Empires: Militarization, Race, and the Imperial Boomerang in Britain and the US (Oxford University Press, 2024).
3 Les « nouveaux historiens israéliens » ont montré comment depuis la Nakba, ou « catastrophe » de 1948, le thème de l’« émigration volontaire » est un prétexte servant à couvrir la colonisation. Voir Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, La Fabrique, 2024 [2000].