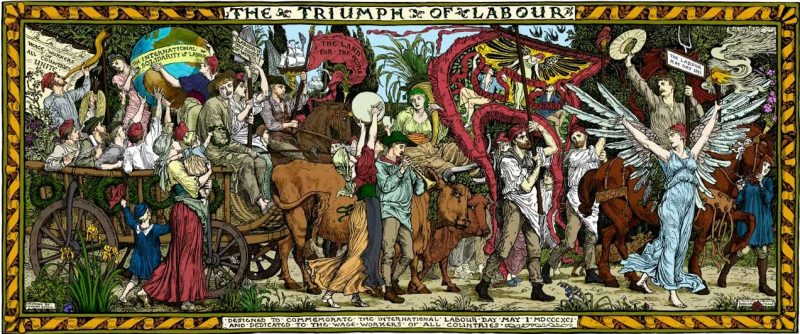Spécialiste de l’impact d’Internet sur la politique et des mouvements d’occupation de places de 2011, Paolo Gerbaudo est sociologue politique au King’s College de Londres. À l’occasion de la sortie de son troisième livre, The Digital Party, nous avons voulu l’interroger sur la démocratie digitale, le rôle du leader en politique, le Mouvement 5 Etoiles ou encore le mouvement des gilets jaunes. Retranscription par Bérenger Massard.
LVSL – Peut-être devrions nous débuter avec la question suivante : comment sont nés ce que vous appelez les partis digitaux ? Et en quoi sont-ils liés, par exemple, à Occupy ou aux indignés en Espagne, c’est-à-dire aux mouvements qui occupent les places ? Existe-t-il un idéal-type de parti numérique ?
Paolo Gerbaudo – C’est une question très intéressante. En effet, cette nouvelle génération de partis est fortement liée à la génération de mouvements sociaux apparus en 2011, notamment Occupy, Los Indignados, Syntagma en Grèce, qui ont porté de nombreux thèmes similaires à ceux de ces partis : le thème de la démocratie, la critique envers les élites, les demandes de participation citoyenne, la critique du capitalisme financier… Malgré leur puissance, ces mouvements ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs finaux, ce qui a donné lieu à beaucoup de discussions sur les places quant aux objectifs et aux moyens à définir. Cela a déclenché une prise de conscience autour de la nécessité de s’organiser pour lutter à plus long terme. Ainsi, je vois la création de ces partis comme une réponse à ces enjeux organisationnels, au fait que vous devez structurer la campagne des mouvements sociaux afin de la rendre plus durable.
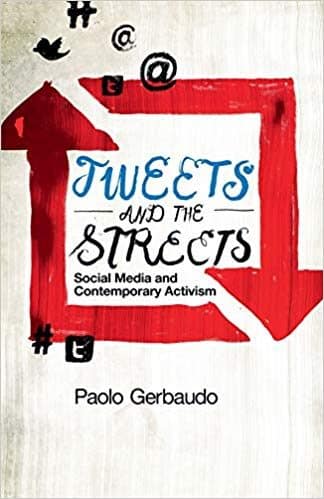
Par exemple en Espagne, il y a eu tout un débat autour du slogan « Non me representam » [« ils ne me représentent pas »]. L’anarchiste l’interprète comme un rejet de la représentation sous toutes ses formes. Mais en réalité, pour beaucoup de gens, c’était quelque chose de plus complexe, qui signifiait : « Nous voulons être représentés, mais les gens qui nous représentent ne sont pas à la hauteur de la tâche. Nous voulons une bonne représentation, nous voulons être représentés par des personnes en qui nous pouvons faire confiance ». Ces nouvelles formations cherchent donc à combler ce vide de la représentation et à en renouveler les formes.
En termes de parti digital idéal, je pense que le modèle le plus pur est celui du mouvement Cinq étoiles, même s’il est en retard sur le numérique. Ils sont convaincus d’utiliser des technologies de pointe, mais ce qu’ils utilisent est assez moyen. Le nombre d’inscrits sur la plateforme est plutôt limité, mais l’idéologie du parti est très fortement imprégnée d’une utopie techniciste, qui repose sur le pouvoir participatif qu’offre la technologie. Il s’agit selon moi de l’idéal-type du parti numérique. C’est celui qui incarne le plus l’esprit populiste et la nouvelle croyance dans le pouvoir de la technologie, qui est au centre de cette génération de partis politiques.
LVSL – Ces partis digitaux semblent difficiles à définir selon les lignes idéologiques classiques, ou même selon des lignes socio-économiques comme la classe sociale, comme c’était le cas pour les partis au XXe siècle. Ils regroupent ce que vous appelez des people of the web qui appartiennent à différents groupes sociaux. Est-ce qu’il s’agit seulement de nouveaux partis attrape-tout, au détriment de la clarté idéologique ?
PG – C’est une question intéressante car pour beaucoup de gens, il y a une différence entre les partis traditionnels de gauche, qui auraient un électorat clair, à savoir la classe ouvrière, et ces nouveaux partis attrape-tout. En réalité, quand vous regardez l’histoire, le PCF en France ou le PCI en Italie ne se sont pas limités à être des partis de la classe ouvrière : environ 50% de leur électorat venait de la classe ouvrière industrielle, le reste provenait d’un mélange de petite bourgeoisie, d’intellectuels, de professions intermédiaires, etc. Il faut garder cela à l’esprit, car existe le mythe selon lequel l’ère industrielle était complètement cohérente, alors que ce n’était pas le cas.
« Ce qui caractérise les électeurs du mouvement 5 Étoiles est la précarité, notamment dans l’emploi, qu’ils travaillent dans des usines, dans les services ou dans des bureaux. »
Pour parler comme Nikos Poulantzas, ce qui est vrai est qu’il existe un nombre diversifié de segments de classe qui composent la base électorale des partis digitaux. Ils sont principalement orientés vers les jeunes qui ont un niveau d’éducation élevé et qui se servent beaucoup d’internet, ainsi que vers la classe moyenne et la classe moyenne inférieure. Bien qu’ils soient nominalement de la classe moyenne, étant donné que leurs parents en faisaient partie, ils se retrouvent souvent dans une situation de déclassement. La classe moyenne se caractérise par son patrimoine, notamment sous forme immobilière. Mais pour de nombreux enfants de la classe moyenne, l’achat d’une maison n’est plus possible, car ils souffrent de bas salaires et d’emploi précarisé. Ils paient des loyers élevés, ce qui signifie qu’ils ne peuvent épargner suffisamment pour obtenir un crédit. Ils se résignent à louer à long terme et à subir un déclassement progressif.
À côté de cela, vous avez d’autres segments de l’électorat qui sont représentés par ces partis : des pauvres, des chômeurs, des gens de la classe ouvrière. C’est donc un ensemble assez disparate, mais qui malgré sa diversité partage un mécontentement à l’égard de la situation actuelle. Par exemple, dans le cas du mouvement Cinq étoiles, certaines recherches socio-démographiques indiquent que ce qui caractérise ses électeurs est la précarité, notamment dans l’emploi, qu’ils travaillent dans des usines, dans les services ou dans des bureaux. En revanche, les électeurs du Partito democratico [parti centriste italien, au pouvoir de 2013 à 2018 avec notamment le passage Matteo Renzi, issu de la fusion des deux anciens partis d’après-guerre, la démocratie chrétienne et le parti communiste] dans les mêmes secteurs de l’économie que ceux du M5S, ont tendance à occuper des postes plus stables et plus sûrs. Cette opposition n’a pas grand chose à voir avec l’occupation d’un emploi dans tel ou tel secteur de l’économie, ou que vous soyez travailleur manuel ou intellectuel, mais plutôt avec le degré de sécurité et de stabilité de votre emploi. Ainsi, les personnes qui se sentent précarisées sont plus susceptibles de voter pour ces partis. Ce sont aussi des gens qui ont tendance à être plus jeunes, car il y a un clivage générationnel.
LVSL – Pensez-vous que les coalitions de ces partis, fondées sur les jeunes et les précaires, reposent sur un contenu idéologique commun ? En réalité, ces partis ne sont-il pas seulement des machines de guerre électorale destinées à mettre dehors le personnel politique actuel et à le remplacer, mais sans véritable programme ?
PG – C’est un autre point intéressant, dans la mesure où ces partis risquent en effet d’être incohérents sur le plan idéologique. Je dirais qu’ils ont une idéologie : elle est fondée sur la récupération de la souveraineté, la coopération, la restauration de la démocratie, la participation citoyenne, la réforme du capitalisme financier… Mais lorsqu’il s’agit d’exigences plus spécifiques, puisqu’ils sont plutôt divers du point de vue de l’appartenance de classe de leurs électeurs, les contradictions apparaissent rapidement.
Le cas de Syriza en Grèce est particulièrement éloquent. Ce n’est certes pas un parti digital à proprement parler, mais plutôt un parti populiste de gauche. Syriza a néanmoins réuni des ouvriers pauvres, des chômeurs qui n’avaient fondamentalement rien à perdre, et des secteurs de la classe moyenne qui avaient beaucoup à perdre, des comptes à vue, des propriétés immobilières libellées en euros… Donc, quand il a été question de quitter l’euro, et sans doute également l’Union européenne, bien que cette sortie ait obtenu un soutien considérable de la part des classes populaires, les classes moyennes ont vraiment eu très peur. Au final, ce sont ces derniers qui l’ont emporté en juillet 2015. C’est pourquoi il a été décidé de rester dans l’euro, en dépit de leurs difficultés et des problèmes que cela représentait pour leur pays.
Nous pouvons aussi voir cela chez Podemos, où il y a deux options idéologiques : une plus populiste et attrape-tout avec Íñigo Errejón, et une seconde plus traditionnellement de gauche radicale, poussée par Pablo Iglesias et Irene Montero. Cette dernière est fondamentalement un mélange d’extrême gauche, de radicalisme et de politique identitaire qui rebute les personnes moins politisées.
LVSL – Comment percevez-vous le Mouvement 5 étoiles qui gouverne avec la Lega depuis environ un an ? Les sondages actuels montrent que la Lega est plus populaire que son partenaire de coalition, en partie grâce de la figure de Salvini et de l’agenda anti-migrants qu’il met constamment en avant. Le M5S peut-il inverser cette tendance, c’est-à-dire mettre en place des mesures qu’il pourra vendre à son électorat ? Ou restera-t-il simplement au gouvernement pour éviter de nouvelles élections, mais sans savoir exactement où aller ?
PG – Ils ont beaucoup souffert de leur alliance avec la Lega. D’une certaine manière, la première option consistait à s’allier au Partito Democratico car ils venaient à l’origine du même espace politique. Leur base initiale était globalement celle des électeurs de centre-gauche déçus par la politique du PD. Maintenant, cette alliance oppose d’un côté un parti populiste à la structure très légère, le Mouvement cinq étoiles, et de l’autre un parti fondamentalement léniniste, à la structure très puissante et à la direction très centralisée et personnalisée, la Lega. Cette dernière a été aux affaires depuis très longtemps. Ses cadres connaissent toutes les combines et toutes les magouilles et ils les utilisent sans retenue. On pouvait donc s’attendre à ce que cela arrive. Le Mouvement cinq étoiles a poussé certaines revendications économiques, en particulier le reddito di cittadinanza [revenu de citoyenneté], de façon à avoir quelques victoires à montrer à ses électeurs. Mais cela ne suffit pas, évidemment, car cela ne résout que certains des problèmes de pauvreté et ne résout pas celui du chômage. Cela ne résout pas les problèmes de beaucoup d’autres personnes, qui ne sont peut-être pas au chômage, mais qui sont confrontées, entre autres, à de bas salaires.
« Cette alliance oppose d’une côté un parti populiste à la structure très légère, le Mouvement Cinq Etoiles, et de l’autre ce qui est fondamentalement un parti léniniste, à la structure très puissante et à la direction très centralisée et personnalisée, la Lega. »
Cela tient aussi au caractère très fluide du parti. La Lega a un récit très clair à présenter à l’électorat. Celui du M5S, globalement, est que ce sont les inscrits du mouvement qui décident. Comme si le parti n’avait aucune valeur, même substantiellement. Comme si les inscrits sur la plateforme pouvaient décider que la peine de mort est bonne ou non. On pourrait imaginer que quelqu’un lance une proposition comme « interdisons les syndicats » et que cela puisse passer après un simple vote sur la plateforme… Donc cela les rend très faibles lorsqu’il s’agit de former une alliance avec un parti plus structuré comme la Lega.
Autre fait intéressant : Salvini a néanmoins compris qu’il ne pouvait pas pousser trop loin son conflit avec le M5S. Il a dernièrement essayé de menacer de quitter le gouvernement sur la question du projet de ligne à grande vitesse qu’il soutient, le Lyon-Turin. C’était assez intéressant de voir les réactions sur Facebook. D’habitude la page de Salvini, peut-être la plus grosse page Facebook d’Europe en ce qui concerne les personnalités politiques, est une base de fans inconditionnels qui boivent ses paroles. Cependant, au cours de ce conflit, et à mesure que devenait réelle la possibilité d’une rupture au sein du gouvernement, il a reçu de nombreuses critiques de la part de ses partisans : « si vous faites ça, vous êtes un traître, si vous faites ça, nous ne vous suivrons plus ». Ces critiques ne se cantonnaient pas à cette question du Lyon-Turin. Elles s’expliquent plutôt par la popularité globale du gouvernement, qui se présente comme un gouvernement de changement. D’une certaine manière, Salvini est enfermé dans son alliance avec le M5S. Son électorat ne veut pas qu’il revienne vers Berlusconi.
LVSL – En France, il y avait en 2017 deux mouvements ou partis qui reprenaient certains aspects des partis digitaux : la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et En Marche ! d’Emmanuel Macron. Tous deux avaient, du moins au début, des structures très faibles et des dirigeants très puissants au sommet. Comment analysez-vous ces deux partis, après deux ans d’existence ?
PG – À l’origine, la France Insoumise est un exemple très réussi de parti numérique, qui a été capable de recruter rapidement un demi-million de personnes. Par rapport au Mouvement cinq étoiles, où les membres sont supposés pouvoir décider de n’importe quoi et même de présenter des propositions de loi, la démocratie numérique de la France Insoumise est plus limitée. Mais quelque part, le système décisionnel de la France Insoumise est plus honnête : il est plus sincère de dire que les membres peuvent avoir leur mot à dire, mais pas sur absolument tout. Par exemple, lors de la préparation de l’élection de 2017, il y a eu deux phases. D’abord, la contribution sous forme de texte ouvert : tout partisan de la France insoumise pouvait envoyer un texte avec ses propositions, après quoi une équipe technique, celle qui a produit les livrets thématiques, analysait la récurrence de certains termes ou propositions dans ces textes. Puis, la base intervenait de nouveau pour donner la priorité à une mesure parmi une dizaine. C’est une intervention limitée, mais c’est peut-être mieux ainsi, car le leadership est une réalité et le restera.
En fait, c’est un mensonge envers les électeurs que de dire qu’il n’y a pas de chef et qu’ils ont un contrôle total. C’est ce que le Mouvement cinq étoiles tente de faire. Ils disent qu’il n’y a pas de chef, seulement des porte-paroles du mouvement, qu’il n’y a pas d’intermédiation en tant que telle, que tout vient de ce que les gens proposent… Pour moi, ce récit ne correspond pas à la réalité. Il vaut mieux avoir un processus de prise de décision participatif plus limité, mais plus clair et plus transparent. La France Insoumise s’est un peu éloigné de cela et a évolué vers un parti plus traditionnel depuis, où les grandes décisions sont plutôt prises lors de consultations internes. Par exemple, il n’y a pas eu de primaires en ligne pour les élections européennes, ce qui me semble être un pas en arrière.
Quant au mouvement En Marche !, il n’a aucun élément de démocratie numérique, juste une stratégie adaptée aux réseaux sociaux : leur plate-forme ne sert qu’à créer des groupes locaux, à coordonner leurs actions, envoyer les membres ici ou là pour diverses activités. Il n’y a aucun lieu où les membres disposent réellement d’une voix sur les décisions importantes. Il n’a pas d’élément démocratique, c’est du top-down autoritaire.
LVSL – Dans votre livre, vous dîtes que l’appareil du parti est court-circuité par une relation beaucoup plus désintermédiée entre les militants et un hyper leader. Vous expliquez que, lorsqu’il y a des votes internes dans ces partis du numérique, la plupart des membres adoptent au final la position de leader. Pourquoi ?
PG – Il y a un certain nombre d’exemples de leadership fortement personnalisé au sommet, qui base son pouvoir sur la célébrité sur les médias sociaux. Par exemple, AOC (Alexandria Ocasio Cortez) est une célébrité, elle a une audience sur les réseaux sociaux, avec 3 millions d’abonnés sur Twitter. Même chose pour Salvini. Ces leaders sont avant tout des célébrités sur les médias sociaux. Cette célébrité a un pouvoir énorme, c’est de cela qu’ils tirent leur autorité. Ils agissent comme des influenceurs ou des youtubeurs, un peu comme Kim Kardashian et toutes ces célébrités, nous racontant tout ce qu’ils font, ce qu’ils mangent, ce qu’ils cuisinent, qui ils rencontrent, où ils vont en vacances. Salvini est incroyable : il n’est au Parlement que 2% du temps, il n’est presque jamais au Ministère de l’Intérieur, car il voyage constamment pour des raisons de campagne.
Pourquoi ? Parce qu’il parcourt le pays, se présente à de nombreux meetings, filme des vidéos, des livestreams… C’est une sorte de campagne permanente, qui ne finit jamais. Pourquoi ? Parce que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de méfiance à l’égard des organisations collectives et des bureaucraties… C’est l’idéologie dominante, le néolibéralisme, qui nous a appris à ne pas faire confiance aux bureaucrates, ces figures sombres qui prennent des décisions à huis clos dans des salles pleines de fumée. Donc les gens sont plus enclins à faire confiance aux individus, aux personnalités auxquelles ils s’identifient. Ils pensent pouvoir leur faire confiance, car ils peuvent les voir directement, les suivre jour après jour. D’une certaine façon, il n’y a aucun moyen d’échapper à ce phénomène. Ce fut également la raison du succès de Bernie Sanders, de Jeremy Corbyn, de Mélenchon. Tout cela met avant tout l’accent sur l’individu. Pour la gauche, cela soulève des questions épineuses car le collectif devrait passer avant les individus. Et en même temps, tactiquement, on ne peut rien faire, on ne peut s’affranchir de cette réalité.
The hyperleader at the dentist. @BetoORourke livestreaming his dentist visit is perhaps the most extreme manifestation of the extreme personalisation of contemporary politics. It is bad manners to inspect the horse's mouth. But apparently that does not apply to political leaders. pic.twitter.com/YepGE5Fj32
— Paolo Gerbaudo (@paologerbaudo) March 18, 2019
LVSL – Depuis quelques années, les primaires se sont multipliées en Europe, parfois même des primaires ouvertes où les non-membres du parti peuvent voter pour choisir le leader pour les prochaines élections. Par nature, ces primaires personnalisent la politique et ignorent l’appareil du parti. Est-ce un outil de démocratisation des partis ou un moyen de donner le pouvoir à des célébrités ?
PG – C’est un phénomène qui a une certaine histoire maintenant. Beaucoup de politologues décrivent un tournant plébiscitaire depuis une vingtaine d’années, non seulement dans le fait de recourir à un référendum sur des questions spécifiques comme le Brexit, mais aussi de manière plus générale. Dans le passé, par exemple dans les partis socialistes ou communistes, vous élisiez votre représentant local, puis de ces représentants locaux émergeait un congrès ou une convention nationale. Et cette assemblée était émancipée vis-à-vis du leader, du comité central, du trésor, etc. Aujourd’hui, on considère que toutes ces sphères doivent être élues de manière directe. Donc, est-ce démocratique ou pas ?
Je pense que bon nombre de ces représentants, ces figures intermédiaires, ne se préoccupent plus que d’eux-mêmes, se sont autonomisés, détachés de la circonscription locale qu’ils sont censés représenter. Pourquoi ? Parce que la participation aux réunions locales est très faible et principalement dominée par des activistes zélés qui ne représentent pas vraiment l’électorat. En fait, la base est devenue un peu trop paresseuse pour assister aux réunions. Lui permettre d’élire directement ses dirigeants, plutôt que de passer par des représentants qui ne sont pas représentatifs, garantit une meilleur respect de la volonté des membres.
On l’a vu dans le parti travailliste [du Royaume-Uni, ndlr], c’était assez paradoxal : Ed Miliband [prédecesseur de Jeremy Corbyn, candidat perdant aux élections de 2015] avait décidé de baisser le tarif des cotisations à seulement 3 livres pour vaincre définitivement la gauche, fortement dépendante des syndicats qui ont votes collectifs dans le parti ; ils votent pour tous leurs membres. Donc, en ouvrant le parti, Miliband pensait attirer des individualistes de classe moyenne qui voteraient pour des gens comme lui. En fait, ce fut exactement le contraire : plus de 60%, une majorité écrasante, ont choisi Corbyn. Et désormais, nous assistons à une lutte entre Corbyn et les adhérents contre les couches intermédiaires du parti. La machine du parti ne supporte pas d’être contrôlée par des adhérents dotés de pouvoirs.
Pour moi, ce qui est important, c’est que seuls les membres du parti puissent voter, pas comme avec le Partito Democratico [qui a récemment organisé sa primaire ouverte] où tout le monde peut voter. Là, c’est très dangereux : cela signifie que des personnes extérieures au parti peuvent le manipuler… La primaire du Parti Démocrate a réuni plus de 1,5 million de personnes. Cela ressemble à une grande réussite démocratique, mais cela contribue-t-il à forger une identité cohérente à ce parti ? Au minimum, nous devrions faire comme aux États-Unis, où les gens, même s’ils ne sont pas membres, doivent s’enregistrer en tant que Démocrates ou Républicains. Au moins, vous vous prémunissez des manipulations de personnes extérieures au parti.
LVSL – Que ce soit en Espagne, en France ou en Italie, les partis numériques, même s’ils ont bénéficié de la haine envers les élus sortants, ont plutôt bien réussi aux élections ces dernières année. Cependant, beaucoup de gens qui rejoignent ces partis ne se mobilisent pas vraiment à long terme, tandis que nous assistons à un déclin, du moins dans les sondages, du M5S, de la France Insoumise ou de Podemos. Les partis numériques sont-ils condamnés, comme les partis pirates, à n’être que des bulles temporaires ?
PG – Je pense qu’ils vont continuer à exister pendant un certain temps, tout simplement parce qu’une fois qu’un parti dépasse 20% ou même moins, il y a une inertie. Il est extrêmement difficile de créer et de consolider de nouveaux partis. Les systèmes partisans sont parmi les systèmes les plus immuables de nos sociétés. Dans n’importe quel système politique, d’une manière générale, de nouveaux partis n’émergent que tous les 40 ans. La dernière vague comparable a peut-être été celle de 1968, avec la formation de nouveaux partis de gauche, comme les partis verts, etc. Une fois fondés, il leur faut un élément majeur pour que les partis disparaissent. Et si déclin il y a, il est plutôt lent.
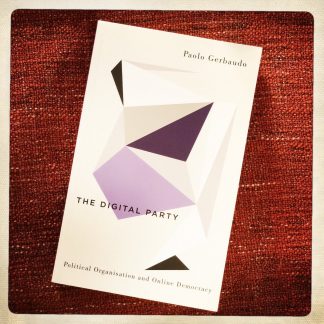
Très honnêtement, j’ignore où va le Mouvement cinq étoiles. La situation est extrêmement fluide dans le monde entier à présent, et donc très imprévisible. En France, nous verrons peut-être quelque chose de similaire au M5S, qui représenterait les revendications du mouvement des gilets jaunes. Dans le fond, il faut tout d’abord un élément de rupture pour qu’arrive une nouvelle génération de partis. Même si, intrinsèquement, cette nouvelle génération de partis est pleine de problèmes et de contradictions internes qui menacent leurs performances à long terme.
LVSL – À propos des gilets jaunes : dans un entretien avec Novara, vous expliquiez qu’à l’inverse du M5S, ils avaient une approche bottom-up plutôt que top-down. Les gilets jaunes sont résolument en faveur de plus de démocratie, ce sur quoi ils sont presque tous d’accord, et ils rejettent également tout type de leadership ou de structure. Comment analysez-vous ce mouvement ?
PG – Pour moi, cela ressemble beaucoup aux mouvements des places et à la vague Occupy de 2011, mais en plus populaire et plus col bleu que ces mouvements. Les mouvements de 2011 étaient en quelque sorte très novateurs car ils adoptaient une identité populiste en cessant de faire appel aux gens avec un langage minoritaire. Ils disaient : « Nous sommes la majorité, nous voulons représenter tout le monde sauf les super riches ». Les gilets jaunes suivent complètement cette vague. En comparaison, Nuit Debout était très bourgeois, très urbain, très parisien, et n’a pas percé en dehors de Paris ou dans les circonscriptions ouvrières. D’une certaine manière, les gilets jaunes sont la version plus populaire de Nuit Debout.
« Les mouvements de 2011 étaient très novateurs car ils adoptaient une identité populiste, ils cessaient de parler aux gens en termes minoritaires et disaient « nous sommes la majorité, nous voulons représenter tout le monde sauf les super-riches. » Les gilets jaunes suivent complètement cette vague. »
Ils contestent très vivement le président et le système de pouvoir, tout en formulant des revendications très concrètes, qui, au fond, concernent des problèmes de fin de mois. Ils ne se préoccupent pas des droits civils, et l’environnement est vu comme une chose abstraite… Leurs revendications concernent le salaire minimum, la limitation des impôts qui punissent les pauvres, les services publics, l’interventionnisme de l’État… Donc c’est principalement un populisme progressiste, qui récupère une part de la social-démocratie des Trente Glorieuses. Ces gens veulent plus de démocratie et veulent avoir leur mot à dire dans les décisions qui les concernent. Toni Negri a beau les percevoir comme une sorte de multitude de gens qui veulent une autonomie par rapport à l’État, c’est exactement le contraire. Ils veulent de l’État, mais pas de celui-ci [rires].
LVSL – Le rejet du leadership et de la structuration fait-il passer le mouvement à côté de tout son potentiel ? Les gilets jaunes veulent plus de démocratie directe, font des sondages sur Facebook, les porte-paroles ne se déclarent jamais leaders… Où conduira cet horizontalisme ?
PG – Dans certains domaines, c’est très horizontal, comme les petits groupes où ils se coordonnent, où pratiquement tout le monde peut prendre la parole… Mais ils ont aussi des leaders tel qu’Eric Drouet. On peut parfois penser qu’il n’y a pas de chef parce qu’il n’y a pas qu’un seul dirigeant. Mais c’est faux, le leadership peut être polycentrique, avec une multitude de dirigeants qui représentent différentes factions du mouvement ; c’est précisément ce qui s’est passé avec les gilets jaunes. Ils ont différentes sections, groupes, sensibilités, donc les leaders parlent à différentes catégories de personnes qui appartiennent au mouvement.
En fin de compte, c’est le rituel des marches du samedi et des ronds points qui maintient la cohérence. Il n’y a pas besoin d’un chef pour vous dire quoi faire car vous marchez chaque samedi jusqu’à l’acte 1000… C’est comparable aux mouvements des places, qui n’avaient pas besoin d’un leadership centralisé car un rituel était instauré : le rassemblement sur des places publiques. D’une certaine façon, les places ou les marches du samedi se substituent au chef. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de leaders : de fait, il y a des gens qui ont essayé de créer des partis en dehors du mouvement.
LVSL – Il y a eu quelques tentatives, mais chaque fois que cela a été fait, presque tout le monde a immédiatement dit que ces personnes ne représentaient pas les gilets jaunes.
PG – Oui, parce que le passage au parti est souvent un processus assez laborieux, qui ne peut émerger du mouvement lui-même. Le mouvement est une chose et le parti en est une autre. Par exemple, Podemos est arrivé trois ans après les Indignados et était principalement constitué de personnes peu impliquées dans ces mouvements, même si elles avaient sympathisé avec celui-ci. Néanmoins, Podemos a réussi à se présenter comme représentant plus ou moins la sensibilité des indignés. Il en va de même pour le Mouvement cinq étoiles, issu des manifestations anti-corruption, anti-Berlusconi et en partie anti-mondialisation initiées par Grillo auparavant, et qui se présente comme le représentant de ces mobilisations. Les conséquences à long terme du mouvement des Gilets jaunes sur la scène politique prendront donc un certain temps à se manifester.