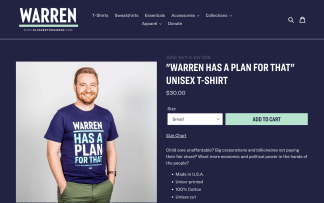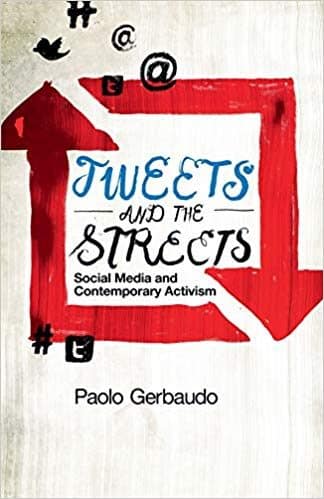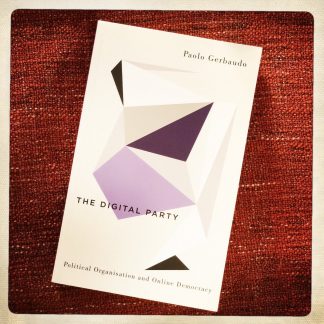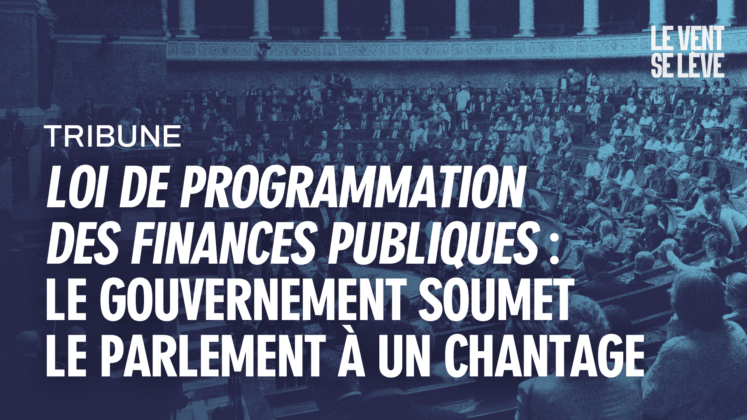En lice pour l’investiture démocrate pour les prochaines présidentielles américaines, le candidat Bernie Sanders s’illustre par sa proposition de Green New Deal : un grand plan de relance centré sur l’équité et la justice climatique. À l’heure où l’enjeu écologique est au cœur des préoccupations mondiales, un programme aussi ambitieux – que nous analysons succinctement – peut permettre de faire pencher la balance envers le sénateur du Vermont, mais aussi d’imaginer un tournant global pour l’ensemble de l’humanité en cas de victoire contre Donald Trump.
Le feu en Australie, la neige au Texas, la fonte des glaces au Groenland… Ces dernières semaines ont été marquées par des événements climatiques extraordinaires à travers le globe, désormais toujours plus fréquents. Conscients de cette réalité, les candidats à la primaire démocrate, qui désignera le futur opposant démocrate à Donald Trump pour les élections présidentielles de septembre prochain, se sont saisis de cette problématique. Alors que s’ouvriront bientôt les premiers caucus, l’enjeu écologique semble bien parti pour occuper une place de choix dans les critères des électeurs. À plus long terme, la centralité de la thématique peut être un atout majeur face au président sortant, faible sur la question climatique, et, pourquoi pas, la force propulsive d’une prise de conscience globale de l’humanité. Pour l’instant, c’est le candidat « démocrate-socialiste » Bernie Sanders qui s’illustre particulièrement dans le domaine, avec un plan politique ambitieux, le désormais fameux « Green New Deal ». Quels en sont les tenants et les aboutissants ?
Le Green New Deal 2.0
L’idée du Green New Deal part d’un constat : le changement climatique met en péril l’espèce humaine et sa capacité à vivre dans de bonnes conditions sur la planète. La réponse doit donc nécessairement être la mise en place d’une vaste politique, de manière à combattre le changement climatique et rendre la société plus soutenable. Si Bernie Sanders faisait déjà figure de pionnier dans sa volonté d’instaurer une véritable politique écologique lors des dernières primaires démocrates de 2015, perdues face à Hillary Clinton, il a désormais affiné sa pensée. À partir du modèle du New Deal, un vaste plan d’investissement lancé par Franklin Roosevelt en 1933 contre la Grande Dépression, il développe, aux côtés d’une nouvelle génération de démocrates-socialistes, à l’image d’Alexandria Ocasio-Cortez, un vaste programme qui comporte plusieurs volets. En tout, c’est 16 400 milliards qui seront consacrés au Green New Deal, un budget bien supérieur à ceux de ses opposants à l’investiture. Comme le précise Pavlina Tcherneva, conseillère économique de Bernie Sanders, dans l’entretien que nous avons réalisé, ce projet comprend à la fois des politiques industrielles, de transition vers des énergies renouvelables, des politiques sociales, avec notamment la mise en place d’une couverture universelle, que des politiques de logement, véritable problématique aux Etats-Unis. L’idée est ici de sortir complètement du modèle actuel, qui est à la fois climaticide, mais aussi injuste et inégalitaire, pour se diriger vers une société socialement, écologiquement et économiquement viable.
Le programme de Bernie Sanders repose sur une doctrine que l’on pourrait considérer comme éco-socialiste [1]. Il a articulé son Green New Deal [2] autour de plusieurs grands axes :
- Transition vers 100% d’énergies renouvelables d’ici 2030 : une sortie totale des énergies fossiles dans les domaines de l’électricité et des transports. 526 millions de dollars seront consacrés à la recherche et au développement d’un réseau les plus respectueux de l’environnement possible, avec comme objectif de combler 100% des besoins énergétiques de la nation.
- Création de 20 millions d’emplois nécessaires dans le domaine de la transition écologique afin de réduire le chômage de masse, et inclure toutes les populations dans cette transformation. Des créations d’emplois sont prévues dans des domaines aussi larges que l’agriculture, la fabrication de voiture électriques, la rénovation et la construction de logements et autres infrastructures.
- Garantir une reconversion professionnelle pour les travailleurs des industries fossiles en investissant 1,3 milliards de dollars dans la formation, des pensions égales aux salaires perçues précédemment, une protection sociale et médicale afin de limiter les coûts d’un tel changement.
- Développement d’une justice autour des questions climatiques pour protéger les personnes les plus vulnérables aux impacts climatiques, reconstruire des infrastructures, ou encore construire des logements pour garantir un logement décent, et plus respectueux de l’environnement, à toute la population.
- Se placer en position de leader de la transition écologique au niveau mondial en rejoignant les accords de Paris, créer et investir 200 milliards de dollars dans le Green Climate Found, et négocier la baisse des émissions avec les pays les plus industrialisés.
Des adversaires moins ambitieux, mais également très présents sur le dossier écologique
Du côté de ses adversaires, la volonté d’une transition verte de cette ampleur reste plutôt timide. Le centriste Joe Biden, principal opposant à l’investiture du sénateur socialiste, appelle à une Clean Energy Revolution and Environmental Justice. Ce plan prévoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre l’objectif des 0%, mais aussi 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050. En parallèle, des fonds devraient être débloqués en faveur de la construction d’infrastructures plus propres, mais aussi la rénovation d’immeubles et résidences fortement énergivore. Sur le plan international, à l’instar de Bernie Sanders, Biden souhaite mettre les États-Unis au centre de la bataille contre le changement climatique, notamment en intégrant à nouveau les Accords de Paris, mais également en mettant en place des traités internationaux en faveur de la protection de l’environnement.
Elisabeth Warren, pour sa part, soutient également un Green New Deal, pour lequel elle a milité aux côtés d’Ocasio-Cortez, quand il a été présenté devant le Sénat. Celui-ci reste néanmoins beaucoup moins abouti que celui de son concurrent démocrate-socialiste. Il est ainsi présenté comme un plan d’investissement en faveur de la transition énergétique, avec objectif de se tourner vers des énergies renouvelables à 100% d’ici les années 2030, et la baisse drastique des émissions de CO2. Néanmoins, si elle parle effectivement de la création de 10 millions de green jobs, aucun détail n’est donné sur les domaines impactés, mais également sur la potentielle volonté, d’entamer une politique de reconversion des ouvriers des industries polluantes par exemple. Pas un mot non plus sur d’éventuels investissements en matière sociale pour garantir une certaine justice climatique.
Seulement, face à la menace que représente candidat socialiste, une figure assez inattendue a fait une percé dans le caucus de l’Iowa. Crédité de 15,4% [3] à la veille du vote, le “Macron américain”, a finalement devancé Bernie Sanders, s’imposant 26,2% contre 26,1% [4]. Mais, à l’instar de son adversaire Michael Bloomberg, le candidat centriste propose un plan écologique qui reste très peu ambitieux, dont les conséquences désastreuses. Ils se contentent ainsi d’objectifs de baisse d’émission et de transition vers des énergies vertes d’ici 2050, d’investissements dans la recherche et l’innovation et de ratification des accords de Paris. Néanmoins, contrairement aux autres, est leur volonté partagée de créer une assurance pour les victimes d’événements liés aux changements climatiques, comme l’ouragan Katrina, qui, en plus de faire de nombreuses victimes, avaient créé d’énormes dégâts matériels.
La contre-attaque de l’establishment
Il faut dire que ces deux derniers candidats, et plus particulièrement Pete Buttiegeg depuis sa récente percée, représentent peut-être le dernier barrage pour empêcher Bernie Sanders d’obtenir l’investiture. Avec un programme fortement ancré à gauche, qu’il décrit lui même comme “socialiste” dans un pays qui a longtemps considéré ce terme comme un anathème, le sénateur du Vermont menace toute la stabilité politique d’un pays, et met en péril le développement de certains secteurs économiques clés, dont les énergies fossiles, génératrice de quantité suffisante pour garantir une indépendance énergétique. Ses promesses de transition vers une énergie renouvelable à hauteur de 100% dès 2030, taxer les industries fossiles à hauteur de leur pollution, et ou encore couper toutes les subventions dans ce domaine, risquent de compromettre les bénéfices de ces secteurs. Du côté de la finance, la peur est de mise avec celui qui pourrait devenir leur “pire cauchemar”, puisque plusieurs annonces, dont la création de l’assurance maladie pour tous, Medicare for All, ou encore la généralisation d’un service minimum autour de 15 dollars de l’heure, pourraient créer une certaine instabilité sur les marchés. Il faut s’attendre, si les bons résultats de Sanders se confirment aux primaires démocrates, à une contre-attaque violente de l’establishement, et notamment des grandes firmes transnationales, principales responsables de la crise écologique, qui, sous de grands discours greenwashés, accueillent avec méfiance la construction d’un front écologiste, qui implique nécessairement une forme de décroissance.
Néanmoins, les candidats ne peuvent faire l’impasse sur la question écologique, qui n’a jamais été aussi importante pour l’opinion publique. Ainsi, d’après des sondages réalisés en 2019, 51% de la population étatsunienne se dit inquiète pour le changement climatique, un chiffre qui atteint 77% chez les votants démocrates. Un chiffre important dans la population jeune, de 18 à 29 ans, qui se sent concernée à hauteur de 67%. Avoir un programme écologique radical, comme le propose le sénateur, permettrait ainsi, d’une part de répondre aux inquiétudes de la population, mais aussi, de faire revenir aux urnes ces populations souvent éloignées de la politique, d’autant plus dans le système bi-partisan étasunien, que sont les jeunes et les abstentionnistes.
Ce que la victoire de Bernie Sanders pourrait changer
De fait, nul politicien ne peut ignorer l’ampleur de la catastrophe. Selon le GIEC [5], il faut considérablement changer ses manières de produire d’ici 2030, au risque de voir des conséquences irréversibles sur l’environnement. Dans cette course contre la montre, les États-Unis peuvent jouer un grand rôle, car ils stagnent à la deuxième place des plus gros pollueurs du monde, derrière la Chine [6]. L’investiture du premier sénateur socialiste représente un réel espoir, d’autant plus que selon les sondages [7], il est le candidat démocrate le plus susceptible de battre Donald Trump, ouvertement climatosceptique, dont la politique a déjà eu des conséquences sur l’environnement [8]. Depuis son arrivée à la tête du pays en 2017, le président américain a levé, par exemple, toutes les restrictions concernant l’exploitation du gaz de schiste et du pétrole, ce qui a certes fait exploser leurs productions, mais surtout causé des dégâts considérables sur l’environnement. L’élection de Bernie Sanders, avec un programme à contre-pied de l’actuel président, pourrait marquer un tournant radical dans les politiques mondiales, autant en matière économique, sociale, que climatique.
En se plaçant à la tête d’une grande révolution verte, Sanders prendrait la tête en matière de politique environnementale, et pourrait ainsi pousser d’autres grandes puissances occidentales à lui emboîter le pas. C’est d’ores et déjà le cas dans plusieurs pays européens, où l’idée d’un Green New Deal For Europe fait son chemin, visant à obliger la Banque Centrale Européenne à débloquer des fonds pour investir dans des infrastructures plus respectueuses de l’environnement – un programme qui pourrait poser la question de la compatibilité entre un agenda écologiste et les institutions européennes actuelles. Dans le même temps, le chef de l’opposition britannique, Jeremy Corbyn, milite en faveur d’une Green industrial Revolution [9], un plan d’investissement de transition écologique et social, inspiré par celui de son allié américain.
À l’aube d’une recomposition totale de l’ordre économique, dans laquelle la Chine convoite la place de première puissance mondiale occupée par les États-Unis, le changement de paradigme idéologique en faveur de la lutte contre le changement climatique poussera cette dernière à se placer en tant que pionnière dans ce domaine. Ainsi, ils pourraient mettre en place toutes sortes d’outils contraignants, à l’instar de sanctions financières, ou d’interdictions d’importations lors de non-respect de normes environnementales.
Enfin, le Green New Deal pourrait surtout pousser à un changement radical vers la sortie du paradigme libéral. Plus le temps avance, plus les liens entre la crise écologique et la crise économique semblent évidents. L’élection de Sanders pourrait faire apparaître au grand jour les liens entre le néolibéralisme et la crise écologique, les intérêts du système oligarchique actuel et la passivité des gouvernements face à la destruction de la planète. . Les inégalités économiques engendrent le plus souvent une exposition encore plus grande aux problèmes des changements climatiques, mais rendent également impossible toute volonté d’amélioration des comportements. De ce fait, il est important de juxtaposer des politiques de transition écologiques, et le retour à un État social fort, permettant à chacun de prendre sa place dans ce mécanisme [10].
Contre toute attente, la révolution verte pourrait venir d’un des pays maître en matière de pollution, et pourrait rabattre toutes les logiques économiques, et sociales mises en place. Et tout cet espoir repose entre les mains d’une personne, Bernie Sanders. Tout l’enjeu pour la suite reste de savoir la réponse à la percée du candidat socialiste et la réaction de l’establishment démocrate, de la finance ainsi que des lobbies en cas de victoire du sénateur du Vermont. Une question qui se posera finalement à l’échelle mondiale, si tant est que la brèche s’ouvre outre Atlantique.
[1] Pierre-Louis Poyau, L’écosocialisme : qu’est-ce donc ? https://www.revue-ballast.fr/lecosocialisme/
[2] Bernie Sanders, The Green New Deal https://berniesanders.com/issues/green-new-deal/
[3] Louis Tanka, Sanders, Biden, Warren, Buttigieg: qui domine les sondages chez les démocrates?
[4] https://www.nytimes.com/interactive/2020/02/04/us/elections/results-iowa-caucus.html
[5] Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C https://public.wmo.int/fr/ressources/bulletin/rapport-sp%C3%A9cial-du-giec-sur-le-r%C3%A9chauffement-plan%C3%A9taire-de-15-%C2%B0c
[6] https://fr.statista.com/statistiques/732709/emissions-dioxyde-de-carbone-etats-unis/
[7]https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_sanders-6250.html
[8] Yona Helaoua, L’exploitation du gaz de schiste dévaste les États-Unis https://reporterre.net/L-exploitation-du-gaz-de-schiste-devaste-les-Etats-Unis
[9] https://labour.org.uk/manifesto/a-green-industrial-revolution/
[10] Pierre Gilbert, Le paradoxe australien : enfer climatique et dirigeants climatosceptiques. https://lvsl.fr/paradoxe-australien-enfer-climatique-et-dirigeants-climatosceptiques/