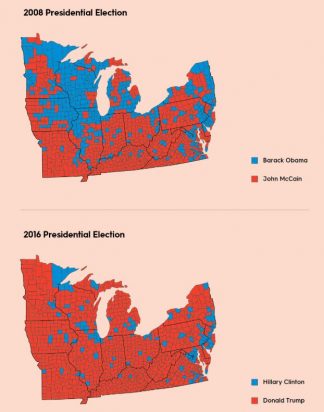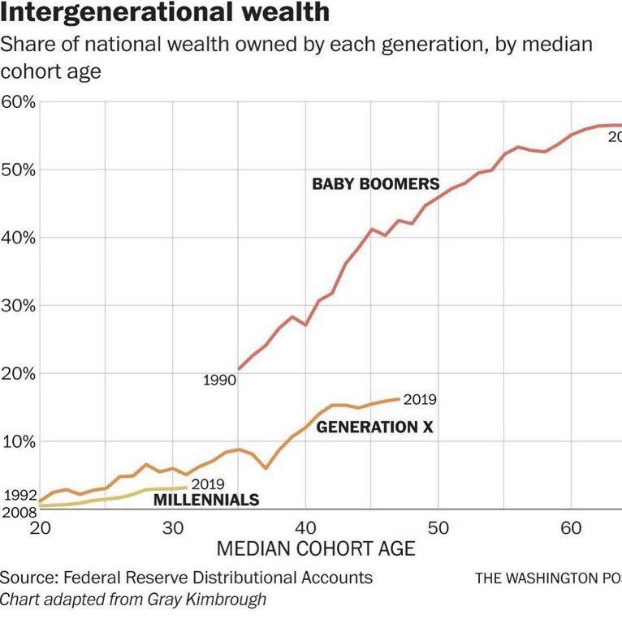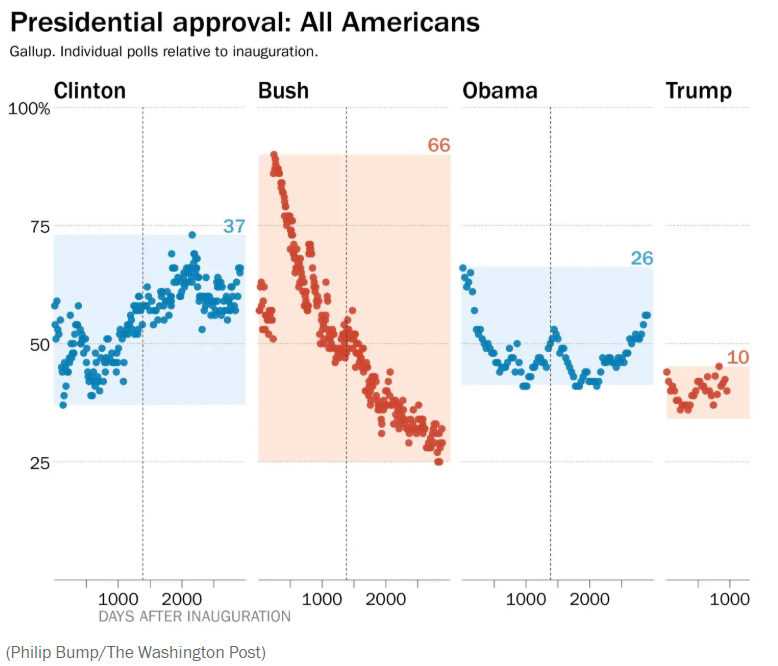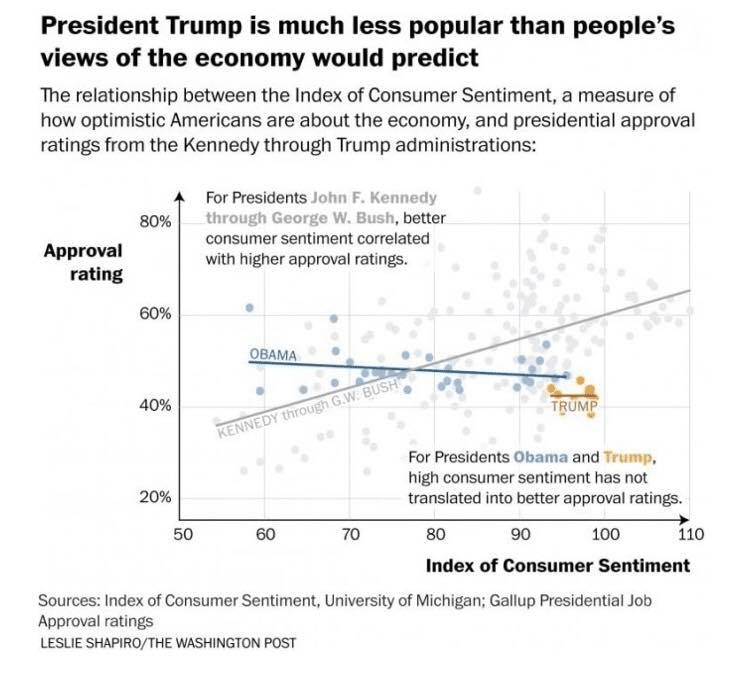L’Iowa devait lancer les primaires démocrates en grande pompe et permettre au parti comme aux candidats de bénéficier d’un tremplin médiatique en vue de la présidentielle. Au lieu de cela, l’incapacité des instances démocrates à publier les résultats en temps et en heure et la façon suspecte dont ils les ont diffusés ensuite ont produit trois effets désastreux : ridiculiser le camp démocrate, diviser le parti et priver Sanders d’une victoire médiatique. Pour autant, le candidat socialiste apparaît désormais favori pour l’investiture, si le parti démocrate n’implose pas avant.
Edit 12/02/2020 : Bernie Sanders a finalement remporté la primaire dans le New Hampshire avec 26 % des voix.
D’un point de vue purement comptable, le caucus de l’Iowa ne présente aucun intérêt. Cet État rural de trois millions d’habitants ne met en jeu que 41 délégués sur les 1940 nécessaires pour remporter la nomination (contre 494 pour la Californie). De plus, le mode de scrutin particulier et sa population majoritairement blanche ôtent tout caractère représentatif à cette élection.
Mais dans les faits, gagner l’Iowa permet de construire un « momentum » en offrant une exposition médiatique considérable. En tant que premier État à voter, il sert de baromètre initial, place le vainqueur en position de force en permettant d’influencer les électeurs des États suivants, et les donateurs qui financent les campagnes. Historiquement, le vainqueur de l’Iowa tend à remporter l’investiture, ce qui explique les efforts démesurés fournis par les différents candidats pour disputer ce scrutin auxquels ne participent qu’un peu moins de deux cent mille personnes. Pete Buttigieg, Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont déployé des dizaines de collaborateurs, formé 1700 « capitaines » chargés d’encadrer chaque bureau de vote, frappé à des dizaines de milliers de portes et passé des centaines de milliers de coups de téléphone. Plusieurs millions de dollars ont été dépensés en publicité ciblée, meetings et autres formes d’actions promotionnelles.
Ces efforts auront été gâchés par un invraisemblable fiasco. Dix-huit heures après le vote, aucun résultat n’était encore publié du fait d’un problème lié à l’application pour téléphone censé prendre en charge la centralisation des scores. Cela n’a pas empêché Pete Buttigieg, avec un aplomb formidable, de se déclarer vainqueur dès la fin de soirée électorale. Le lendemain matin, le comité de campagne de Bernie Sanders a cherché à étouffer le feu allumé par son adversaire en publiant ses résultats internes sur la base de 60 % des bureaux de vote, montrant Sanders clairement en tête. [1]
La surprenante incompétence lors de la diffusion des résultats attise la perception d’une manipulation
À 17h le mardi, le parti démocrate de l’Iowa publie des résultats incomplets, concernant 62 % des caucus seulement, et dans la plus grande opacité.
Pete Buttigieg figure en tête des délégués locaux (27 % contre 25 % pour Sanders, 20 % pour Warren et 15 % pour Biden), mais largement derrière Sanders en ce qui concerne le nombre de voix.
Car rien n’est simple en Iowa. Du fait du mode particulier du scrutin organisé en « caucus » (sortes d’assemblées où l’on vote à main levée dans chaque bureau de vote), il n’existe pas moins de quatre façons de présenter les résultats : le nombre de voix au premier tour, au second, le nombre de délégués locaux remportés (environ 2100 répartis sur 1700 bureaux de vote) et le nombre de « véritables » délégués comptant pour l’investiture (au nombre de 41 pour l’Iowa).
Les médias ont majoritairement titré sur la victoire de Pete, lui permettant de débuter son meeting du New Hampshire en se déclarant vainqueur pour la seconde fois en 24h.
Mais les vagues de publications suivantes (71 %, 75 %, 85 %, 92 % et 97 % étalés sur 24 heures) ont permis à Sanders de rattraper son retard en délégués et d’accroître son avance en termes de voix. Il faudra néanmoins attendre deux journées et demie pour que la presse commence à parler de match nul.
La séquence de diffusion des résultats interroge fortement, puisque les bureaux de vote favorables à Bernie Sanders ont été publiés en dernier, permettant à Buttigieg de continuer de clamer sa victoire trois jours durant, et de monter de 9 points dans les sondages du New Hampshire.
Pire, la publication des résultats à 85 % a dû être mise à jour après que le parti démocrate a été pris la main dans le sac à transférer des délégués remportés par Sanders vers d’autres candidats. Une fois arrivé à 97 % et au point où Sanders allait dépasser Pete Buttigieg, ce dernier a fait appel au comité électoral central du parti démocrate (le DNC, critiqué pour son attitude partisane en 2016) pour demander un audit.
Selon CNN, le président du DNC Tom Perez aurait accepté cette requête à cause des doutes concernant les « caucus satellites » (des bureaux de votes par procuration ouverts pour les ouvriers et immigrés naturalisés, mais ne parlant pas anglais, qui ont tous voté pour Bernie Sanders). Ce faisant le DNC s’attaque aux électeurs marginaux pour lesquels la campagne de Sanders avait déployé des efforts considérables. [2]
Tom Perez n’en est pas à son premier fait d’armes. Imposé au poste clé de la présidence du DNC par Barack Obama en 2017 contre l’avis des sénateurs modérés et de l’aile gauche, il avait pris parti pour Hillary Clinton en 2016 malgré son devoir d’impartialité. Incompétent, compromis, Tom Perez incarne à merveille cet establishment démocrate qui fait obstacle à toute tentative d’unification du parti, préférant défendre le maintien d’un écosystème fait de milliers de consultants et conseillers carriéristes qui alternent les postes dans les think tanks, administrations et instances du parti, quitte à enchaîner les défaites électorales. Le fait qu’Obama l’ait imposé au DNC ne peut se comprendre que par sa volonté de maintenir en vie ce réseau d’influence et de conseillers nourri par les financement privés. [3 : cf. cet exposé du American Prospect]
Ainsi, malgré les preuves apportées par le New York Times et CNN des multiples erreurs contenues dans les résultats diffusés par le parti démocrate depuis trois jours, celui-ci a fini par publier les 3 % de bureau de vote restant après en avoir gelé la publication pendant une journée entière et sans apporter la moindre correction. Le résultat officiel montre désormais Pete Buttigieg avec 1,5 délégué local de plus que Sanders (sur les 2100 disponibles), soit 0.1 % d’avance. Le comité de campagne de Bernie Sanders a identifié, sur la base des résultats papier mis en ligne par les présidents de bureaux de vote, quatorze erreurs qui auraient dû permettre à Bernie Sanders de passer très légèrement en tête.
Le timing de la publication de cette dernière batterie de résultats par le parti démocrate est particulièrement suspect : il a eu lieu pendant une émission organisée par CNN en prime time, où les différents candidats défilent tour à tour sur le plateau. Les résultats sont tombés après le passage de Sanders et juste avant celui de Buttigieg, permettant au maire de South Bend de déclarer victoire pour la quatrième fois en soixante-douze heures.
Au-delà des soupçons de manipulation qui pèsent sur la diffusion des résultats, Pete Buttigieg a su tirer parti d’une performance électorale surprenante pour capitaliser sur ce succès. Joe Biden a évité l’humiliation d’une quatrième place grâce au chaos général, et Donald Trump s’est moqué d’un parti qui « veut nationaliser l’assurance maladie, mais n’arrive pas à compter les voix en Iowa ». Mike Bloomberg, qui avait déclaré sa candidature trop tardivement pour participer aux primaires de l’Iowa, a également fustigé un scrutin inutile.
Lorsqu’un tel fiasco intervient dans un pays d’Amérique latine, les USA sont prompts à soutenir un coup d’État. Ici, les dirigeants démocrates ont agi avec une déconcertante nonchalance, ne semblant pas réaliser à quel point le parti qui vient d’échouer dans sa tentative de destitution du président et prétend diriger le pays dans 10 mois est passé pour une organisation incompétente et corrompue.
La diffusion scabreuse des résultats risque également de décourager les électeurs les moins engagés politiquement, c’est-à-dire la base de Bernie Sanders.
Autrement dit, la séquence est particulièrement nuisible à Sanders, que les médias ont décrit comme un mauvais perdant risquant de diviser le parti démocrate.
Aux origines du fiasco, un establishment démocrate miné par les conflits d’intérêts et l’hostilité envers Bernie Sanders.
Depuis que Bernie Sanders a pris la tête de certains sondages, les cadres du parti démocrate ont multiplié les déclarations d’hostilité à son égard.
Il y a d’abord cette réunion d’avril 2019 rapporté par le New York Times, où Nancy Pelosi (présidente de la majorité démocrate au Congrès), Pete Buttigieg et d’autres cadres du parti et riches donateurs s’étaient rencontrés pour discuter d’une stratégie pour « stopper Sanders ». Puis la candidature de dernière minute de Mike Bloomberg a débouché sur la décision unilatérale du DNC de modifier les règles de participation aux débats télévisés pour y inclure le multimilliardaire.
À cela se sont ajoutées les déclarations lunaires d’Hillary Clinton et de John Kerry (candidat malheureux face à Bush en 2004) qui ont implicitement affirmé préférer Donald Trump à Bernie Sanders. Le journal Politico a également rapporté que certains membres du DNC envisageaient de changer les règles des primaires si Sanders s’approchait de la nomination. Or le fameux Tom Perez a décidé de garnir le comité d’organisation de la convention démocrate (qui doit confirmer le nominé en juin) d’anciens proches d’Hillary Clinton et de lobbyistes ayant à peu près tous affirmé publiquement leur opposition à Bernie Sanders. [4]
Côté médiatique, la tentative de repeindre Bernie Sanders en sexiste orchestrée par CNN avec le concours (prémédité ou circonstanciel) d’Elizabeth Warren et le débat télévisé de janvier construit comme un véritable guet-apens s’ajoute à une longue liste de « bashings » parfaitement documentés et parfois outrageusement comiques. Chris Mathews, la star de la chaîne MSNBC (équivalent de FoxNews pour les centristes démocrates) a fustigé un Sanders « qui ne s’arrêterait pas pour vous si vous êtes renversé par une voiture » avant d’avertir qu’il pouvait gagner le caucus de l’Iowa car « les socialistes aiment les assemblées ».
Le samedi précédant le vote, le DesMoines Register (principal journal de l’Iowa) a renoncé à publier son très attendu et respecté « dernier sondage », qui devait être présenté pendant une heure en prime time sur CNN. L’annulation de l’émission a été effectuée à la demande de Pete Buttigieg, suite à la plainte d’un de ses militants qui aurait été contacté par l’institut, et affirmait que le sondeur ne lui aurait pas présenté Buttigieg parmi les options. Le résultat de ce qui constitue le sondage le plus important des primaires a fuité dans la presse après l’élection. Il donnait Sanders en tête (22 %) devant Warren (18 %), Pete (16 %) et Biden (13 %).
Tous ces efforts, plus celui d’un lobby démocrate et pro-Israël (dirigé par un proche de Buttigieg) qui a dépensé près d’un million de dollars en publicité télévisée pour attaquer directement Bernie Sanders durant le weekend qui précédait le vote en Iowa, ont contribué à provoquer ce climat de méfiance, pour ne pas dire d’antagonisme. Sans empêcher Sanders de l’emporter.
Lorsqu’il est apparu que les résultats ne seraient pas publiés à temps, l’attention s’est focalisée sur l’application téléphonique censée permettre leur centralisation. Elle est produite par une entreprise baptisée Shadow (“ombre”, cela ne s’invente pas) et dont les quatre dirigeants sont d’anciens cadres de la campagne d’Hillary Clinton ayant manifesté une hostilité ouverte envers Bernie Sanders. Les campagnes de Pete Buttigieg et Joe Biden ont loué les services de Shadow.inc (pour quarante-deux mille dollars dans le cas de Pete). Elle est une filiale de la société Acronym, responsable du développement d’outils numériques au service du parti démocrate. Cette société mère initiée par d’anciens collaborateurs d’Hillary Clinton et de Barack Obama compte l’épouse du directeur stratégique de la campagne de Pete Buttigieg parmi ses cofondateurs. Enfin, des sources internes citées par The Intercept y dénoncent une culture d’entreprise clairement hostile à Sanders. [5]
Pourtant, plutôt que de voir dans le fiasco de l’Iowa une machination orchestrée par l’establishment démocrate aux bénéfices de Pete Buttigieg, on peut l’interpréter comme une énième manifestation de l’incompétence et des conflits d’intérêts qui minent le parti depuis des années.
En 2018, Alexandria Ocasio-Cortez choque la nation en détrônant le numéro 2 du parti démocrate au Congrès lors de sa fameuse primaire. Son succès s’explique en partie par les outils numériques innovants qu’elle avait utilisés. Au lieu de chercher à déployer cette technologie à l’échelle nationale, le DNC a décidé de blacklister toute entreprise qui travaille pour des candidats démocrates non approuvés par le comité électoral (autrement dit, tous les candidats de gauche souhaitant contester une investiture officielle dans le cadre d’une primaire). Cet épisode a conduit Ocasio-Cortez à refuser de verser une partie de ses levées de fond au DNC, pour les redistribuer aux candidats dissidents. [6]
L’attribution du contrat à Acronym (et sa filiale Shadow.inc) avait été présentée comme un effort pour combler le retard abyssal du parti démocrate sur la campagne de Donald Trump en matière de communication numérique. Elle peut se comprendre comme une énième manifestation de l’incompétence relative de l’establishment démocrate, et des conflits d’intérêts qui y règnent. Comment expliquer autrement le fait de donner du crédit aux architectes du désastre que fut la campagne d’Hillary Clinton en 2016 ? Et comment justifier le fait que le décompte et la centralisation des résultats des caucus, qui était effectués jusqu’à présent par téléphone et papiers, soient sous-traités à une application produite par une entreprise privée ?
Ironiquement, la presse avait fait état d’inquiétudes concernant l’application, dont le nom avait été tenu secret soi-disant pour éviter un piratage informatique de la part de la Russie… Le comité de campagne de Bernie Sanders avait anticipé les problèmes, et a pu déjouer toute tentative de manipulation trop grossière en publiant ses propres décomptes. Car lors d’un caucus, on vote en public et devant témoins.
Des nouvelles encourageantes pour Bernie Sanders, malgré tout
Malgré le fiasco de l’Iowa, ce premier scrutin permet de tirer de nombreux enseignements relativement favorables au sénateur du Vermont.
Premièrement, le scénario d’une forte mobilisation au-delà du niveau de 2016 et proche de celui de 2008 ne s’est pas matérialisé. De quoi inquiéter le parti démocrate qui avait gagné les élections de mi-mandat grâce à une forte mobilisation, et qui aura besoin d’un mouvement similaire en 2020. Le manque d’intérêt pour la primaire peut cependant s’expliquer par des causes liées, une fois de plus, à l’establishment démocrate. Le choix du calendrier de la destitution de Donald Trump aura cannibalisé l’espace médiatique, produisant dix fois moins de couvertures pour les primaires de l’Iowa que ce qu’on avait observé en 2016. Ce black out a permis à Bernie Sanders de prendre la tête des sondages sans provoquer une réaction trop appuyée des médias, mais aura nui à la participation, malgré un certain succès du camp Sanders pour mobiliser son propre électorat et les abstentionnistes. Les jeunes et classes populaires se sont déplacés dans des proportions historiques, alors que les plus de 55 ans abreuvés aux chaînes d’information continue ont boudé le scrutin, expliquant en partie la débâcle de Joe Biden.
Solidement arrimé en tête des sondages nationaux depuis l’annonce de sa candidature, l’ancien vice-président d’Obama résistait de manière quasi incompréhensible aux attaques de ses adversaires, à son implication dans l’affaire ukrainienne et aux performances désastreuses qu’il livrait non seulement lors des débats télévisés, mais également au cours de ses rares meetings de campagne. La principale raison de son succès résidait dans son image d’homme expérimenté et la perception qu’il était le candidat le mieux placé pour battre Donald Trump.
En terminant en quatrième place de l’Iowa et à 15 % seulement, la bulle de son « électabilité » semble avoir finalement éclaté. Sa contre-performance peut s’expliquer par son inhabilité à répondre aux critiques de Bernie Sanders concernant ses prises de position passées en faveur de coupes budgétaires dans la sécurité sociale et l’assurance maladie, et l’absence d’organisation de terrain capable de mobiliser ses électeurs en Iowa.
Depuis sa contre-performance, Biden plonge dans les sondages et semble promis à un second désastre en New Hampshire. Cependant, l’ex-vice-président bénéficie toujours d’une cote de popularité très élevée auprès des Afro-Américains et latinos, ce qui peut lui permettre de rebondir au Nevada et en Caroline du Sud avant le Super Tuesday.
Inversement, une victoire de Buttigieg en New Hampshire pourrait ne pas suffire à rendre la candidature du jeune maire viable sur le long terme. Mayor Pete reste moins populaire que Donald Trump auprès des Afro-Américains, et très en retard sur Bernie Sanders auprès des latinos, des jeunes et des classes populaires.
Le succès de Pete Buttigieg doit beaucoup à l’importance des moyens qu’il a déployés en Iowa pour mobiliser les classes sociales aisées et blanches (majoritaires dans cet État), mais sa performance auprès des jeunes et des minorités laisse à désirer. Pete pourrait donc caler au Nevada ou en Caroline du Sud et terminer très bas lors du Super Tuesday de Mars, où la Californie et le Texas sont en jeu.
Bernie Sanders a donc quelques raisons de se réjouir : la percée de Buttigieg risque de diviser le vote centriste, et la troisième place d’Elizabeth Warren place Sanders en position naturelle pour incarner l’aile gauche du parti. Quant à l’effondrement de Biden, il devrait provoquer un report de voix en provenance des minorités et des classes ouvrières vers le sénateur du Vermont.
Pour contrer la percée médiatique de Buttigieg, Sanders a publié les résultats de ses levées de fond du mois de janvier, établissant un nouveau record à 25 millions de dollars (plus que ce que ses adversaires avaient récolté lors des trois derniers mois de 2019). Le New York Times décrivait des chiffres « impressionnants », alors que ses adversaires semblent opérer en flux tendu.
Un long chemin semé d’embûches pour Bernie Sanders
Sanders pourrait manquer de nouveau la première marche du podium en New Hampshire et démarrer une longue série de seconde place (cédant la première à Pete Buttigieg puis à Joe Biden au Nevada et en Caroline du Sud par exemple). Ses adversaires peuvent se permettre d’arriver à la convention du parti démocrate en juin en tête des délégués, mais sans une majorité absolue, pour ensuite se rallier derrière un candidat centriste. Bernie ne bénéficiera pas d’une telle opportunité, et aura besoin d’une majorité nette pour ne pas être mis en minorité à la convention.
Le modèle analytique du site Fivethirtyeight, qui avait prédit avec une précision déconcertante les résultats des élections de mi-mandat, ne s’y est pas trompé. Après l’Iowa, Sanders a pris la première place du classement (40 % de chances de victoires), devant le scénario sans vainqueur majoritaire (25 %) et Joe Biden (passé de 40 à 20 %).
Mais le modèle n’intègre pas le fait que Bernie Sanders doive faire face à de multiples fronts. En plus des intérêts financiers menacés par son programme et de Donald Trump, le sénateur du Vermont risque, en cas de succès, de mettre au chômage tout un pan de l’establishment démocrate qui œuvre dans les think tanks, équipes électorales, au DNC et à Washington. La principale opposition va donc venir de son propre camp, et si l’Iowa peut nous apprendre quelque chose, c’est que les cadres du parti démocrate emmenés par Tom Perez préféreront couler le navire plutôt que de laisser la barre à un socialiste.
[1] : https://theintercept.com/2020/02/04/sanders-campaign-release-caucus-numbers-iowa-buttigieg/
[2] : The Intercept a couvert ces caucus particulier et produit une enquête passionante sur les efforts de l’équipe Sanders, à lire ici : https://theintercept.com/2020/02/05/bernie-sanders-iowa-satelllite-caucuses/
[3] : Lecture indispensable pour comprendre les enjeux au sein du DNC et le rôle de Tom Perez : https://prospect.org/politics/tom-perez-should-resign-dnc/
[5] : https://theintercept.com/2020/02/04/iowa-caucus-app-shadow-acronym/
[6] : https://thehill.com/homenews/campaign/477705-ocasio-cortez-defends-decision-not-to-pay-dccc-dues