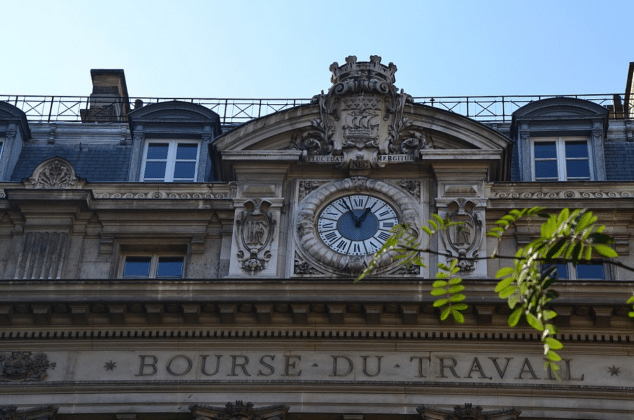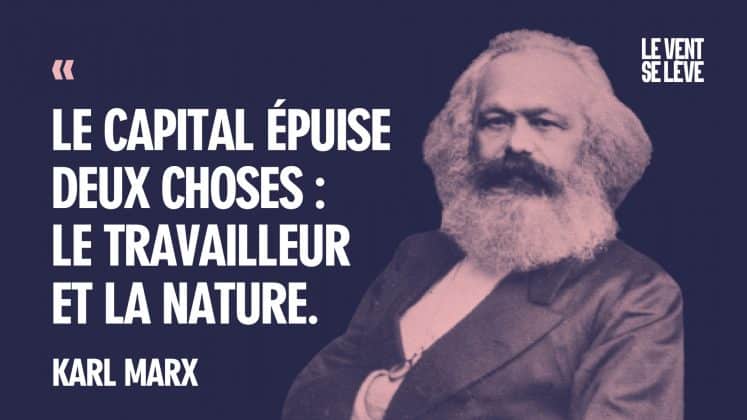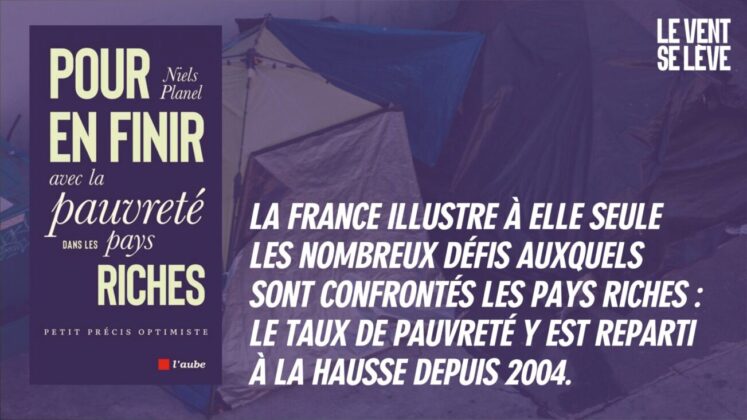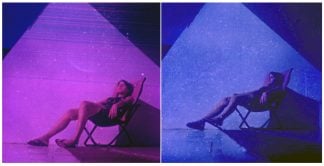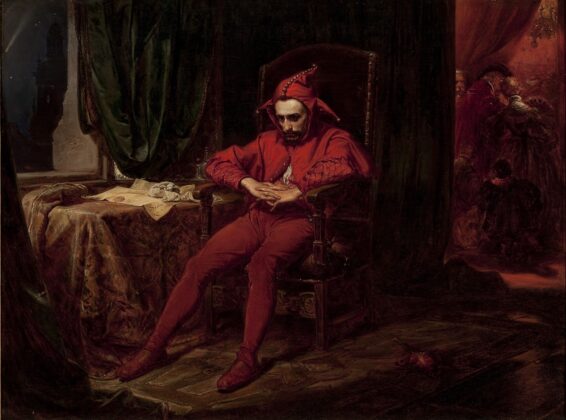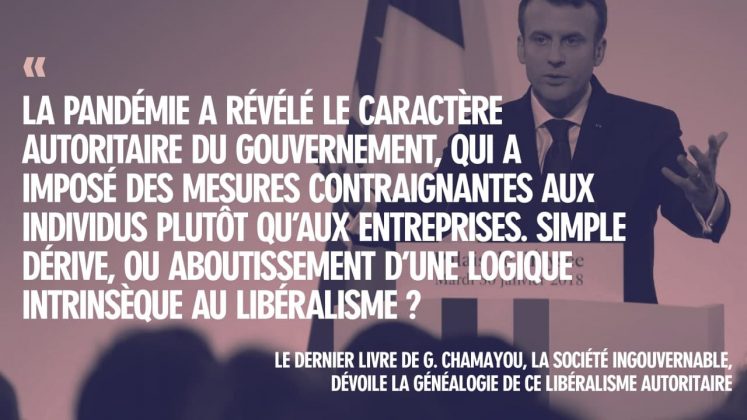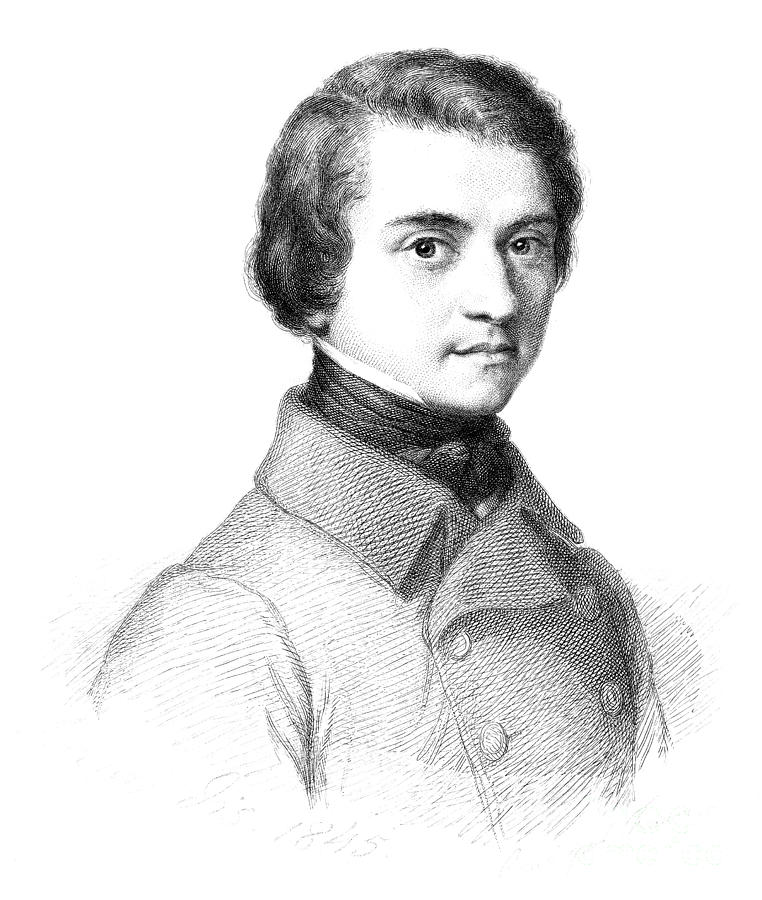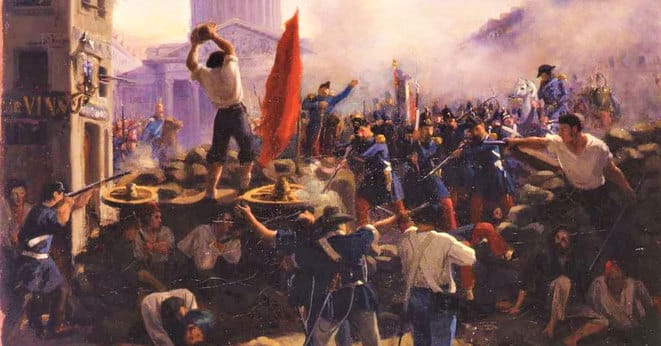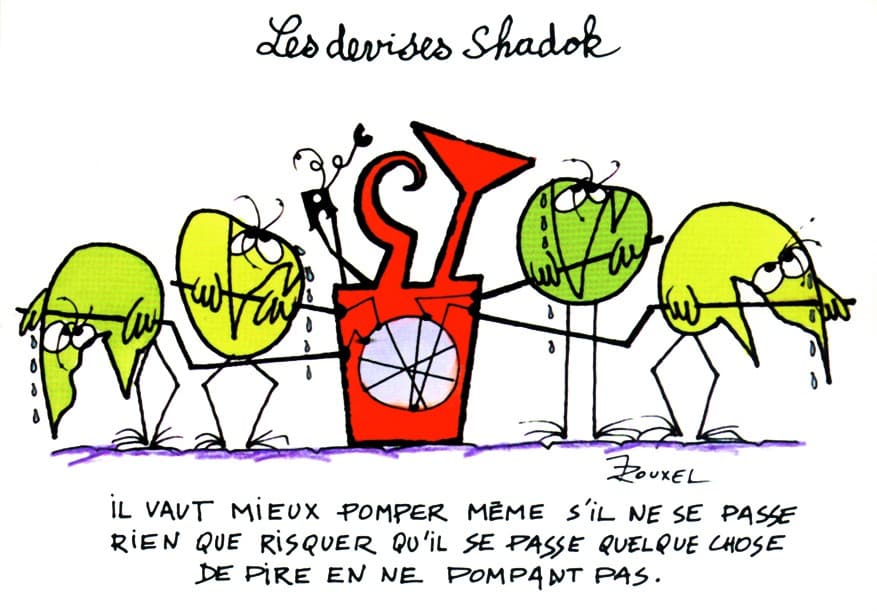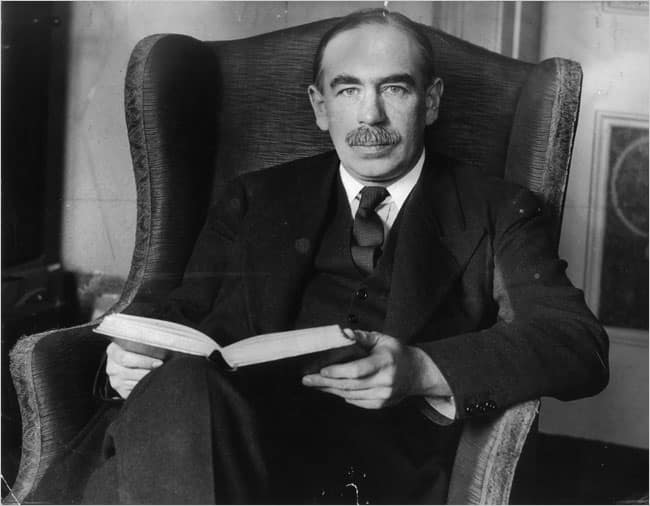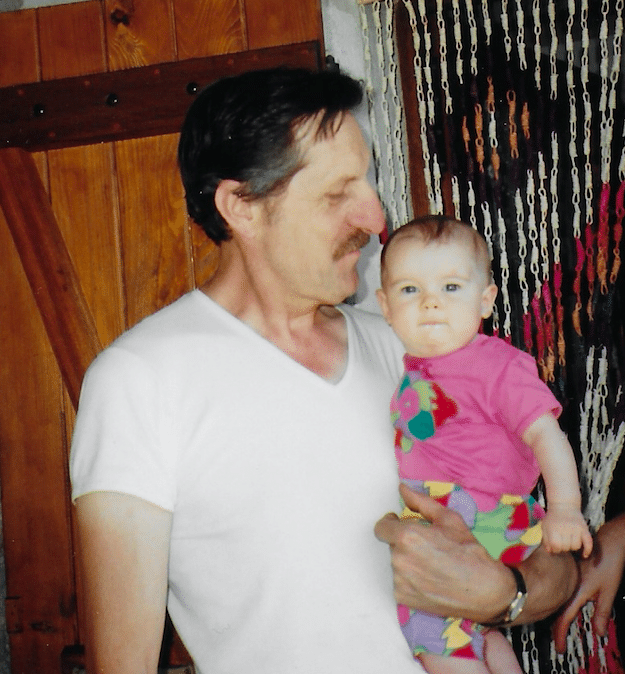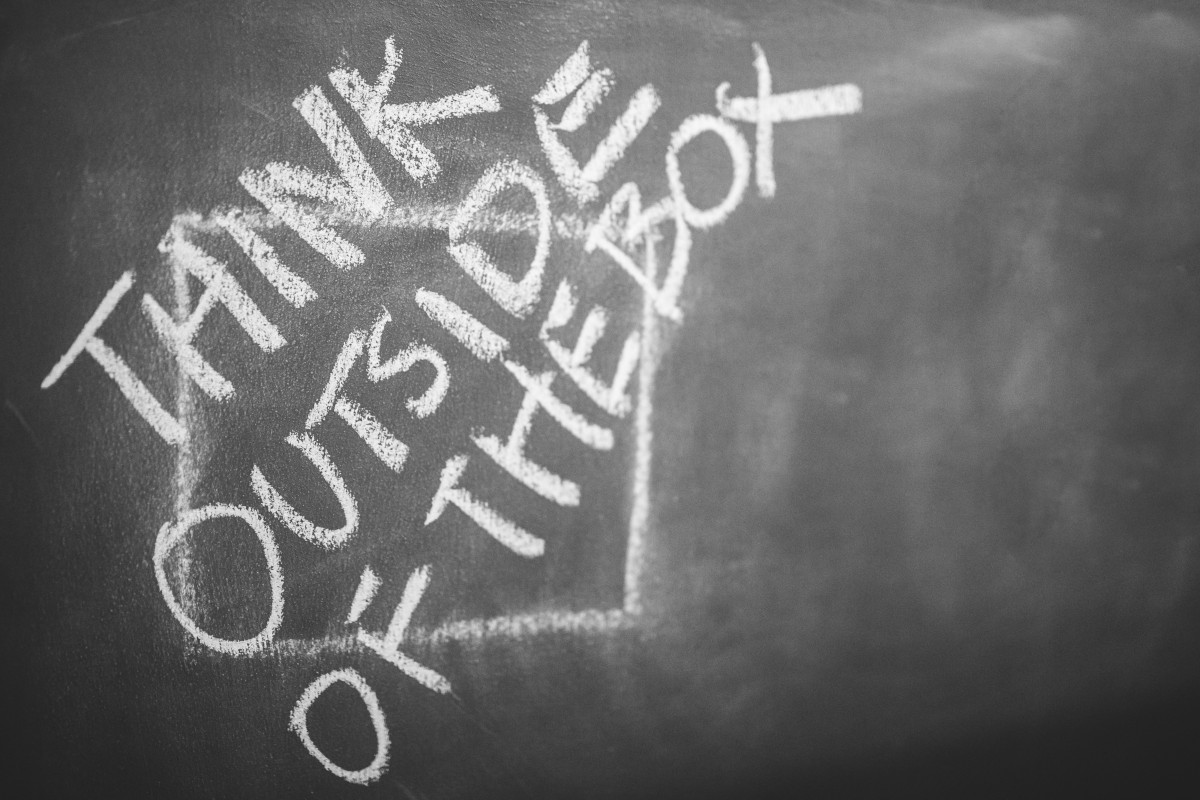Les mêmes arguments continuent d’agiter le paysage politique. Une partie de la gauche proteste contre les cadeaux fiscaux et la réduction des services publics. Une partie de la droite explique qu’il en va de l’attractivité et de la compétitivité de notre économie. S’il n’aura échappé à personne que depuis trente ans les discours se répètent des deux côtés, les observateurs attentifs auront noté que la distinction entre impôt et cotisation sociale n’est jamais faite : tous deux sont mis dans le même sac des « charges ». Cette absence de distinction doit nous interpeller. L’enjeu de cette dichotomie est pourtant crucial : la cotisation est, contrairement à l’impôt, un mécanisme intrinsèquement émancipateur.
Redistribuer ou répartir mieux ?
Pour beaucoup de celles et ceux qui aspirent à un monde plus juste, la redistribution que permet l’impôt est une arme qu’il faut revendiquer et défendre. Certes, l’impôt présente des avantages, mais il présente des défauts qui ne peuvent pas demeurer impensés, alors même que concevoir des solutions alternatives est un enjeu central dans tout projet émancipateur.
D’abord, si l’impôt permet de redistribuer le niveau de valeur économique qui ne lui échappe pas à travers l’évasion, la fraude ou les niches fiscales, il légitime du même coup le profit puisque c’est lui, en grande partie, qui le finance. Ainsi, « l’impôt prend acte de l’existence du capital et le taxe » : il n’émancipe jamais véritablement les bénéficiaires de la redistribution fiscale car il tend structurellement à légitimer la première répartition des ressources, celle-là même à l’origine du besoin de redistribution en raison des profondes inégalités créées.
L’enjeu n’est pas d’abandonner totalement l’impôt mais de l’améliorer en le rendant plus progressif ou en supprimant les niches néfastes écologiquement et socialement. Cependant, l’impôt ne peut pas tout, notamment parce qu’il est contourné, mais aussi parce que son fonctionnement même ne permet pas d’agir en amont des inégalités primaires, lesquelles découlent de ce système que légitime la fiscalité. Il convient alors logiquement de réfléchir à d’autres moyens.
Cotisons : décidons
Il existe justement un mécanisme bien plus émancipateur qui socialise une part de la valeur économique pour qu’elle soit gérée par les travailleurs qui l’ont produite : la cotisation sociale.
La cotisation opère un renversement radical par rapport à l’impôt. Là où ce dernier intervient après la première répartition des ressources, la cotisation agit en amont : elle fait partie intégrante de la distribution primaire. De ce fait, il n’y a pas, dans la cotisation, au contraire de l’impôt, de prélèvement qui puisse être objectivement présenté comme relevant de la confiscation : la socialisation du salaire a lieu lors de la première distribution. Elle correspond à une partie de la valeur créée par les travailleurs, est gérée par ceux-ci, et échappe aux logiques capitalistes d’allocation de ressources.
« L’impôt place la répartition de la richesse au cœur du débat, la cotisation y place sa production. »
C’est d’ailleurs cette idée qui fonde le régime général de la Sécurité Sociale mis en place à partir de 1946 : les Caisses d’Assurance Maladie sont alimentées par les cotisations sociales et, jusqu’à la fin des années 1960, ce sont des travailleurs élus par leurs pairs qui les dirigent. Le système de protection sociale « à la française » renferme ainsi originellement des principes de démocratie économique et sociale d’une ampleur inouïe, qu’il convient à présent de réactualiser. Car non seulement les cotisations rendent possible un accès universel à la protection sociale, mais leur gestion par les travailleurs élus a pour conséquence inestimable de responsabiliser ces derniers et de leur octroyer le pouvoir – légitime – de gérer une partie de la valeur produite (environ un tiers du PIB) notamment en matière d’investissement et de salaires socialisés à verser.
Changer la définition du travail
Comme l’énonce l’économiste et sociologue Bernard Friot, « l’impôt place la répartition de la richesse au cœur du débat, la cotisation y place sa production ». C’est bien cette distinction qui permet de comprendre pourquoi le régime général de Sécurité Sociale est si précieux : il nous permet de gérer en partie la production de richesse. Cette socialisation par les cotisations ouvre la voie à un mode de production libéré de la logiques capitaliste.
Ce mécanisme permet en effet de financer un certain nombre de salaires en outrepassant le marché. C’est d’abord le cas du salaire des soignants, qui travaille dans l’hôpital public sans alimenter aucun capital par des profits, bien que des processus inspirés du management entrepreneurial y soient désormais appliqués. La cotisation permet de reconnaître leur travail dans une logique alternative au capitalisme, et de ce fait commence à changer la définition du travail. En effet, le travail n’est pas une notion naturelle ou immuable : elle varie avec le temps et les institutions. Il faut par ailleurs distinguer l’activité du travail. La première représente à peu près toute action que nous entreprenons, à la différence du travail qui est la part de notre activité reconnue par une institution légitime comme contribuant à la création de valeur économique. Dans le système de production capitaliste, ce qui transforme notre activité en travail c’est le fait qu’elle mette en valeur du capital. En octroyant aux soignants un salaire (grâce à la cotisation) alors même qu’ils ne mettent pas en valeur de capital dans un hôpital public qui n’appartient à aucun actionnaire, le régime général les reconnaît comme contribuant à la création de valeur économique, et commence à subvertir la définition capitaliste du travail.
Les caisses du régime général financent également d’autres rémunérations : celle des chômeurs, des retraités et même des parents, via la CAF. Trois ministres communistes, Maurice Thorez, Marcel Paul et Ambroise Croizat, épaulés par la CGT, ont mis ce système en place dès 1946. Ici, le salaire a d’émancipateur le fait qu’il reconnaît une qualification à des personnes indépendamment de l’occupation ou non d’un poste de travail. La qualification devient l’abstraction qui permet de mesurer la capacité d’un travailleur à produire de la valeur économique. Dans le secteur privé – et grâce à une conquête centrale de la lutte des classes au XXème siècle – la qualification est rattachée au poste de travail. La conquête reste cependant partielle car les propriétaires lucratifs conservent le pouvoir sur le poste. Dans le système public, les fonctionnaires d’Etat sont titulaires de leur grade – donc de leur qualification – et le salaire leur est attribué peu importe le poste de travail qu’ils occupent : le support de leur qualification (dont dépend leur salaire) n’est pas leur poste, mais leur personne même.
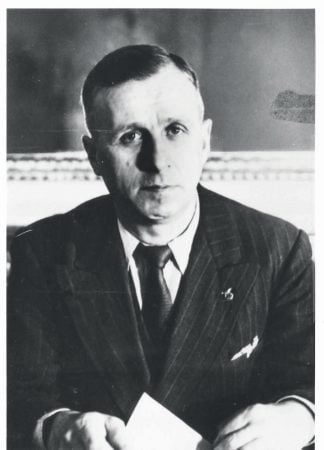
Les pensions versées aux retraités, aux chômeurs ou aux parents imitent ce système. Le fondement de l’allocation familiale n’est pas la reconnaissance du coût d’un enfant, mais bien la reconnaissance que l’élever implique une qualification, rattachée aux parents indépendamment d’un poste de travail. Il en va de même pour les retraites. Le ministre de la production industrielle Marcel Paul parle de « salaire d’inactivité de service » pour les électriciens-gaziers retraités. Le versement de la pension par les caisses de retraite est donc à envisager comme le droit à une continuité de salaire pour les retraités, lesquels restent les titulaires reconnus de leur qualification, dans une logique libérée du marché du travail. On est bien loin de la vision libérale-capitaliste de la retraite comme simple « différé des cotisations » qui passerait par une collection de points dont dépendraient nos droits.
Enfin, les caisses du régime général permettent de financer une autre forme de salaire socialisé, grâce aux prestations en nature. Les travailleurs, qui sont les seuls à produire la valeur économique dont une part est socialisée à travers la cotisation, décident collectivement des critères de conventionnement. Il est ensuite possible à chacun de dépenser ce salaire socialisé – sous forme de prestation en nature – auprès de professionnels conventionnés. Là encore, on pourrait réactualiser ce mécanisme et l’étendre à d’autres secteurs. Partant par exemple du principe qu’une alimentation saine est un besoin vital, lequel serait rencontré en transformant l’agriculture industrielle en agriculture paysanne, il serait dès lors envisageable de bâtir une sécurité sociale de l’alimentation.
Marginaliser la propriété lucrative de l’outil de travail
Par ailleurs, la cotisation se révèle encore plus émancipatrice quand elle permet aux caisses qu’elle alimente de financer l’investissement nécessaire à l’activité économique par subvention. Autrement dit, la subvention boycotte les crédits bancaires et les marchés de capitaux.
Si la plupart des investissements implique bien une avance, qui permettra de dégager plus de travail, et donc plus de valeur économique, la cotisation ouvre la voie à un autre mode de financement de l’activité économique. Au lieu que l’avance nécessaire à l’investissement provienne du crédit ou des marchés de capitaux qui achètent des titres de propriété et nous posent comme étrangers au travail [1], la cotisation permet de réaliser cette avance grâce à la part de valeur social isée que gèrent les directeurs et directrices de caisses élus. Ainsi, la cotisation nous dispense purement et simplement des prêteurs et de la dette d’investissement.
“La subvention boycotte les crédits bancaires et les marchés de capitaux.”
Un des meilleurs exemples pour illustrer ce concept est la vague d’investissements subventionnés par les Caisses d’Assurance Maladie à partir des années 1950 en vue de construire des hôpitaux et CHU en France : les caisses de l’Assurance Maladie ont subventionné l’investissement et personne ne s’est endetté. Ce mécanisme permet donc de marginaliser la propriété lucrative de l’outil de travail : ainsi financé, l’hôpital n’appartient à aucun propriétaire cherchant à s’accaparer une part de la valeur produite par le travail du personnel hospitalier. Cette copropriété d’usage gagnerait à être étendue à bien d’autres secteurs.
Le sabotage du régime général de la Sécurité Sociale
Certes, on peut discuter des modalités de versement des cotisations. Mais cela ne leur ôterait en rien leur caractère révolutionnaire qui permet non seulement d’agir en amont de la première distribution et de ne pas légitimer le profit, mais d’ouvrir en plus la voie à des perspectives bien plus radicales car portant en elles les germes d’institutions macroéconomiques alternatives au capitalisme.
Rappelons en effet que lorsque les caisses sont gérées par les salariés, elles ne dépendent pas de l’Etat. Mais la bourgeoisie capitaliste qui colonise la sphère publique ne cesse d’œuvrer pour une reprise en main par l’Etat d’un tel creuset producteur de richesse. Battu en brèche, le régime général de la Sécurité Sociale est de plus en plus financé par l’impôt et de moins en moins par la cotisation [2]. Il s’agit là d’un enjeu de classe de premier ordre : dès lors que c’est l’impôt qui alimente les caisses de la Sécurité Sociale, leur gestion devient affaire de l’Etat, non plus de celles et ceux qui en produisent la valeur.
Confondre les impôts et les cotisations est un formidable cadeau à la bourgeoisie capitaliste, qui conserve ainsi son hégémonie sur le travail et l’investissement. Le régime général est un outil de premier ordre pour marginaliser la définition capitaliste du travail, qui ne vise que le profit. Mais en le présentant comme un mécanisme de solidarité nationale et intergénérationnelle, la bourgeoise en nie le caractère révolutionnaire.
En fait, le régime général de la Sécurité Sociale permet de reconnaître une multitude de personnes comme travaillant, donc exerçant une activité qui a une valeur économique, en leur attribuant un salaire financé par les cotisations, qui dépend d’une qualification rattachée à leur personne. Sans le régime général, qui subvertit les logiques capitalistes, les soignants ne seraient pas reconnus comme contribuant à la création de valeur économique : ils seraient cantonnés à la valeur d’usage et on exalterait leur utilité sociale. Dans ce sens, le régime général amorce bien un changement dans la définition du travail. Mais il a aussi pour objet central de responsabiliser les travailleurs et de leur donner un droit et un pouvoir économiques considérables : gérer la part de la valeur socialisée. Dès lors, l’origine du financement de la Sécurité Sociale, entre impôt et cotisation sociale, est une bataille idéologique fondamentale et non un simple problème comptable.
Réarmer les travailleurs, ne plus les définir négativement comme de simples vaincus, leur redonner le pouvoir de décider de l’usage d’une part des richesses produites, ouvrir la voie à des modes de production non capitalistes, changer la définition du travail ou encore solvabiliser – grâce à la cotisation – un type de demande conventionnée : autant d’horizons enthousiastes que la cotisation nous permet d’atteindre. L’annulation de cotisations sociales en sortie de Covid doit nous faire réagir : il s’agit de saboter encore davantage l’hôpital public, ni plus ni moins. Mais pour toutes les raisons évoquées ici, il est nécessaire d’aller au-delà de l’opposition aux allègements de charges : il est temps de rendre aux salariés l’important pouvoir qu’ils ont conquis, notamment grâce à des combats syndicaux et à l’expérience ministérielle d’Ambroise Croizat.
[1] C’est également un enjeu sémantique de parler d’insertion dans le marché du travail, comme si le travail, devenu marchandise, était fatalement extérieur aux travailleurs, alors même que c’est eux qui produisent la valeur.
[2] L’un des plus puissants vecteurs de cette contre-révolution est l’instauration, en 1991 par le gouvernement Rocard, de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), qui ouvre ensuite la voie, à partir de 1996, aux Lois de Financement de la Sécurité Sociale, qui évincent purement et simplement les salariés de la gestion de leur régime général et rompt avec les logiques de démocratie économique et sociale.