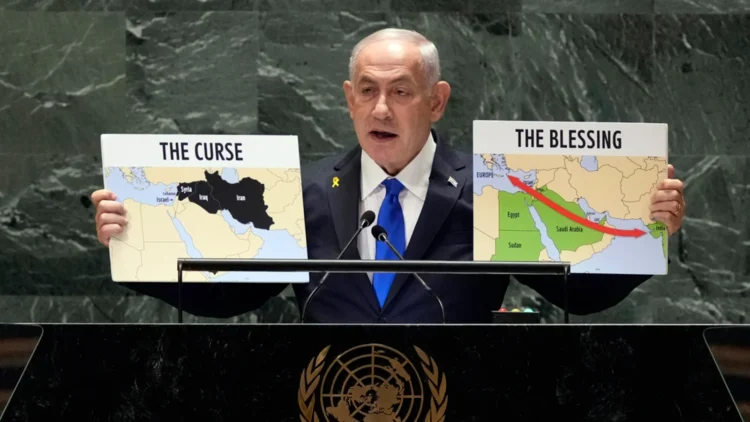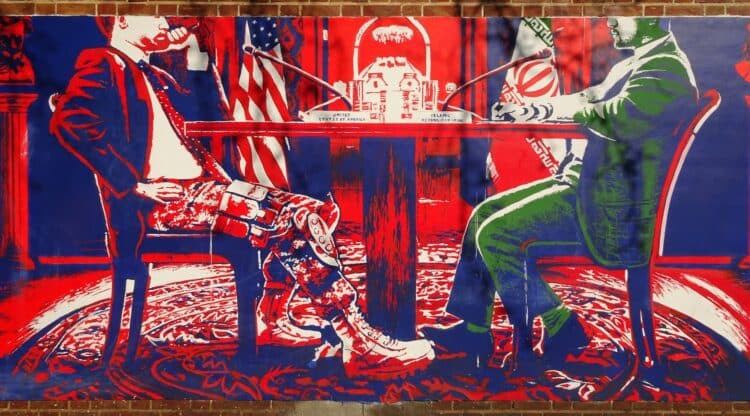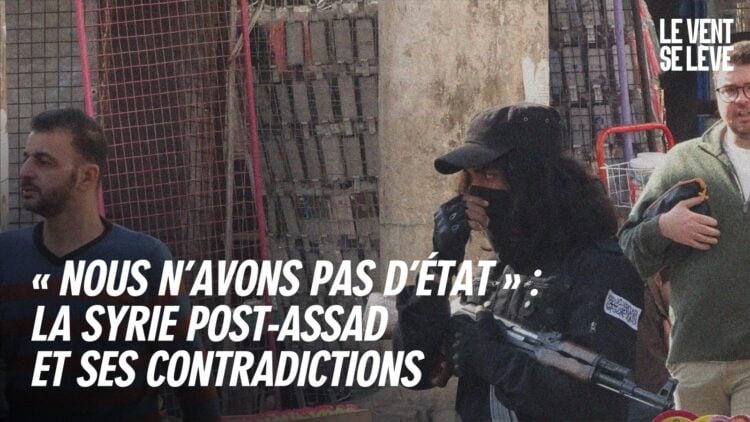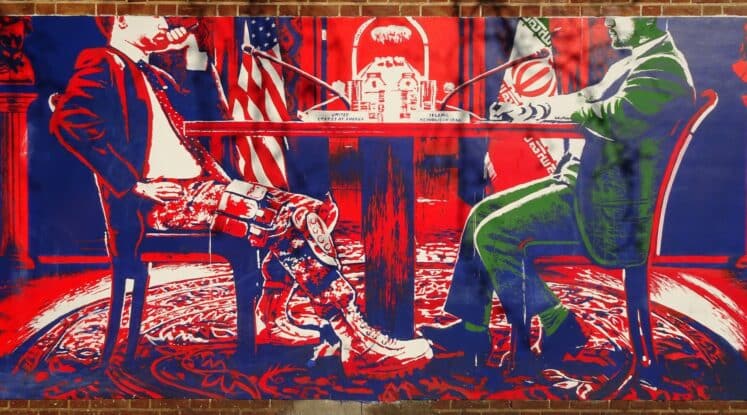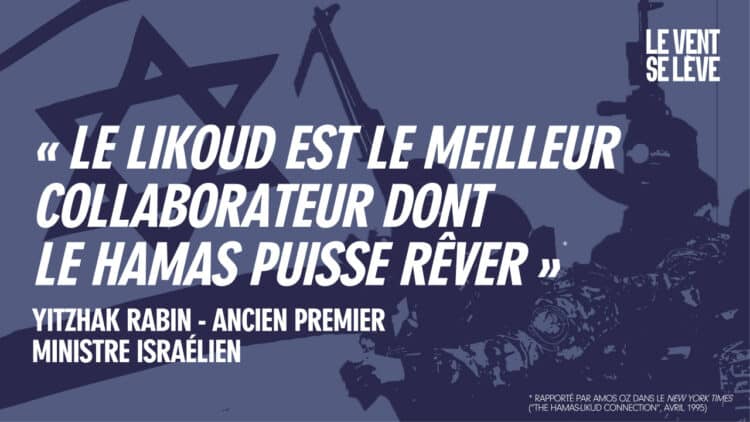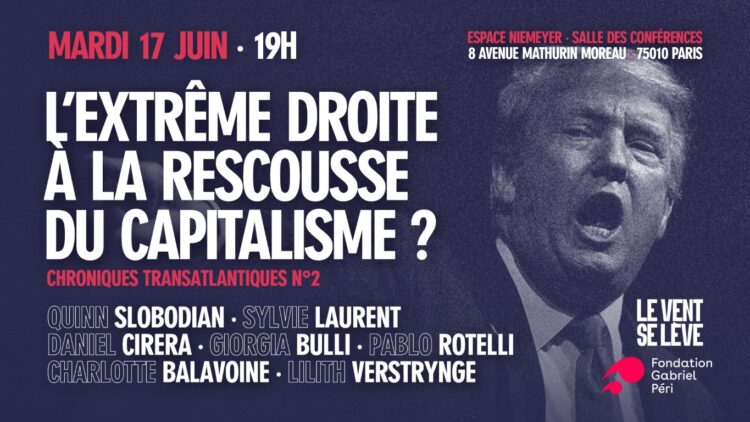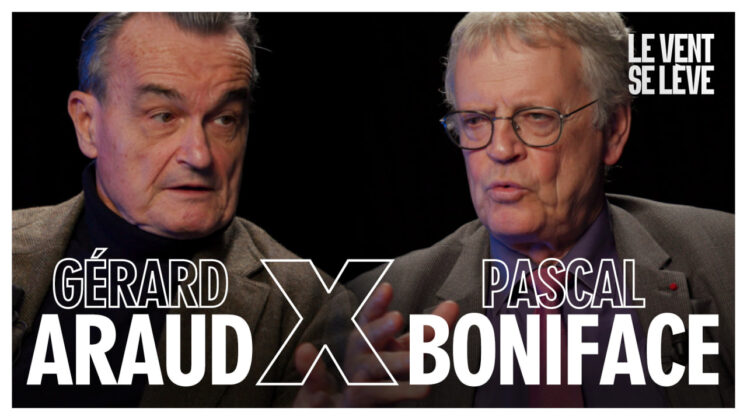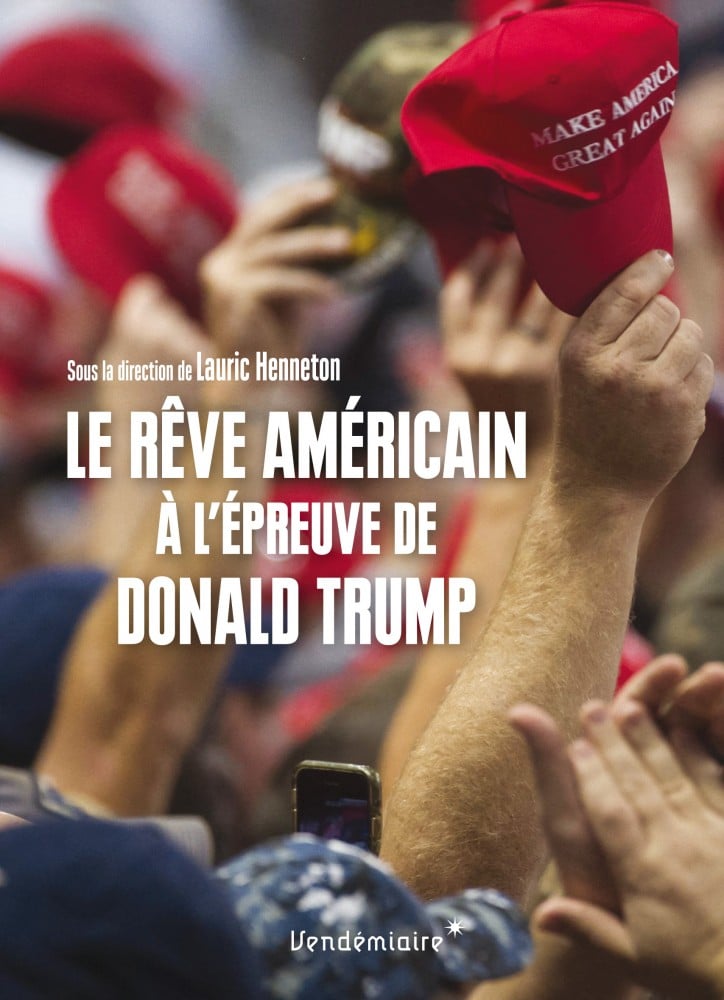Alors que les dirigeants européens serrent les rangs derrière l’objectif des 5 % du PIB consacré à la défense, le chef du gouvernement espagnol rompt le rang. Tandis qu’à La Haye il dénonce un « keynésianisme militaire » aux effets délétères pour les investissements sociaux, à Madrid ses partenaires de gauche menacent de quitter le gouvernement. À l’horizon, ce sont les contradictions de la coalition de gauche qui apparaissent : pourra-t-elle longtemps résister à la prédation américaine tout en respectant les normes de l’intégration européenne et atlantique ?
Jeudi, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rompu les rangs avec les autres dirigeants de l’OTAN en refusant de s’engager à porter les dépenses de défense à 5 % du PIB. Depuis son entrée en fonction, Donald Trump réclame une hausse massive du plafond actuel, fixé à 2 %, dans le cadre de son projet de réduction de la présence militaire américaine en Europe. Pour de nombreux États membres, la promesse des 5 % vise avant tout à ménager Trump, après des mois de turbulences diplomatiques inédites. Mais pour le gouvernement de coalition de la gauche large espagnole, elle illustre aussi une course au réarmement européen menée sans le moindre esprit critique.
En vertu du projet actuel du secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, les États membres seraient tenus de consacrer au moins 3,5 % de leur PIB à la défense traditionnelle d’ici 2032, auxquels s’ajouteraient 1,5 % dédiés à des questions de sécurité plus larges, comme la cybersécurité et le contrôle des frontières. Rutte présente ce « compromis » comme un moyen de laisser aux États la marge nécessaire pour atteindre l’objectif des 5 % — un objectif qui s’inscrit globalement dans la ligne des annonces faites récemment par l’Allemagne et la France. Si ces dernières suscitaient déjà le scepticisme, la proposition de Rutte impliquerait, pour la plupart des pays d’Europe du Sud, de plus que doubler leur budget militaire en l’espace de sept ans.
C’est le cas pour le gouvernement de Sánchez : les dépenses militaires espagnoles n’atteignaient que 1,3 % du PIB en 2024 — le taux le plus bas parmi les membres de l’OTAN. Dans une lettre adressée à Rutte avant le sommet décisif de l’OTAN prévu la semaine prochaine, Sánchez a exposé les raisons de son refus d’adopter l’objectif des 5 %, soulignant qu’il était « incompatible avec notre État-providence » et ne serait possible qu’au prix « d’une hausse des impôts pour les classes moyennes, d’une réduction des services publics et d’un recul des prestations sociales pour les citoyens ». « Il revient à chaque gouvernement, en toute légitimité, de décider s’il est prêt à consentir de tels sacrifices, » poursuivait-il. « En tant qu’allié souverain, nous choisissons de ne pas le faire ».
Dans cette même lettre, il soulignait également qu’un tel objectif ne ferait que renforcer la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’armement américain. Il notait notamment que « en précipitant l’Espagne [et d’autres pays européens] vers des achats sur étagère » de matériel militaire, « une part substantielle de leurs ressources » serait dirigée « vers des fournisseurs non européens, les empêchant ainsi de développer leur propre base industrielle ».
Txema Guijarro, porte-parole défense de Sumar — le partenaire de gauche du PSOE dans la coalition — a confirmé ce point auprès de Jacobin [duquel la version anglaise de cet article est issue NDLR] : « nous parlons d’un objectif arbitraire, qui ne repose sur aucune analyse des besoins réels de sécurité ». « C’est aussi totalement contraire à l’objectif d’accroître l’autonomie stratégique de l’Europe vis-à-vis des États-Unis », ajoute-t-il. « Mais d’autres pays, même parmi les plus lourdement endettés comme l’Italie, semblent s’aligner sur cette logique et se précipiter pour obéir. »
À l’approche du sommet de l’OTAN du 24 juin, Sánchez apparaît en effet isolé au sein de l’alliance transatlantique – seul le Premier ministre britannique Keir Starmer n’ayant pas encore pris publiquement position parmi les dirigeants de premier plan. Mais même face à la menace brandie par Trump d’imposer de nouveaux droits de douane à tout pays refusant de signer son exigence des 5 %, Sánchez dispose de solides raisons internes pour refuser de se plier au jeu — à commencer par un vaste scandale de corruption qui ébranle actuellement son Parti socialiste (PSOE). Il avait déjà annoncé, en avril, une hausse immédiate de 10,4 milliards d’euros du budget militaire, sous la pression diplomatique de l’administration Trump. Il savait aussi qu’un nouvel engagement aurait été inacceptable pour son partenaire de coalition Sumar, comme pour ses alliés parlementaires catalans et basques, dont le PSOE dépend pour conserver sa majorité.
Alors qu’il se bat pour sa survie politique, plusieurs membres de son entourage étant impliqués dans cette affaire de corruption, Sánchez se prépare désormais à un possible affrontement avec Trump lors du sommet. L’un des derniers dirigeants de centre-gauche en Europe se retrouve ainsi à nager à contre-courant d’une vague de militarisme.
Bouleversement des plaques tectoniques
La position isolée de Sánchez contraste avec celle qu’il occupait en 2020, lorsqu’il jouait un rôle central dans les négociations autour des fonds européens de relance post-pandémie, dits NextGeneration. À l’époque, il faisait partie d’un bloc uni des pays du Sud, aux côtés de dirigeants italiens et portugais, qui poussaient à l’adoption de ce plan de relance sans précédent — financé pour la première fois par une dette commune de l’UE. L’accord visait à renforcer l’investissement public dans la transition écologique, la numérisation et les politiques sociales, même si ce cadre reposait fortement sur des partenariats public-privé. Il avait aussi fourni à Sánchez un contexte favorable pour gouverner en coalition avec Unidas Podemos sur la base d’un programme social-démocrate modéré.
Mais depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et les menaces de son administration de remettre en cause l’alliance militaire occidentale, le rythme de la réponse européenne est désormais dicté par les pays du « triangle de Weimar » : la France, l’Allemagne et la Pologne. Durant les semaines tendues de février et du début mars, alors que des responsables de l’administration Trump interrompaient temporairement certaines aides militaires à l’Ukraine et adoptaient une posture de rupture avec la Russie, il devenait difficile de distinguer, des deux côtés de l’Atlantique, ce qui relevait de la rhétorique et ce qui traduisait une véritable intention.
Le soir même de sa victoire électorale, le 23 février, le futur chancelier allemand Friedrich Merz appelait à une « indépendance » vis-à-vis de l’Amérique de Trump et alertait sur un possible éclatement de l’OTAN — tout en annonçant que les dépenses de défense seraient désormais exclues des règles budgétaires restrictives imposées par la loi sur la dette en Allemagne.
Mais si plusieurs dirigeants européens évoquaient l’autonomie stratégique de l’UE vis-à-vis des États-Unis, il s’agissait moins d’un véritable objectif commun que d’un discours destiné à préparer l’opinion publique à la remilitarisation — et à la nécessité d’accroître le soutien militaire à l’Ukraine. Compte tenu de l’impossibilité pour l’UE de remplacer, dans la décennie à venir, les capacités américaines en matière de renseignement, d’aviation ou de puissance navale, des pays comme la Pologne et les États baltes partaient du principe que Washington resterait le garant ultime de leur sécurité.
Par ailleurs, Friedrich Merz comme son prédécesseur Olaf Scholz ont exclu toute nouvelle opération de transferts financiers européens sur le modèle de NextGeneration, qui permettrait de financer une expansion significative de la base industrielle de défense du continent. Le plan ReArm Europe, proposé par la Commission européenne pour un montant de 800 milliards d’euros, prévoit en effet de faire peser l’essentiel du fardeau (650 milliards) sur les budgets nationaux — déjà lourdement endettés — en activant une clause temporaire de dérogation de quatre ans aux règles budgétaires de l’UE pour les dépenses de défense.
Pedro Sánchez, de son côté, est resté discret sur la campagne de réarmement engagée par l’Union européenne. Il a choisi de ne pas participer à certains événements comme le sommet de la « coalition des volontaires » organisé à Kiev lors du Jour de la Victoire, le mois dernier, afin d’éviter d’attirer l’attention médiatique sur un sujet qui ne suscite pas le même soutien populaire en Espagne qu’ailleurs sur le continent. En coulisses, il tente un exercice d’équilibre délicat : maintenir la cohésion de sa majorité gouvernementale, tout en s’adaptant à l’évolution des lignes dominantes au sein de l’UE.
Représentant de centre gauche dont l’approche du pouvoir est intimement liée aux structures multilatérales européennes, Sánchez n’a pas remis en cause de manière frontale la course au keynésianisme militaire dans laquelle s’est lancé le bloc durant les premiers mois de la présidence Trump. Il a plutôt cherché à préserver les acquis de sept années de dépenses sociales expansionnistes, en plaidant pour davantage de flexibilité dans les engagements propres à l’Espagne dans le cadre du plan ReArm Europe. Il a également insisté sur le fait que les nouveaux niveaux de dépenses militaires devaient « rester compatibles avec les responsabilités sociales, environnementales et internationales des États membres ».
Sánchez a aussi défendu à plusieurs reprises l’idée d’un élargissement du concept de sécurité autour duquel s’articule le plan ReArm Europe — en y intégrant notamment des investissements dans les infrastructures critiques, la défense civile ou encore la cybersécurité. À certains moments, notamment à l’approche du sommet du Conseil européen de mars, cette insistance a donné lieu à de véritables tentatives pour rééquilibrer les priorités budgétaires de l’UE, au nom des besoins spécifiques des pays d’Europe du Sud en matière de sécurité. Mais ce discours lui a aussi permis, sur le plan intérieur, d’atténuer la polémique autour des nouvelles dépenses militaires annoncées en avril — en présentant une hausse historique du budget de l’armée sous des atours technocratiques et rassurants.
Contradictions de l’Union européenne
Selon Enric Juliana, chroniqueur de La Vanguardia, à la suite du sommet européen de mars — où sa proposition d’élargir les priorités du plan ReArm Europe avait été rejetée — Sánchez estimait encore possible de négocier une forme d’« exemption espagnole » partielle, permettant de limiter l’ampleur du programme de réarmement. Mais à l’approche du sommet de l’OTAN de juin, et alors que la pression de l’administration Trump s’intensifiait dès le début du mois d’avril, son entourage préparait déjà un virage vers une hausse des dépenses militaires — geste perçu comme un signal d’ouverture à destination de Washington, tout en permettant de sonder la réaction de l’opinion publique et des alliés parlementaires du PSOE.
Les tensions avec les États-Unis avaient atteint un pic en avril, lorsque Pedro Sánchez rencontra le président chinois Xi Jinping la même semaine que Donald Trump proclamait la mise en place de nouveaux droits de douane mondiaux, lors du « Jour de la Libération ». Le chef du gouvernement espagnol s’est imposé comme l’un des plus fervents défenseurs, au sein de l’UE, d’un rapprochement diplomatique et commercial avec la Chine, perçu comme un contrepoids stratégique à l’influence américaine. Mais à la veille de cette rencontre, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait averti que la position de Sánchez revenait à « se trancher la gorge » — avant de faire pression sur le ministre espagnol des Finances, Carlos Cuerpo, lors d’une réunion tendue à Washington, pour qu’il s’engage clairement sur les dépenses de défense.
Dix jours après son déplacement à Pékin, et vingt-quatre heures après l’annonce du décès du pape François, Sánchez dévoilait une hausse historique du budget militaire, à hauteur de 10,4 milliards d’euros. Ce plan visait à faire passer, dès cette année, les dépenses militaires espagnoles à 2 % du PIB — objectif fixé de longue date par l’OTAN, mais initialement prévu pour 2029. Cette décision marque une accélération spectaculaire de l’effort de défense (soit une hausse de 50 % par rapport au budget 2024), tout en intégrant près de 5 milliards d’euros de dépenses liées à la « sécurité » au sens large, dont une bonne partie ne rentre pas dans la définition strictement militaire adoptée par l’OTAN. Des engagements comme les 1,75 milliard destinés à la gestion des catastrophes naturelles et des urgences civiles semblaient taillés sur mesure pour rendre le paquet budgétaire acceptable — quoique sous protestation — par le partenaire de coalition de gauche du PSOE, Sumar.
La vice-présidente Yolanda Díaz, cheffe de file de Sumar, s’est contentée de critiques mesurées et n’a à aucun moment remis en cause la présence de sa formation au sein du gouvernement. Pourtant, la grogne montait dans ses rangs. Izquierda Unida, composante communiste de la coalition, exprimait « son rejet absolu de la décision prise en Conseil des ministres », affirmant qu’elle « ne correspondait pas à l’esprit dans lequel ce gouvernement avait été formé en 2023 ». Le lendemain, elle menaçait de quitter l’exécutif (où elle détient un portefeuille ministériel) après la révélation d’un contrat passé par le ministère de l’Intérieur pour l’achat de quinze millions de munitions auprès d’une entreprise israélienne.
Face à cette menace, Sánchez fit rapidement annuler le contrat en question, assurant ne pas en avoir eu connaissance. Mais l’incident soulignait déjà une contradiction majeure dans sa doctrine de sécurité. Alors même que Sánchez insistait sur le fait que seuls 19 % de la nouvelle enveloppe seraient consacrés à l’achat d’armes, et mettait en avant les investissements dans les télécommunications ou les infrastructures numériques, El País révélait que les 700 millions prévus pour la modernisation des radios militaires iraient à un consortium comptant la société israélienne Elbit parmi ses membres. Depuis le début de la guerre à Gaza, Sánchez s’est distingué comme l’un des dirigeants européens les plus critiques à l’égard d’Israël — allant jusqu’à qualifier l’État hébreu de « génocidaire » le 14 mai. Pourtant, son ministère de la Défense continue de signer des contrats avec des entreprises israéliennes lorsque, selon lui, aucune alternative n’est disponible. Une tendance qui risque fort d’être amplifiée par la brusque montée en puissance des dépenses militaires.
Et les contradictions ne s’arrêtent pas là. L’ampleur de la hausse budgétaire — 10,4 milliards d’euros pour la défense et la sécurité — met déjà à mal la promesse explicite de Sánchez de « ne pas retirer un seul centime des dépenses sociales ou environnementales ». Pour éviter une crise gouvernementale, la révision budgétaire permettant d’absorber ces nouveaux crédits militaires n’a pas été soumise au vote du Parlement — décision justifiée par le fait qu’elle ne consistait qu’en une réaffectation de fonds déjà approuvés. Selon l’exécutif, cet argent proviendrait, entre autres, d’une hausse des recettes fiscales, de gains d’efficacité, mais aussi d’une enveloppe de fonds européens NextGeneration non encore utilisés — initialement destinés à financer des priorités comme la transition énergétique.
Lignes de crêtes
Ironiquement, c’est quelques jours après avoir annoncé cette hausse massive des dépenses militaires que l’Espagne a subi la pire panne de courant du continent Europe depuis plusieurs décennies — causée par les fragilités de son réseau électrique privatisé et par le manque d’investissements dans des mégabatteries coûteuses, pourtant devenues nécessaires avec l’essor du secteur des renouvelables. Si le resserrement budgétaire auquel est confronté le gouvernement Sánchez ne s’est pas encore traduit par des coupes franches dans l’État social ou dans les dépenses vertes déjà engagées, il limite d’ores et déjà les marges d’expansion future dans ces domaines — d’autant que, avec une majorité parlementaire aussi fragile, l’exécutif a peu de chances de faire adopter les réformes fiscales progressistes pourtant inscrites dans l’accord de coalition.
L’engagement des 5 % que l’OTAN compte faire entériner la semaine prochaine rendrait la situation encore plus intenable. La pression sur Sánchez s’est accentuée au cours du dernier mois, alors que responsables américains et hauts fonctionnaires de l’Alliance atlantique redoublaient d’injonctions. En mai, le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte déclarait que l’Espagne « atteindrait sans aucun doute » l’objectif des 5 %. Une semaine plus tard, après une rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, le secrétaire d’État américain Marco Rubio publiait un communiqué exhortant « l’Espagne à rejoindre ses alliés en allouant 5 % de son PIB à la défense ».
Alors que les dirigeants européens cherchent un moyen de satisfaire les nouvelles exigences fixées par Donald Trump pour garantir la poursuite du parapluie militaire américain, le débat qui précède le sommet de l’OTAN se concentre désormais sur le calendrier à adopter pour atteindre l’objectif des « 3,5 + 1,5 % ». Rutte milite pour une échéance stricte de sept ans, avec des objectifs obligatoires chaque année ; le Canada et plusieurs pays d’Europe occidentale plaident pour un délai de dix ans, assorti d’une plus grande souplesse sur le rythme des hausses annuelles.
L’Espagne demeure le seul État à avoir exprimé publiquement son opposition à l’objectif global — tout en cherchant, en coulisses, à négocier une déclaration finale suffisamment ambivalente pour pouvoir la signer sans provoquer de crise politique intérieure. Mais même avant que n’éclate un scandale de corruption au sein du PSOE, compromettant la stabilité immédiate de l’exécutif, ses alliés à gauche avaient déjà haussé le ton : Izquierda Unida menaçait une nouvelle fois de quitter la coalition. « Si l’Espagne accepte le réarmement brutal exigé par Trump, il sera impossible pour Izquierda Unida de rester au gouvernement », tweetait le dirigeant communiste Enrique Santiago le 7 juin. Ione Belarra, cheffe de Podemos, interpellait quant à elle le chef du gouvernement en séance parlementaire : « Vous n’avez pas le courage de dire non à Donald Trump. »
Mais après avoir reçu, mercredi dernier, le projet final de déclaration conjointe rédigé par Rutte — d’un ton inflexible —, en pleine crise politique, Sánchez a publié une lettre ferme rejetant la cible des 5 % et annonçant que l’Espagne n’augmenterait pas davantage ses dépenses militaires. Dans ce texte, pour la première fois, il s’en prend au fondement même du nouveau keynésianisme militaire : l’idée selon laquelle une hausse des dépenses d’armement, même financée par des coupes dans d’autres budgets publics, pourrait générer un stimulus économique global. À rebours de cette logique, il soutient que le plan de Rutte « accentuerait la fuite de l’épargne européenne vers les marchés étrangers » et freinerait la croissance en « détournant les investissements d’activités cruciales à effet multiplicateur supérieur à celui de l’industrie de défense (comme l’éducation, la santé, ou les technologies numériques) ».
Sánchez espère désormais que d’autres États hostiles à l’objectif des 5 % fassent entendre leur voix lors du sommet de l’OTAN — et compte sur une éventuelle confrontation avec Donald Trump pour ressouder sa base électorale, actuellement démoralisée. L’affaire de corruption, qui implique les deux derniers secrétaires à l’organisation du PSOE, a provoqué une crise de confiance dans son leadership, tant au sein du parti que dans l’électorat progressiste. Mais sa capacité à tenir tête à la diplomatie brutale de Trump pourrait représenter un tournant politique majeur, en lui permettant de défendre l’idée que la cible des 5 % devrait rester facultative.
Deux ans plus tôt, lorsque la coalition gouvernementale avait été reconduite à la surprise générale, l’Espagne était présentée comme une exception dans une Europe basculant vers la droite. Sánchez, en particulier, apparaissait comme un dirigeant progressiste bon teint parvenant à se maintenir grâce à une alliance avec des forces situées à sa gauche. En politique étrangère, il s’est également distingué en condamnant le génocide à Gaza et en refusant de céder à l’hystérie guerrière contre l’Iran. Mais à mesure que le réarmement devient la nouvelle norme du consensus européen, sous l’impulsion de Trump, la marge de manœuvre de Sánchez ne cesse de se réduire.
Cet article est initialement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « Spain Is Right to Reject Increased Military Spending »