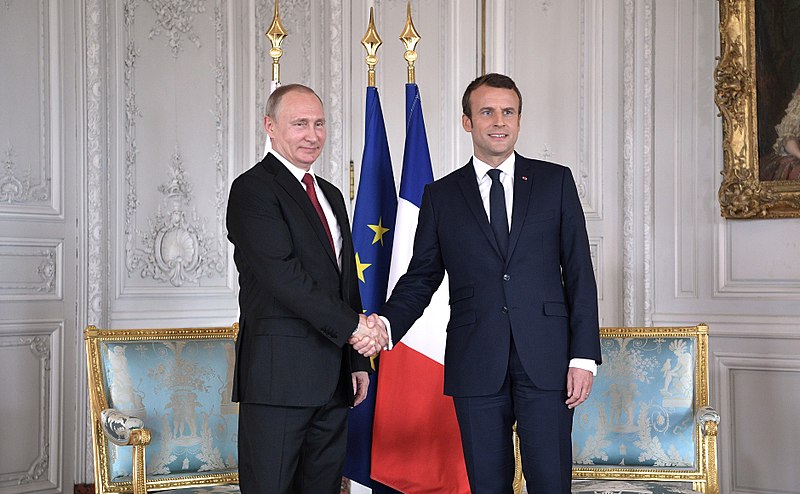Journaliste d’investigation, Marc Endeweld s’est spécialisé dans la révélation des coulisses des mondes économiques et politiques. Avec Le Grand Manipulateur, son deuxième ouvrage sur Emmanuel Macron, il met en lumière les multiples réseaux activés par Emmanuel Macron dans sa quête de l’Élysée. Entretien réalisé par Lenny Benbara, retranscrit par Vincent Ortiz.
LVSL – À la fin de votre second livre sur Emmanuel Macron, vous évoquez le « château de cartes » fragile sur lequel il reposerait. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce « château de cartes » et sur sa fébrilité ?
Marc Endeweld – C’est une manière de mettre en évidence qu’Emmanuel Macron ne s’est pas construit tout seul, contrairement à ce qu’il avance, mais avec l’aide de différentes cartes. Quand Emmanuel Macron se lance à l’assaut de l’Élysée, il n’a ni expérience politique, ni expérience élective. Ne disposant pas d’un parti politique traditionnel, il a investi les réseaux au cœur même de l’État français, et pas uniquement à Bercy ou même ceux du monde économique dont il est issu, mais également à la Défense, dans la diplomatie, dans le renseignement, la sécurité, etc. L’homme qui s’est présenté comme celui du nouveau monde s’est en réalité fortement appuyé sur l’ancien monde.
« Cette absence de parti traditionnel est aujourd’hui sa plus grande faiblesse : désormais à l’Élysée, Emmanuel Macron est un homme seul, avec et face à ces réseaux. »
Pourquoi j’utilise cette image du « château de cartes » ? Parce que si ce réseautage intense lui a permis de mener à bien son ambition personnelle, il ne lui a pas permis de construire réellement une ambition collective : il n’a pas eu le temps, de par son jeune âge politique, de constituer ses propres réseaux, et a donc utilisé les réseaux des autres, de ses concurrents. Certes, de cette manière, il est notamment parvenu à assécher la concurrence autour de lui, en affaiblissant de l’intérieur François Hollande, puis Manuel Valls. Mais cette absence de parti traditionnel est aujourd’hui sa plus grande faiblesse : désormais à l’Élysée, Emmanuel Macron est un homme seul, avec et face à ces réseaux. Notamment, parce qu’en l’absence d’un vrai parti, et de ministres avec un vrai poids, il n’existe pas de tampon entre l’Élysée et certaines personnes qui ont pu lui rendre service au cours de son ascension, comme on a pu s’en apercevoir lors du surgissement de l’affaire Benalla au cours de l’été 2018.
Cette fragilité, on la retrouve au cœur même de sa campagne présidentielle. À partir de février 2017, Macron est devenu le favori, et ce n’est qu’à ce moment là que tous sont venus à lui. Tous les réseaux institutionnels qui parcourent l’État – lobbyistes, réseaux d’influence –, mais aussi les réseaux de l’ombre de la Vème République – la sécurité, le renseignement, la Françafrique – sont tous venus lui proposer leurs services. Finalement, même quand ils s’étaient opposés à lui les mois précédents, ils sont tous allés à Canossa pour éviter Marine le Pen ou… éliminer François Fillon.
Macron apparaissait alors comme la meilleure personne pour représenter les intérêts de tous ces réseaux. Dans ce schéma, quand une difficulté politique survient par la suite, de tels réseaux et intérêts peuvent rapidement retirer ou amenuiser leur soutien, ou, ce qui revient au même, renforcer leurs pressions à l’égard d’Emmanuel Macron. Je finis ainsi mon livre sur les coulisses des derniers mois du pouvoir face aux Gilets jaunes. Lors de l’acmé de ce mouvement inédit – en décembre 2018, où la fonction présidentielle a été touchée, au sens propre comme au sens figuré – Macron n’a en réalité pas uniquement peur de la violence des Gilets jaunes ; il a peur car il se rend compte qu’une partie de ses soutiens, dans le monde économique, ou au sein de l’État, pourrait le lâcher.
« Si Macron, un jour, est éjecté du pouvoir, il perdra une bonne partie des réseaux qu’il a pourtant utilisés sans vergogne pour arriver jusque-là. »
Certes, une partie de ses soutiens continue de souhaiter la mise en place de contre-réformes néolibérales extrêmement dures à l’égard de la population, mais encore faut-il les faire passer avec le sourire, et dans la bonne humeur ! Et au cœur même de l’oligarchie, certains s’aperçoivent que le pays n’est tout simplement pas prêt à ces projets « d’économies », et surtout que le président de la République n’est pas apte à les faire passer. Entre le « monsieur économie » du président Hollande, et le patronat, le charme est en tout cas rompu. Au cours de l’hiver, on observe ainsi en coulisses, toute une frange du monde économique, y compris des grands patrons, prendre leurs distances avec Macron. C’est encore imperceptible dans l’espace public, car ces acteurs économiques ne trouvent aucune alternative institutionnelle au Président. Mais il ne faut pas croire que Macron est ultra-puissant face à ces réseaux économiques ; il l’est du fait des institutions de la Vème République, mais il ne faut pas sous-estimer les luttes internes à l’État, dans la haute administration, et au sein du capitalisme français, y compris dans les différents champs du pouvoir autour d’Emmanuel Macron : pouvoir économique, pouvoir médiatique, et même pouvoir culturel.
Il ne faut jamais oublier que le premier « président des riches », Nicolas Sarkozy, avait perdu une bonne partie de ses soutiens économiques en 2012. Même un grand patron proche de lui, Martin Bouygues, propriétaire de TF1, avait alors décidé de ne pas le soutenir dans sa tentative de réélection. C’est aussi la raison pour laquelle je termine sur cette métaphore du château de cartes : si Macron, un jour, est éjecté du pouvoir, il perdra une bonne partie des réseaux qu’il a pourtant utilisés sans vergogne pour arriver jusque-là.
LVSL – Au cours de cette enquête sur le personnage Macron et ses réseaux, vous mettez en avant la logique de séduction. On a du mal à réaliser par quelle manière elle se fait, et comment des acteurs aussi variés n’ont pas pu se rendre compte que Macron disait à chacun ce qu’il voulait entendre. Comment cette ambiguïté a-t-elle pu être aussi efficace ?
Marc Endeweld – Il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Une dimension psychologisante d’abord. L’ambition d’Emmanuel Macron repose en effet sur une bonne dose de narcissisme personnel, mais cela n’est pas suffisant pour expliquer sa trajectoire fulgurante. En fait, dès son plus jeune âge, il a réussi à se hisser très vite en sachant activer le narcissisme de ses interlocuteurs. Tout au long de son parcours, il n’a eu de cesse de tendre un beau miroir à ses interlocuteurs, notamment vis-à-vis des plus âgés. Une méthode qu’il a utilisée dans plusieurs lieux de pouvoir qu’il a traversés : inspection générale des Finances, commission Attali, banque Rothschild. Macron n’agit pas dans une séduction qui serait naturelle mais plutôt dans un calcul froid et sans affect. C’est un très bon acteur, comme s’en sont aperçus un peu tard à leurs dépens ses congénères.
Dans son ascension vers le pouvoir, sa stratégie la plus redoutable aura ainsi été de contourner les apparatchiks, qui ont entre 40 et 50 ans dans les différentes structures, et notamment dans les partis politiques traditionnels, pour récupérer le plus vite possible les manettes. Quand j’enquêtais sur lui pour mon premier livre (L’Ambigu Monsieur Macron, 2015, 2018), il m’avait confié : « je ne me vois pas à 60 ans faire de la politique ». Manière pour lui de dire qu’il était très pressé, et qu’il visait déjà la plus haute marche. C’était la période où il expliquait que l’élection à la députation était « un cursus d’un ancien temps ». Concrètement, pour arriver à ses fins, il a en fait séduit les plus vieux représentants des différents systèmes de pouvoir qu’il a côtoyés. Parmi ces « vieux », une partie était justement en train de sortir de leur position dominante dans leurs différents secteurs sans avoir trouvé véritablement d’héritiers. Macron a joué et a profité à plein de cette bascule générationnelle entre les générations d’après-guerre et les enfants de mai 1968. Alain Minc ironise souvent en expliquant que Macron est un « séducteur de vieux ». Mais son intérêt pour les plus anciens n’est pas gratuit. Il les a en effet séduits pour récupérer leurs réseaux, leur carnet d’adresse, leur influence, leur expérience. Par cette proximité avec ces « anciens », il a ainsi emmagasiné énormément de capital, de pouvoir. Mais dans le même temps, il a dû utiliser des plus jeunes que lui, des petites mains, corvéables à merci, qui ne lui contestaient rien, pour pouvoir assurer une grande charge de travail. Le génie de Macron réside principalement dans cette gestion de la ressource humaine dans son entourage.
C’est l’un des aspects du management du pouvoir macronien : en économie, comme en politique, il a toujours utilisé les plus anciens – on retrouve ainsi de nombreuses figures de la Vème République dans la macronie de l’ombre, comme Michel Charasse, ancien ministre de François Mitterrand, qui est l’un des visiteurs du soir d’Emmanuel Macron, ou Hubert Védrine qui le rencontrait dès 2012 à l’Élysée. Dans le même temps, il nomme et promeut, au sein du gouvernement et dans les cabinets, des très jeunes sans expérience. On pense à Gabriel Attal par exemple, passé de simple collaborateur de cabinet à secrétaire d’État, sans avoir connu une quelconque expérience professionnelle. Car Macron ne supporte pas qu’une tête puisse le dépasser, et au final, il préfère favoriser la médiocrité. Son seul objectif est le contrôle.
Sa stratégie du « beau miroir » a fonctionné à fond sur le terrain politique. C’est ce qui explique principalement le quiproquo général derrière l’ambigu Monsieur Macron, tant sur la composante de sa matrice idéologique que sur sa pratique du pouvoir. Tous ses soutiens – de François Bayrou à la « deuxième gauche », en passant par Jean-Pierre Chevènement – ont en effet projeté sur lui leur identité politique, leurs présupposés idéologiques. En 2017, bien peu se souciait alors de la cohérence de l’ensemble, bien que le rassemblement de toutes ces traditions politiques pouvait déjà sembler hasardeux, du moins au niveau de l’organisation de l’État. Mais, à l’époque, le discours contre les « extrêmes » a joué à plein, réduisant le débat politique et le combat pour le pouvoir à la préservation des intérêts sociologiques du bloc bourgeois. Tous ont cru à une grande alliance des « centres ».
Car, au fond, quel est le point commun entre la deuxième gauche rocardienne et le chevènementisme ? On me rétorquera que durant longtemps le Parti Socialiste ou les partis de droite ont rassemblé des traditions politiques très différentes, sauf qu’elles étaient insérées dans des projets globaux et plus ou moins collectifs. L’illusion de tous ces vieux acteurs de la politique est d’avoir cru qu’un homme providentiel pouvait les dispenser d’une reconfiguration idéologique et d’une actualisation programmatique, au regard des mutations de la société française, et avec la prise en compte les clivages sociaux qui la traversent. C’est l’autre intuition de Macron, ou son cynisme : en économie, il n’y a, pense-t-il, qu’une voie possible, celle du néolibéralisme. C’est le TINA de Thatcher, bien que les macroniens s’en défendent. De ce point de vue là, Macron est aussi la créature d’un PS totalement dévitalisé et acquis aux règles de la globalisation. À sa décharge, ce sentiment diffus se retrouvait depuis une vingtaine d’années à travers l’ensemble de l’arc institutionnel de la droite à la gauche. Et de cet affaiblissement idéologique, notamment parmi les héritiers de la social-démocratie, Macron a su en tirer tous les bénéfices pour sa propre ambition.
« Emmanuel Macron, c’est un peu le « qui m’aime me suive ». C’est d’ailleurs son péché originel lors de sa victoire de 2017 : celui de ne pas avoir cherché à former une véritable coalition politique entre différentes sensibilités et différents partis politiques, à la manière de ce qui se pratique dans des régimes parlementaires comme en Allemagne ou en Italie par exemple. »
Dans un premier temps, et notamment au cours de la campagne électorale, ces représentants de « l’extrême centre », comme le journaliste Jean-François Kahn, soutien de Bayrou, et promoteur d’un « centrisme révolutionnaire » bien flou, ont littéralement été séduits par le télé-évangéliste Macron avec ses discours fourre-tout, œcuméniques. Mais pour beaucoup aujourd’hui, c’est la douche froide : car ils n’avaient pas compris que Macron était, au fond, un césariste, un bonapartiste, dans la plus pure tradition autoritaire à la française.
Emmanuel Macron, c’est un peu le « qui m’aime me suive ». C’est d’ailleurs son péché originel lors de sa victoire de 2017 : celui de ne pas avoir cherché à former une véritable coalition politique entre différentes sensibilités et différents partis politiques, à la manière de ce qui se pratique dans des régimes parlementaires comme en Allemagne ou en Italie par exemple. Au contraire, il a misé sur la destruction, sur l’affaiblissement structurel de l’arc politique institutionnel, l’amenant à croire faussement qu’il était majoritaire dans le pays, et lui permettant de bénéficier de l’absence d’une opposition en bonne et due forme. Au cœur même de la crise des gilets jaunes, un ancien ministre de Jacques Chirac m’avait partagé le constat suivant que je trouve très pertinent : « le drame de Macron, c’est qu’il dispose de la légitimité constitutionnelle, mais qu’il ne dispose plus de la légitimité politique ».
Mais Macron n’est pas seulement apparu séduisant parce qu’il portait un « beau miroir ». Il ne faut pas croire que derrière la tactique politique, son machiavélisme, sa grande capacité à manipuler, et sa soif de reconnaissance et de séduction, ne se loge pas une dimension proprement idéologique. Selon moi, si Macron a autant pris parmi les dominants, c’est qu’il a réussi, par son discours, son image, à ré-instaurer auprès des élites politico-financières une croyance vaine dans le système.
Après la crise financière de 2008, après le référendum européen de 2005, Macron se plaisait à parler de nouveau d’Europe fédérale, voire d’Europe « puissance », sans dévoiler réellement ses cartes pour y arriver, en dehors de sa volonté de répondre aux injonctions européennes pour finir de bouleverser les dernières régulations sociales issues du Conseil National de Résistance, notamment contre les protections sociales, les services publics, l’assurance chômage. Dès juillet 2015, le ministre Macron avait d’ailleurs confié lors d’une rencontre organisée à Bercy qu’il « n’aimait pas le terme de modèle social » ! Son projet est bien de liquider le compromis de l’après guerre, soit disant pour reconstruire quelque chose, mais en réalité, il n’en est rien. Il s’agit de « s’adapter » toujours plus au moins disant social. Au nom de l’Europe ! Et au nom de « l’efficacité » !
« Ces élites n’attendaient finalement qu’un homme fort – un homme qui tape du poing sur la table et se présente comme le roi que les Français attendent selon eux, comme Macron l’a lui même affirmé lors d’une interview. Il n’est pas surprenant que les mêmes, aujourd’hui, regardent de manière complaisante ce qui se produit au Brésil, avec Bolsonaro. »
Peu importe les dégâts pour Macron finalement, lui a le « courage » pense-t-il d’aller au bout du rêve de tous ces néolibéraux des années 1990, qui après le référendum de 2005 et la crise de 2008, continuaient à porter leur néolibéralisme d’une manière relativement honteuse en France. Macron est apparu comme la personne qui allait retrouver le sens de la mondialisation heureuse, pour reprendre le mantra d’Alain Minc. Il a énormément utilisé cette plus-value idéologique auprès de toutes ces élites. Elles ont été formées comme lui, dans la doxa de Bercy, et étaient depuis bien longtemps dans une sécession par rapport au cadre démocratique, et dans une pulsion d’autorité. Ces élites n’attendaient finalement qu’un homme fort – un homme qui tape du poing sur la table et se présente comme le roi que les Français attendent selon eux, comme Macron l’a lui même affirmé lors d’une interview. Il n’est pas surprenant que les mêmes, aujourd’hui, regardent de manière complaisante ce qui se produit au Brésil, avec Bolsonaro. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus la capacité de conviction que Macron a su développer plus globalement vis-à-vis des fameuses classes « éduquées » que raille à juste titre Emmanuel Todd, repliées comme il s’en désespère dans une forme de crétinisation, et se réfugiant, à tout prix, dans leur cocon de la « construction européenne », et sans aucun recul critique.
LVSL – La stratégie de Macron était donc fondée sur une capacité à croiser des réseaux en apparence concurrents. Vous décrivez comment il s’est appuyé sur certains réseaux de la Sarkozie dans un certain nombre de secteurs de l’État – en particulier la place Beauvau à laquelle il avait difficilement accès, venant de Bercy –. Pouvez-vous revenir sur cette manière qu’il possédait de se mouvoir au sein de l’État et d’en prendre le contrôle de pans entiers ?
Marc Endeweld – Venant de la finance, il a continué à se comporter comme un banquier d’affaires dans la sphère politique. En l’absence de parti politique historique, dont il ne disposait pas, il a méthodiquement récupéré les réseaux de ses concurrents, parfois avec l’accord tacite de ces derniers qui préféraient abandonner, parfois en procédant à des OPA hostiles dans leur dos. Il a récupéré les hommes, mais aussi la logistique, et parfois les moyens financiers. Bien sûr, Emmanuel Macron a eu une chance extraordinaire en 2017. Mais il a également suscité sa chance par rapport à tous ces réseaux, notamment en asséchant en amont la concurrence.
Dans cette stratégie méthodique, il a été sans scrupules. Emmanuel Macron n’a pas hésité à utiliser tous les réseaux de la droite, et notamment une bonne partie des réseaux de la Sarkozie. Le rapprochement entre l’actuel président et l’ancien président, que l’on constate depuis quelques mois, trouve en réalité son explication dans les proximités qu’Emmanuel Macron a cultivé depuis son passage à la banque Rothschild, et par le réseautage qu’il a exercé avec sa femme, Brigitte Macron, dès son arrivée à l’Élysée comme collaborateur de François Hollande. Sans complexe, dans son ascension, Macron a utilisé une partie des réseaux de Nicolas Sarkozy, et de la droite. Aujourd’hui, comme durant la dernière ligne droite de la campagne, ces deux grands fauves de la politique sont en réalité alliés objectifs. Ils s’instrumentalisent mutuellement, mais s’entraident également, alors même que Nicolas Sarkozy fait l’objet de plusieurs mises en examen par la justice.
« Dans sa pratique du pouvoir, Macron est en fait un anachronisme, c’est un jeune vieux. »
Résultat, après plus de dix ans d’anti-sarkozysme dans l’espace politique, porté notamment par les socialistes ou par François Bayrou, le discours sur la moralité politique, et la lutte contre la corruption, s’est trouvé, dans les faits, remis au placard par le « en même temps ». Par ambition politique, mais aussi par souci d’efficacité économique, Macron n’a que faire de nettoyer les vieux réseaux, et de transformer durablement les mauvaises habitudes de la pratique du pouvoir à la française, dans le cadre de notre monarchie présidentielle à bout de souffle. Dans les domaines purement régaliens – la diplomatie, la défense, le renseignement, la sécurité – Macron s’est d’ailleurs principalement appuyé sur la génération précédente, issue notamment de la cohabitation Mitterand-Balladur dans les années 1990. Une génération politique dont la pratique du pouvoir, fondée sur l’opacité et la realpolitik, cadre mal effectivement avec l’image du « nouveau monde ». Dans sa pratique du pouvoir, Macron est en fait un anachronisme, c’est un jeune vieux.
De ce point de vue là, sa pratique du pouvoir est en fait une rupture nette avec l’histoire récente du Parti socialiste qui avait tenté avec Lionel Jospin le fameux « droit d’inventaire » de la part d’ombre du mitterandisme, et s’était démarqué par la suite de la droite française en développant un discours sur « la République exemplaire ». Discours que Macron avait repris à son compte durant sa campagne, pensant séduire les électeurs de centre-gauche peu a l’aise avec la notion même de pouvoir. Après leur défaite de 2002, les socialistes s’étaient en effet construits dans « l’anti-sarkozysme », critique finalement un peu fourre-tout, notamment mise en avant par François Hollande, promouvant une rhétorique selon laquelle la Sarkozie représentait un danger pour la démocratie. C’est tout le discours porté notamment par le PS durant des années sur la droite « bling bling », la soirée du Fouquet’s, et le yacht de Bolloré…
Personnellement, Macron ne s’est jamais inscrit dans cette critique anti-sarkozyste. D’abord pour des raisons personnelles, que j’ai découvertes : jeune énarque, puis chez Rothschild, il baignait autant dans les réseaux de droite, sarkozystes comme anti-sarkozystes, que dans les réseaux PS. C’était alors le chouchou de Jean-Pierre Jouyet, lui-même au centre de tous ces réseaux, et ancien secrétaire d’État de Nicolas Sarkozy. C’est à cette époque que Macron rencontre le grand patron Bernard Arnault qui n’a jamais caché ses sympathies sarkozystes. Le communicant Franck Louvrier, ex conseiller de Nicolas Sarkozy, est ainsi venu l’aider à plusieurs reprises lors de réunions secrètes à l’Élysée au début du quinquennat Hollande pour travailler sur son image publique !
Macron a donc autant construit ses réseaux dans la droite que dans la gauche institutionnelle. Politiquement, on pourrait même dire qu’il est le bébé de cette couverture de Paris-Match où François Hollande et Nicolas Sarkozy posaient ensemble pour promouvoir le « oui » au référendum de 2005. Ensuite, d’un point de vue plus structurel, de contrôle de l’État, il a effectivement utilisé les réseaux sarkozystes, dans le domaine du renseignement, de la sécurité et de la défense notamment, pour contourner les réseaux de François Hollande et de Manuel Valls. Il a donc utilisé certaines figures de la Sarkozie pourtant honnies par une bonne partie des militants et électeurs socialistes, ou mis en accusation durant des années dans la presse de gauche. Macron, n’étant pas issu du Parti socialiste et n’étant pas tributaire de l’histoire de ce parti, a donc utilisé sans scrupules la droite à Beauvau, au Quai ou à Brienne, sans plus se poser de questions, notamment quant aux réseaux que l’on trouvait derrière. C’est aussi par ce cynisme qu’il a acquis le pouvoir en 2017.
LVSL – Concernant les questions financières, vous évoquez dans votre livre un certain nombre de réseaux, notamment ceux de la Françafrique. Pouvez-vous revenir sur les liens entre Emmanuel Macron et ces réseaux ?
Marc Endeweld – Le point de départ de l’enquête était le suivant : depuis l’accession au pouvoir d’Emmanuel Macron, j’avais plusieurs signaux faibles qui m’interpellaient sur les frontières de plus en plus poreuses entre la Macronie, la Sarkozie, et par ailleurs certains réseaux politiques de l’ombre, que l’on pourrait qualifier d’affairistes – les fameux intermédiaires de la République. Ce qui m’a frappé dès le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, contrairement au discours qu’il portait sur la République exemplaire, sur l’homme aux mains propres, j’ai été très étonné de constater que tous les acteurs traditionnels de la part d’ombre de la Vème République, tous les réseaux secrets de la Vème République, se retrouvaient en nombre autour d’Emmanuel Macron. Il n’y avait pas seulement, comme ses communicants et certains journalistes l’ont mis en scène, les jeunes strauss-kahniens de la « bande de la Planche ». Il a nommé au sein de l’État de nombreuses personnalités issues de la Chiraquie, de la Sarkozie, etc. Ce n’étaient pas des signaux de renouvellement de la vie politique, bien au contraire. L’autre aspect frappant, c’était de voir que sa pratique politique était très liée au secret, notamment d’un point de vue diplomatique, et qu’il avait une pratique du pouvoir totalement à l’inverse du discours d’ouverture qui avait marqué sa campagne présidentielle – un discours largement marketing, et qui correspond à toute une nouvelle sociologie électorale : les plus jeunes ont un rapport à la politique et à l’État assez différent de leurs aînés. Désormais au pouvoir, Macron reproduit pourtant les pratiques anciennes de la Vème République où la raison d’État est reine.
« J’ai été très étonné de constater que tous les acteurs traditionnels de la part d’ombre de la Vème République, tous les réseaux secrets de la Vème République, se retrouvaient en nombre autour d’Emmanuel Macron »
Il n’a pas uniquement utilisé les réseaux politiques traditionnels – militants, responsables politiques, etc. – : il a également utilisé ce que l’on appelle les réseaux transversaux de la République, que l’on retrouve dans la Françafrique, dans le complexe militaro-industriel, dans le domaine du renseignement – réseaux que certains nomment « l’État profond » – ; ces réseaux, depuis trente ou quarante ans, ont utilisé et rendu des services au Parti socialiste comme à la droite française. Ces réseaux transversaux, pour une partie d’entre eux, ont été les acteurs du financement de la vie politique française en général.
Dans mon livre, je démontre que les réseaux de la Françafrique, notamment ceux de Sassou-Nguesso au Congo Brazzaville, ont parfois été en contact direct avec Macron, bien en amont de la présidentielle. C’est le cas de l’Algérie également : lors de son voyage à Alger de février 2017, derrière ses déclarations sur « les crimes contre l’humanité » qui ont attiré l’attention des médias, Emmanuel Macron a rencontré en coulisses les réseaux affairistes algériens, alors au pouvoir, sans prendre beaucoup de précautions.
J’ai découvert – et cela m’a surpris – que Macron, qui a été présenté comme l’homme de la « nouvelle économie », ou des grands patrons, n’avait obtenu dans un premier temps, c’est-à-dire à la fin 2016, que cinq millions d’euros pour financer sa campagne. Résultat, il s’est retrouvé face à de graves difficultés financières entre janvier et avril 2017. Sa campagne de collecte de fonds, soit via des dîners avec de riches invités, soit via son portail internet, ne lui avait pas permis de récupérer suffisamment d’argent. Entre janvier et avril 2017, cette difficulté financière a été renforcée par le fait que son équipe de financement avait parié sur l’obtention rapide de prêts bancaires. J’ai découvert qu’il n’avait obtenu ces prêts bancaires que très tardivement, en fin de campagne, quelques jours avant le premier tour. Il y a toute une zone d’ombre entre janvier et avril 2017 sur la manière dont il a pu mener sa campagne.
La justice a ouvert une enquête préliminaire en octobre 2018 sur 144.000 euros de dons suspects – une goutte d’eau sur l’ensemble. La commission de campagne a certifié les comptes, mais quand on annonce qu’aujourd’hui la campagne d’Emmanuel Macron a été rendue possible grâce au financement de 900 grands donateurs, qui ont permis de récupérer 15 millions d’euros environ – une somme importante -, on oublie de dire que la plupart des dons ont été récupérés via le parti, et non via le candidat, et donc à la fois en 2016, mais aussi en 2017 (ce qui était possible en passant par le parti, avec des reversements ensuite vers le candidat), et qu’au plein cœur de la campagne, le candidat Macron a bien dû gérer des problèmes de trésorerie.
« L’objectif de Macron depuis qu’il s’est engagé en 2015 dans la course présidentielle est donc toujours le même : assécher la concurrence, notamment d’un point de vue financier et logistique. »
Aujourd’hui, le président est bien décidé à rester le plus longtemps au pouvoir. « Il est là pour 10 ans », m’a confié dès le début de mon enquête un responsable de la droite. L’objectif de Macron depuis qu’il s’est engagé en 2015 dans la course présidentielle est donc toujours le même : assécher la concurrence, notamment d’un point de vue financier et logistique. Il existe donc actuellement une guerre sourde pour le contrôle effectif de l’État, et dont les vieux réseaux sont le théâtre.
LVSL – Vous décrivez un Macron sans scrupules, avec une pratique du pouvoir verticale et autoritaire différente de ce qu’il avait annoncé ; un Macron plus conservateur, également, que ce qui était attendu, puisqu’on le pensait plutôt clintonien ou blairiste. Sans tomber dans la psychologisation, que pense réellement Macron, et que représente-t-il ?
Marc Endeweld – Macron a pu être présenté dans un premier temps comme social-libéral, clintonien, « le Obama français », etc., qui aurait été la quintessence du libéralisme dans toutes ses facettes : politique, économique et culturel. Mais Macron est pour moi beaucoup plus néolibéral que libéral. Il ne faut jamais oublier que le « néolibéralisme » a une composante autoritaire et anti-démocratique. Dans mes premières enquêtes, je m’étais ainsi aperçu que Macron avait un rapport à l’État beaucoup moins rocardien que l’on avait pu le présenter jusqu’alors ; de lui-même, il m’avait expliqué qu’il considérait que la deuxième gauche avait un rapport « complexé » à l’État. C’est de cette manière qu’il m’avait expliqué son intérêt très précoce pour le chevènementisme : étudiant à Sciences po, il avait en effet participé à plusieurs Universités d’été du Mouvement des Citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Quelques années plus tard à peine, il avait trouvé accueil dans la deuxième gauche, à travers la revue Esprit, mais aussi via Michel Rocard – qu’il avait rencontré via son ami et mentor, Henry Hermand –. Dans mon premier livre, je m’étais notamment intéressé à ce déplacement idéologique apparent, à ce grand écart, à cette ambiguïté.
Effectivement, depuis son élection, il n’a cessé de vouloir restaurer, notamment en termes de communication, la fonction présidentielle. Par rapport à Nicolas Sarkozy ou François Hollande, Emmanuel Macron a un rapport au pouvoir beaucoup moins complexé. On le voit aujourd’hui avec sa pratique très maximaliste de la Vème République, qui comprend des éléments autoritaires. J’avais remarqué très tôt son ambivalence par rapport à la démocratie ; elle se doublait d’ailleurs d’un autre élément : dans l’un des rares articles qu’il avait écrit dans Esprit, « les labyrinthes du politique » (2011), il avait expliqué que sur les questions budgétaires, il assumait une parenthèse démocratique, la dépossession des populations par le cadre supranational européen. Cela dénotait un rapport assez problématique à la souveraineté populaire. Il exprimait à cette occasion une pure posture technocratique sans aucun complexe.
« À gauche, Macron est apparu très vite comme l’incarnation de la haute finance internationale totalement déconnectée des classes populaires. Il a donc été critiqué d’un point de vue identitaire, alors que sa principale ambiguïté politique se situe du côté de la souveraineté, du respect du cadre démocratique. »
Très tôt, à gauche comme à droite, à l’extrême-gauche comme à l’extrême-droite, les critiques se sont multipliées à l’encontre d’Emmanuel Macron et sur ce qu’il pouvait représenter : la quintessence du « progressisme » néolibéral. Une partie de l’extrême-droite avait attaqué Emmanuel Macron sur le fait qu’il était dit « progressiste », donc problématique d’un point de vue identitaire. Lui-même s’est affirmé « progressiste » en se plaçant comme le seul rempart aux « conservatismes » et aux « nationalismes ». À gauche, Macron est apparu très vite comme l’incarnation de la haute finance internationale totalement déconnectée des classes populaires. Il a donc été critiqué d’un point de vue identitaire, alors que sa principale ambiguïté politique se situe du côté de la souveraineté, du respect du cadre démocratique.
Ensuite, quelle est la part de convictions et d’opportunisme chez Macron ? Certes, il y a chez lui beaucoup de cynisme, mais il a de toute évidence de fortes convictions sur les questions économiques : il pense réellement que l’avenir économique de la France passe par l’adaptation forcenée à la globalisation. Par ailleurs, il est séduit par le modèle de développement californien, ou même celui de Dubaï : un modèle de développement hors-sol, financiarisé – d’où sa volonté de faire venir des traders, qui dépasse le simple coup de communication. Il est convaincu que la France, n’étant plus une puissance industrielle, est vouée à devenir une économie de haute valeur ajoutée dans les services, les services financiers, les technologies numériques. C’est la raison pour laquelle il préfère rencontrer les grands patrons des GAFA plutôt que ceux des grandes filières industrielles françaises. De ce point de vue, il est à l’image d’une partie de la droite et du PS qui, depuis quarante ans, ont sciemment sacrifié la filière industrielle française.
Enfin, très tôt, je m’aperçois effectivement qu’Emmanuel Macron est beaucoup plus conservateur que l’image qu’en donnent les médias un peu rapidement. Brigitte Macron, issue de la bourgeoisie traditionnelle d’Amiens, n’y est pas pour rien dans cette influence conservatrice, notamment concernant les questions d’éducation, les questions de société en général. Quand Macron était secrétaire général adjoint de l’Élysée, sous François Hollande, il était ainsi l’un des rares du cabinet à ne pas vouloir faire de la question du mariage pour tous une priorité. Macron pensait que l’objectif premier du quinquennat de François Hollande ne devait pas reposer sur les questions de société, mais sur les questions économiques – sous un angle libéral.
Par rapport à une stratégie néolibérale d’un Tony Blair, qui avait fait monter au Royaume-Uni les minorités et les questions de société pour faire passer la pilule des contre-réformes de casse du droit du travail (avec la multiplication de dispositions punitives contre les chômeurs, mais aussi via la criminalisation des classes populaires comme aux États-Unis), Emmanuel Macron n’a jamais véritablement utilisé cette arme-là. Il est beaucoup plus conservateur et prudent concernant la société multiculturelle, ce qui ne l’empêche pas de jouer parfois avec quelques images, comme Sarkozy bien avant lui. Et dans le fond, même s’il a troqué le jeune de banlieue pour un gilet jaune dans le rôle de « l’ennemi de l’intérieur », ce n’est pas pour autant qu’il a mis en avant les minorités, qui se sentent dans les faits totalement délaissées.
Dès février 2017, Macron, pourtant le chantre de la « bienveillance » en politique, ne s’était pas gêné en pleine campagne pour parler de « tolérance zéro » vis-à-vis de l’insécurité. Il avait également mis l’accent sur l’islamisme et le terrorisme, et était devenu en quelques jours de plus en plus distant à l’égard des questions de migration – comme le début de son quinquennat a achevé de le démontrer. Tout cela était donc déjà en germe durant sa campagne, qu’il avait très tôt prévu de mener « à droite ». Le dernier discours que l’on pourrait qualifier de social-libéral est celui de la porte de Versailles de décembre 2016, alors qu’il doit encore séduire les sympathisants du Parti socialiste. Ce n’est qu’après l’élimination de Manuel Valls aux primaires du PS, qu’il se met à cibler l’électorat de droite le plus conservateur. Il affirme ainsi à l’Obs que les participants à la « manif pour tous » ont été « humiliés » par François Hollande, il donne une longue interview à Causeur, dont il fait la couverture.
Ces ferments-là apparaissent donc dès la campagne. Bien sûr, depuis son élection, on perçoit plus clairement ses inclinations droitières, à travers la criminalisation du mouvement social, la multiplication des lois sécuritaires, l’utilisation de l’appareil policier et de renseignement… même si ce sont des tendances lourdes qui gangrènent notre démocratie depuis une vingtaine d’années en amenuisant peu à peu les libertés individuelles, et qu’elles ont été largement accentuées sous le précédent quinquennat du fait des décisions de François Hollande, Manuel Valls, et Bernard Cazeneuve.
Toutefois, dans le dernier documentaire de Bertrand Delais, La fin de l’innocence, Macron déclare que son projet est bien « national et global », dans le sens de l’adaptation aux standards de la globalisation. Il assume pleinement le terme « national ». Il est à l’aise avec l’autorité de l’État et l’imagerie qui lui est associée. Le lancement du SNU est à replacer dans ce contexte. Macron est donc très éloigné de la conception distanciée de l’État propre à la deuxième gauche ou aux pays anglo-saxons. Il en a une conception autoritaire, qu’on peut retrouver au cœur du néolibéralisme.
Cela ne l’empêche pas de jouer des questions de société et de se servir des fractures identitaires de la société française, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant lui. Exemple avec les dernières élections européennes : dans un premier temps, Macron a envoyé de nombreux signaux aux électeurs de droite, avec succès, ils ont massivement voté pour lui. Mais quelques jours après la publication de résultats attestant du déplacement sociologique de l’électorat d’Emmanuel Macron – d’un électorat sympathisant PS à un électorat sympathisant LR –, le gouvernement a annoncé qu’il allait avancer sur le dossier de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. On retrouve ainsi chez Macron le même cynisme et le même esprit tacticien que chez Hollande et Sarkozy sur ces questions de société.
LVSL – Où en est-on depuis les élections européennes ? Une menace démocratique pèse-t-elle sur la France du fait de l’isolement d’Emmanuel Macron ?
Marc Endeweld – Aux européennes, Macron a bien réussi son coup tactique sans bouger sur les questions de fiscalité, alors que les Gilets jaunes le réclamaient. Il n’a pas bougé, d’une part pour faire plaisir aux grands patrons, mais d’autre part pour récupérer la bourgeoisie traditionnelle de droite. Ce pari-là, d’un point de vue purement électoraliste, a en grande partie fonctionné. Alors qu’il a déçu bien des sympathisants de centre-gauche, qui voyaient en lui un homme providentiel permettant d’échapper au conservatisme d’un François Fillon, il a pu se refaire en récupérant une frange de l’électorat de droite traditionnelle. Et cela, peu de personnes, y compris au sein de l’appareil d’État ou dans le monde économique, pensaient qu’il allait réussir cette épreuve. Comme il bénéficie par ailleurs d’un écrasement des forces politiques traditionnelles et institutionnelles, et qu’il a réussi son jeu dangereux d’apparaître comme la seule alternative possible face au Rassemblement national – qu’il promeut comme seul parti d’opposition – les forces économiques sont relativement désemparées, car elles n’ont pour l’instant aucune alternative à Emmanuel Macron
« L’obsession de beaucoup est de ne surtout pas apparaître comme un opposant au pouvoir actuel. Il existe donc une véritable paranoïa chez un grand nombre d’acteurs, au sein de l’appareil d’État ou dans le monde économique, vis-à-vis de Macron. »
Toujours en off, les initiés du pouvoir, y compris dans la macronie, expriment leur inquiétude quant à la pratique du pouvoir autoritaire d’Emmanuel Macron. Mais une majorité d’entre-eux se réfugient dans un certain fatalisme. L’obsession de beaucoup est de ne surtout pas apparaître comme un opposant au pouvoir actuel. Il existe donc une véritable paranoïa chez un grand nombre d’acteurs, au sein de l’appareil d’État ou dans le monde économique, vis-à-vis de Macron. Car ces gens du pouvoir savent pertinemment que les lignes de rouge en termes de libertés individuelles ont largement été franchies par l’administration macronienne. Tous dénoncent, officieusement bien sûr, l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place.
Le public ne le perçoit pas forcément en tant que tel, car il n’y a plus de vecteur d’information, notamment parce qu’il n’existe plus réellement la balance de pouvoir des partis traditionnel. Lors de la période sarkozyste, la pratique du pouvoir du président avait été très critiquée par les partis d’opposition et par la presse, notamment en raison de son utilisation de barbouzes, des services de renseignement… De nombreux organes de presse en avaient fait leur axe principal – On se souvient des couvertures de certains hebdos ou quotidiens sur la « folie » de Nicolas Sarkozy… -. Les partis politiques d’opposition avaient repris à leur compte ces critiques espérant revenir au pouvoir sur cette base. D’où le discours de François Hollande lors de sa campagne de 2012 sur la « présidence normale ».
Aujourd’hui, la pratique du pouvoir d’Emmanuel Macron, en-dehors de quelques associations et mouvements politiques, n’est pas critiquée en tant que telle. Quelques avocats et magistrats ont enfin commencé à lancer des appels, quelques associations de droits de l’homme, notamment sur les questions migratoires, commencent à tirer la sonnette d’alarme, mais c’est extrêmement parcellaire. Les mouvements politiques et syndicaux démontrent leur faiblesse et leur incapacité à affronter frontalement le pouvoir actuel. Ils sont comme tétanisés.
C’est ce que les Gilets jaunes ont révélé en creux : la faiblesse des forces institutionnelles d’opposition, leur incapacité à coaliser la colère populaire – ce qu’ont réussi à faire les Gilets jaunes. Ils sont apparus comme le principal opposant au pouvoir, mais également comme le mouvement exprimant tout l’angle mort du macronisme, qui est en réalité l’expulsion de la question sociale du débat politique au sens où on l’entendait depuis le XIXème siècle. Emmanuel Macron évacue totalement les questions de justice sociale au nom de ladite efficacité, ce qui est très inquiétant sur les violences réelles qui pourraient s’exprimer dans les prochaines années dans le pays. On pourrait très bien se retrouver dans une situation similaire à celle de l’Italie des années 1970.