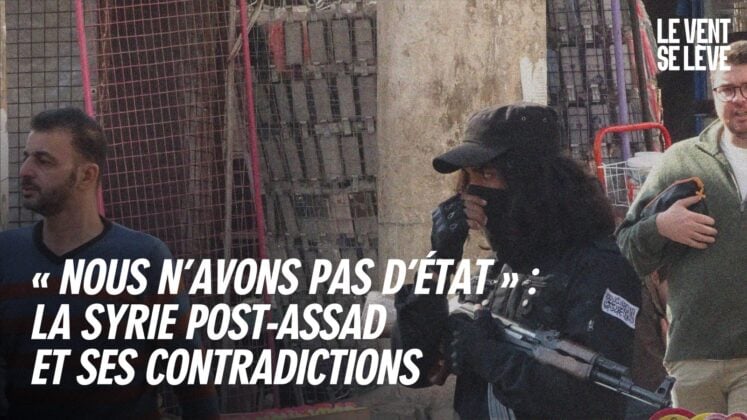Vice-président de Bolivie, Álvaro García Linera a gouverné le pays aux côtés d’Evo Morales durant treize ans (2006-2019). Théoricien politique, il est l’auteur d’une oeuvre d’inspiration marxiste, centrée autour de l’émancipation indigène. Dans cet entretien, il revient sur les défis d’une Amérique latine en butte à la réélection de Donald Trump. Celui-ci proclame son isolationnisme, mais Álvaro García Linera estime que les pressions impérialistes pourraient s’accroître sur le sous-continent : à l’heure de la démondialisation et de la régionalisation des chaînes de valeur, l’Amérique latine redevient un fournisseur capital de matières premières pour les États-Unis. Il plaide pour une intégration régionale, visant à faire émerger la région comme un pôle indépendant. Et revient sur les processus progressistes latino-américains, dont il fut l’un des protagonistes.
LVSL – Comment analysez-vous le retour au pouvoir de Donald Trump et ses implications pour l’Amérique latine ?
Álvaro García Linera – La victoire de Trump était prévisible. En période de crise économique, de transition d’un régime d’accumulation et de domination vers un autre, les positions centristes deviennent intenables. Le centre-gauche et le centre-droit apparaissent comme faisant partie du problème. En ces temps de crise, nous vivons des moments sismiques : les élites se fracturent, le centre disparaît, des positions radicalisées émergent. Trump incarne, depuis la droite, le nouvel esprit de l’époque.
Cette époque est marquée par un déclin global du mondialisme. Trump incarne un alliage de protectionnisme comme réaction au mondialisme et de récupération des aspirations souverainistes face à la mondialisation – sous une forme morbide. Cette voie ambiguë, hybride, amphibie, de « néolibéralisme souverainiste », commence à être testé dans certains endroits du monde – que l’on pense à Giorgia Meloni en Italie, à Viktor Orban en Hongrie, ou à Jair Bolsonaro au Brésil précédemment.
De quoi ce « néolibéralisme souverainiste » est-il le nom ? C’est une tentative de sortir de la crise du mondialisme néolibéral.
« L’Amérique latine, autrefois considérée comme insignifiante à l’heure du globalisme triomphant, redevient une zone convoitée. »
Qu’est-ce que cela va signifier pour l’Amérique latine ? Elle va se retrouver prise dans la dispute entre une Chine en expansion, qui repose sur des chaînes de valeur globales, et des États-Unis en contraction, qui ont besoin de régionaliser leurs chaînes de valeur. L’Amérique latine est déjà liée à la Chine par des chaînes de valeur globales, mais les États-Unis veulent l’intégrer dans leur sphère d’influence régionale. La Chine a l’avantage car elle dispose d’argent pour investir. Les États-Unis en manquent. Face à ce manque de ressources, on peut s’attendre à ce que les États-Unis choisissent la voie de la force pour imposer cette régionalisation des chaînes de valeur.
LVSL – Le nom de Marco Rubio, nommé Secrétaire d’État (soit l’équivalent de notre ministre des Affaires étrangères) par Donald Trump, apparaît dans des enregistrements audios liés au coup d’État en Bolivie de 2019 [sénateur républicain d’origine cubaine, Rubio est connu pour son hostilité viscérale à la gauche latino-américaine NDLR]. Il est cité comme un intermédiaire entre putschistes boliviens et les lobbies américains. Comment interprétez-vous sa nomination comme secrétaire d’État ? Prévoyez-vous un tournant interventionniste ou une politique de continuité avec les démocrates ?
AGL : Il n’y aura pas de continuité. Les démocrates incarnaient les restes de l’ancien mondialisme – malgré des décisions souverainistes évidentes, comme la hausse des tarifs douaniers. Trump, en revanche, a une proposition claire : un nouveau modèle économique pour les États-Unis, sauvagement capitaliste, impliquant un nouveau régime d’accumulation. Dans ce modèle, l’Amérique latine joue un rôle important du fait de sa proximité géographique.
Si un endroit doit devenir le substitut des importations, le lieu de repli des chaînes de valeur, c’est bien le sous-continent latino-américain. Cette tension sera-t-elle canalisée par des flux financiers ou l’utilisation de la matraque ? Les États-Unis étant confrontés à de nombreux problèmes économiques, ils ne peuvent rivaliser avec la Chine en termes de flux financiers. On ne concurrence pas les centaines de milliards de dollars investis par la Chine pour l’accès aux matières premières.
Je pense que les États-Unis chercheront à compenser leur déficit financier dans leurs relations avec l’Amérique latine par une exacerbation de l’interventionnisme. Il s’agira d’imposer une « route de la soie nord-américaine », autoritaire et militarisée, par opposition à aux « nouvelles routes de la soie » chinoises, basées sur les flux d’investissements, les infrastructures et le crédit. Marco Rubio n’est pas un élément essentiel : nous sommes face à un changement de régime d’accumulation, qui se régionalise. L’Amérique latine, autrefois considérée comme insignifiante à l’heure du globalisme triomphant, redevient une zone convoitée.
« Je pense que les États-Unis chercheront à compenser leur déficit financier dans leurs relations avec l’Amérique latine par une exacerbation de l’interventionnisme. Il s’agira d’imposer une « route de la soie nord-américaine », autoritaire et militarisée. »
Ainsi, on assiste à une tentative de réactiver la rhétorique de la « guerre contre la drogue », qui a toujours été un cheval de Troie de l’interventionnisme américain [la « guerre contre la drogue » désigne les campagnes de lutte contre le narcotrafic qui prévalent en Amérique depuis les années 1980, souvent pilotées par la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine NDLR]. Aujourd’hui, deux modèles coexistent : des pays comme la Colombie ou le Mexique ont abandonné les méthodes coercitives au profit d’une perspective de lutte structurelle contre les causes du trafic. L’Équateur, de son côté, a renoué avec une « guerre contre la drogue » aux méthodes répressives traditionnelles sous la présidence de Daniel Noboa. Il a été applaudi par les États-Unis, pour une très bonne raison : la « guerre contre la drogue » leur ouvre les portes du territoire. Le gouvernement de Noboa a explicitement pris des mesures permettant le retour de bases militaires américaines dans son pays. Pour autant, cette tentative de donner une seconde jeunesse à la « guerre contre la drogue » sera sans doute limitée.
À son apogée, la « guerre contre la drogue » répondait à deux motivations principales : exercer une forme de contrôle territorial par le biais de bases militaires (Équateur, Colombie, Bolivie) et d’une présence policière. Ensuite, limiter l’entrée de la drogue sur le marché nord-américain. Cette donnée a changé au cours de la dernière décennie : la drogue produite en Amérique latine est maintenant principalement destinée au marché européen. Cela a réduit l’urgence d’une lutte contre le narcotrafic en Amérique latine. Le « plan Colombie » avait mobilisé un milliard de dollars ; en Bolivie, cela représentait cent millions de dollars. Aujourd’hui, ces montants sont réduits à quelques millions.
Dans un but de contrôle politico-militaire, ce discours pourrait être réactivé, mais il ne bénéficierait plus de la même légitimité auprès des électeurs américains – dont la préoccupation n’est plus la cocaïne latino-américaine, mais les usines de fentanyl opérant aux États-Unis mêmes. Je ne pense donc pas qu’il s’agira à nouveau d’un axe central.
D’autres légitimations apparaissent : comme l’a suggéré la cheffe du Commandement Sud, c’est la présence chinoise elle-même qui justifiera le retour des États-Unis. Certains évoquent par exemple le port de Chancay, construit au Pérou par la Chine, comme un possible point d’entrée pour des navires militaires chinois. Une idée saugrenue, mais qui pourrait être montée en épingle. Je pense que la lutte contre la présence chinoise sera brandie en impératif de sécurité nationale.
En réalité, il s’agit d’une simple lutte pour le contrôle des chaînes de valeur. La transition énergétique nécessitera de nombreuses matières premières. Selon l’Agence internationale de l’énergie des États-Unis, entre 2025 et 2050, les volumes de matières premières stratégiques devront être multipliés par dix ou douze pour garantir cette transition. Une grande partie de ces ressources se trouve en Afrique et en Amérique latine, et les deux grandes puissances de ce monde cherchent à y accéder. Le reste n’est que littérature.
Sur ce terrain, la Chine a l’avantage. Elle a été beaucoup plus astucieuse ces vingt dernières années, investissant sans imposer de conditions, développant des infrastructures routières et portuaires, tandis que les États-Unis, considérant l’Amérique latine comme acquise, n’ont rien investi et se retrouvent à présent en position de faiblesse économique. Pour combler ce manquement, il faudrait des investissements massifs, de l’ordre de plusieurs centaines de milliards de dollars. Si les États-Unis ne sont pas disposés à engager de telles ressources, ils chercheront à compenser par des mesures coercitives : interventions, pressions, chantages, présence policière et militaire, etc.
En 2019, l’administration américaine a soutenu un coup d’État en Bolivie. Les officiers qui se sont rebellés avaient des liens avec le Département d’État. Claver Carone, fonctionnaire du Département d’État, est directement intervenu pour encadrer les militaires dans leur action putschiste. Des actions de ce genre pourraient se multiplier en Amérique latine : aux investissements, les États-Unis substitueraient des actions coercitives et une présence policière accrue.
LVSL – Face à ces tensions qui s’exercent sur le sous-continent, la gauche plaide pour la coopération régionale. Comment celle-ci prendrait-elle forme, et comment réagirait-elle face au déclin de la mondialisation néolibérale ?
AGL – Dans cette lutte de titans, chaque pays latino-américain, pris individuellement est insignifiant – une fourmi face à un éléphant. Mais si ces petites voix s’unissent, la voix du sous-continent sera entendue. Cela nécessite des mécanismes fondamentaux d’intégration. On peut rêver à une unification nationale latino-américaine, mais elle ne serait pas réaliste à court terme. Ce que l’on peut envisager, ce sont des accords régionaux fondés sur de grands axes thématiques : négociation commerciale, justice environnementale, fiscalité, etc. Ces accords thématiques, concrets et peu grandiloquents, permettraient à l’Amérique latine de porter une voix plus forte face aux grandes puissances.
Cette intégration doit être soutenue par des ressources qui permettent de créer des infrastructures communes et de niveler certaines inégalités. C’est ici que le bât blesse : peu de ressources ont été mises à disposition pour l’intégration et les infrastructures.
Face au reflux du globalisme, l’Amérique latine a montré une voie alternative, avec l’arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes. Leurs réformes, souvent peu radicales, ont cependant marqué une rupture dans la manière dont l’État intervient dans la distribution, la protection du marché intérieur et l’élargissement des droits. Si l’on observe les débats actuels aux États-Unis et en Europe sur des politiques industrielles, la souveraineté énergétique et agricole, ou encore la protection de certaines industries stratégiques, ce sont des discussions que l’Amérique latine a déjà eues il y a 20 ans.
LVSL – Après la première vague progressiste des années 2000 [marquée par la présidence de Hugo Chavez, Evo Morales, Lula, Rafael Correa, ou les époux Kirchner NDLR], la gauche renoue ici et là avec la victoire – au Mexique par exemple, où Claudia Sheinbaum a été triomphalement élue. Comment voyez-vous cette seconde vague ?
ALG – Il est juste de parler de deux vagues progressistes. Le Mexique, qui arrive après les autres pays d’Amérique latine, bénéficie d’une expérience accumulée qui lui permet de bénéficier d’un élan plus important. Il faut cependant rester attentif : les symptômes des limites du progressisme latino-américain commenceront déjà à apparaître, comme ce fut déjà le cas au Brésil, en Argentine, en Bolivie ou en Uruguay. Actuellement, le Mexique est dans une phase d’ascension, mais c’est justement dans le succès que les expériences progressistes rencontrent qu’elles trouvent leurs limites.
« En temps de crise, la gauche doit désigner un coupable : l’oligarchie, la caste, les ultra-riches. »
En Bolivie, le progressisme a été un succès, ayant sorti 30 % de la population de la pauvreté, redistribué les richesses et renforcé le pouvoir des peuples indigènes. Mais dans ce succès a germé ses limites : une fois qu’un objectif est atteint, il peut se vider de son sens. La société évolue, les demandes changent, et les structures sociales se transforment. Ainsi, pour continuer à progresser, il faut mettre en place des réformes de deuxième génération.
Le problème que vit actuellement l’Amérique latine est qu’après des réformes de première génération relativement réussies, leur élan a été stoppé. Le système de redistribution des richesses, les interventions de l’État dans le marché intérieur : tout cela a porté ses fruits, mais il faut désormais réinventer la manière dont nous produisons la richesse. L’Amérique latine a par exemple hérité d’un modèle extractiviste. Au lieu de laisser les profits partir à l’étranger, nous avons réussi à les réinjecter dans nos économies, à internaliser les bénéfices pour financer la justice sociale et élargir les droits.
Cependant, ce système devient vulnérable lorsque les matières premières, comme le pétrole ou le lithium, perdent de leur valeur. Se pose la question de sa durabilité. Pour que la redistribution de la richesse ne dépende plus des fluctuations du marché, il est nécessaire de créer un nouveau modèle productif, moins dépendant des prix mondiaux des matières premières. Cela représente une réforme de deuxième génération, qui ne se limite pas à modifier la répartition de la richesse, mais à la transformation du système productif.
LVSL – Quels sont les leviers qu’il est possible d’actionner ?
AGL – Pour mener à bien ces réformes, il faut revoir le système fiscal. Quand les prix des matières premières étaient élevés, on n’avait pas besoin de réformes fiscales profondes, car les excédents commerciaux permettaient de financer la redistribution. Aujourd’hui, la situation a changé. Peu de pays ont introduit des réformes fiscales progressives, même si la Bolivie a tenté de mettre en place un système plus équitable. Pour que le progressisme perdure, il est crucial de mettre en place des réformes qui incluent une taxation plus importante des grandes fortunes.
À lire aussi... Evo Morales : « Les nationalisations ont permis des progrès …
Il faut aussi introduire des politiques environnementales plus ambitieuses. Dans les réformes de première génération, nous avions besoin de ressources immédiates. À présent, il est crucial de développer des politiques environnementales plus strictes pour garantir la soutenabilité de long terme du modèle économique.
La présidence de Gustavo Petro en Colombie ou de Claudia Sheinbaum au Mexique pourraient donner lieu à une hybridation des réformes de première et de seconde génération. Mais il y a un risque : tout dépendra de la lucidité des mouvements progressistes et de l’audace des dirigeants. En temps de crise, il faut un bouc émissaire, un responsable. La stratégie de Kamala Harris, consistant à promouvoir le consensus et l’unité, a failli. Ce type de discours a sa place dans une période de stabilité, mais en temps de crise, il faut désigner un coupable : l’oligarchie, la caste, les ultra-riches. Il faut trouver un adversaire à affronter.
LVSL – Parmi les leaders de la droite latino-américaine, c’est Javier Milei qui prétend le plus clairement proposer un modèle alternatif. Comment analysez-vous les premiers moments de sa présidence ?
AGL – Je ne dirais pas que la politique économique de Javier Milei a échoué, bien qu’elle ait un coût social considérable. Sur le court terme, il est parvenu à réduire l’inflation – au prix d’une récession, de licenciements et de la destruction de l’industrie locale. Il se trouve dans une situation paradoxale : bien qu’il parvienne à dompter l’inflation, cela ne peut pas durer, notamment parce que les dollars n’arrivent pas. Le FMI n’a pas fourni de soutien significatif et bien que les grandes entreprises argentines aient investi dans des stratégies financières à l’étranger, les résultats économiques à long terme risquent d’être insoutenables.
Ce qui rend cette victoire temporaire de Milei compliquée pour la gauche, c’est que, du côté de l’opposition, il n’y a pas de véritable contre-proposition. Lorsque vous demandez à quelqu’un comment résoudre l’inflation, tout le monde reste silencieux. Cette absence d’alternative permet à Milei de conserver une certaine légitimité, malgré le caractère destructeur de ses mesures.
LVSL – En Bolivie, la gauche se déchire. L’ex-président Evo Morales et l’actuel chef d’État Luis Arce se livrent à une lutte fratricide. Comment voyez-vous la situation ?
AGL – Ce à quoi nous assistons en Bolivie est une lutte entre deux personnalités qui exprime quelque chose de plus profond : la transition de la première à la deuxième vague progressiste. Cette lutte est symptomatique du déclin de l’efficience des réformes.
Les discussions, au sein du parti MAS (Mouvement vers le Socialisme, parti au pouvoir depuis 2006, excepté la période du coup d’Etat de 2019 à 2020, ndlr), ne portent pas sur ce sujet mais sur le candidat à la prochaine élection présidentielle. Cela dévoile une autre limite, qui a trait à la personnalisation très forte du processus progressiste bolivien. Evo Morales incarne un leadership indigène – et il faut garder à l’esprit que l’État plurinational est l’œuvre des peuples indigènes. Cela pourra-t-il perdurer ainsi ? Ou les peuples indigènes subiront-ils une sorte d’expropriation par les classes moyennes créoles ?
Troisième enjeu : la manière dont on transite du leadership charismatique au leadership routinier. Personne n’a encore trouvé la solution. En Bolivie, cela n’a pas fonctionné, de même qu’en Argentine, en Équateur ou partiellement au Brésil – où Dilma Rousseff semble avoir été un simple parenthèse avant le retour de Lula.