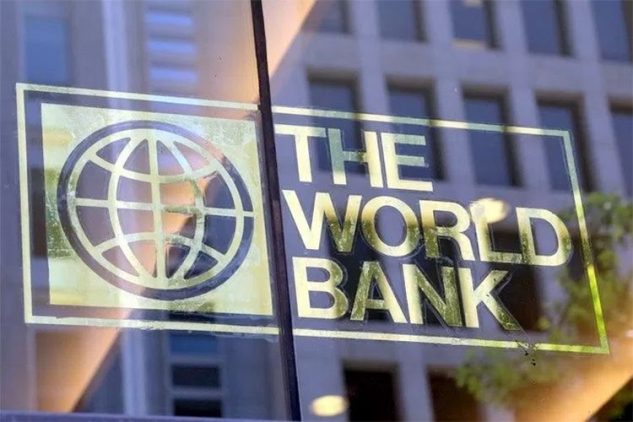Il y a un an en Haïti, le 7 juillet 2021, était assassiné le président Jovenel Moïse, précipitant encore davantage la faillite de l’État et la montée en puissance des bandes armées. Fin avril, des affrontements entre gangs ont fait 188 morts dans des quartiers populaires de Port-au-Prince. Loin d’être une surprise, cette violence extrême s’inscrit dans la continuité d’un banditisme d’État qui jouit depuis longtemps de complicités internationales.
Fin avril – début mai 2022, dans les quartiers populaires de Tabarre et de Croix-des-Bouquets, à Port-au-Prince, des bandes armées rivales s’affrontent pendant une dizaine de jours. Le bilan provisoire (probablement sous-estimé), de l’ONU, fait état de 188 personnes tuées, 12 disparus, 113 blessés et des milliers de déplacés. Des atrocités ont été signalées : corps incendiés, décapitations, mutilations, viols collectifs, y compris d’enfants.
Trois jours avant le début de ce massacre, la France organisait la troisième réunion – les deux précédentes avaient été organisées, en décembre 2021, par les États-Unis, et, en janvier 2022, par le Canada – des partenaires internationaux de haut niveau sur Haïti. Il y était question, en l’absence de toute représentation de la société civile haïtienne, de « l’appui des progrès réalisés ». L’ampleur des exactions, la dynamique des violences et la coïncidence des événements, sur les scènes locale et internationale, dessinent les contours du drame haïtien.
Phénomène ancien, dynamique nouvelle
Haïti est devenu le pays au monde avec le nombre le plus élevé d’enlèvements par habitant ; plus de 1 000 en 2021. Au cours des cinq premiers mois de cette année 2022, la police a déjà enregistré plus de 200 homicides et 540 kidnappings – 198 pour le seul mois de mai –, s’accompagnant quasi-systématiquement de viols. En réalité, leur nombre est bien plus élevé ; nombreuses sont les familles des victimes qui, par défiance, ne rapportent pas les faits ; et certains quartiers sous la coupe des bandes armées demeurent hors de portée de la police et des statistiques.
Du 1er janvier au 31 mai 2022, près de 800 personnes ont été tuées. L’essentiel des violences se concentre dans la capitale Port-au-Prince et dans sa périphérie, dont la majeure partie du territoire est passée sous le contrôle des gangs. Ces derniers, mieux armés que les policiers, seraient plus d’une centaine, tirant leurs ressources des enlèvements, du racket, de leurs liens avec l’élite économique et du prélèvement illégal de taxes dans les quartiers où ils opèrent.
Face à une telle situation, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est dite profondément troublée, évoquant des « violences extrêmes », qui avaient « atteint des niveaux inimaginables et intolérables », tandis que la Représentante spéciale de l’ONU en Haïti, Helen La Lime, parle d’un « état de terreur ». Il convient cependant de se dégager de la sidération provoquée par les images, les citations et les chiffres, afin d’analyser à froid cette violence.
La présence des bandes armées en Haïti est un phénomène ancien. Mais la nouveauté tient à leur prolifération, leur extension territoriale et l’intensité de leur connexion avec la classe politique et le monde des affaires. Les gangs sont nés sur le terreau de la pauvreté (qui touche plus de 59% de la population), des inégalités – Haïti est le pays le plus inégalitaire du continent le plus inégalitaire du monde –, de l’absence d’accès à des services sociaux, du désintérêt de l’État, et du clientélisme.
Implantées dans les quartiers populaires, les bandes armées réalisent un substitut de travail social, assurent un contrôle du territoire et un réservoir de votes auprès d’hommes politiques et de membres de l’oligarchie. Leurs interventions, qui tendent à s’intensifier en période électorale, étaient auparavant circonscrites à des zones spécifiques, et ne se matérialisaient pas par une violence généralisée. Il s’agissait d’un phénomène préoccupant, mais localisé.
« La gangstérisation de l’État est une nouvelle forme de gouvernance »
Réseau national de la défense des droits humains
Au cours des six mois précédents l’investiture du président, Jovenel Moïse, en février 2017, seuls 20 kidnappings avaient été signalés. Quatre ans plus tard, en 2021, le nombre d’homicides et d’enlèvements dépassait de loin ceux cumulés de 2019 et 2020. Et depuis, la situation sécuritaire n’a cessé de se détériorer. Le tournant remonte à 2018.
Modus operandi des violences
Les 13 et 14 novembre 2018, 71 personnes étaient assassinées à Port-au-Prince dans le quartier de La Saline, un bastion de l’opposition au président Jovenel Moïse. C’était le premier d’une série de massacres de grande ampleur. Celui de fin avril qui s’est soldé par l’assassinat de près de 200 personnes n’était que le dernier en date.
Le massacre de La Saline est emblématique. Non seulement parce qu’il est le premier de cette ampleur, mais aussi parce qu’il inaugure un modus operandi qui ne cessera de se répéter. Cette tuerie témoigne en effet d’un niveau de planification, de concertation, et d’organisation, qui n’existait pas auparavant. Les bandes armées y pratiquèrent une politique de la terreur – viols collectifs, mutilations, incendies, disparitions des corps –, diffusée sur les réseaux sociaux afin d’asseoir leur autorité sur le territoire et la population. Et, bien qu’elle fût avertie, la police n’intervînt pas. Du moins pas pour protéger la population, car nombre de témoignages et d’enquêtes révélèrent la participation directe de policiers aux exactions.
Si les gangs attaquèrent un lieu significatif avec La Saline, ils intervinrent surtout dans un moment stratégique. L’été 2018 avait été marqué par des manifestations contre l’augmentation du prix des carburants et par la révélation d’un scandale de corruption qui avait poussé les jeunes et les classes moyennes urbaines dans la rue. À partir de septembre 2018, ces deux vagues de protestation vont converger en un mouvement social d’une ampleur inédite, bousculant les revendications initiales pour mettre en cause le « système ». Aussi imprécis que soit le terme, il n’en cible pas moins la corruption, l’impunité, et le mépris de la classe dominante. Le massacre de La Saline doit, dès lors, largement être compris comme la réponse d’un gouvernement acculé au soulèvement populaire.

Face à ces crimes, le gouvernement s’est naturellement distingué par son silence et son indifférence, garantissant l’impunité. De même que Jovenel Moïse avait attendu des semaines avant d’évoquer La Saline, l’actuel Premier ministre par intérim, Ariel Henry, ne s’est toujours pas prononcé sur le crime de masse de mai dernier. Et, à ce jour, toutes les enquêtes sur les massacres – de même que celles sur l’assassinat de l’ancien président, de journalistes et d’avocats – sont au point mort. Pire même, un des responsables de la tuerie de La Saline, Fednel Monchery, ancien directeur du ministère de l’Intérieur, qui avait été interpelé, fut rapidement relâché suite à une intervention des autorités.
Les gangs, une privatisation de la puissance publique ?
Le phénomène des gangs s’inscrit dans un mouvement au long cours de réduction des ressources publiques et de délégation des fonctions de l’État. Ce délitement de l’État au profit d’entités privées fût mené par une classe politique alliée à l’élite économique, et soutenu par une communauté internationale habitée des idéaux néolibéraux, dont la myriade d’ONG bénéficiait de la privatisation. La dynamique s’est accélérée à partir du gouvernement de Michel Martelly, en 2011, dont Jovenel Moïse est le dauphin. En ce sens, les gangs sont moins le fruit de l’absence de l’État haïtien que de la privatisation de ses services, y compris de la force publique : officieusement, celle-ci fût peu à peu déléguée aux bandes armées afin de réprimer la contestation sociale, d’asseoir le pouvoir des dirigeants et d’assurer leur impunité.
Il y a ainsi un véritable concubinage – documenté et dénoncé par de nombreux rapports nationaux et internationaux – des bandes armées et des autorités publiques. Ces enquêtes mettent en évidence la responsabilité de hauts fonctionnaires d’État et d’agents de police, soit qu’ils aient planifié les attaques, soit qu’ils aient approuvés et soutenus ces crimes. Le massacre des habitants de La Saline, perçus comme opposants, est ainsi lié à l’administration Moïse qui a facilité, organisé, voire directement commandité ce crime. Des témoignages attestent que les membres des bandes armées se déplaçaient dans des blindés de police, d’autres relèvent le port de l’uniforme par certains assaillants. La non-intervention des forces de police – alors que ces violences durèrent plusieurs jours –, le silence d’État et l’impunité des responsables finissent d’accabler le gouvernement. Le meurtre du président Jovenel Moïse en juillet 2021 est donc en grande partie le retour de bâton d’une violence qu’il a entretenue et instrumentalisée. Son assassinat semble être en effet un règlement de compte entre différents clans de l’oligarchie.
Pour qualifier la situation, le Réseau national de la défense des droits humains (RNDDH) parle de « gangstérisation de l’État comme nouvelle forme de gouvernance ». Ce banditisme d’État jette une lumière crue, non seulement sur le pouvoir haïtien, mais aussi sur la diplomatie internationale ; sur son soutien sans faille aux gouvernements de Jovenel Moïse, hier, et d’Ariel Henry, aujourd’hui. À rebours du mythe d’un pays « sans État », il met en évidence la confiscation des instances et fonctions étatiques – y compris la police – par une élite corrompue, et l’aspiration frustrée de la majorité des Haïtiens et Haïtiennes à bénéficier d’institutions publiques, qui les représentent et soient à leur service.
Un drame sous responsabilité internationale
Si la classe dominante haïtienne s’est appuyée sur les bandes armées pour maintenir son pouvoir, menacé par le soulèvement populaire de 2018-2019, elle a pu compter, comme par le passé, sur un autre allié de poids : Washington. La Maison blanche a fixé pour Haïti les conditions de la diplomatie internationale, sur lesquels se sont alignés les autres États, français et européens en tête, ainsi que les institutions internationales, dont la plus importante d’entre elles, l’ONU. Et Biden, qui s’était montré critique envers la stratégie de l’administration Trump vis-à-vis d’Haïti, a poursuivi la même politique.
Adoptant un formalisme démocratique – qu’ils défendent à géométrie variable –, Washington et l’Union européenne ont appelé à un « dialogue national inclusif », au respect de la légalité et à la tenue rapide d’élections. La dérive autoritaire et mafieuse du gouvernement, le délitement accéléré des institutions publiques, ainsi que la multiplication des massacres, au fur et à mesure que les bandes armées gagnaient du terrain, n’y changeront rien. Pourtant, dans de telles conditions, la possibilité même d’organiser un scrutin libre et transparent est contestée par la population. Les œillères de la communauté internationale, qui insiste pour organiser des élections, sont donc une prise de partie : le maintien de l’élite politique corrompue plutôt que l’écoute des revendications populaires.
« Ce téléguidage des affaires internes est une énième illustration de la double dépendance – économique et politique – de l’État haïtien vis-à-vis de ses bailleurs. »
Les acteurs et actrices du soulèvement populaire avaient en effet convergé, dès 2020, autour de la revendication d’une « transition de rupture ». Cette convergence s’est ensuite consolidée et s’institutionnalisée dans l’Accord de la Conférence citoyenne pour une solution haïtienne à la crise (dit Accord de Montana), signé le 30 août 2021 par l’ensemble des mouvement sociaux (syndicats, églises, mouvements paysans, mouvements de femmes, organisations de droits humains…).
Deux options se font donc face : des élections, aussi vite que possible pour retrouver un semblant de stabilité ; ou une transition, qui permette de mettre en place, à terme, les conditions d’une campagne électorale, en rompant avec la corruption, l’impunité et, plus généralement, l’effondrement des institutions publiques.
Au nom de l’urgence et de la légalité, l’option d’une transition a été balayée par la communauté internationale, qui revendique la priorité du scrutin. Ce téléguidage des affaires internes est une énième illustration de la double dépendance – économique et politique – de l’État haïtien vis-à-vis de ses bailleurs. D’abord prévue pour juin, puis octobre 2021, repoussées encore, la tenue d’élections avant la fin 2022 apparait désormais, selon les propres termes des Nations unies, « peu probable ».
Le mandat du gouvernement actuel, de même que celui des deux-tiers du parlement, étant arrivés à terme, ceux-ci ne s’appuient plus sur aucune base légale, et encore moins légitime. Alors que les lignes rouges sont dépassées les unes après les autres, Haïti est piégé dans une phase transitoire sans transition ni deadline. Pour maintenir le pays sous son influence, et empêcher la voie à une transition qui a toutes les chances de leur échapper, l’international s’est pieds et poings liés à la classe dominante haïtienne. Celle-ci le sait, et agit en conséquence.
À défaut de faciliter une sortie de crise et bloquant tout véritable changement, Washington et ses affidés multiplient (à l’instar d’Ariel Henry) les effets d’annonce, augmentent l’aide humanitaire – celle-ci ne résout rien et demeure largement en-deçà des besoins qui s’accroissent (et vont continuer de s’accroître) –, et entendent former, équiper et renforcer la police haïtienne. Ce faisant, ils ne tirent aucune leçon de la complicité répétée et documentée entre l’institution policière et les bandes armées.
La réduction de la question haïtienne aux paramètres sécuritaire et humanitaire est à la fois cause et effet d’une dépolitisation. Faire de l’insécurité et de l’impunité un simple problème de moyens et de capacités est un leurre ; auquel l’international s’accroche d’autant plus qu’il lui permet de ne pas reconnaître l’échec de sa politique.
À quand la fin de cette descente aux enfers ?
Double et douloureux paradoxe historique : première république noire, issue de la révolution d’esclaves, en 1804, mettant une idée radicale de la liberté à l’agenda du monde, Haïti a vu son indépendance confisquée par la nouvelle élite au pouvoir, et sa souveraineté assujettie. Cette confiscation sur le plan national et cet assujettissement sur la scène internationale sont les deux versants d’une même stratégie de développement, où se lit l’alliance de l’oligarchie locale avec Paris d’abord, Washington ensuite.
Or, les principaux relais et orchestrateurs de cette dépendance – par le biais des diverses missions onusiennes, plans économiques et autres ingérences, plus directement politiques –, se sont autoqualifiés « pays amis », et ne cessent de prétendre aider Haïti à se relever. D’une autoévaluation à l’autre, ils se plaisent à présenter les défis et « avancées », en gommant la faillite de leur politique, ou en attribuant cet échec à l’incapacité et à la mauvaise volonté des Haïtiens eux-mêmes.
Les données de l’équation sont relativement simples : le statu quo ou le changement. De 2018 à nos jours, la situation a empiré. Et elle continuera de se dégrader si rien n’est fait. La descente en enfer du pays est le prix à payer pour maintenir cet état de fait. Plus exactement, c’est le prix que l’international et l’oligarchie locale font payer aux Haïtiens et Haïtiennes pour que rien ne change.