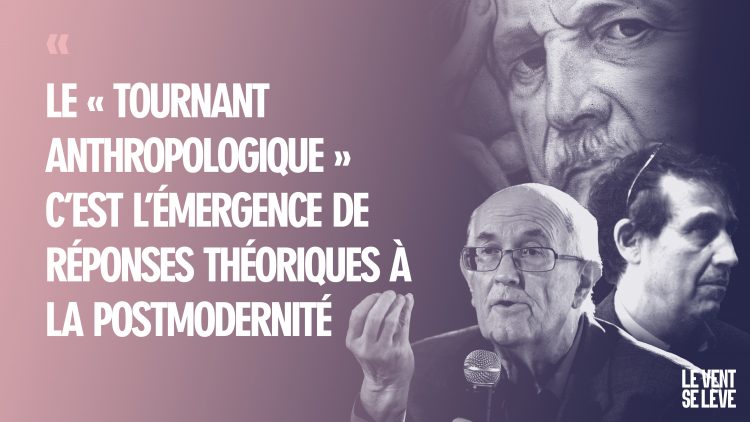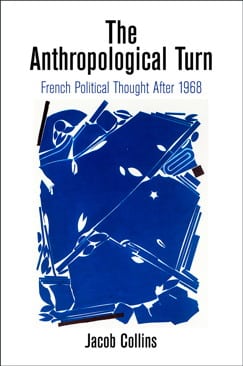Comment s’est déroulé le processus de formation des États au cours des deux derniers millénaires ? Quel a été son effet sur le mode de vie des populations des montagnes d’Asie du Sud-Est ? À rebours de l’histoire civilisationnelle classique, l’anthropologue James C. Scott (décédé le 19 juillet 2024) montre au travers d’une ethnographie comment les formes étatiques se sont imposées par la violence et l’assujettissement dans cette région. Et ce, au prix d’une détérioration des conditions matérielles et psychologiques des habitants qui, pour certains, ont préféré la fuite et le nomadisme dans les hautes terres à la réduction à l’esclavagisme. En filigrane de cette ethnographie, Scott dresse un portrait rousseauiste de ces sociétés sans État, présumées plus prospères, égalitaires et pacifiques que les sociétés étatiques – au mépris, parfois, de quelques faits historiques sur les conditions de vie objectives de ces populations.
Un contre-récit de l’histoire civilisationnelle classique
Zomia est un terme issu de plusieurs langues tibéto-birmanes qui signifie « gens de la montagne », et qui, géographiquement, désigne un ensemble de territoires situés à plus de trois cents mètres d’altitude qui s’étend des hautes vallées du Vietnam aux régions du nord-est de l’Inde, traversant ainsi six pays d’Asie du Sud-Est : le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Chine et la Birmanie. Au total, cette zone s’étend sur 2,5 millions de kilomètres carré et est peuplée par près de 100 millions de personnes issues d’une centaine d’ethnies différentes et pratiquant des langues empruntées à cinq grandes familles linguistiques distinctes. À défaut d’une unité ethnique, politique ou géographique, la Zomia rassemble des populations qui partagent de nombreuses caractéristiques, ce qui en fait une entité politique et donc un objet d’étude à part entière.

C’est l’histoire de ces peuples que Scott relate dans son ouvrage, une histoire intimement mêlée à celle des États d’Asie du Sud-Est. Si certains des habitants de la Zomia n’ont jamais connu l’État, beaucoup y ont été confrontés et ont choisi la fuite plutôt que l’assimilation et la servitude. À rebours de l’histoire civilisationnelle et évolutive traditionnelle, Scott montre d’une part que l’État n’est pas la forme achevée de civilisation – rappelant les piètres conditions de vie d’une grande majorité de la population étatique asservie – et d’autre part que les peuples des collines ne sont pas de lointains ancêtres qui n’auraient pas évolué. Ils sont au contraire un « effet d’État » : leur mode de production comme leurs structures sociales – nomadisme, égalitarisme, oralité – peuvent être vus comme des stratégies qui facilitent la dispersion et l’exode, mais surtout, adaptés pour empêcher toute institution étatique d’accéder à l’existence. Les peuples des collines sont, écrit-il, « barbares à dessein » : ils ont abandonné l’agriculture sédentaire pour d’autres formes d’organisation souples et propices à la fuite. La Zomia constitue en cela une zone refuge idéale, montagneuse, difficile d’accès, à l’ultra-périphérie des centres étatiques.
Scott entend également renouveler l’épistémologie anthropologique et historique. Tout d’abord, peuples des collines et des vallées n’ont cessé de se mélanger au travers de mouvements de population incessants et réciproques, de commercer, et de coévoluer, les États définissant sans cesse leur identité en opposition avec les « barbares », et qui n’auraient pu voir le jour sans les ressources alimentaires et humaines des collines. En ce sens, Scott s’inscrit, dans la lignée de Pierre Clastres, dans le courant anthropologique constructiviste, rendant ainsi inopérante toute tentative d’essentialisation des deux peuples. C’est enfin l’histoire de l’État que Scott entend renouveler afin de mettre à distance une histoire centrée sur les élites et les centres monarchiques selon laquelle la construction de l’État est un processus stable et inéluctable. À l’inverse, l’auteur dresse une contre-histoire des populations et dépeint le processus d’étatisation comme un épiphénomène à l’échelle de l’humanité, instable par nature et mouvant, se restructurant en permanence autour d’unités politiques élémentaires. Le sous-titre du livre, « Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-Est » prend alors tout son sens.
Les conditions d’émergence de l’État : plaine, densité de population et assujettissement
Scott commence par décrire le processus de construction des États. D’abord, l’émergence de l’État coïncide avec celle de l’agriculture sédentaire : les ressources, souvent obtenues sous la forme de revenu fiscal ou de rente agricole, sont une condition nécessaire au bon fonctionnement de l’État pour alimenter une bureaucratie ou une cour monarchique. Le foyer étatique doit donc se trouver près d’un terrain à la fois fertile et propice à l’appropriation des richesses, autrement dit être aisément accessible afin de permettre aux percepteurs de lever l’impôt.
L’autre ressource cruciale pour la puissance étatique est la main-d’œuvre, nécessaire pour cultiver les terres mais également pour combattre ou défendre les ressources en cas d’attaque. La formation de l’État est donc fortement contrainte géographiquement : le terrain doit permettre une concentration des ressources et des sujets. En Asie du Sud-Est, ce sont les plaines alluviales propices à la riziculture irriguée qui répondent à ce double impératif. L’absence de relief autour de ces plaines rend possible la circulation des marchandises et le prélèvement de l’impôt. Le rendement par unité de terrain y est élevé et les ressources peuvent donc être concentrées sur un territoire restreint.
Enfin, l’espace étatique est contraint par les frictions de terrain que sont les collines, par les intempéries, les cours d’eau. Il n’est donc jamais, contrairement aux conceptions actuelles de l’État-nation, un territoire nettement délimité. Il s’étend près des cours d’eau et le long des plaines, mais est absent au-delà d’une certaine altitude. Ces territoires difficiles d’accès sont donc une ressource stratégique pour ceux qui souhaitent se tenir à distance de l’État.
Pour s’assurer d’avoir à portée de main une population corvéable et mobilisable en cas de guerre, les bâtisseurs d’État ont le plus souvent utilisé la contrainte, la guerre et l’esclavage, comme en témoignent de nombreuses archives historiques : marquage au fer rouge des esclaves, mention du nombre de prisonniers après chaque bataille, guerres dans l’ensemble peu meurtrières dans la mesure où les perdants étaient capturés et asservis. La contrainte s’applique également aux individus intégrés à l’espace étatique puisque l’État doit faire face à une double difficulté : éviter l’exode de sa population en la fixant, et taxer les rendements agricoles le plus possible – ce que Scott appelle « réduire l’écart entre le PIB sur un territoire et la production recouvrable par l’État ». Pour ce faire, l’une des priorités de l’État est de rendre lisibles et imposables tous les biens marchands et humains. Monoculture et agriculture sédentaires répondent à cette nécessité pour la puissance étatique d’inventorier la production, en dépit de son manque d’efficacité. L’agriculture sur brûlis fut ainsi largement interdite et, jusqu’à nos jours, les États du Sud-Est asiatique continuent de pourchasser les nomades et d’en mépriser la culture.
« Un peuple était considéré comme civilisé dés lors qu’il était soumis à une administration étatique »
Ce dernier point, le mépris de la vie en altitude et du nomadisme, est crucial car il soulève un paradoxe : alors même que les peuples des collines et ceux des vallées étaient des partenaires économiques et qu’il a toujours existé une forte mobilité géographique entre l’une et l’autre région, ceux des collines sont systématiquement essentialisés et considérés comme sauvages. Cette distinction établie par les élites des basses terres entre barbares et civilisés, sauvages et apprivoisés, cru et cuit, relève vraisemblablement d’une volonté des bâtisseurs d’État de discréditer les alternatives à la vie au sein de l’État. Cette séparation des mondes atteint son paroxysme avec la naissance de l’hindouisme et du bouddhisme dans les sociétés birmanes d’Asie du Sud-Est. Ceux qui pratiquent ces religions étant considérés comme raffinés et cultivés, les autres, comme de sauvages païens.
C’est à ce moment d’émergence des États et des religions institutionnelles que se sont construits les récits généalogiques des peuples des hautes terres, considérés comme de lointains ancêtres auxquels il faudrait apporter la culture civilisatrice et qu’il est possible de civiliser étant donné le socle génétique commun. Dans les faits, un peuple était considéré comme civilisé dès lors qu’il était soumis à une administration étatique ou, pour reprendre les termes de l’administration Qing au XVIIIe siècle pour qualifier les habitants des hautes terres du Hainan, dès lors qu’ils « figuraient sur la carte ».
La distinction entre barbares et civilisés tient donc moins à une véritable différence de pratiques culturelles, mais davantage à l’incorporation ou non à un État, et semble servir aux bâtisseurs d’État à discréditer la culture d’une population qui lui échappe. Ces entrepreneurs de morale sont, en d’autres termes, des entrepreneurs d’État.
La Zomia, une zone refuge
La Zomia serait une zone refuge pour les populations souhaitant échapper à la servitude, mais également aux piètres conditions de vie associées à la monoculture : risques de famine causée par la faible diversité agricole, épidémies dues à la plus forte densité de population.
L’ensemble de leurs pratiques culturelles doit ainsi se lire comme des adaptations à la fois pour résister aux invasions étatiques extérieures, et pour empêcher l’étatisation d’advenir au sein de la société. Installation dans les collines difficiles d’accès (dans le Yunnan par exemple), culture sur brûlis et cueillette toutes deux compatibles avec le nomadisme sont adoptées car elles offrent la possibilité de se disperser et empêchent toute forme de taxation. Les structures sociales des peuples des collines sont également calibrées pour résister à la captation et à l’assujettissement. La dissolvabilité de l’organisation tribale et son égalitarisme empêchent d’une part aux États d’entrer en négociation avec les peuples des collines – faute d’identifier ce peuple et d’en trouver l’interlocuteur – et d’autre part l’émergence de chefs au sein du groupe. Les Wa du Nord de la Birmanie refusent par exemple aux plus riches d’organiser des offrandes festives, de peur qu’ils n’aspirent au statut de chef. Les peuples des collines ont par ailleurs un large répertoire de modèles politiques, allant de l’égalitarisme strict des Wa à l’existence de sociétés munies d’un chef héréditaire, comme les Gumsa de Birmanie étudiés par Edmund Leach. Loin d’être figée, leur structure sociale oscille entre ces différentes options politiques, elle est par nature plastique et polymorphe pour faciliter la dispersion et l’adaptation que nécessitent l’évitement de la captation étatique.
De même, l’oralité est une transformation récente de la culture collinéenne à la suite des exodes et relève d’un choix délibéré des tribus qui maintiennent l’illettrisme afin de rendre souples les récits généalogiques. Ainsi, les Akha, les Wa et les Karènes sont dotés d’un récit expliquant l’abandon de l’écriture, toujours lié à un bouleversement écologique ou politique et suggérant alors que ces populations ont délibérément abandonné l’écriture qu’ils maitrisaient autrefois. Sans État, l’écriture perd d’abord fortement son utilité : nul besoin de lire ou rédiger des documents administratifs dans une tribu. L’oralité présente par ailleurs l’avantage d’être plus démocratique, partagée par tous et plus modelable au gré de ce que les individus souhaitent se rappeler en fonction de leurs intérêts. Leur histoire est donc flexible, laissant ainsi la possibilité à un groupe de se scinder et de modifier son récit généalogique en conséquence. Plus radicalement, l’oralité offre la possibilité de se passer de généalogie afin d’éviter à toute institution gouvernante d’émerger au nom d’une légitimité historique.
L’auteur aborde enfin la question de la religion des populations des hautes terres, avec un accent particulier mis sur le millénarisme des Hmong, Karènes et Lahu, populations dotées d’un passé révolutionnaire fort. Le millénarisme s’accompagne en effet d’une croyance dans l’inversion soudaine du monde, des statuts et des fortunes, portant ainsi en germe des révoltes sociales. En tant qu’initiateur de mouvement et d’exode, les croyances millénaristes peuvent elles aussi être comprises comme un atout de plus dans la panoplie des structures sociales fugitives destinées à tenir à distance les États.
L’art de ne pas être gouverné consiste à établir une distance culturelle avec les peuples étatisés et à affirmer le refus de constituer un État. Les Akha d’Asie du Sud-Est ont même bâti leur identité sur ce refus de l’État : un des personnages de leur récit généalogique est un roi du XIIe qui aurait été massacré par son peuple après avoir institué un recensement. Ce récit fait office d’avertissement contre les hiérarchies et la formation d’un État.
Ces exemples montrent donc que, contrairement à ce que voudrait la doxa, ces populations ne sont pas les vestiges des premiers humains. Elles ont elles-mêmes eu des velléités étatistes jusqu’à ce que la menace d’être assujetties par un autre État les pousse à changer d’organisation sociale et à s’exiler dans les collines. Le peuple Tai autrefois étatisé a été repoussé vers l’est et le sud-ouest, comme en témoignent ses pratiques culturelles caractéristiques : religion séculaire, pratique de la riziculture irriguée, autant d’indices qui permettent d’affirmer que ce peuple fut un bâtisseur d’État. De même, la culture sur brûlis ou le nomadisme pratiqué au cours des siècles passés ne précèdent pas la riziculture sur la très contestable échelle de l’évolution sociale : ces pratiques sont, au contraire, des « adaptations secondaires » qui relèvent d’un choix essentiellement politique.
La mosaïque d’identités comme stratégie d’évitement de l’État
Au grand désarroi des administrateurs et des colons, les peuples des collines sont fortement hétérogènes et présentent peu d’unité identitaire interne (linguistique ou culturelle). Sans trait partagé par le groupe, il est donc délicat de définir les contours d’une « tribu », et Scott réfute ainsi la pertinence du terme d’ethnie. Les peuples des collines pratiquent une variété d’agriculture et de culture, et pour cause : ces groupes des collines n’ont cessé d’incorporer d’autres groupes avec qui ils interagissaient en permanence. Tout comme Clastres avait montré que les populations amérindiennes étaient d’anciens agriculteurs sédentaires contraints d’abandonner l’agriculture en raison des conquêtes et de l’effondrement démographique, Scott montre que l’histoire du peuple des hautes terres est intimement liée à celle des basses terres, que ces régions ont été marquées par des échanges symboliques, économiques et humains. L’unité de ces peuples est donc par nature instable et chaotique, ce qui empêche toute classification.
Si le concept d’ethnie est utilisé par les acteurs, ce n’est pas pour mimer la dynamique identitaire des États mais pour défendre leur autonomie et donc pour y résister. Les États eux-mêmes sont fondés sur la combinaison d’une multitude d’ethnies et n’auraient pas, comme le laisserait penser l’histoire nationaliste moderne, une base ethnique mais bien cosmopolite. Pour accréditer leur récit historique, les nations ont gommé les différences antérieures par la coercition et l’uniformisation. C’est donc un « constructivisme radical » qu’adopte ici Scott, postulant que les identités sont par nature multiples et mobiles, artificiellement délimitées par l’État dans le but de contrôler sa population mais également à des fins de catégorisation des territoires voisins.
L’idée développée dans cette partie est radicale et assumée comme telle par Scott : les tribus, au sens d’unités sociales distinctes, sont une pure invention des administrateurs pour classifier et recenser les populations. Les peuples des collines possèdent plusieurs modèles politiques et identitaires qu’ils adaptent stratégiquement en fonction de leur relation avec les États. Ainsi, certains Lahu de Chine ont choisi de s’établir dans les montagnes et de pratiquer la cueillette dans certaines circonstances, et, dans d’autres, d’adopter un mode de vie sédentaire au sein de villages agricoles. En 1973, plusieurs d’entre eux quittèrent les basses terres de la Birmanie après qu’une révolte contre l’État birman eut échoué pour se réfugier dans les collines.
L’auteur déplore enfin la disparition progressive de la Zomia dans cette dernière phase de construction de l’État qui voit l’espace administré se confondre avec pratiquement toute la surface du globe. Cette dernière phase de l’expansion de l’État s’explique par les nouvelles technologies à la disposition des États pour absorber les périphéries et parachever le processus de formation des États-nations.
Scott, entre constructivisme anarchiste et essentialisation de l’État
En filigrane de son œuvre, Scott brosse un portrait de l’État peu reluisant qui, en plus d’être asservissant pour sa population, en dégrade les conditions de vie en raison de l’adoption de la monoculture et des taxes. L’État serait donc par nature et invariablement coercitif, imposant à une majorité les décisions d’une minorité. Or, les premiers États d’Asie décrits par Scott sont tout sauf semblables aux États contemporains, moins meurtriers (du moins pour les populations internes) et plus protecteurs. L’État-providence en est l’exemple le plus récent et le plus frappant puisqu’il assure une protection sociale et une redistribution des richesses à grande échelle.
Partant de ce constat que l’État serait, de tout temps et en tous lieux, contraire aux intérêts des individus, Scott développe l’idée selon laquelle l’organisation sociale et économique des habitants de la Zomia serait pensée pour conserver leur autonomie. Or, on peut se demander si ces structures adoptées par les populations des collines ne découlent pas simplement des contraintes géographiques et environnementales des espaces dans lesquels ils vivent, plutôt que d’être un choix politique d’anarchisme. Leur mode de production pourrait en fait être une simple adaptation à la vie dans les montagnes, de même que leurs structures sociales pourraient être la conséquence de l’organisation que nécessite un certain mode de production. Il a par exemple été montré que la culture du blé requiert moins de coordination que la culture du riz qui demande davantage d’interdépendance entre les individus1. Cette différence entre culture du blé et culture du riz peut expliquer les différences culturelles entre Chine du Sud, davantage holiste et valorisant la hiérarchie, le népotisme et la loyauté, et Chine du Nord, plus individualiste. Scott semble donc privilégier l’explication des caractéristiques sociales en termes de stratégies individuelles, sans aborder les déterminants structurels (environnementaux et sociaux) de ces caractéristiques.
En lien avec cette idée que les peuples des collines ne sont pas si averses à l’État que Scott le laisse entendre, Brass2 souligne que les Karènes se sont battus pour exiger un État karène ethniquement constitué en 1940, avec l’aide des conservateurs britanniques voulant affaiblir l’État birman. On peut alors se demander si l’absence d’État dans les collines est véritablement un choix politique ou une simple résignation.
Une romanticisation des sociétés sans État ?
Enfin, Scott souligne à plusieurs reprises le contraste de qualité de vie entre collines et vallées. La vie dans les collines prémunirait des famines et des épidémies récurrentes dans l’État en raison de l’agriculture diversifiée et de la faible densité de population, une idée présentée par Richard B. Lee au symposium « Man the Hunter » en 1966. S’appuyant sur ses ethnographies des !Kung du désert de Kalahari en Namibie, Lee avait montré que contrairement aux croyances communes, l’espérance de vie des !Kung après 60 ans était largement comparable à celle des populations industrialisées3.
Toutefois, de nombreuses données suggèrent que le mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs est loin d’être idéal. Nancy Howell notait que « les !Kung sont très maigres et se plaignent souvent de la faim, à tout moment de l’année. »4 L’espérance de vie n’était guère plus reluisante, avec une moyenne à trente-six ans chez les !Kung5, l’hypothèse principale avancée étant que le nomadisme empêche les organismes de développer des anticorps prémunissant des maladies locales. Si les populations sédentaires, comme le souligne Scott, encourent le risque de maladies infectieuses et d’épidémies, les chasseurs-cueilleurs sont donc confrontés à d’autres risques sanitaires autrement importants.
Plus largement, la forte mortalité des populations de chasseurs-cueilleurs ne s’expliquerait-elle pas par un niveau extrêmement élevé d’homicides et de violences intergroupes ? C’est ce que suggère Peter Turchin dans Ultrasociety6, qui défend l’idée que le lot commun des sociétés pré-étatiques est un état constant de guerre. Les fouilles archéologiques révèlent par exemple que parmi 264 cadavres d’Indiens de l’Illinois vivant à la fin du Moyen Âge, 16% sont morts suite à des violences infligées par des armes (haches en pierre, flèche). Sur un échantillon de quinze sociétés de petite-échelle, onze ont un taux d’homicide supérieur à celui des nations modernes7.
Si l’on comprend les intentions d’un tel discours d’inspiration rousseauiste – renverser le discours progressiste dominant jusqu’en 1960 selon lequel la marginalité rurale était sous-développée et constituait donc un problème à résoudre – il est toutefois regrettable que James C. Scott ne rende pas précisément compte des conditions de vie de ces populations.
Notes :
[1] Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture. Science, 344(6184), 603–608. https://doi.org/10.1126/science.1246850
[2] Brass, T. (2012). Scott’s “Zomia,” or a Populist Post-modern History of Nowhere. Journal of Contemporary Asia, 42(1), 123–133. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.634646
[3] Lee, R. B. (1968). What hunters do for a living, or, how to make out on scarce resources. In Man the Hunter (pp. 30–48). Aldine Publishing Company. https://hraf.yale.edu/ehc/documents/743
[4] Citation originale: “The Kung are very thin and complain often of hunger, at all times of the year.”
[5] Gurven, M., & Kaplan, H. (2007). Longevity Among Hunter- Gatherers: A Cross-Cultural Examination. Population and Development Review, 33(2), 321–365. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2007.00171.
[6] Turchin, P. (2015). Ultrasociety: How 10,000 Years of War Made Humans the Greatest Cooperators on Earth. Beresta Books.
[7] Fry, D. P. (2013). War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views. OUP USA.