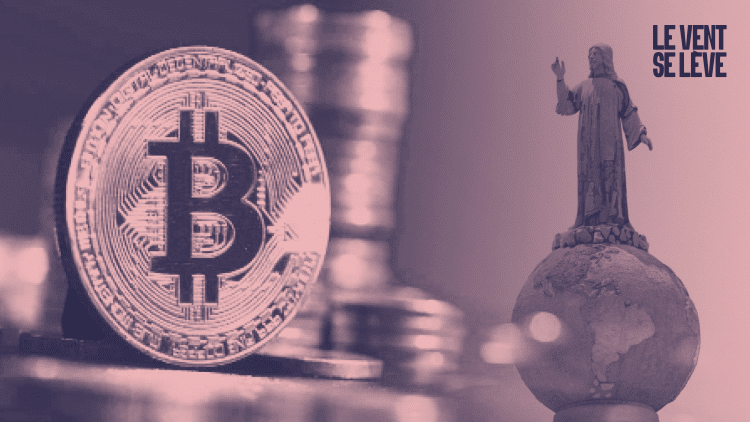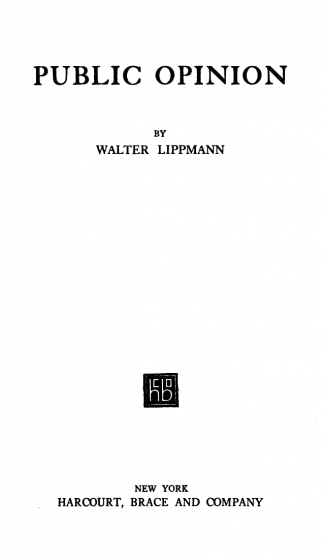Après trois budgets austéritaires adoptés par 49.3 depuis 2022, la colère des Français contre des services publics exsangues et une fiscalité toujours plus régressive ne cesse de croître. Si les macronistes espéraient échapper à une censure grâce à des concessions mineures au Parti Socialiste et au Rassemblement National, ainsi qu’un « dialogue social » permettant d’endormir les syndicats, la menace d’un mouvement d’ampleur le 10 septembre, rappelant les gilets jaunes, les a conduits à changer de tactique. Alors que le départ de François Bayrou est quasi-certain, Emmanuel Macron conserve plusieurs cartes pour continuer à mener son entreprise de destruction : nomination d’un nouveau gouvernement de droite dure, menace de dissolution ou encore pression des marchés financiers. Puisque de nouvelles législatives ont peu de chances de clarifier la situation politique, le salut ne semble pouvoir venir que de la mobilisation populaire. À condition que les leçons du passé récent soient tirées.
« À la rentrée, il y aura une confrontation entre le réel et les idéologies. » Voilà ce que déclarait François Bayrou lors d’une énième conférence de presse destinée à défendre son budget austéritaire prévoyant 44 milliards d’euros de saignées supplémentaires dans les dépenses publiques. Une petite phrase qui reprend le refrain habituel des néolibéraux : la dette publique est un mal absolu, seul un démantèlement de l’État pourra le résoudre, quoi qu’en disent les « idéologues ». Ce propos méprisant pourrait bien se retourner contre la Macronie : l’idéologie austéritaire, combinée à la « politique de l’offre » consistant à multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises, est bien celle qui a créé plus de 1000 milliards d’euros de dette supplémentaire sous le règne du « Mozart de la finance ». S’il est donc un « réel », au terme du mandat Macron, c’est celui de l’appauvrissement des Français, de l’effondrement des services publics et d’une économie en manque critique d’investissement.
La Vème République toujours plus autoritaire
Jusqu’à présent, Emmanuel Macron avait réussi tant bien que mal à éviter un nouveau mouvement social d’ampleur contre sa politique, alors que son premier quinquennat avait été marqué par celui des Gilets jaunes et le second a débuté par des mois de mobilisation contre une réforme des retraites injuste et injustifiée. Certes, son pari de dissoudre l’Assemblée nationale pour renforcer son camp ou cohabiter avec le Rassemblement national (RN) avait échoué, le Nouveau front populaire ayant obtenu le plus grand nombre de sièges. Mais le blocage politique du pays en trois camps lui a permis de reprendre la main. Outrepassant les usages républicains, qui veulent que le chef de l’État nomme une personnalité issue du camp ayant le plus grand nombre de députés, il a préféré sceller une alliance minoritaire avec les Républicains via la nomination de Michel Barnier.
L’obstination du « bloc central » à défendre les intérêts de l’oligarchie et à supprimer des dizaines de milliards d’euros dans tous les budgets sauf ceux de l’armée et de la sécurité intérieure, ont cependant vite abouti à la censure de ce dernier, après seulement trois mois à Matignon. Mais une fois encore, la Constitution de la Vème République a démontré son utilité pour permettre à l’exécutif de passer outre les blocages parlementaires. Macron a vite nommé un autre Premier ministre reprenant la même politique, François Bayrou, qui a réussi à faire passer le budget 2025 en recourant à l’article 49.3. Des dispositions tout à fait anti-démocratiques mais permises par la Constitution du « coup d’État permanent ».
Pour éviter de subir le même sort que son prédécesseur, Bayrou n’a eu qu’à recourir à la peur de « l’instabilité » et d’une attaque des marchés financiers sur la dette française. Immédiatement, le RN, dont le programme économique est désormais presque identique à celui du « bloc central », et le Parti socialiste, toujours plus soucieux d’apparaître « sérieux » auprès de la bourgeoisie que de respecter ses électeurs, ont accepté de ne pas le censurer en échange de maigres concessions. Parmi elles, un « conclave » sur les retraites, très vite parti en fumée : en fixant un cadre de rigueur strict à respecter et en s’appuyant sur le MEDEF pour le représenter, le gouvernement a dès le départ cadenassé la discussion avec les syndicats. Finalement, presque tous ont quitté la table, à l’exception des syndicats patronaux et des plus conciliants, notamment la CFDT, dont la secrétaire générale affirme ne pas regretter « d’avoir joué le jeu du dialogue social ».
Après le non-respect du référendum de 2005, le recours toujours plus important au 49.3, le non-respect des résultats des urnes et le mépris de la démocratie sociale, les outils de démocratie participative sont à leur tour piétinés.
La non-censure du PS et du RN et l’accaparement des syndicats dans cette comédie stérile ont permis à Bayrou de gagner quelques mois au pouvoir, durant lesquels tous les sujets politiquement risqués ont été remis à plus tard. La seule loi majeure adoptée depuis janvier a été la loi Duplomb, du nom d’un sénateur lobbyiste de la FNSEA, qui réintroduit des pesticides dangereux pour la santé, dérégule à tout va pour multiplier les méga-bassines, les fermes-usines et autorise l’épandage de pesticides par drone. Son parcours législatif résume à lui seul la dérive anti-démocratique que permet la Vème République : adoptée par le Sénat, chambre élue indirectement où la droite conserve la majorité, elle a été rejetée par ses propres soutiens à l’Assemblée nationale afin d’éviter l’obstruction de la gauche, avant d’être adoptée dans une Commission mixte paritaire (instance réunissant 7 parlementaires de chaque chambre, ndlr) où les débats sont à huis clos ! Malgré la propagande vendant cette loi comme un « soutien aux agriculteurs », plus de deux millions de Français ont signé une pétition citoyenne sur le site de l’Assemblée nationale pour exprimer leur opposition à ce texte. Mais seul un débat sans vote a été concédé.
Une révolte populaire qui gronde
Après le non-respect du référendum de 2005, le recours toujours plus important au 49.3, le non-respect des résultats des urnes et le mépris de la démocratie sociale, les outils de démocratie participative sont à leur tour piétinés, comme cela avait déjà été le cas de la Convention citoyenne pour le climat, enterrée par Macron. C’est dans ce contexte de fuite en avant autoritaire et d’acharnement austéritaire qu’ont émergé les appels sur les réseaux sociaux à lancer un grand mouvement social le 10 septembre. Après le prix de l’essence, c’est cette fois-ci la suppression de deux jours fériés qui a fédéré les colères. Mais les braises étaient déjà chaudes avant cette étincelle supplémentaire : pouvoir d’achat rogné par l’inflation, services publics toujours plus affaiblis, multiplication des scandales dans les gouvernements successifs, révélation de 211 milliards d’euros par an d’aides aux entreprises, arrogance des gouvernants…
Le fait que cette initiative ne vienne ni des partis politiques, ni des syndicats rappelle la mobilisation des gilets jaunes en 2018-2019, le plus grand mouvement social français depuis mai 1968. Les revendications de justice fiscale, de mise en place d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), de hausse des salaires et de confrontation avec l’Union européenne font également penser à la colère populaire d’il y a sept ans, tout comme les appels à bloquer les centres logistiques et axes de transport, en plus d’une « grève générale ». Pour une majorité des Français, il n’y a en effet plus grand chose à attendre des élections, aboutissant à un blocage qui permet aux institutions de continuer à fonctionner sans légitimité démocratique, ni des syndicats, dont les journées de grève éparses ont échoué à bloquer la réforme des retraites il y a deux ans. La rue semble être le seul espace restant pour s’exprimer, malgré la répression policière.
Pour une majorité des Français, il n’y a plus grand chose à attendre des élections, aboutissant à un blocage qui permet aux institutions de fonctionner sans légitimité démocratique, ni des syndicats, dont les journées de grève éparses ont échoué à bloquer la réforme des retraites. La rue semble être le seul espace restant pour s’exprimer.
Certes, à ce stade, il est difficile de savoir à quel point ce mouvement social sera d’ampleur, qui y prendra part, sous quelle forme et combien de temps il durera. La volonté des soutiens du mouvement du 10 septembre d’éviter toute « récupération » politique suffit en tout cas à faire trembler le gouvernement, qui n’aura pas d’interlocuteurs à amadouer. Certes, la France insoumise, puis les communistes et les écologistes, ont annoncé soutenir le mouvement tout en lui laissant son autonomie, retenant donc les leçons des gilets jaunes. Mais contrairement aux affirmations de la presse, qui accuse déjà Jean-Luc Mélenchon de vouloir le chaos absolu dans les rues, celui-ci n’aura que peu de prise sur un mouvement qui semble avoir plus de similarités avec la révolte serbe où le peuple s’auto-organise.
Sacrifice de Bayrou, répression, dissolution : les cartes d’Emmanuel Macron
Les deux mois qui séparent les premiers appels de la date de mobilisation auront cependant permis au pouvoir de se préparer. Tandis que les plans de déploiement des CRS sont en préparation dans les préfectures, un « conseil de défense sur la guerre informationnelle » et les ingérences étrangères est également annoncé le 10 septembre, ce qui fait craindre des mesures de blocage des réseaux sociaux si le mouvement devenait menaçant. Le réseau Tiktok avait ainsi été bloqué en Nouvelle-Calédonie l’an dernier et le gouvernement avait également envisagé de couper l’internet mobile, tandis que le fondateur de l’application Telegram a été arrêté (il est depuis en liberté conditionnelle, ndlr) en France l’an dernier afin de forcer sa messagerie à coopérer davantage avec les forces de police.
Sachant que la réponse répressive ne pourra suffire, Emmanuel Macron a décidé de sacrifier François Bayrou. Sans grand état d’âme, puisque ce dernier avait imposé sa nomination comme Premier ministre en menaçant de retirer le soutien de son parti, le MODEM, à l’alliance gouvernementale. En forçant Bayrou à demander la confiance des députés le 8 septembre lors d’une session extraordinaire, le Président de la République ne fait qu’anticiper l’étude de la motion de censure déposée par les insoumis prévue le 23 septembre, qui aurait sans doute abouti. Les socialistes et le Rassemblement national, en plus des insoumis, des communistes et des écologistes, ayant annoncé ne pas lui accorder leur confiance, son gouvernement est déjà condamné. En avançant le calendrier, Macron espère que cette censure, la seconde en neuf mois, permettra de contenir les blocages prévus le surlendemain.
C’est alors que l’incertitude demeure : si la mobilisation n’est pas forte, le Président de la République pourra continuer à démembrer les services publics et à vendre le pays à la découpe. Le gouvernement actuel pourrait d’ailleurs ne pas quitter le pouvoir tout de suite, l’expérience du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal, resté deux mois de plus que prévu à Matignon l’été dernier, ayant montré combien les règles de la Vème République sont souples. Plus probablement, Macron pourrait alors nommer un autre Premier ministre de droite reprenant les mêmes ministres et surtout la même ligne politique. Une succession accélérée de gouvernements qui illustre combien le problème se situe plus à l’Elysée qu’à Matignon. 67% des Français réclament d’ailleurs la démission d’Emmanuel Macron.
Une dissolution présente l’avantage pour le pouvoir de canaliser l’énergie des représentants politiques et des médias vers une élection plutôt que vers la mobilisation sociale.
Si le pays venait à être sévèrement bloqué, le chef de l’Etat disposera cependant d’une autre carte : une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Ayant déjà beaucoup perdu de députés l’an dernier, Macron n’a plus grand chose à y perdre. Quant à une victoire potentielle du Rassemblement national, elle pourrait convenir à Macron, qui préfère cohabiter avec Jordan Bardella plutôt que redistribuer les richesses. Si le retour aux urnes n’est jamais une mauvaise chose, les chances d’obtenir une clarification politique et une majorité sont faibles. Mais cette option présente l’avantage pour le pouvoir de canaliser l’énergie des représentants politiques et des médias vers une élection plutôt que vers la mobilisation sociale. Dans l’intervalle, un gouvernement technocratique pourrait mettre en place les mesures d’austérité exigées par la Commission européenne.
Attaques des marchés contre pression populaire
Pour faire passer sa politique toujours plus impopulaire, l’oligarchie et ses représentants s’emploient désormais à saborder la confiance dans la dette française, en répétant partout que le pays est en faillite et que les marchés financiers ne nous prêterons bientôt plus, ou à des taux prohibitifs. Les médias multiplient déjà les graphiques sur les spread (différence de taux d’intérêts, ndlr) entre la France, l’Allemagne, l’Italie ou la Grèce et interrogent leurs « experts » sur le risque d’une mise sous tutelle du Fonds monétaire international (FMI). Des scènes surréalistes alors que la demande de dette française sur les marchés est toujours très supérieure à l’offre, que le coût de la dette reste mesuré et que de multiples solutions existent : une baisse des taux directeurs de la BCE, l’annulation des dettes qu’elle détient, une autre politique fiscale pour remplir les caisses de l’État, des mesures protectionnistes qui diminueraient le déficit commercial français et alimenteraient le budget. Des pistes pourtant jamais débattues sérieusement.
Mais cette petite musique d’un pays au bord de la banqueroute vise en réalité à créer une prophétie auto-réalisatrice dont les marchés financiers raffolent : si les taux d’intérêt de la France commencent à monter, alors d’autres prêteurs jugeront le risque plus élevé et exigeront une prime plus importante, alimentant un cycle infernal. Les promoteurs de la rigueur pourront alors invoquer la « charge de la dette » pour justifier encore plus de coupes budgétaires, qui affaibliront à leur tour l’économie en détruisant la demande et l’investissement, alimentant ainsi un cercle vicieux. Une méthode efficace pour privatiser à tout va, déjà testée avec succès dans de nombreux pays européens depuis quinze ans.
Si l’opposition au budget fédère les soutiens du 10 septembre, le pouvoir ne manque pas de moyens de diviser le mouvement, en laissant monter la violence pour terroriser les participants pacifiques ou en proposant « d’augmenter le salaire net » en supprimant des cotisations à destination de la Sécurité sociale.
Pour déjouer ce scénario, la mobilisation sociale devra être massive et s’organiser autour d’objectifs clairs. Si l’opposition au budget envisagé fédère pour l’instant les soutiens du 10 septembre, le pouvoir ne manque pas de moyens de diviser le mouvement, par exemple en laissant monter le niveau de violence pour terroriser les participants pacifiques ou en proposant « d’augmenter le salaire net » en supprimant des cotisations à destination de la Sécurité sociale. L’émergence de revendications fortes et cohérentes est donc nécessaire pour éviter un tel sabotage. Sur le plan politique, la démission d’Emmanuel Macron, l’instauration du RIC et le passage à une VIème République seront indispensables pour mettre un terme à la dérive autoritaire actuelle. Sur le plan économique, les propositions de justice fiscale ne manquent pas, mais la seule redistribution ne saurait résoudre les maux de l’économie française, qui a également besoin de protectionnisme et d’investissements massifs pour la réindustrialisation. Des points sur lesquels l’apport d’intellectuels ou de personnalités politiques compétentes pourra être bénéfique.
Pour les partis et les syndicats, un équilibre à trouver
La question de l’articulation entre les organisations traditionnelles, notamment les partis et les syndicats, et la mobilisation d’un peuple largement non-encarté et non-syndiqué sera ici décisive. Chaque camp aura en réalité besoin de l’autre. D’une part, les participants au mouvement auront besoin de représentants et l’anti-parlementarisme est condamné à l’impasse : sans accès au pouvoir législatif, espérer transformer la société sera vain. De l’autre, les partis de gauche qui ont apporté leur soutien au mouvement ont tout intérêt à ne pas chercher à le noyauter et à le contrôler, faute de quoi ils accentueront le rejet à leur égard et se retrouveront avec leurs militants habituels, insuffisamment nombreux pour faire plier Macron. Sur ce plan, les premières déclarations – Jean-Luc Mélenchon parlant par exemple « d’aider et de servir le mouvement » tout en évitant toute «récupération » – sont plutôt encourageantes. Reste à savoir comment elles se traduiront par la suite.
Les stratégies obscures des centrales syndicales, souvent plus promptes à participer à n’importe quel « dialogue social » qu’à s’appuyer sur la colère populaire pour enclencher un bras de fer, leur ont fait perdre la confiance de nombreux salariés.
La même question se pose avec les syndicats, dont l’expérience peut être utile à des primo-manifestants et la présence, même réduite, dans des secteurs stratégiques (transport, énergie, raffinage, gestion des déchets…) décisive pour « tout bloquer ». Cependant, les stratégies obscures des centrales syndicales, souvent plus promptes à participer à n’importe quel « dialogue social » qu’à s’appuyer sur la colère populaire pour enclencher un bras de fer, leur ont fait perdre la confiance de nombreux salariés. Les leçons de l’échec de la mobilisation contre la réforme des retraites devront être tirées : alors que la victoire avait été obtenue dans les têtes, avec une très large majorité de Français opposés à une réforme dont ils avaient compris les enjeux, et à l’Assemblée nationale, puisque le texte n’a jamais été voté (il a été imposé par 49.3, ndlr), les syndicats avaient la responsabilité d’organiser la colère populaire en bloquant le pays. La majorité des citoyens y étaient prêts, comme en témoignent les journées de mobilisation rassemblant un, deux, voire trois millions de personnes dans la rue, et les dons historiques aux caisses de grève. Pourtant, les syndicats habituellement les plus combatifs, comme la CGT et Solidaires, ont préféré conserver l’unité de l’intersyndicale à tout prix, s’alignant ainsi sur la stratégie perdante de « grève perlée » promue par la CFDT.
Si Solidaires et la CGT, poussée par ses fédérations les plus combatives (chimie, mines et énergie, commerce), ont annoncé rejoindre le mouvement du 10 septembre en faisant grève, les autres syndicats ne se joignent pas à ces appels. Bien sûr, la perte de salaire et la répression patronale invitent à ne pas lancer des appels à la grève générale trop facilement, au risque de décourager les troupes. Au vu de l’atmosphère sociale, il semble pourtant que le fer est aujourd’hui chaud et qu’il n’attend plus que d’être battu.