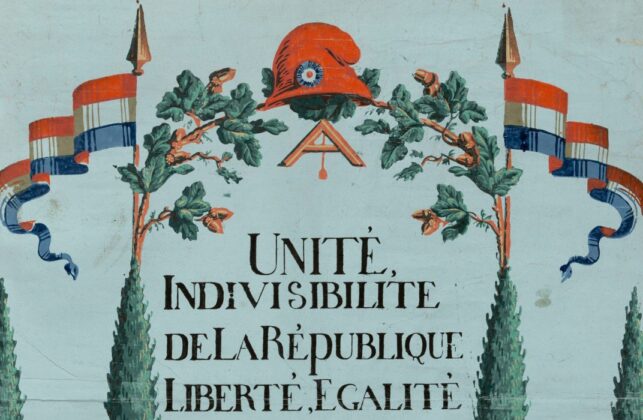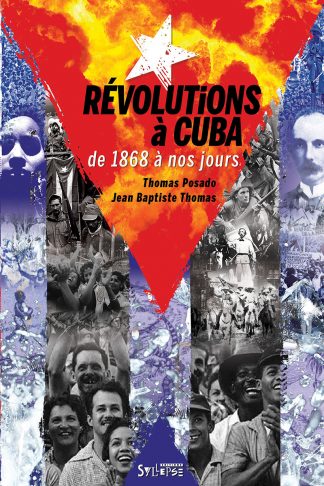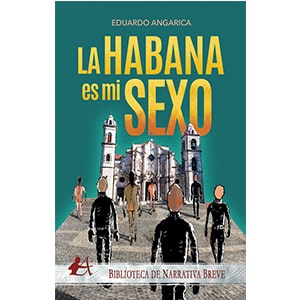Les sanctions économiques de grande ampleur sont devenues le moyen privilégié des États-Unis et de leurs alliés pour défendre leurs intérêts et écraser leurs adversaires. Parallèlement, la critique et l’opposition à ces mesures imposées de manière arbitraire ont fortement augmenté, surtout dans le Sud global, où elles sont considérées comme des interventions néocoloniales contraires au droit international. Avec la guerre économique contre la Russie, les conflits internationaux à leur sujet ont pris une nouvelle dynamique. Les mesures pratiques qui sont désormais de plus en plus adoptées dans le Sud global pour surmonter, contourner et prévenir les blocages économiques sont également dirigées contre la domination occidentale en général, accélérant ainsi les bouleversements vers un monde multipolaire [1].
Alors que jusqu’à la fin de la guerre froide, seuls quelques pays étaient confrontés à des sanctions économiques, ce chiffre a augmenté de 1990 à début 2023 pour atteindre 27% des pays du monde. Bien que le terme « sanctions » ne soit strictement correct que pour les restrictions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU, car elles seules sont généralement considérées comme légitimes. En réalité, nous sommes principalement confrontés à des mesures coercitives unilatérales des États-Unis, que l’UE soutient dans environ la moitié des cas. Celles-ci visent aujourd’hui, à divers degrés, plus de 40 pays, soit, en termes de population, un tiers de l’humanité.
Une arme utilisée depuis des décennies
Les pays les plus touchés aujourd’hui étaient toutefois déjà soumis à des blocages économiques de grande ampleur avant 1990 : La Corée du Nord, Cuba, l’Iran et la Syrie, ainsi que la Russie en tant que membre de l’Union soviétique. La Corée du Nord est soumise à des mesures d’embargo de la part des États-Unis depuis le début de la guerre de Corée en 1950 et à des sanctions de l’ONU depuis 2006. Combinées, elles reviennent à interdire presque totalement le commerce, les investissements et les transactions financières avec le pays.
Cuba est confronté depuis près de 60 ans à un blocus économique, commercial et financier, dans le prolongement des opérations militaires et de renseignement lancées par les États-Unis contre le gouvernement révolutionnaire à partir de la fin 1959, après la chute de la dictature de Batista. Ces mesures visent à provoquer un effondrement économique et à entraver le développement du pays. Comme dans les autres cas, elles servent également à la dissuasion. L’île ne doit en aucun cas servir de modèle aux autres pays pauvres du Sud. Avec les lois Torricelli et Helms-Burton de 1992 et 1996, Washington contraint également les entreprises et les institutions financières de pays en développement à participer au blocus par le biais de « sanctions secondaires », afin de complètement isoler l’île du système commercial et financier international.
L’Iran fait également l’objet de mesures de blocus d’une ampleur similaire. Les États-Unis les ont imposées à partir de 1979, après la chute du Shah Reza Pahlavi, leur principal allié dans la région, et n’ont cessé de l’étendre depuis lors. Depuis 1995, la République islamique est soumise à un blocus total, et des « sanctions secondaires » ont été instaurées pour en garantir le respect, comme le « Iran and Libya Sanctions Act » de 1996.
La Syrie est également confrontée à des mesures coercitives étasuniennes depuis 1979. Washington avait placé le pays sur sa liste des « promoteurs du terrorisme d’État » en cette année de bouleversements, en raison du soutien de la Syrie aux organisations palestiniennes et autres organisations anti-impérialistes.
Ces quatre exemples montrent déjà de manière évidente la nature et les objectifs des mesures coercitives occidentales, qui sont souvent justifiées officiellement par la menace supposée que représenteraient les pays visés en se basant sur les violations des droits humains et d’autres motifs similaires. Il s’agit manifestement d’affaiblir, de déstabiliser et d’obliger à changer de régime.
Même si elles sont désormais perçues de manière plus critique en Occident, les sanctions demeurent largement considérées comme un moyen efficace et légitime pour punir les violations du droit international et contraindre les pays à respecter les droits de l’homme. Cependant, en pratique, on observe que seules les puissances ou alliances économiquement dominantes sont capables d’imposer efficacement des mesures de blocus, sans jamais être elles-mêmes la cible de telles mesures, même lorsqu’elles commettent les pires crimes.
Excepté la guerre économique contre la Russie, ce sont surtout les pays les plus pauvres du Sud global qui font l’objet d’attaques économiques de la part des puissances impérialistes et des anciennes puissances coloniales.
Et évidemment, elles ne sont appliquées que dans la poursuite de leurs propres intérêts. C’est pourquoi les sanctions ne renforcent pas du tout la « force du droit », comme aiment à le prétendre certains responsables politiques, mais ne font qu’imposer la « loi du plus fort ». Elles restent donc des actes arbitraires, même dans les cas où les motifs invoqués semblent justifiés, et relèvent en fin de compte, selon Hans Köchler de l’Organisation Internationale pour le Progrès à Vienne, de « l’arsenal du droit de la force ».
Les blocus économiques sont également presque exclusivement imposés par les États-Unis et leurs alliés, et ce de plus en plus. Ils visent invariablement les pays considérés comme des adversaires ou des rivaux des États-Unis et de leurs alliés, ou qui ne veulent pas se soumettre assez volontiers à leurs intérêts économiques et géopolitiques. Si l’on fait abstraction de la guerre économique contre la Russie, ce sont en premier lieu les pays en développement les plus pauvres du Sud global qui font l’objet d’attaques économiques de la part des puissances impérialistes et des anciennes puissances coloniales. Leurs actions d’extorsion doivent donc également être considérées comme une forme de néocolonialisme.
Pour les États-Unis et l’UE, les mesures coercitives globales sont des moyens qui ne sont pas considérés comme des attaques militaires – elles représentent une alternative plus avantageuse avec des risques et des effets secondaires bien moindres pour les agresseurs. Comme ils agissent sans effusion de sang, il leur est plus facile de susciter un soutien public et d’atteindre leurs objectifs sans attirer trop d’attention Mais la situation peut rapidement se transformer en véritable guerre économique, tout aussi meurtrière et destructrice. En effet, ces mesures ont le potentiel de réduire à néant des décennies de progrès dans les pays concernés dans des domaines clés tels que les soins de santé, le logement, les infrastructures de base et le développement industriel. De plus, elles comportent toujours le risque d’une escalade vers une confrontation militaire ouverte.
L’arme la plus redoutable : les blocages financiers
Les États-Unis privilégient désormais le recours aux blocages financiers, allant de l’interdiction de certaines transactions à la fermeture de comptes, jusqu’à l’exclusion totale du marché financier étasunien. Ils s’appuient sur le rôle central des institutions financières étasuniennes dans le traitement des transactions financières transfrontalières et sur le rôle dominant du dollar américain en tant que monnaie de référence, de réserve et de transaction mondiale.
Pour les transactions internationales, il est généralement impossible de passer à côté des établissements financiers étasuniens. Cela donne aux autorités du pays de l’Oncle Sam de larges possibilités d’intervention. Elles sont justifiées par le simple fait que de passer par des comptes étasuniens ou d’utiliser le dollar place l’entreprise sous la souveraineté américaine, même si l’expéditeur et le destinataire sont situés dans d’autres pays et qu’il n’y a pas de lien avec les États-Unis. Les blocages dans ce domaine sont donc l’arme de sanction la plus efficace et la plus universellement applicable des États-Unis. Contrairement aux mesures d’embargo classiques, comme les restrictions aux exportations et aux importations, elles ont un impact considérable même sans soutien international.
Les sanctions financières sont l’arme la plus efficace et la plus universellement applicable des États-Unis. Contrairement aux embargos classiques, elles ont un impact considérable même sans soutien international.
Les blocages financiers jouent également un rôle essentiel dans l’application de « sanctions secondaires » visant à contraindre les personnes et les entreprises de pays tiers à se conformer aux règles étasuniennes en matière d’embargo. Les pays réfractaires risquent de se voir retirer leurs actifs, de payer de lourdes pénalités, voire d’être exclus des marchés américains. Les « sanctions secondaires » sont largement perçues au niveau international (y compris par l’UE) comme étant contraires au droit international.
En 1996, en réaction à la loi Helms-Burton contre Cuba, Bruxelles a adopté un règlement « de protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’actes juridiques adoptés par un pays tiers ». Il interdit même explicitement le respect de sanctions secondaires, mais reste totalement inoffensif, l’UE n’étant pas capable de protéger les citoyens et les entreprises de l’UE contre le chantage étasunien.
Dans la guerre économique contre la Russie, Bruxelles a commencé l’année dernière à menacer elle-même de « sanctions secondaires » les entreprises. Et les think tanks européens poussent les États de l’UE à miser encore plus sur la contrainte économique dans la poursuite de leurs intérêts économiques et géopolitiques. « Au siècle de la concurrence entre la Chine et l’Occident, l’empire de la géoéconomie constituera probablement le front central », explique par exemple le European Council on Foreign Relations dans une analyse d’avril 2023. Les auteurs se prononcent en faveur d’une « OTAN géo-économique », qui serait un forum pour l’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni, où ils pourraient coordonner les décisions relatives aux mesures économiques coercitives.
Conséquences mortelles
Parallèlement à l’extension des blocages économiques, la résistance envers ces derniers s’accroît. Elle s’enflamme principalement à cause des conséquences humanitaires désastreuses. Les critiques se sont multipliées, notamment à propos des conséquences catastrophiques de l’embargo imposé à l’Irak en 1990, qui a coûté la vie à plus d’un million d’Irakiens. L’embargo a été décrété par le Conseil de sécurité de l’ONU, mais sa levée a été bloquée par les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Même si elles ne sont pas aussi dévastatrices qu’en Irak, toutes les mesures économiques coercitives de grande envergure, dès qu’elles deviennent effectives, détériorent inévitablement les conditions de vie de la population. Les personnes pauvres, malades et âgées en souffrent particulièrement. De nombreuses études ont montré les effets négatifs majeurs, allant de la chute du revenu par habitant à la dégradation des soins de santé, ainsi qu’une hausse de l’extrême pauvreté, des inégalités et de la mortalité.
Les critiques se sont multipliées, notamment à propos des conséquences catastrophiques de l’embargo imposé à l’Irak en 1990, qui a coûté la vie à plus d’un million d’Irakiens.
La situation est encore aggravée par le fait que les États concernés sont généralement des pays en développement, déjà confrontés à des problèmes financiers et de développement. Les effets négatifs sur les populations des pays concernés ne sont en aucun cas des dommages collatéraux regrettables », mais font partie intégrante du calcul – contrairement à ce que l’on veut faire croire. En effet, la détérioration des conditions de vie est censée conduire à une pression publique sur le gouvernement pour qu’il cède aux exigences des puissances bloquantes, voire à un soulèvement, comme dans le cas de Cuba, de la Syrie ou de l’Iran par exemple.
Outre les organisations de défense des droits humains, des organisations des Nations unies telles que le Programme alimentaire mondial et l’UNICEF, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé, considèrent donc que les mesures économiques coercitives ne sont pas compatibles avec le droit international. Elles enfreignent, entre autres, les droits fixés dans la « Déclaration universelle des droits de l’homme » de 1948. Parmi ceux-ci figurent le droit à la vie, à une alimentation et à des soins de santé adéquats ainsi qu’à la sécurité sociale. En outre, ils violent clairement les dispositions contraignantes du « Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » de 1966, que tous les États occidentaux ont également signé. L’article 1 stipule que « En aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance ».
Déjà au début de l’année 2000, le célèbre juriste belge Marc Bossuyt, spécialiste du droit international, constatait dans une expertise pour la Commission des droits de l’homme de l’ONU : « La ‘théorie’ derrière les sanctions économiques est que la pression économique sur la population civile se traduit par une pression sur le gouvernement pour qu’il change sa politique. Cette théorie est un échec, tant sur le plan juridique que pratique ».
Au lieu d’inciter à la révolte ou même de faire tomber des gouvernements opposés, les sanctions ont, dans la plupart des cas, plutôt consolidé la position des élites dirigeantes.
Cette théorie est d’autant plus un échec, que même les blocages économiques de grande ampleur n’ont guère eu de succès jusqu’à présent, comme cela a été prouvé. Les objectifs n’ont été atteints que dans de très rares cas, où on a vu le comportement d’un État cible se modifier de la manière souhaitée. Ils n’ont jamais pu mettre fin à une guerre. Au lieu d’inciter à la révolte ou même de faire tomber des gouvernements opposés, ils ont, dans la plupart des cas, plutôt consolidé la position des élites dirigeantes.
Contre le droit international
En Occident, la critique des blocus économiques se limite principalement à leurs conséquences humanitaires et à leur manque de succès. Leur légitimité au regard du droit international n’est généralement pas remise en question, même par leurs détracteurs. Au lieu de cela, on réfléchit intensément à la manière d’utiliser la contrainte économique comme instrument sans s’exposer à des reproches sur ses effets trop négatifs.
Dans les pays du Sud, une vision totalement opposée prédomine. Les conséquences négatives y sont critiquées de manière bien plus ferme, tout comme l’ingérence prétentieuse de l’Occident. Les représentants du Sud mondial soulignent ainsi l’importance des principes de l’égalité souveraine entre tous les États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, des principes inscrits dans la Charte des Nations unies.
Dans les pays du Sud, une vision totalement opposée prédomine. Les conséquences négatives y sont critiquées de manière bien plus ferme, tout comme l’ingérence prétentieuse de l’Occident.
Ceux-ci ont été développés et ancrés dans le droit coutumier dans les années 1960 par une série de résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’interdiction d’intervention. Avec l’embargo étasunien contre Cuba, la lutte contre les mesures coercitives arbitraires a également été mise à l’ordre du jour. La « Charte des droits et obligations économiques des États », adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1974, stipule qu’aucun État ne peut recourir à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à se soumettre ou pour obtenir d’autres avantages de quelque nature que ce soit.
En décembre 1983, la majorité des États a voté en faveur d’une résolution de l’ONU visant directement « l’action économique comme moyen de coercition politique et économique contre les pays en développement ». Elle condamne la pratique des pays industriellement très développés qui profitent de leur position dominante dans l’économie mondiale par rapport aux pays en développement. À partir de 1987, de telles résolutions ont été présentées tous les deux ans par le « Groupe des 77 » et la Chine et ont été adoptées à une nette majorité. Ces résolutions ont notamment appelé la communauté internationale à « prendre d’urgence des mesures efficaces pour mettre fin à l’utilisation par certains pays industrialisés de mesures économiques coercitives unilatérales à l’encontre des pays en développement ».
Depuis 1996, une résolution supplémentaire est adoptée chaque année, présentée par le Mouvement des pays non-alignés (MNA), qui, sous le titre « Droits humains et mesures coercitives unilatérales », dénonce encore plus strictement les conséquences humanitaires de la pratique occidentale des sanctions et souligne encore plus clairement son incompatibilité avec le droit international et les droits humains universels.
Ces résolutions ont été précisées et élargies par la suite. La liste des violations et des effets néfastes, adoptée par l’Assemblée générale le 31 décembre 2022, s’est allongée et comprend désormais 34 points. Ainsi, les mesures coercitives arbitraires sont désormais également condamnées comme étant « le plus grand obstacle » à la réalisation du « droit au développement et de l’Agenda 2030 pour le développement durable ». Enfin, la majorité des membres de l’ONU réclame des contre-mesures efficaces et réaffirme son « engagement en faveur de la coopération internationale et du multilatéralisme ».
Le texte a été adopté par 123 voix pour et 53 voix contre. Le vote négatif des pays de l’OTAN et de l’UE et de leurs proches alliés, l’Australie, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Corée du Sud, n’a été suivi au Sud que par de petits États comme les îles Marshall, la Micronésie ou les Palaos, qui dépendent entièrement de l’Occident.
Se référant aux nombreux accords et décisions internationaux pertinents, la résolution justifie de manière convaincante que « les mesures et lois coercitives unilatérales sont contraires au droit international, au droit international humanitaire, à la Charte des Nations unies et aux normes et principes régissant les relations pacifiques entre les États ».
Les résolutions, formulées avec beaucoup de soin, reflètent la conception du droit international qui s’est développée dans le Sud global. Il s’agit notamment d’une interprétation large de l’interdiction d’intervention. Les résultats des votes montrent à leur tour le profond fossé qui sépare les pays du Sud de la vision qui prévaut en Occident.
L’ignorance de l’Occident
Malgré leur large soutien, les résolutions contre les mesures coercitives sont totalement ignorées en Occident. Les États-Unis les déclarent tout simplement non pertinentes, car elles remettraient en question le droit souverain des États à « organiser librement leurs relations économiques et à protéger leurs intérêts nationaux légitimes ». Selon eux, les sanctions unilatérales sont un « moyen légitime » d’atteindre « des objectifs de politique étrangère, de sécurité et d’autres objectifs nationaux et internationaux ».
Les États membres de l’UE partagent largement ce point de vue. Ils insistent également sur le fait qu’il ne saurait être question d’une contrainte contraire au droit international, relevant de l’interdiction d’intervention, puisque chaque pays est libre de décider avec qui il souhaite commercer et dans quelle mesure.
Les mesures de blocus imposées par l’Occident à la Russie ont beau être les plus complètes de l’histoire à ce jour, elles n’ont rien donné jusqu’à maintenant, bien au contraire.
Cependant, même les services scientifiques du Bundestag estiment que ce semblant d’argumentation n’est pas défendable. Ils soulignent que les mesures coercitives unilatérales sont perçues comme des « pressions extrêmes » et contreviennent à l’interdiction d’intervention dès lors qu’elles touchent aux intérêts vitaux d’un État et entravent de manière significative sa souveraineté. C’est notamment le cas des embargos occidentaux, vu l’énorme pouvoir de chantage économique des États-Unis et des anciennes puissances coloniales.
Quand les sanctions accélèrent l’avènement d’un monde multipolaire
Au vu du rejet majoritaire, il n’est pas étonnant que de nombreux pays aident depuis longtemps à contourner les blocages économiques. La guerre économique contre la Russie a donné une véritable impulsion à cette tendance. Les mesures de blocus imposées par l’Occident à la Russie ont beau être les plus complètes de l’histoire à ce jour, elles n’ont rien donné jusqu’à maintenant, bien au contraire. De plus, les pays de l’OTAN restent assez isolés dans leurs efforts. Seuls cinq pays en dehors de l’OTAN et de l’UE y participent plus ou moins activement : L’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Corée du Sud. Non seulement les autres États poursuivent leur coopération avec la Russie, mais ils l’ont même parfois intensifiée.
Dans ce contexte, l’Iran a pu récemment renforcer ses relations économiques et politiques internationales, d’une part en coopérant plus étroitement avec la Russie, mais surtout en développant sa coopération économique avec les pays asiatiques. La Chine est de loin devenue son plus grand partenaire commercial, tandis que l’Iran joue un rôle clé dans son initiative « La Ceinture et la Route » – souvent appelée la « nouvelle route de la soie » – en raison notamment de sa situation géographique.
L’Inde et d’autres pays asiatiques ont commencé à renforcer leurs relations de commerce et de coopération économique avec la République islamique, notamment en augmentant les importations de pétrole. En outre, l’Iran développe, en coopération avec ses voisins, de grands axes de transport sur son territoire et s’intègre ainsi de plus en plus dans sa région. En devenant membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai, l’alliance la plus importante d’Asie en matière de sécurité et de politique économique, il a pu institutionnaliser cette intégration. Enfin, la position de l’Iran vis-à-vis de l’Occident sera renforcée de manière décisive par son admission dans la communauté des États du BRICS (à l’origine Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).
Les sanctions économiques occidentales de plus en plus sévères, associées au gel des avoirs des pays visés, ainsi qu’à leur exclusion du système financier américain et du réseau de communication financière international SWIFT, alimentent le désir d’indépendance économique et financière vis-à-vis des États-Unis et de l’UE.
De nombreux pays s’efforcent désormais de se détacher du dollar et du système financier dominé par les États-Unis – souvent en collaboration avec la Chine, la Russie et l’Iran. Dans d’autres domaines également, on constate une coopération de plus en plus étroite entre les pays du Sud mondial afin de se libérer des dépendances vis-à-vis de l’Occident et de la tutelle occidentale. Les guerres économiques des États-Unis et de l’UE agissent manifestement comme des catalyseurs. Elles obligent de nombreux pays à coopérer, soit parce qu’ils voient le risque réel d’être eux-mêmes frappés, soit parce qu’ils veulent échapper au chantage des « sanctions secondaires », qui limitent leur souveraineté et leur portent préjudice sur le plan économique.