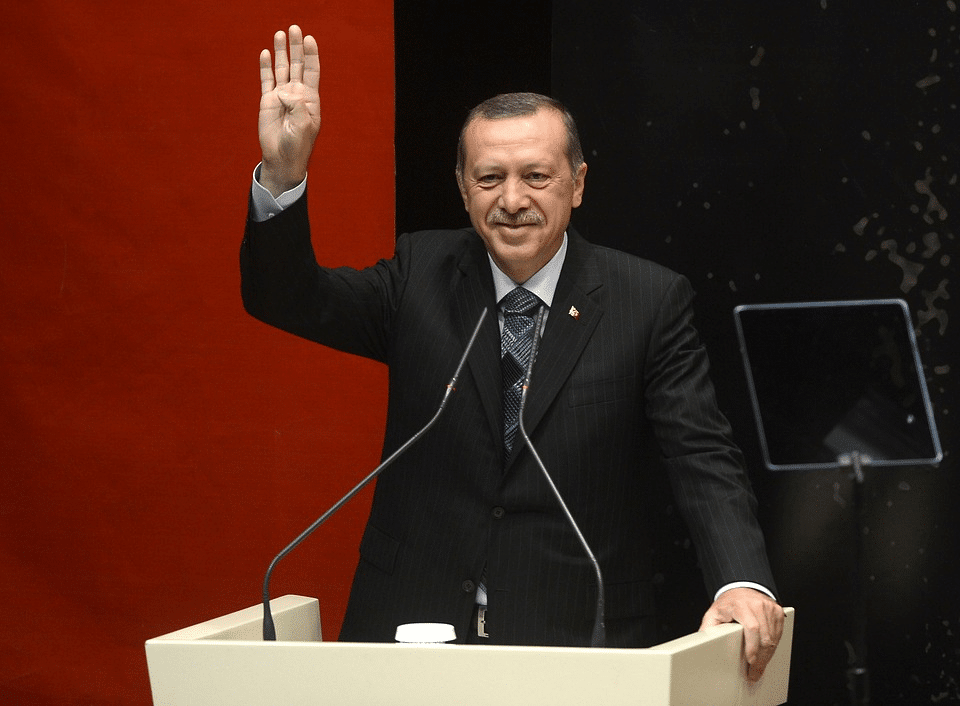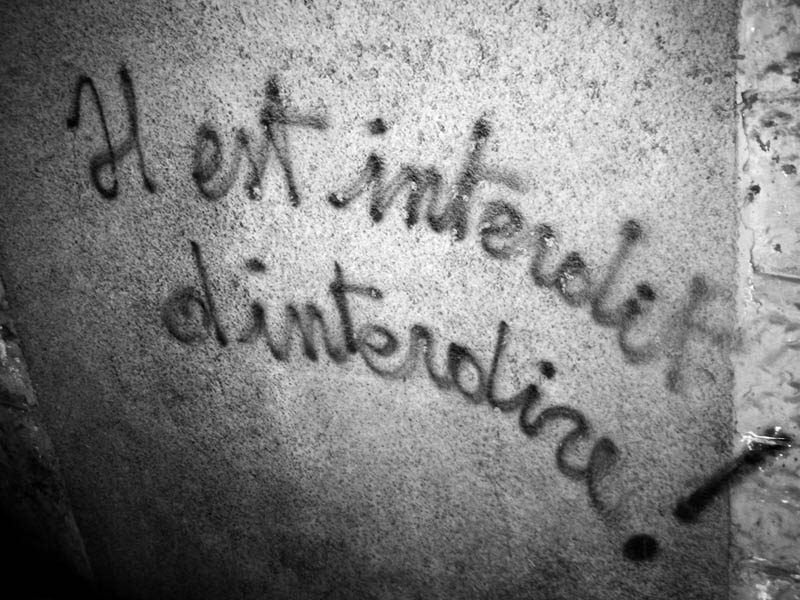À l’occasion de la parution de Généalogie de la religion, Nathan Devers et François Janay interrogent les tensions inhérentes au concept de religion. Nathan Devers est normalien et dirige le séminaire Heidegger à l’ENS.
François Janay – Vous commencez votre livre en disant que, pour étudier ce qu’est une religion, il est essentiel de dépasser une approche descriptive (« je suis juif » ; « moi chrétien » ; « je crois en la Trinité » ; « moi plutôt en ceci », etc.) qui répertorierait simplement les contingences liées aux différentes pratiques. Vous préconisez une approche beaucoup plus réflexive, capable d’expliquer à partir des textes de l’Ancien Testament l’existence de la religion parmi les hommes. Y a-t-il un enjeu à privilégier l’approche philosophique de la religion à l’approche relativiste de la religion, comme vous semblez le faire ?
Nathan Devers – Toute tentative de penser la religion se heurte à une difficulté préalable : la religion interdit les approches neutres. Il faut se positionner par rapport à elle avant même d’avoir commencé à la questionner. Si la religion est un système tissant des liens entre les domaines du divin et de l’humain, il importe au plus haut point de savoir dans quelle mesure celui qui l’étudie est lui-même déterminé par ces liens. Il s’ensuit qu’avant même de se mettre en marche, la pensée de la religion doit d’emblée choisir : sera-t-elle elle-même une pensée religieuse du religieux ? Dans ce cas, une certaine distance lui fera sans doute défaut et, trop occupée à vouloir affirmer la légitimité de son objet d’étude, trop investie dans une démarche apologétique, elle risquera de tourner en rond. Sera-t-elle, alors, une pensée irréligieuse ou areligieuse ? Cette posture d’extériorité, sinon de surplomb, ne va pas sans soulever d’autres écueils. Comment pourrait-elle étudier la manière dont la religion tisse des liens et cultive des appartenances, si elle ne pénètre pas d’abord son esprit et sa vie intérieure ? Nous cherchions un point de départ, c’est un dilemme qui s’offre à nous : la religion est soit mienne soit étrangère à mon existence, et cette alternative paraît indépassable.
Dans cette situation, la tentation serait grande de reconquérir une neutralité du regard, et de construire artificiellement l’objectivité qui nous manque. Et il y a, assurément, une position qui prétend répondre à une telle attente : l’idée de tolérance, qui suspend le problème de l’adhésion au religieux. À équidistance de l’approbation et du rejet, la tolérance aborde la religion sans avoir à s’engager face à elle. On comprend aisément ce que son paradigme comporte de séduisant, d’autant plus qu’elle présente un intérêt pratique indubitable (éthique, social et politique) : dans la suspension qu’elle instaure, la tolérance fait advenir une concorde provisoire. Mais cette dernière est une paix négative : elle s’en tient, en effet, au constat, presque photographique, d’une irréductible contingence.
F.J. – C’est donc dans ce cadre que vous semblez sceptique vis-à-vis du concept de tolérance, hérité des Lumières ? À première vue, cette remise en question est paradoxale, voire contestable.
N.D. – Mon enjeu n’était pas de réhabiliter l’intolérance face à la tolérance, mais de remarquer que, très étrangement, ces deux valeurs reposent sur le même principe, qu’elles se contentent d’exprimer autrement. La tolérance et son contraire, autrement dit, déclinent la même aspiration. Quelle est la formule de l’intolérance ? « Sois comme moi ! » Ainsi pense l’homme qui refuse d’accepter l’altérité (religieuse, idéologique, culturelle) de son prochain. Souvent, cette formule s’accompagne d’une menace : « sois comme moi, sinon je te tuerai, je t’ostraciserai, je te persécuterai, je te discriminerai. » L’intolérance cherche à ramener l’autre au même. Quelle est, pour sa part, la devise de la tolérance ? « Je te tolère, parce que tu es un homme, comme moi. » C’est sous cette forme, par exemple, qu’on la trouve chez Lessing ou Voltaire. La tolérance repose sur une assimilation générique à la condition humaine : tu as beau être musulman, catholique, juif, protestant ou athée, tu en demeures mon semblable, et c’est à ce titre que je te tolère.
La tolérance et son contraire s’appuient donc sur un socle commun : la logique de l’identification. Chez l’individu tolérant, elle se conjugue à l’impératif ; chez l’autre, elle est indicative ou descriptive. Dans les deux cas, il s’agit de refuser l’altérité en tant que telle, soit en la pointant du doigt, soit en l’absorbant sous une identité commune. La tolérance repose donc sur une indifférence à l’autre en tant qu’autre – indifférence certes bienveillante et pacifique, mais qui empêche, par exemple, de comprendre la religion dans sa densité propre.
Cette carence enraye le mécanisme de la tolérance qui, afin d’être effective, repose inévitablement sur un sacrifice de la compréhension : il faut, pour accepter les religions, s’interdire de penser le religieux en tant que tel. C’est précisément pour cette raison que j’ai commencé mon livre en congédiant la tolérance – mise à l’écart, qui, bien sûr, ne concerne pas sa valeur pratique, mais porte uniquement sur sa prégnance théorique. Il ne s’agit pas, évidemment, d’appeler à l’intolérance, mais de soutenir que, pour penser la religion, il importe au préalable de sortir du cadre théorique de la tolérance, tel qu’il a été façonné au XVIIIe siècle. Tel est le geste préalable pour appréhender ce que j’appelle l’intimité du religieux, c’est-à-dire pour tâcher de comprendre les tonalités humaines qui l’animent dans sa chair.
F.J. – En dehors de cette méthode négative, consistant à refuser de partir du relativisme pour appréhender le religieux, quelle est votre méthode positive dans ce livre ?
N.D. – J’ai essayé de court-circuiter cette difficulté en étudiant la religion depuis la perspective de sa naissance. Au lieu de la considérer comme fruit et résultat d’une histoire, je l’ai appréhendée comme source de celle-ci et comme processus. Substituer la constitution à la description, la généalogie à l’antinomie, voilà qui permet de montrer quelles tensions façonnent, de l’intérieur, la religion en tant qu’elle vient au jour. En l’occurrence, j’ai tâché de relire la naissance du monothéisme, telle qu’elle est racontée dans la Bible.
F.J. – Si nous résumons la généalogie que vous proposez, il s’agit de montrer que le monothéisme juif s’est constitué, dans l’Ancien Testament, à travers trois moments : la figure d’Abraham, qui a vécu sa foi de façon intime dites-vous, mais n’a pas fondé de religion à proprement parler, c’est-à-dire de lien social autour du judaïsme ; celle de Moïse, qui lui, réussit à créer ce lien social, qui crée le monothéisme juif autour d’un peuple mais, ce faisant, remplace la foi par la politique – et retombe donc dans l’idolâtrie. Enfin, troisième moment, la destruction du Temple par les armées de Nabuchodonosor, qui symbolise l’échec du projet mosaïque mais provoque un exil fécond pour le judaïsme. Néanmoins, plutôt que de penser que Moïse aurait trahi Abraham, est-ce qu’on ne pourrait pas appréhender ces deux figures comme complémentaires ?
N.D. – Abraham fonde le monothéisme à partir d’un double refus. Le refus de l’idolâtrie, et celui du politique. En s’arrachant à l’idolâtrie, Abraham ne se distancie pas seulement des cultes qui vénèrent des statuettes ou des astres, mais il rejette, plus radicalement, toute tentative de réduire Dieu à l’échelle humaine du visible et de la présence. Abraham, selon la formule bien connue, est l’athée des faux dieux. Parallèlement à ce positionnement, il s’émancipe aussi du politique, c’est-à-dire de toute démarche consistant à fonder une communauté humaine. Nomade, indifférent aux promesses d’une postérité nombreuse, Abraham décline toutes les propositions qui lui sont faites de participer, d’une manière ou d’une autre, à quelque fondation du politique. Ce double refus, tel qu’il se configure dans la trajectoire d’Abraham, n’est pas une convergence accidentelle, ni une cristallisation fortuite : il démontre, dans la Genèse, l’idée d’une consubstantialité de l’idolâtrie et du politique, qui seraient, chacun, l’envers masqué de l’autre.
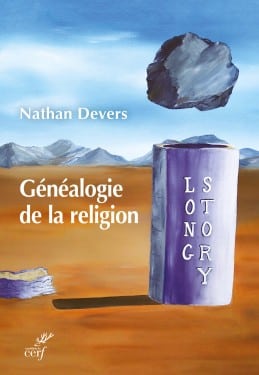
Or, il est évident que la posture d’Abraham ne peut pas se prolonger indéfiniment : elle tend vers un reflux du politique. Quelques générations suffisent en effet pour que la descendance des patriarches devienne nombreuse. Le monothéisme familial et nomade devient l’affaire d’une communauté, puis d’un peuple, et donc d’une politique. Cette métamorphose du monothéisme, Moïse est la figure qui l’incarne ; mais, à travers lui, c’est surtout l’époque mosaïque que j’ai voulu interroger – et ce à partir d’une question directrice : en réintroduisant le politique dans le monothéisme, cette époque ne réintroduit-elle pas l’idolâtrie ? Cette hypothèse me paraît confirmée dès l’Exode, où le rapport entre les hommes et Dieu se remodèle totalement. Le divin, jadis transcendant et caché, autrefois réticent à la présence et à l’apparition, lui qui optait jusqu’alors pour des manifestations discrètes (dans des songes, notamment), se dérobe soudain à l’absence. Auprès des Hébreux et devant les Égyptiens, il multiplie les miracles, ne cesse de mettre en œuvre des phénomènes surnaturels (depuis le buisson ardent jusqu’à l’ouverture de la Mer des Joncs, en passant par les dix plaies), élabore des stratégies politiques… Non que le divin disparaisse, mais il a désormais pour fonction de fédérer le social : il devient, en un mot, le lieu d’une sacralité. Pour ne donner qu’un exemple de cette inversion mosaïque, il est symptomatique de constater que le mot sacré (k-d-ch en hébreu) apparaît dans l’Exode, alors qu’il était pour ainsi dire absent de la Genèse.
Bien évidemment, les figures d’Abraham et de Moïse s’opposent parce qu’elles sont, en un sens, complémentaires. Et c’est en ce paradoxe que réside la tension profonde du phénomène religieux : sans Moïse et son époque, le projet d’Abraham n’aurait pu se prolonger. Avec lui, il se pérennise, accède à une existence stable et se déploie dans son être. Mais ce déploiement suppose une trahison des principes sur lesquels Abraham avait fondé le monothéisme. J’étudie cette révolution, dans mon livre, à travers quantité d’exemples. Pour n’en citer que quelques uns, on pourrait souligner que la place de Dieu dans l’économie de l’être est modifiée sous Moïse, que le rapport à la justice et la violence se bouleverse en profondeur, que l’idée même d’élection change de statut, ou encore que la superstition fait alors son entrée dans la Bible. Toutes ces oppositions structurelles au monothéisme patriarcal sont, paradoxalement, le vecteur de sa survie et de sa prolongation. Et c’est ce sacrifice du religieux sur l’autel de la religion que j’ai voulu interroger : Abraham donne au monothéisme sa possibilité, et Moïse lui confère sa réalité. Mais, en rendant réel le projet d’Abraham, Moïse le rend impossible. On pourrait dire, en ce sens, que les conditions de réalité du religieux sont en même temps ses conditions d’impossibilité.
F.J. – À travers Abraham et Moïse, n’y aurait-il pas deux visions radicalement opposées de la figure du grand homme ?
N.D. – Tout dépend de ce que l’on entend par grand homme. Si l’on considère, comme Carlyle, que « l’histoire du monde, c’est la biographie des grands hommes », si l’on tient donc ces derniers pour créateurs de leur époque, pour architectes du destin des peuples et des idées, alors je ne suis pas sûr qu’on puisse appliquer la catégorie de « grand homme » à la manière dont je dépeins Abraham et Moïse. Ma lecture de la Bible n’essaie pas tant de distinguer Abraham et Moïse en tant qu’individualités, mais bien davantage d’opposer les époques abrahamique et mosaïque. À savoir que Moïse et Abraham me paraissent moins fonder leur époque que la personnifier. C’est une affaire, me semble-t-il, d’incarnation, et on peut voir que la figure d’Abraham restitue, à elle seule, les nuances et les tensions de l’esprit patriarcal. Cette incarnation est encore plus flagrante dans le cas de Moïse : je m’efforce, dans mon livre, de montrer que ce dernier est l’homme de sa situation, prêt à assurer le tournant du politique et de la sacralité. Les grands hommes, pour cette raison, sont des bornes, des repères, des marqueurs posés sur le chemin de l’évolution structurelle du religieux.
F.J. – Vous affirmez qu’Abraham se caractérise par son désintérêt politique. Mais on pourrait vous répondre qu’il a reçu, lui aussi, la promesse d’une grande descendance, donc d’une collectivité à venir…
N.D. – Exactement. La promesse d’une postérité aussi foisonnante que la poussière de la terre constitue un motif récurrent dans l’existence d’Abraham. Autrement dit, Dieu éveille en lui le désir de fonder un peuple et de faire renaître le politique. Comment interpréter ce désir ? En remarquant, d’abord, que ces promesses de Dieu n’émanent pas d’une demande ou d’une inquiétude du patriarche. En soulignant, ensuite, qu’Abraham manifeste une certaine indifférence envers ces dernières : quand, au chapitre 13 de la Genèse, Dieu lui affirme qu’il confiera pour l’éternité la terre de Canaan à sa postérité, Abraham se contente d’aller dresser sa tente… Comme s’il feignait de n’avoir rien entendu. Comme si, plutôt, il cultivait une prudence exacerbée envers ce désir du politique.
Mais il faudrait également relever que, chez Abraham, le désir d’une autre politique n’a pas vocation à gagner la sphère de l’action. Bien évidemment, quand je soutiens qu’Abraham « sort » du politique, je ne veux pas affirmer par là qu’il s’isole dans une grotte ou sur une montagne, à la manière du Saint Antoine de Flaubert ou du Zarathoustra de Nietzsche. Abraham, tout au long de son existence, continuera d’avoir des interactions avec ses semblables – et, parfois même, avec des hommes politiques : pendant la guerre des rois (Genèse 14), pendant ses séjours en Egypte et au royaume de Gherar. Mais il s’efforce toujours, dans de telles circonstances, de déminer la relation de ce qu’elle pourrait avoir de politique. Abraham, en un mot, se contente de poser les conditions de possibilité d’une politique monothéiste – reste à savoir si, quand cette politique adviendra, elle s’établira depuis ces conditions ou si elle les décomposera.
F.J. – Finalement, tout au long de votre peinture démystifiante de Moïse, on songe à un paradoxe : comment Moïse a-t-il réussi à fonder une collectivité, et à agir comme un chef politique, alors que son peuple est un peuple à l’état nu, c’est-à-dire sans institutions, sans terre, et sans État ?
N.D. – C’est tout le talent politique de Moïse : parvenir à diriger un peuple auquel il n’appartient plus vraiment (étant donné qu’il grandit parmi les Égyptiens), et être en mesure de le politiser. Pour comprendre ce paradoxe, il faut à mon avis prêter attention à deux phénomènes. Premièrement, le peuple des Hébreux, en plus d’être politiquement nu, est asservi en Égypte. Il se lamente, s’afflige, souffre. Autrement dit, il aspire à l’émancipation. Deuxièmement, tout au long du récit biblique, Moïse ne cesse de s’exposer à la résistance de son peuple, qui refuse souvent d’épouser sa démarche, de respecter ses lois, de suivre sa direction… Il y a, autrement dit, une friction permanente entre les Hébreux et leur premier chef. Mais cette friction ne doit pas faire perdre de vue l’essentiel : à savoir que la politisation incarnée par Moïse obéit à une condition. Il faut que les Hébreux puissent se réunir autour d’une divinité fédératrice. La divinité patriarcale était inapte à cette communion : recluse, mystérieuse, retirée du naturel, non législatrice, objet de vénérations spontanées… Si Moïse parvient à ses fins, c’est parce qu’il incarne un autre rapport au divin, beaucoup plus solennel, où Dieu se manifeste par des miracles éclatants, où il est associé à des endroits sacrés, où il est à l’origine de centaines de lois…
F.J. – Auguste Comte allait même plus loin, arguant que le judaïsme n’existait pas en tant que tel, ou que ce n’était pas un vrai monothéisme, mais plutôt une théocratie conduite par Moïse – qui, certes, avait pour ambition de donner un monothéisme à son peuple. Reprenez-vous en quelque manière cette interprétation ?
N.D. – Cette interprétation se trouve déjà chez Spinoza. Au chapitre XVII du Tractatus theologico-politicus, il montre en effet que les Hébreux, à leur sortie d’Égypte, se sont libérés de toute législation étrangère, désireux de se soumettre uniquement à la loi de Dieu, c’est-à-dire de lui transférer tout leur droit. Or, Spinoza remarque que, dès leur première entrevue avec Dieu, les Hébreux « furent frappés d’épouvante » et demandèrent à Moïse d’aller écouter Dieu à leur place, pour leur transférer ses ordres. Pour Spinoza, cette transition est décisive : désormais, le rapport entre les Hébreux et Dieu est médiatisé par la figure de Moïse, qui seul peut interpréter la loi divine. Loin d’être un simple messager, Moïse devient le véritable souverain : « Il régnait sur les Hébreux à la place de Dieu », écrit Spinoza. Les conséquences de ce déplacement de souveraineté sont majeures : dès lors, quiconque prétendrait être également prophète serait considéré comme un usurpateur (et, si besoin, mis à mort).
Une théocratie conduite par Moïse, mélange de monarchie et de souveraineté divine, travestissant le monothéisme : les contradictions soulevées par cette transition sont plurielles. Et il serait inadéquat de tenir Moïse pour seul responsable de cette situation : Spinoza montre que c’est le peuple des Hébreux qui décida de lui octroyer un tel pouvoir, parce qu’il ne se sentait pas en mesure de faire face à Dieu. Dès lors, il y a, comme vous le dites, conflit entre l’ambition et les moyens de sa réalisation – et voilà pourquoi le concept de théocratie est intrinsèquement impossible à penser.
F.J. – Nous aimerions également vous poser une question sur la naissance même du monothéisme dans la Bible. Il y aurait selon vous des reliquats de polythéisme dans le monothéisme juif. Pouvez-vous revenir sur ce point ?
N.D. – Cette idée ne vient pas de moi, mais de la critique biblique, qui soutient que le premier chapitre de la Genèse a pour but de fonder le monothéisme en multipliant les allusions à des éléments et à des mythes polythéistes. À en croire Thomas Römer, par exemple, la cosmogonie biblique inclut les mythologies polythéistes, leur offre un espace textuel. Reste à savoir comment interpréter cette inclusion. Il me semble, pour ma part, qu’elle est le marqueur d’une antériorité du polythéisme sur le monothéisme. Cela signifie, tout d’abord, que le second naît dans le creuset du premier. Le monothéisme, autrement dit, advient négativement, en s’arrachant à une configuration du monde où les dieux recouvrent toutes les régions des choses. Mais cette antériorité signifie également que, même lorsque le monothéisme s’extirpe du polythéisme, il demeure, consciemment ou non, tributaire de certains réflexes, de certaines dispositions issues de la terre natale qu’il a fuie. Abraham, par exemple, conserve, jusqu’à la ligature de son fils, une propension sacrificielle trouvant sa source, selon certains commentateurs, auprès des Chaldéens.
F.J. – Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la généalogie du monothéisme juif en particulier ?
N.D. – L’horizon de mon livre était d’essayer d’appréhender le concept de religion depuis son intimité, et de le saisir en sa singularité, pour le dissocier notamment des autres formes de rapports au divin. Mais il m’a paru que ce concept était inaccessible de manière immédiate. D’où la nécessité d’en passer par une généalogie singulière, celle de l’apparition du monothéisme dans l’Ancien Testament. Pour parler comme Fink, la religion était le concept topique, et le monothéisme biblique le concept opératoire.
Pourquoi donc la définition du religieux n’est-elle pas à portée de main pour la pensée ? Kant disait qu’un raisonnement philosophique doit éviter de partir des définitions, car ses concepts ne peuvent pas être saisis originairement. Faute d’être immédiatement donnés dans leur pleine et entière signification, ils doivent être conquis en leur sens. En l’occurrence, le mot de religion est, dans la langue quotidienne, employé, sinon avec gratuité, du moins avec une certaine facilité, pour désigner n’importe quelle forme de rapport que l’homme peut nouer avec Dieu. Si on se contente d’une telle position, on aura le plus grand mal à distinguer la religion de la croyance, de la théologie, du théologico-politique ou de la mystique – et, par conséquent, on sera incapable ne serait-ce que de poser la question : « Qu’est-ce que la religion ? »
Or, le terme de « religion », loin d’être vierge, charrie une historicité propre. Il véhicule, en son cœur, des strates de déterminations et un fleuve sémantique. Je prends soin, pour ma part, de distinguer deux concepts : d’une part, ce que j’appelle la relation (ou structure) humano-théologique, qui désigne toute spiritualité ou toute organisation sociale qui intègre une dimension de divin ; de l’autre, la religion en tant que telle, qui est une configuration très précise et très spécifique des structures humano-théologiques possibles. Quelle est donc la singularité du religieux par rapport aux autres liens envisageables avec le divin ?
Derrida faisait remarquer, et il avait raison, qu’on parle latin quand on évoque la religion. On aura donc le plus grand mal à utiliser ce mot pour renvoyer à n’importe quelle attitude envers Dieu. Encore faut-il, avant de délimiter l’extension et le champ d’application de ce concept, le déterminer précisément. En l’occurrence, le mot « religion » fait l’objet de deux étymologies possibles. Il viendrait, selon Cicéron, de relegere (terme qui, rigoureusement, serait intraduisible dans le De natura deorum, mais que l’on peut rendre par « recueillir »), et selon Lactance de religare (« relier »). La religion se caractériserait donc par l’acte de recueillir le divin ou de se relier à lui – mais comment trancher cette équivoque ? Derrida, dans Foi et Savoir, se proposait de la dépasser : l’important n’est pas le radical (legere ou ligare), mais le préfixe « re– ». C’est ce qui lui permettait de définir la religion par son « retour » entre les deux veines complémentaires et opposées qui la caractérisent. La religion, en somme, souligne une relation qu’elle avait tracée autrement, elle repasse toujours sur elle-même en recommençant autrement ce qu’elle avait fondé jadis.
Dans mon livre, j’ai voulu tenir compte de l’historicité propre au concept de religion. C’est pourquoi il m’était impossible de partir d’une définition, dont l’objet aurait été inévitablement prisonnier avant même d’être déterminé. J’ai essayé, au contraire, de construire la religion, non pas a priori dans l’intuition, comme le font les concepts mathématiques, mais généalogiquement, c’est-à-dire dans sa temporalité. Et cette généalogie m’a également conduit à définir la religion depuis ce que j’appellerais son être-retourné. La religion désigne, à ce titre, une structure humano-théologique où règne un décalage temporel entre son initiateur spirituel et son fondateur politique : pour le judaïsme, entre Abraham et Moïse ; pour le christianisme, entre Jésus et son institutionnalisation lente et graduelle… C’est dans ce décalage que surgit la tension dont la religion aura à se nourrir, le conflit dont elle fera sa moelle. Toute la question sera ainsi de savoir comment elle pourra mettre en marche la charge de vie contradictoire et la densité plurielle dont elle s’est investie.
F.J. – Nous voudrions maintenant revenir sur le projet plus global de votre livre. En vous lisant, on se pose nécessairement la question de votre discipline, qui rejoint celle de votre méthode : est-ce de la théologie, de la philologie (vous revenez sans cesse sur des épisodes de l’Ancien Testament), de la philosophie, de la sociologie (il y en a parfois), voire de la psychologie ? On s’étonne du nombre de passages où vous essayez d’analyser les réactions d’Abraham et Moïse au prisme de la psychologie individuelle…
N.D. – La méthode généalogique a pour fonction de « relire » les phénomènes qu’elle étudie (la religion, la morale, l’objectivité scientifique, etc.). Cette relecture est double : elle veut dire qu’on les lit une deuxième fois, mais qu’on les lit également à l’envers, à rebours de ce qu’ils montrent. Nécessité, donc, de restituer cette historicité en croisant les perspectives. Pour mettre en place ma généalogie, il m’a fallu en revenir au texte biblique – et tâcher d’y étudier la naissance du religieux dans toutes ses dimensions : politique, sociologique, psychologique. La généalogie, à ce titre, est une compromission de la philosophie, une incitation à sortir de son domaine pour s’engager ailleurs, dans d’autres disciplines, dans une convergence de regards, et ce afin de rendre aux phénomènes leur ramification de visages. Dans la généalogie, la philosophie ne surplombe plus les savoirs qui seraient ses concurrents. Elle s’essaie en eux, tente de les convoquer, de les interroger chacun, et de leur demander ce qu’ils ont à dire pour répondre à la question posée.
Un mot seulement sur la théologie. Vous ne trouverez pas, dans mon livre, une seule page « théologique ». Vous ne trouverez pas un seul passage où je cherche, sinon à trancher, du moins à soulever le problème de Dieu, c’est-à-dire à positionner le divin par rapport à l’être. Et pour cause : ces deux questions, celle de la religion et celle de Dieu, me paraissent distinctes. Non que Dieu soit l’absent de la religion. Mais il n’importe pas d’en découdre avec lui pour appréhender celle-ci. Cerner le religieux, en effet, ne suppose pas de déterminer si Dieu est, s’il n’est pas ou s’il précède l’être, mais de savoir comment il s’intègre à l’économie du monde religieux, comment sa révélation peut changer de modalité, comment ses attributs peuvent s’intervertir, comment il peut entretenir plus ou moins de distance envers les aspirations humaines. Cette économie-là, parce qu’elle est « historiale », comme dirait Heidegger, en dit plus sur les hommes que sur le divin en tant que tel.
F.J. – Vous préconisez d’ailleurs une « lecture naïve de la Bible ». Mais c’est une question que beaucoup de jeunes chrétiens se posent aujourd’hui : la Bible doit-elle se lire avec les éclairages des exégètes ou bien de façon personnelle – en acceptant que « chacun de nous [mette] son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens » comme l’écrivait Proust ?
N.D. – La question que vous me posez revient, au fond, à se demander à quelle norme doit se soumettre l’interprétation d’un texte, quelle méthode doit adopter une herméneutique. Je n’opposerais pas, pour ma part, l’exégèse à une lecture personnelle, et ce pour deux raisons. D’abord parce que l’exégèse est, telle qu’elle se constitue, dans ses controverses et ses oppositions, dans sa polyphonie et son déploiement, une réunion de lectures personnelles, le plus souvent discordantes et trouvant, tantôt, un rare îlot d’unanimité. Ensuite, parce qu’une lecture personnelle n’est jamais vierge ou immédiate. Elle est, qu’elle le sache ou non, toujours captive d’une armature historique, d’un tissage conceptuel.
La « lecture naïve » que je préconise dans mon livre ne désigne absolument pas un rapport capricieux aux œuvres qu’on veut commenter. Cette naïveté ne saurait consister en une facilité. Elle ne revient pas du tout à croire que les textes, qu’ils soient bibliques ou non, sont les miroirs de l’imagination du lecteur, de ses intuitions arbitraires et de ses projections fantasmatiques. Bien au contraire, elle est une exigence de précision, une borne rigoureuse, une frontière protégeant la lecture de ses anarchies.
Nous savons que la Bible est un livre sémantiquement ouvert, parsemé de trous, de blancs, d’ellipses, de zones de mystère. D’où la nécessité fondamentale, pour la lire, de l’interpréter – et de l’interpréter en tâchant de faire jaillir du sens parmi ses interlignes, de transmuer ses marges en autant de commentaires potentiels. Comment, concrètement, peut se déployer une telle démarche ? En traquant les allusions. En cherchant des symboles. En frottant les textes les uns contre les autres, en les forçant à se mettre en rapport, en les obligeant à se confronter, en y décelant des correspondances ou des décalages. En tâchant de faire parler la Bible dès lors qu’elle est muette : quand elle fait l’économie d’une information, quand elle ne raconte pas un événement, quelle est la signification de son silence ? Il s’agit, en somme, de soumettre le texte à une succession de relectures infinies.
Cette ouverture sémantique soulève évidemment un problème décisif : si la Bible n’a pas une signification unique, peut-on lui faire dire n’importe quoi ? Peut-on tirer la couverture vers soi et tâcher d’extorquer à la Bible les vérités qui nous confortent ? Je remarque que, très souvent, les exégètes se sont arrangés avec la Bible : à chaque fois que sa signification littérale les dérangeait pour une raison ou pour une autre, ils s’efforçaient de la nier au forceps de leur interprétation, aussi intelligente fût-elle. À plusieurs reprises, les commentateurs, face au texte biblique, sont plongés dans l’embarras : soit qu’un verset invite au meurtre, soit qu’il établisse des sanctions capitales, soit qu’il paraisse contradictoire avec tel ou tel point de doctrine. Pour résorber ce malaise, ils utilisent parfois un procédé consistant à soutenir que la Bible dit ce qu’elle ne dit pas, et qu’elle ne dit pas ce qu’elle dit, tout en le disant quand même… Par exemple, quand le Deutéronome dispose que les enfants rebelles doivent être lapidés sur la place publique, les exégètes furent confrontés à une réelle difficulté. S’ils s’en étaient tenus au sens brut de ce passage, alors leur interprétation aurait eu une conséquence directe : les enfants rebelles devraient, soit être mis à morts, soit être tenus pour potentiellement passibles d’une telle sanction. C’est ainsi que, pour résorber cette difficulté, le traité Sanhedrin du Talmud propose un exercice d’interprétation fallacieuse : il s’efforce, non sans une virtuosité extrême, de faire dire au Deutéronome le contraire de ce qu’il dit – à savoir que, selon les commentateurs du Talmud, l’enfant rebelle correspondrait à un cas purement hypothétique. De la libre interprétation, on est alors passé à la négation de la signification littérale. Ici, il ne s’agit plus, pour l’exégèse, de chercher un double sens, mais de camoufler le sens premier.
La lecture naïve que je préconise consiste à imposer une règle à l’interprétation : même si les livres sont sémantiquement ouverts, même si l’on peut puiser en eux des myriades d’interprétations possibles, on ne peut pas leur faire dire le contraire de ce qu’exprime leur sens littéral. La posture naïve, ainsi perçue, ne s’oppose pas à l’exigence de l’intelligence, mais à la licence que s’octroie la ruse. Elle n’est pas manipulable à loisir, mais vise, au contraire, à se protéger des tromperies, à ne pas être dupe des beaux esprits. Elle incarne, à ce titre, une modalité de la prudence.
Une dernière remarque sur ce problème : les enjeux relatifs de l’interprétation de la Bible ne soulèvent pas seulement un problème d’exégèse. Ils sont peut-être le vestibule de la métaphysique. Nietzsche avait identifié ce dont cette logique du double sens était le vestibule, lui qui écrivait que « la métaphysique explique (…) le Livre de la nature, comme l’Église et ses docteurs le faisaient autrefois de la Bible. »
F.J. – Vous n’hésitez pas non plus, afin d’interpréter les grands épisodes bibliques, à faire des analogies avec des ouvrages non-religieux de la modernité (théâtre de Marivaux, Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand…). Comment le justifiez-vous ? Ne faudrait-il pas faire l’inverse ?
N.D. – Je ne pense pas qu’il faille opposer frontalement ouvrages « religieux » et « non-religieux ». Sur quel critère pourrait s’établir une telle démarcation ? Il pourrait s’agir, par exemple, de dessiner cette démarcation de manière thématique : religieux seraient les livres qui parleraient de Dieu, du sacré, etc. Non-religieux seraient ceux qui développeraient des sujets profanes : sexualité, relations de pouvoir, stratégie militaire, rivalités personnelles… Or, la Bible regorge de motifs « profanes » et, s’il fallait s’empêcher d’y prêter attention, le risque serait grand de recouvrir notre lecture d’une pudeur superstitieuse et aveugle. Si j’ai donc, à plusieurs reprises, convoqué des textes littéraires, ce n’était pas pour amalgamer profane et sacré, mais au contraire pour tenter de faire ressurgir l’imaginaire de la narration biblique.
Je vais vous donner un exemple, peut-être le plus parlant. Il y a un passage, dans la Bible, où Abraham, à deux reprises, fait croire qu’il n’est pas le mari de sa femme – et conduit donc cette dernière à se faire épouser par des monarques locaux, et à partager leur couche. Cet épisode est naturellement déroutant : étant donné que cet événement advient deux fois, on ne peut pas invoquer, pour l’expliquer, un quiproquo entre les protagonistes ou une simple erreur de jugement de la part du patriarche. Pourquoi donc Abraham pousse-t-il son épouse à se retrouver dans le lit d’un autre ? Pour interpréter ce comportement, il m’a semblé pertinent de le mettre en perspective avec deux textes de la littérature dite « profane » : l’histoire du roi Candaule, telle qu’elle est rapportée par Hérodote ; l’Histoire d’O, où l’on voit comment le don de la liberté sexuelle peut exprimer une domination paradoxale.
F.J. – À propos de « résurgence biblique ». Vous développez assez longuement un point sur l’épisode de Babel. Beaucoup d’auteurs, les romanciers réalistes notamment, ont vu dans les villes un lieu infernal où s’exacerbaient les luttes de classes, où mourait la spiritualité, et où le matérialisme le plus sauvage opprimait les aspirations les plus idéalistes. Est-ce une résurgence de l’épisode de Babel, que vous interprétez comme le premier épisode d’urbanisation malheureuse, qui éloigne les hommes de Dieu ?
N.D. – Si l’on s’en tient à une lecture littérale de la Bible, la seule faute des hommes de Babel est celle de l’urbanisation. Point de haine du prochain chez eux, point de meurtres en série ou d’injustice sociale, mais seulement la volonté de réunir les hommes autour d’une tour. D’où la thèse, en effet, selon laquelle la ville est le lieu, par excellence, de l’idolâtrie – et d’où la fertilité de ce motif dans l’histoire des idées, où l’idolâtrie sera remplacée par l’aliénation (Marx), la mondanité (Rousseau), l’ambition (Balzac), etc. J’aime beaucoup, pour ma part, cette phrase de Rousseau : « les villes sont le gouffre de l’espèce humaine. » Gouffre n’est pas nécessairement péjoratif, ici. Il s’agit seulement de souligner que les villes sont inséparables d’un vertige. Qu’elles soient une modélisation de l’existence où l’angoisse peut se manifester dans toute sa nudité.
F.J. – Vous avez essayé, dans votre livre, de définir la religion à partir de tensions fondatrices : entre la foi et le sacré, entre la solitude mystique et l’institutionnalisation politique, entre la violence et son rejet. Pensez-vous que ces tensions du religieux sont à l’œuvre aujourd’hui ? Pensez-vous qu’elles sont encore lisibles dans les religions contemporaines ?
N.D. – Si la religion est, ainsi que je la définis, sempiternellement scindée entre deux veines qui s’entrelacent, se combattent, se tressent et se contrarient en elle, si elle est donc l’arène où se déploie une contradiction vivante, cette situation de déchirement interne éclaire sans doute le problème de la « revendication » : une religion est-elle responsable des actions qui se revendiquent d’elles ? Ces questions ont été, il y a quelques années, soulevées dans le débat médiatique à propos de l’islam, mais elles le furent, quelques siècles auparavant, au sujet du christianisme et elles le seront sans doute, dans un avenir plus ou moins lointain, à propos d’une autre religion.
Dans le débat médiatique, j’ai noté que la notion de « revendication » était interrogée à travers le concept d’amalgame. Quand un attentat islamiste était commis, ses auteurs ne prétendaient pas agir au nom de l’islamisme, mais au nom de l’islam. D’où la question de la valeur de cette revendication : dans quelle mesure la religion revendiquée est-elle impliquée par celui qui s’en revendique ? Cette question, parce que mal posée, donnait lieu à des débats interminables. D’un côté, certains appelaient à faire l’amalgame entre islam et islamisme, arguant que certains passages du Coran invitaient au meurtre. De l’autre, des voix s’élevaient pour éviter cet amalgame, citant d’autres passages du Coran, contredisant les premiers. Ainsi sont nées des ratiocinations qui se prolongent encore aujourd’hui, dissertant dans le vide, au forceps d’un indigeste concours de citations.
L’amalgame, invoqué dans ces circonstances, répond-il seulement au problème ? Comme le rappelait très justement Didier Pourquery, l’amalgame désigne initialement les alliages métalliques, et la signification politique de ce terme fut longtemps méliorative, notamment dans le cadre de la lutte antiraciste. À proprement parler, donc, le melting pot américain est un amalgame, aspirant à brasser les singularités des nations du monde au sein d’une nouvelle espérance. Quant à la religion, parler en termes d’amalgame reviendrait, par exemple, à se demander : la violence et la religion sont-elles séparées, ou bien, sinon synonymes, du moins indissociables ? La religion engendre-t-elle vraiment les violences qui se déploient en son nom sur le théâtre de l’histoire ?
On voit bien que, dans ce genre de débats, aucun concept n’est interrogé : ni celui de religion, ni celui d’amalgame, ni celui de revendication. En l’occurrence, si l’on perçoit qu’au sein de la religion, deux schèmes (à savoir deux configurations indépendantes des circonstances empiriques) s’opposent et se complètent, si l’on note que ces deux schèmes, dans leur lutte, ne parviennent jamais à porter le coup fatal à l’autre, si l’on s’avise du caractère interminable de ce combat, si l’on définit donc la religion comme fondamentalement double, il s’ensuit qu’elle ne peut tout simplement pas être interrogée à travers le concept d’amalgame, ni vraiment depuis la notion de revendication. Le fond du problème, en cela, c’est que la religion est confrontée à l’impossibilité de son incarnation : aucune action, aucun discours, aucune figure, ne pourront l’exprimer autrement qu’à moitié.