Mi-janvier, l’Équateur contractait un prêt de 3,5 milliards de dollars auprès des États-Unis. En contrepartie, il s’engageait à rompre tout commerce avec la Chine dans le domaine des télécommunications. Plus récemment, la quasi-totalité de la presse équatorienne affirmait qu’Andrés Arauz, le candidat soutenu par l’ancien président Rafael Correa, entretenait des liens avec un mouvement de guérilla colombien. Elle reprenait ainsi une accusation régulièrement émise par des responsables américains. Plus que toute autre, cette élection présidentielle du 7 février se déroule dans l’ombre de Washington. Elle est le dernier acte d’un long processus, entamé avec l’élection de Lenín Moreno en avril 2017, au cours duquel les États-Unis n’ont reculé devant aucun moyen – judiciaire, financier, médiatique ou militaire – pour ramener dans leur giron ce pays récalcitrant. En quatre ans, ils ont démantelé les principales réalisations de la « révolution citoyenne » menée par Rafael Correa.
Nous retrouvons Virgilio Hernandez dans un café de Quito. Cet ex-conseiller ministériel, proche de Rafael Correa et démissionnaire du gouvernement de Lenín Moreno, a été condamné à une peine de prison pour délit de rébellion avant d’être remis en liberté conditionnelle. Comme tant d’autres, il dénonce une chasse aux sorcières menée par les juges équatoriens contre les « corréistes » ; une « guerre judiciaire », surnommée lawfare (contraction de law et warfare). Aussitôt arrivé, il s’excuse : « Je dois signaler ma présence au parquet, comme chaque semaine. C’est un passage obligé de cette persécution judiciaire. Vous m’accompagnez ? ».
Nous entrons dans un bâtiment imposant, où il signe une déclaration. À son pied droit un GPS est attaché, condition sine qua non pour échapper à la prison. Il relativise la gravité de son cas : « Paola Pabón, la préfète de Pichincha [la région équatorienne autour de Quito NDLR] doit signaler sa présence trois fois par semaine au parquet ».

Comme Virgilio Hernandez, Paola Pabón fait partie des démissionnaires de la première heure du gouvernement de Lenín Moreno. Comme lui, elle est accusée par le parquet d’avoir partie liée aux protestations massives survenues en novembre 2019 et vit en liberté conditionnelle depuis un an.
Pour une mise en perspective des soulèvements de 2019, lire sur LVSL l’article de Pablo Rotelli, Vincent Arpoulet et Nicolas Netto Souza : « Le bloc néolibéral vacille sous le coup des révoltes ».
Le pouvoir judiciaire, bras armé de la doctrine Monroe ?
Tous deux ont ressenti la vague de procès qui a frappé les adversaires du gouvernement comme une onde de choc. Sous le prétexte de lutter contre la corruption d’une ampleur exceptionnelle qui aurait gangrené le gouvernement de Rafael Correa, les principaux leaders « corréistes » ont été condamnés à de lourdes sentences.
Dans le système médiatique équatorien, les fonds et réseaux issus des États-Unis sont loin d’être absents. Ils transitent notamment par la National Endowment for Democracy (NED), organisme américain subventionné par le Congrès, dont le but affiché est de « soutenir la liberté à travers le monde ».
Rafael Correa lui-même, résidant en Belgique, écoperait de huit ans de prison s’il revenait en Équateur. Il a été condamné dans le cadre du scandale Oderbrecht, qui implique la multinationale brésilienne éponyme, accusée d’avoir financé illégalement son parti, entre autres formations politiques. Son avocat dans cette affaire, Fausto Jarrín, nous rappelle pourtant qu’aucune preuve n’implique directement Rafael Correa, malgré le fait que la justice équatorienne ait eu accès à l’intégralité des pièces du dossier : « Il n’existe aucun contrat signé par Rafael Correa. Il n’existe aucune réunion de Rafael Correa, aucun appel, message ou courriel, permettant d’établir de tels liens ». Le parquet équatorien a finalement conclu à la culpabilité de l’ex-président, lequel aurait exercé une « influence psychique » (influjo síquico) sur les personnes inculpées dans l’affaire Oderbrecht – un délit dont l’imprécision provoque l’ironie des corréistes.
À l’inverse, plusieurs figures proches du pouvoir, éclaboussées par le scandale Oderbrecht – comme Jaime Nebot, l’ex-maire de Guayaquil – n’ont pas été inquiétées par les juges équatoriens. Comment expliquer un tel biais de la part de la justice ?

Il faut d’abord garder à l’esprit que le directeur du parquet est nommé par l’Assemblée nationale, ce qui relativise l’indépendance de l’appareil judiciaire. Les enquêtes du parquet, par ailleurs, ont eu recours à la collaboration de plusieurs entités étatiques, tel le fisc équatorien, comme le rappelle Paola Pabón, qui n’hésite pas à évoquer en conséquence « une opération dirigée par l’État ». Il faut ensuite prendre en compte la forte médiatisation des affaires judiciaires depuis 2017. Avant même que les sentences ne soient prononcées, les médias se sont fait l’écho des procès, limitant à leur tour l’autonomie des processus judiciaires.
Le système médiatique est pour cette raison la cible privilégiée des corréistes. Fausto Jarrín a tôt fait d’énumérer les quelques oligopoles bancaires qui possèdent les médias équatoriens, à l’orientation anti-corréiste évidente : « Teleamazonas est entre les mains de la Banque de Pichincha. Ecuavisa est entre les mains de la banque de Guayaquil. Les deux plus grandes chaînes de télévision sont la propriété des banques ! Le quotidien El Universo est la propriété de Carlos Perez, un ennemi déclaré de Rafael Correa ».
Dans ce système médiatique, les fonds et réseaux issus des États-Unis sont loin d’être absents. Ils transitent notamment par la National Endowment for Democracy (NED), organisme américain subventionné par le Congrès, dont le but affiché est de « soutenir la liberté à travers le monde ». Créée en 1983 sous l’impulsion de Ronald Reagan pour soutenir les contras du Nicaragua face aux sandinistes, cette institution finance aujourd’hui de multiples ONG et think-tanks pro-américains en Équateur. C’est le cas de Fundamedios ou de Participación ciudadana, organisations consacrées à la défense de la « liberté d’expression » et de la « transparence », ou encore de Mil Hojas, think-tank en pointe dans la « lutte contre la corruption ». Ils sont à l’origine de publications, de rapports ou de colloques qui entretiennent le récit d’une corruption hors-norme et d’un autoritarisme sans pareil qui auraient caractérisé la présidence de Rafael Correa ; ils sont de fait souvent repris par les médias équatoriens.
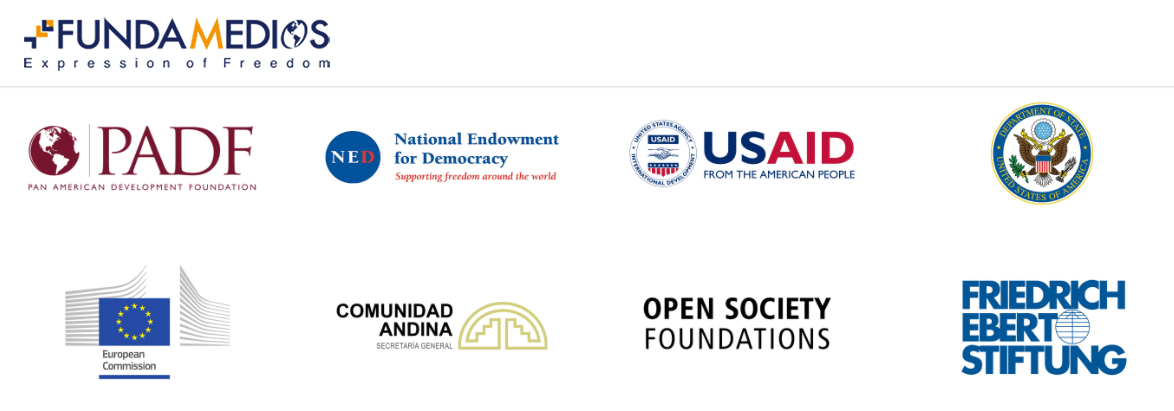
Quel fut le rôle des États-Unis dans cette gigantesque opération judiciaire ? Virgilio Hernandez souligne la primauté des élites équatoriennes, arguant qu’elles n’ont pas eu besoin d’un aiguillon américain pour agir de la sorte. Paola Pabón est moins catégorique ; elle rappelle les multiples gages donnés par Moreno aux États-Unis : « Je suis convaincue que le lawfare, ainsi que sa pointe avancée, le cas Oderbecht, ont été conçus depuis Washington, en lien avec les oligarchies nationales ». Même son de cloche chez Fausto Jarrín : « Le parquet, le ministère de l’Intérieur, qui sont le fer de lance de la persécution judiciaire, reçoivent des visites constantes de fonctionnaires de l’ambassade des États-Unis. À chaque visite, un nouveau procès est intenté ». Il s’interroge sur la manière dont ses données personnelles, hébergées dans son téléphone portable ou sa boîte mail, ont pu être récupérées – sans son aval – par la justice et les médias équatoriens. Il accuse les services américains.
L’appui des États-Unis à l’Équateur dans sa lutte contre la corruption n’a rien d’un secret. Elle a été officialisée et institutionnalisée à plusieurs reprises, via de multiples accords de coopérations sécuritaires. L’un d’eux, signé début 2020, se félicite de la création d’une « unité spéciale de lutte contre la corruption », regroupant « des organismes nord-américains, le parquet équatorien (…) et le ministère de l’Intérieur d’Équateur ».
Les États-Unis ont à vrai dire rapidement pris acte de l’hostilité de l’appareil judiciaire à l’égard des « corréistes » – et compris le profit qu’ils pouvaient en tirer. Dès 2006, avant même l’élection de Rafael Correa, les fonctionnaires de l’ambassade américaine à Quito identifiaient les instances judiciaires équatoriennes comme l’un des adversaires auquel devrait faire face le président. Dans un câble diplomatique révélé par Wikileaks, on peut lire : « Une victoire de Rafael Correa signifierait que les relations avec les partis politiques traditionnels, le Congrès et le pouvoir judiciaire (où les intérêts partidaires sont bien ancrés via la Cour constitutionnelle) deviendraient immédiatement conflictuelles »1.
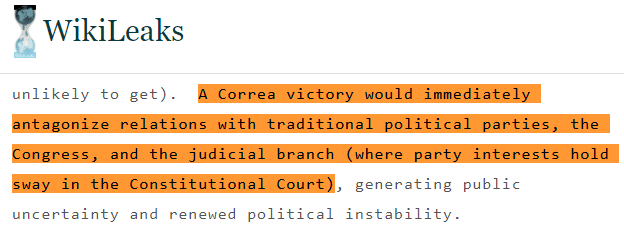
Une décennie plus tard, la lutte « anti-corruption » est identifiée par le gouvernement américain comme un moyen de lutter contre les régimes qui leur sont opposés. En 2017, dans le très officiel rapport annuel sur la sécurité nationale des États-Unis, les mesures « anti-corruption » et les « actions judiciaires » étaient considérées, au même titre que les « sanctions » économiques, comme des moyens de « dissuader, d’exercer une action coercitive ou de contraindre [leurs] adversaires »2.
La lutte contre la corruption, nouvelle justification – après la lutte contre le communisme et le narcotrafic – apportée à l’ingérence des États-Unis dans le sous-continent ? Une note de l’IRIS analyse la congruence entre le lawfare et l’agenda nord-américain en Amérique latine, prenant le Brésil pour cas d’étude3. L’épisode équatorien est cependant singulier et à bien des égards irréductible aux chasses aux sorcières judiciaires que l’on a pu observer au Brésil ou en Argentine. Cette séquence ne fait en effet pas suite à un changement de majorité électorale, comme en Argentine, ou à un coup d’État judiciaire, comme au Brésil ; elle a été initiée par le président Lenín Moreno, élu sur une plateforme de continuité avec Rafael Correa.
Pour une mise en contexte de la pratique du lawfare en Amérique latine, lire sur LVSL l’article de Vincent Ortiz : « Lawfare : la légalisation des procès politiques ? »
L’ambassade américaine à Quito, second palais présidentiel
Quels sombres desseins ont pu pousser Lenín Moreno, ancien vice-président de Rafael Correa, à mettre en place cet agenda néolibéral qu’il condamnait quelques années plus tôt ? Les raisons de ce coup de théâtre, digne d’un mauvais film d’espionnage, ont fait couler beaucoup d’encre. Chez les corréistes, il prend les contours d’une « trahison » aux accents shakespeariens. Si c’est effectivement de cette manière que l’immense majorité de ses électeurs a ressenti ce tournant, celui-ci était-il réellement si imprévisible qu’il n’y paraît ?
« L’ambassadeur des États-Unis se promenait dans le palais présidentiel comme si c’était sa maison. Il ne passait aucun contrôle de sécurité. Il attendait, à quelques mètres du bureau du président, que celui-ci daigne le recevoir ».

Un récit alternatif à celui de la « trahison » existe ; une version des faits dont personne n’accepte de témoigner publiquement. Dans cette réalité alternative, Rafael Correa n’aurait pas été dupe de Lenín Moreno, le plus modéré des protagonistes de la « révolution citoyenne ». Il aurait aimé qu’il ne fût pas candidat en 2017, mais son favori, Jorge Glas, était déjà la cible d’une cabale médiatique qui allait culminer avec l’affaire Oderbrecht. Toutes les enquêtes d’opinion le donnaient perdant face à Guillermo Lasso, le banquier de Guayaquil et le soutier des États-Unis. À contrecoeur, Rafael Correa aurait donc investi Lenín Moreno, espérant le contrôler grâce à une majorité parlementaire loyale à la « révolution citoyenne ». Un garde-fou qu’aurait fait sauter Moreno par une série d’habiles manœuvres au sein du parti présidentiel Alianza País, lui permettant de placer un nombre confortable de ses proches comme candidats à la députation. C’est donc sans enthousiasme que Rafael Correa et sa garde rapprochée auraient œuvré à la victoire de Moreno, dont le discours public consensuel annonçait déjà un changement d’approche. Le tournant à 180 degrés fut tout de même brutal. « Nous nous attendions à ce qu’il trahisse ; mais pas si vite », nous résume-t-on.
« Trahison » ou non, il convient de ne pas se focaliser outre mesure sur le changement à la tête de l’exécutif, tant les pressions exogènes exercées sur le gouvernement semblent avoir été déterminantes. Sitôt Lenín Moreno élu, les oligopoles bancaires et les représentants des grandes entreprises, bridés par une décennie de « révolution citoyenne », ont envoyé leurs émissaires auprès du nouveau gouvernement. Ils ont dû faire face à la résistance de plusieurs ministres idéologiquement proches de Rafael Correa. Lenín Moreno lui-même, ballotté entre une majorité attachée à l’héritage de son prédécesseur et le lobbying des élites économiques, semble avoir longtemps effectué des palinodies ; plusieurs témoignages indiquent qu’il a été surpris par la violence de la thérapie de choc que l’on souhaitait infliger à l’Équateur.
Mais plus encore que les actionnaires de la Banque de Guayaquil ou les commis de l’aristocratie terrienne de la Sierra, un homme semble avoir eu un rôle décisif dans le tournant à 180 degrés qui allait bientôt être entrepris : Todd Chapman, l’ambassadeur américain à Quito. Son nom apparaît sur toutes les lèvres sitôt que l’on évoque la transition. « Il se promenait dans le palais présidentiel comme si c’était sa maison. Il ne passait aucun contrôle de sécurité. Il attendait, à quelques mètres du bureau du président, que celui-ci daigne le recevoir », indique un témoin.

Carlos de la Torre, ministre de l’Économie et des Finances sous le premier gouvernement Moreno, s’y est heurté à plusieurs reprises. Après plusieurs années fastes, la situation économique du pays s’était dégradée : le cours des matières premières avait chuté, et l’Équateur, incapable d’effectuer une dévaluation depuis sa dollarisation, enregistrait un déficit commercial significatif.
Le ministre tente alors d’agir sur les douanes : un rapport lui indique que pour 70 % des items (terme très large qui peut désigner des pièces détachées aussi bien que des produits finis) importés en Équateur, les taxes étaient inférieures à cinq centimes. Face à cette sous-taxation manifeste, il souhaite les doubler et les porter à dix centimes. Cette volonté protectionniste rencontre l’opposition des États-Unis. Lors d’un voyage à Washington, Carlos de la Torre est convoqué par une dizaine de hauts fonctionnaires du Trésor américain. « J’avais l’impression d’assister à un interrogatoire du FMI », plaisante-t-il. « Ils m’ont pressé de changer de politique, sous peine de faire prendre à l’économie équatorienne le chemin du Venezuela ».
Dans le même temps, Todd Chapman, l’ambassadeur des États-Unis, manœuvre pour imposer ses conseillers économiques à Lenín Moreno. Celui-ci multiplie alors les signes d’apaisement à l’égard des adversaires historiques de la « révolution citoyenne », s’entoure d’une « petite table » (mesa chica) de conseillers, dont aucun n’est issu du « cœur historique » du corréisme, et critique publiquement son prédécesseur.
Ces attaques provoquent les premières démissions. Carlos de la Torre, Paola Pabón et Virgilio Hernandez abandonnent leurs fonctions. La transition est engagée. Les partisans d’une thérapie de choc néolibérale se heurtent cependant à une administration encore constituée de nombreux corréistes, et à l’inertie d’un appareil d’État modelé par une décennie de révolution citoyenne. Est-ce la raison de ces multiples procès qui sont intentés par l’appareil judiciaire les mois suivants ? Virgilio Hernandez souligne le fait qu’ils ne ciblent pas uniquement les proches de Rafael Correa, mais « tous ses ex-fonctionnaires » ; il insiste sur leur magnitude : « Ce sont des milliers d’actions qui ont été entreprises. Pas seulement à l’égard d’ex-ministres, mais contre des jeunes, qui occupaient des fonctions purement techniques ». Le lawfare a rempli une fonction disciplinaire manifeste, épurant l’administration des fonctionnaires les plus attachés à la « révolution citoyenne », et mettant fin aux éventuelles velléités d’insubordination des autres.

Le retour auprès du FMI pouvait désormais s’opérer sans accrocs, malgré l’incompréhension populaire. « Solliciter cette institution n’a pas été nécessaire en dix ans de révolution citoyenne, y compris durant les crises pourtant très difficiles de 2008 et de 2015, au cours duquel le prix des barils de pétrole a chuté », fait remarquer Paola Pabón.
Lire sur LVSL notre entretien avec Rafael Correa, rencontré à Bruxelles : « La presse est l’arme létale des élites néolibérales ».
Le retour sur les sentiers de la dépendance
Visiblement hésitant quant à la marche à suivre, Lenín Moreno rappelle en mars 2018 María Elsa Viteri, ex-ministre de Rafael Correa et modérément critique de son bilan. Elle avait œuvré à l’annulation de la dette équatorienne en 2008, et sa nomination a été interprétée par les États-Unis comme une marque de défiance. Tentative désespérée, de la part de Lenín Moreno, de limiter la brutalité de la transition en cours ?
L’Équateur n’intéresse pas seulement les États-Unis comme pays pauvre limitrophe de pays riches. Durant la « révolution citoyenne », il fut l’un des artisans du rapprochement de l’Amérique latine avec la Chine.
Entre-temps, cependant, des cessions de souveraineté difficilement réversibles avaient été opérées. Dans le secteur financier comme dans le domaine sécuritaire, Lenín Moreno prenait l’exact contre-pied de son prédécesseur, réduisant à néant toutes les mesures prises par Rafael Correa pour se libérer de la tutelle des États-Unis. Le gouvernement équatorien courtisait en effet depuis plusieurs mois les marchés financiers américains, auprès desquels l’Équateur avait précisément refusé de payer sa dette souveraine en 2008. Les traités bilatéraux d’investissement entre l’Équateur et les États-Unis, décrétés inconstitutionnels depuis 2008, reprenaient peu à peu force de loi. Les accords de coopération sécuritaire, dénoncés un à un par Rafael Correa, étaient de retour ; du matériel, des hommes et des informations, circulaient désormais entre les administrations équatorienne et américaine.
À la tête du ministère de l’Intérieur, Lenín Moreno avait nommé Mauro Toscanini. Formé aux États-Unis, partisan manifeste d’un rapprochement avec la première puissance mondiale, il passe, aux yeux des corréistes, pour l’homme de main de Washington. Sa nomination coïncide avec une situation sécuritaire critique : des myriades de réfugiés vénézuéliens affluaient en Équateur, accueillis dans des conditions avilissantes, générant une phobie populaire massive ainsi qu’une demande de renforcement des dispositifs policiers. Les États-Unis ont-ils usé de l’ascendant qu’ils possédaient sur le ministre de l’Intérieur, à même de paralyser le pays par la fonction capitale qu’il occupait, pour faire plier Lenín Moreno ? Les spéculations les plus folles courent à ce sujet. Quoi qu’il en soit, Moreno a obtempéré en un temps record. Deux mois après sa nomination, María Elsa Viteri quittait ses fonctions.
Dès lors, l’assujettissement de l’Équateur aux desiderata américains n’allait plus connaître de limites. Tandis que Julian Assange était expulsé de son ambassade et livré à la lente torture des prisons londoniennes, le pays andin effectuait son grand retour dans les institutions de Bretton Woods et replongeait dans une « longue nuit néolibérale ». Des réductions budgétaires drastiques étaient initiées, le marché du travail encourait une flexibilisation sans équivalent depuis les années 1990, et l’imposition sur le capital était réduite à portion congrue. Cet ajustement structurel imposé par le FMI s’est révélé d’une telle brutalité qu’il fait à présent l’objet d’une condamnation unanime de la part des candidats à la présidentielle, Guillermo Lasso compris.
Ressources naturelles et positionnement géostratégique
Une énigme demeure. Comment expliquer que les États-Unis aient consacré tant de moyens pour obtenir la sujétion d’un pays de dix-sept millions d’habitants, au marché intérieur rachitique et aux ressources naturelles limitées ? Si l’Équateur était un eldorado pétrolier dans les années 80, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’importance de l’exploitation pétrolière dans son PIB a en effet fortement décru, comme l’atteste la brillante étude de Vincent Arpoulet4. Aujourd’hui, si des mines d’or sont ouvertes aux quatre coins du pays, elles n’intéressent que modérément les États-Unis, dont les entreprises ne sont pas spécialisées dans son extraction. Alors que le lithium a pu justifier le soutien actif des États-Unis au coup d’État en Bolivie, l’Équateur est dépourvu de tels métaux rares.
Lire sur LVSL l’article de Baptiste Albertone : « Des coups d’État à l’ère de la post-vérité ».
« Ce ne sont pas les ressources naturelles qui attirent les États-Unis, mais la position stratégique de l’Équateur par rapport aux intérêts américains », tranche Carlos de la Torre. Comme d’autres, il rappelle que sous la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont utilisé les îles Galápagos comme support pour leur aviation dans le Pacifique. Elles servaient alors à protéger le canal de Panama d’une possible agression japonaise. Depuis 2019, elles accueillent à nouveau des installations aériennes nord-américaines.

Elles permettent aux États-Unis de disposer d’une force de frappe rapidement déployable dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Venezuela, la Colombie et les nations caribéennes, mais aussi en Asie de l’Est. Cette occupation des Galápagos s’inscrit également dans le cadre des sanctions prises par Washington contre le Venezuela depuis 2017. Les îles permettaient à l’Équateur, du temps de Rafael Correa, de ravitailler le Venezuela en plusieurs biens dont il manquait. Les États-Unis veillent à présent à ce que le nouveau régime respecte les interdits édictés par le Congrès.
Paola Pabón rappelle également le rôle de médiateur entre le gouvernement colombien et la guérilla FARC qu’avait tenu le gouvernement de Rafael Correa. Celui-ci n’avait pas peu fait pour favoriser les accords de paix de 2016, qui avaient infligé un camouflet aux paramilitaires Colombiens ainsi qu’aux États-Unis. « Sous le mandat de Lenín Moreno, l’Équateur a été retiré, de manière honteuse, de la table des négociations. L’Équateur occupe une position géopolitique exceptionnelle en Amérique latine. Le contrôle sur l’Équateur assure aux États-Unis un contrôle sur la Colombie et le Pérou ».
L’Équateur n’intéresse pas seulement les États-Unis comme pays pauvre limitrophe de pays riches. Durant la « révolution citoyenne », il fut l’un des artisans du rapprochement de l’Amérique latine avec la Chine. C’est en effet auprès du gouvernement chinois que l’Équateur sollicita des fonds après avoir annulé sa dette souveraine auprès des créanciers occidentaux en 2008. Malgré les taux d’intérêt léonins pratiqués par la Chine, celle-ci avait l’heur de ne pas conditionner ses prêts par des plans d’ajustement structurels. S’ensuivirent de multiples investissements de capitaux chinois en Équateur, dans des projets d’infrastructures ou d’extraction minière – non sans frictions.
À l’instar de l’Équateur, de nombreux gouvernements d’Amérique latine ont tenté de s’appuyer sur la volonté chinoise d’expansion pour contrecarrer la domination nord-américaine. Prêts et investissements ont afflué dans le sous-continent durant la décennie 2010, jusqu’à inquiéter les États-Unis ; des documents du département d’État américain évoquent le « défi hégémonique » posé par l’Empire du milieu à la puissance du Nord. Dans plusieurs secteurs, les États-Unis accusent à présent un sérieux retard. C’est le cas dans le domaine des télécommunications et des technologies numériques. Le récent accord entre l’Équateur et la Development Finance Corporation (DFC) des États-Unis, garantissant au pays un prêt de 3.5 milliards de dollars contre la rupture de ses contrats avec Huawei, peut s’interpréter à la lueur de ces enjeux. La nature des relations qu’un éventuel gouvernement dirigé par Andrés Arauz souhaiterait entretenir avec la Chine s’annonce d’ores et déjà comme un point d’achoppement majeur avec l’administration Biden.

Il faut enfin évoquer un dernier facteur, rétif à des réductions chiffrées ou topographiques. La présidence de Rafael Correa fut celle où l’Équateur émergea du rang des nations anonymes ; l’asile accordé à Julian Assange, le bras de fer engagé avec la major pétrolière Chevron, ont conféré au pays une aura mondiale au sein des mouvements critiques de la domination nord-américaine. Aux côtés de Hugo Chávez et de Fidel Castro, Rafael Correa a plaidé pour une intégration régionale accrue et l’édification d’institutions qui contrebalancent celles de Bretton Woods. Ce n’est pas par hasard que le siège de l’UNASUR fut édifié à Quito.
Pour une mise en perspective de la politique étrangère équatorienne sous Rafael Correa, lire notre entretien avec Guillaume Long : « Comment la révolution citoyenne d’Équateur a été trahie ».
Si les États-Unis souhaitent tant conserver leur tutelle sur l’Équateur, est-ce parce qu’ils craignent qu’une victoire d’Andrés Arauz, faisant suite à celle d’Alberto Fernandez en Argentine et de Luis Arce en Bolivie, ne permette au pays de redevenir un pôle d’opposition à leur hégémonie ?
Notes :
1 Cité dans Eirik Vold, Ecuador en la mira, El Telegrafo, 2016, p. 21. Cet ouvrage compile et analyse les câbles révélés par Wikileaks attestant d’une ingérence permanente des États-Unis sous le mandat de Rafael Correa.
2 « National security strategy of the United States of America », Maison-Blanche, Washington, 2017, p. 34.
3 Celso Amorin, Carol Proner, « Lawfare et géopolitique : focus sur l’Amérique latine », traduit par Arley Carvalho Meneses, IRIS, 2021.
4 Vincent Arpoulet, « Les variations de la politique pétrolière équatorienne à la lumière du contexte économique régional et international (1972-2017) », mémoire rédigé pour la Sorbonne-Nouvelle, 2020.












