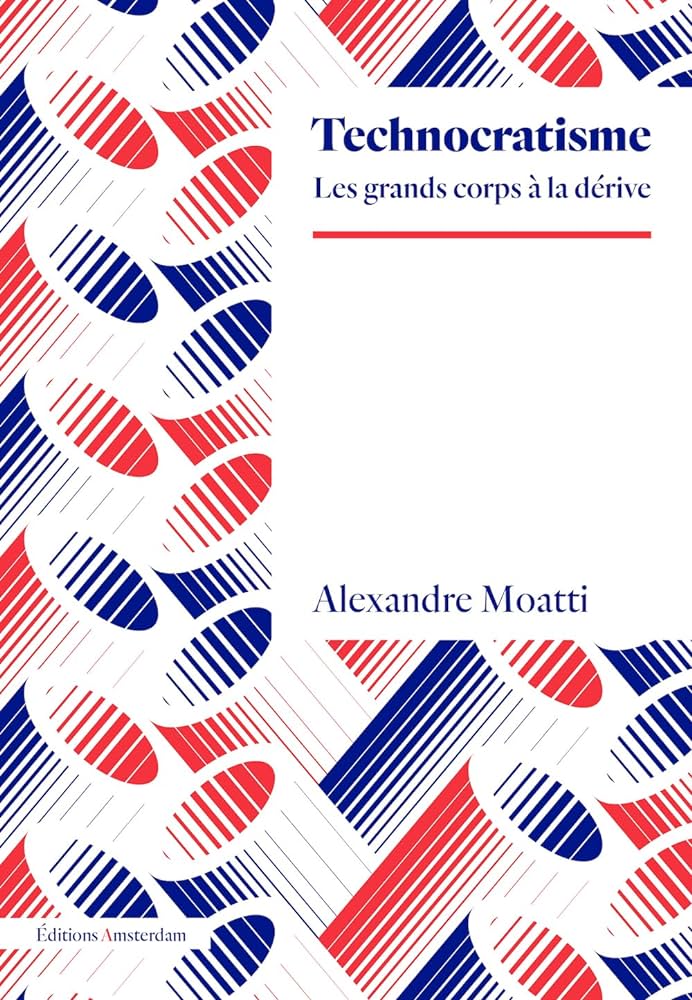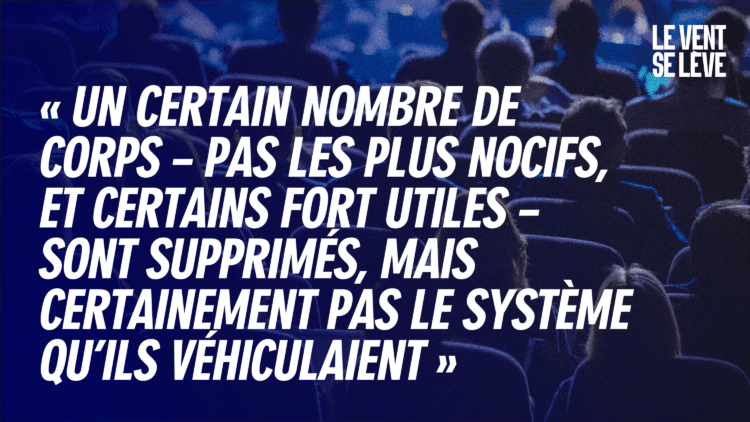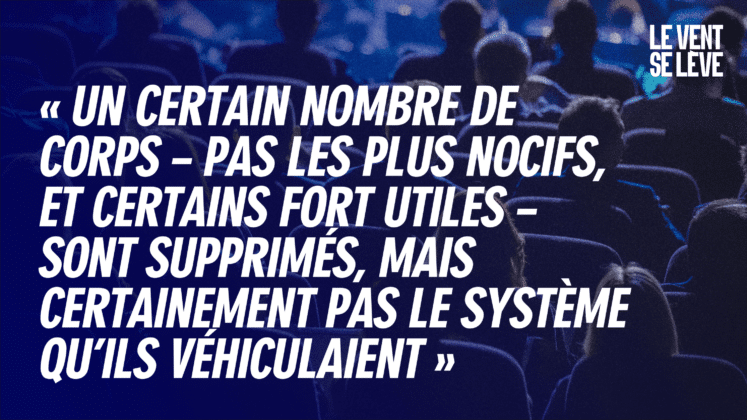Conseiller d’État, Jean-Éric Schoettl a occupé de nombreuses fonctions au sein de l’administration française : directeur général du CSA de 1989 à 1992, il a ensuite été nommé directeur au secrétariat général du Gouvernement avant d’exercer la fonction de secrétaire général du Conseil constitutionnel de 1997 à 2007. Dans cet entretien, il analyse la transformation progressive de la République française fondée sur la primauté de la loi, la souveraineté nationale et l’intérêt général en une société libérale fondée sur les seuls droits individuels. Il plaide pour un rééquilibrage des priorités pour permettre à la France de faire primer les exigences du bien commun sur la coalition des desiderata individuels et des intérêts particuliers.
LVSL – Vous soutenez que l’État de droit tel qu’il a évolué depuis un demi-siècle se consacre essentiellement à préserver les droits et libertés, sans laisser une part importante aux exigences collectives. Est-ce que vous pouvez tracer les étapes qui ont jalonné la transformation d’une République fondée sur l’intérêt général en une société libérale centrée sur les droits individuels ?
Jean-Éric Schoettl – L’expansion des droits fondamentaux, et plus précisément des droits subjectifs, opposables par un particulier à une personne publique, caractérise l’évolution du droit, en France comme partout en Occident, depuis un demi-siècle.
La déferlante des droits fondamentaux trouve son origine ailleurs que dans le droit, mais elle a investi progressivement celui-ci. Sa source est dans la société, à la confluence de divers phénomènes. En premier lieu, elle tient au « vagabondage d’idées chrétiennes devenues folles » (Gilbert Keith Chesterton) et à l’épanchement d’un État-providence, assureur universel, devenu « État nounou » (Michel Schneider). Ensuite, on peut l’expliquer par le développement d’un individualisme exacerbé induit par les formes actuelles de la mondialisation et l’extension illimitée du domaine du marché d’une part, et le délitement du sens de la transmission, de la civilité, de la solidarité, de la discipline, de l’autorité et de la Nation, d’autre part. Enfin, il faut sans doute mentionner le rôle de la political correctness communautariste importée des campus américains et pointer un certain gauchisme découvrant dans le droits-de-l’hommisme un substitut aux luttes révolutionnaires de naguère.
Là où un droit est proclamé, le pouvoir politique et son bras administratif sont sommés d’exaucer. Ils ne peuvent plus arbitrer, ce qui est pourtant au cœur du politique et ce qui est le terrain d’élection de la recherche de l’intérêt général.
Le droit textuel et jurisprudentiel cautionne dans un second temps ce dévoiement de l’individualisme philosophique. Il devient, pour les militants de la transformation radicale de la société, le champ de bataille principal, alors qu’il n’était, pour leurs prédécesseurs marxistes, qu’une superstructure bourgeoise dont il fallait dénoncer les faux-semblants.
Selon leur nature, les droits fondamentaux contraignent diversement le législateur et l’administration. Les droits-libertés limitent toujours plus strictement les marges de manœuvre de l’État régalien, lorsque celui-ci entend faire prévaloir l’intérêt général ou sauvegarder l’ordre public. Les droits-créances assujettissent les pouvoirs publics en général et le législateur en particulier à une obligation de résultat, les transformant en simples courroies de transmission d’un logiciel qui dénie aux élus de la Nation, comme aux administrateurs, leurs prérogatives d’arbitrage.
Or là où un droit est proclamé, surtout si c’est un droit-créance, le pouvoir politique et son bras administratif sont sommés d’exaucer. Ils ne peuvent plus arbitrer, ce qui est pourtant au cœur du politique et ce qui est le terrain d’élection de la recherche de l’intérêt général.
LVSL – La République française est longtemps restée attachée aux principes qui l’ont fondée : les actes de souveraineté, par nature unilatéraux et arbitraires, la suprématie de la loi, des juges cantonnés au rôle de « bouche de la loi ». Le droit européen est construit sur un paradigme inverse, héritier de la tradition juridique allemande : la sanction juridictionnelle des droits et libertés et la régulation par le marché, le rôle central de la jurisprudence et du droit conventionnel, la place laissée aux principes découverts par le juge. Renouer avec l’intérêt général est-il possible dans ce cadre ?
J.-É. S. – C’est la grande question. Comme dirait Jean-Claude Michéa, l’addition d’une multitude de « C’est mon choix » ne dessinera jamais les contours du Bien commun. Une société sans valeurs ni disciplines collectives, une société reposant sur la seule autonomie de l’individu, retournerait tôt ou tard à l’état de nature décrit par Hobbes. La glorieuse apothéose de l’individu au sein de la démocratie occidentale moderne n’aurait été alors que l’antichambre d’une vertigineuse régression.
Pour remonter cette pente, il convient de rétablir la primauté de l’intérêt général. Rétablir la primauté de l’intérêt général, c’est reconnaître la noblesse du politique qui doit arbitrer entre besoins multiples et moyens limités, ce qu’ignore superbement l’intégrisme droits de l’hommiste.
Pour celui-ci, en effet, le politique, l’élu, l’administrateur ne sont que la courroie de transmission d’un catalogue de droits, dont le juge, actionné par les groupes militants, est l’unique protecteur, voire inventeur, légitime. Dans cette vision, chacun doit être complètement rempli de ses droits, y compris lorsque ses droits sont une créance sur la société et qu’honorer une telle créance devient matériellement impossible ou conduit à sacrifier une politique publique à une autre.
LVSL – La logique de l’intérêt général implique une subordination des désirs individuels au bien commun. L’épidémie du Covid-19 a montré tant la pertinence de ce principe que la réticence du Gouvernement à poser de tels actes unilatéraux. Dans ces conditions, sur quels principes supérieurs et transcendantaux peut-on fonder le retour à une République de l’intérêt général ?
J.-É. S. – Pour tenter de cerner ce que la notion d’intérêt général a d’incontournable pour les politiques publiques, on peut en effet partir, de façon peut-être un peu provocatrice, d’une méditation sur l’état d’urgence.
Nous avons connu en 2015 l’état d’urgence anti-terroriste ; nous connaissons aujourd’hui l’état d’urgence sanitaire. Pourquoi tant d’états d’urgence en si peu de temps ? Est-ce en raison de la récurrence de chocs exogènes qui ébranlent inopinément notre société ? De la répétition aléatoire de circonstances exceptionnelles ? Du retour du tragique dans l’Histoire contemporaine ? Cette réitération des états d’urgence révèle-t-elle une tentation liberticide de la part des pouvoirs publics ?
Je proposerai une tout autre explication : l’état d’urgence a pour véritable objet de rétablir un équilibre, rompu par le droit ordinaire, entre intérêt général, d’une part, prérogatives individuelles et catégorielles, d’autre part. En effet, en raison de l’évolution à laquelle je faisais allusion il y a un instant, le droit contemporain intègre de moins en moins le souci de l’intérêt général.
L’ordre constitutionnel dont il se réclame ne comprendrait plus, au terme de cette évolution, que des droits, dont la communauté politique en général, l’État en particulier, devraient se borner à assurer la satisfaction et la conciliation. La majeure partie de la doctrine (en France comme ailleurs en Occident) ne veut plus voir que des droits fondamentaux dans les chartes fondamentales et n’admet de limitation des droits fondamentaux qu’au titre de leur harmonisation.
ll n’y a plus beaucoup de place, dans notre État de droit, pour des exigences collectives (susceptibles de prévaloir sur les prérogatives individuelles), telles que les intérêts supérieurs de la Nation, l’ordre public ou le bien des générations futures. Voilà pourquoi, lorsque la nécessité oblige à restaurer la primauté du commun, à faire prévaloir des disciplines collectives sur l’autonomie personnelle, on a besoin d’une légalité d’exception, et qui n’est d’exception que parce que la légalité ordinaire fait l’impasse sur le commun.
Je retournerai donc, pour ma part, le procès fait par la doxa droits-de-l’hommiste aux pouvoirs publics lorsque ceux-ci instaurent un état d’urgence ou lorsque, au sortir de l’état d’urgence, ils en pérennisent certains aspects : l’anomalie est-elle là où ils la dénoncent ? Ou n’est-elle pas plutôt dans le fait que le droit contemporain, comme plus généralement les politiques publiques contemporaines (à l’exception peut-être, et encore, des politiques environnementales), ont mis en sourdine l’intérêt général ?
La démocratie ne peut être réduite à la promotion des droits. Lorsque je dis cela, lorsque je m’inquiète du droits-de-l’hommisme hégémonique, c’est-à-dire de la réduction de la démocratie aux droits, je ne remets en cause ni les droits fondamentaux, ni les libertés publiques, ni la nécessité de mettre fin aux injustices que tel ou tel groupe a pu subir dans le passé.
Notre société ne peut non plus renoncer à assurer le respect de ses valeurs, de son ordre public symbolique, car le besoin d’un surplomb commun, d’une forme de transcendance, survit à la sécularisation du politique.
Je ne chante pas les mérites de l’État autoritaire (même si je déplore la perte d’autorité de l’État, surtout en cette ère d’ensauvagement de la société). Je dis seulement que, tout en mettant un point d’honneur à respecter les droits et libertés, notre système juridique ne doit ni les laisser confisquer par les groupes de pression, ni tout leur sacrifier, notamment pas la solidarité, l’ordre public et la cohésion sociale.
Pensons aux vaccinations obligatoires, aux sujétions de la défense nationale (et demain, peut-être, du service national), aux servitudes d’urbanisme, à la sécurité routière, à l’ordre public économique et social, aux multiples sacrifices que supposerait une politique écologique ambitieuse pour nos libertés personnelles. Il faut bien construire les centres de traitement d’ordures ménagères, les établissements pénitentiaires et les hôpitaux psychiatriques quelque part (in someone’s backyard).
Paralysera-t-on demain le don d’organes, l’enseignement de la médecine et la recherche médicale, parce que, au nom de la liberté religieuse ou d’une conception subjective de la dignité de la personne humaine, on aura subordonné au consentement explicite de l’intéressé, donné de son vivant, l’utilisation de son corps après sa mort ?
Notre société ne peut non plus renoncer à assurer le respect de ses valeurs, de son ordre public symbolique, car le besoin d’un surplomb commun, d’une forme de transcendance, survit à la sécularisation du politique.
LVSL – Les cours de justice sont de plus en plus instrumentalisées par les intérêts privés qui prétendent se servir des juges pour satisfaire leurs intérêts catégoriels. Quelles ruptures faut-il consentir pour inverser cette dynamique ?
J.-É. S. – Les dispositions dans lesquelles le juge va chercher l’énoncé d’un droit font l’objet de formulations le plus souvent vagues, dont le juge est l’ultime exégète. Sa jurisprudence déterminera donc à la fois les implications véritables et la force contraignante de l’énoncé constitutionnel ou conventionnal en cause. Les intentions du constituant ou celles des négociateurs du traité ne feront plus entendre, à ce stade, qu’un écho lointain.
Il en résulte que c’est le juge, dûment actionné par les gardiens des colonnes du temple (autorités administratives indépendantes comme le Défenseur des droits, le CSA ou la CNIL, organismes européens ou onusiens, associations militantes dotées de la capacité de se porter partie civile, doctrine juridique acquise à l’expansion indéfinie des droits fondamentaux sous la protection active du juge), qui prescrira in fine le contenu des politiques publiques.
Qui plus est, le droit nouvellement proclamé entre tôt ou tard en conflit avec des droits concurrents ou avec l’intérêt général. Seul le juge saura dire (toujours trop tard pour que la sécurité juridique y trouve son compte) comment il convient de les concilier.
S’opère ainsi un déplacement du centre de gravité de la vie publique des deux premiers pouvoirs vers le troisième et vers d’autres, dépouillant les représentants directs de la souveraineté populaire (Gouvernement et Parlement) au bénéfice d’un pouvoir juridictionnel polycéphale (non moins de cinq cours suprêmes, dont trois nationales et deux européennes) et d’autres instances non élues, nationales ou supranationales, chargées de veiller à la suprématie des droits et au respect des traités.
Cette apothéose du juge est saluée par la nouvelle doxa juridique, avec des accents eschatologiques, comme l’accomplissement de l’état de droit. Le républicain y verra au contraire une régression : le retour des parlements d’ancien régime, contre lesquels la Révolution française s’est en partie faite.
Même les politiques régaliennes se voient « préformatées » par une jurisprudence poussant toujours plus loin le contrôle de proportionnalité et par un droit humanitaire toujours plus invasif, par exemple en matière d’immigration. La religion des droits fondamentaux et, plus généralement, ce que Marcel Gauchet a appelé l’« abouchement du droit des juristes et du droit des philosophes » ont fait émerger un juge démiurge, à l’image de la Cour suprême des USA, du Verfassungsgericht, des cours de Strasbourg et de Luxembourg et de leurs divers émules en Occident.
Ce juge démiurge, non content d’imposer la prépondérance des droits individuels sur l’intérêt général, en énonce de nouveaux en produisant à jet continu, par-dessus la tête du Représentant, un droit supra-législatif ineffable et arborescent, élaboré sans garde-fou à partir des formulations très générales qui abondent dans nos textes constitutionnels et conventionnels.
Cette apothéose du juge est saluée par la nouvelle doxa juridique, avec des accents eschatologiques, comme l’accomplissement de l’État de droit. Le républicain y verra au contraire une régression : le retour des parlements d’ancien régime, contre lesquels la Révolution française s’est en partie faite.
La souveraineté populaire, c’est la démocratie représentative avant la jurisprudence, l’élection avant le pouvoir juridictionnel. La recherche du bien commun par les représentants de la Nation, au travers du vote de la loi, est l’expression de la volonté générale. La règle commune ne peut résulter de l’exécution contrainte d’un catalogue de droits et principes pré-institués par des chartes et grossis sans contrepoids démocratique par la jurisprudence des cours.
La mission du juge est d’appliquer la loi. Il est aussi de l’interpréter, certes, mais sans la dénaturer, ni la compléter indûment. Le juge constitutionnel ou conventionnel ne devrait censurer que les dérapages manifestes du législateur dans l’exercice de la conciliation qui lui incombe entre droits et libertés (des uns et des autres) et intérêts généraux.
En France, Conseil d’État et Conseil constitutionnel ont d’abord résisté sur le terrain de l’intérêt général, de la conception universaliste de l’égalité des droits (notamment en matière de discriminations positives) ou pour mettre un frein à une conception illimitée de la liberté individuelle.
Mais la digue est rompue, y compris au Conseil d’État, par exemple avec une subjectivisation du droit des étrangers qui fait prévaloir sur toute autre considération les conséquences de l’application de la loi sur la situation personnelle de l’intéressé ; ou encore avec la technique de la neutralisation de la loi « dans les circonstances de l’espèce », sur la base de l’empathie du juge à l’égard d’une situation individuelle concrète, comme dans une affaire d’insémination post mortem jugée en mai 2016.
Des notions vagues comme le « respect de la vie privée et familiale » (convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) ou « l’importance primordiale devant être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant » (convention de New York sur les droits de l’enfant) fondent, en France comme ailleurs, ce pouvoir juridictionnel (conventionnel, judiciaire ou administratif) impressionniste, désinvolte envers le législateur, plus souvent bienveillant pour le requérant que soucieux des enjeux collectifs.
Même empressement du côté du Conseil constitutionnel qui pourtant n’a pas à appliquer les traités et dont le contentieux normatif, même a posteriori (QPC), est objectif (voir sa jurisprudence ultra-restrictive sur les traitements de données personnelles ou l’intensité de son contrôle récent de proportionnalité en matière de procédure pénale et de police administrative).
Les deux ailes du Palais-Royal jouent aujourd’hui les bons élèves de Luxembourg et de Strasbourg, rejoignant ainsi les juges judiciaires, depuis longtemps émules des cours supranationales. Tous les juges de France, de Navarre et de Lotharingie, communient désormais dans la suprématie des droits subjectifs. Ce ralliement trouve un moteur supplémentaire dans la griserie du juge à devenir le grand prêtre de la nouvelle religion, accueillant sous son aile les doléances des victimes du système et soumettant celui-ci à ses censures et injonctions, sous les applaudissements médiatiques.
L’intervention du juge, surtout si c’est un juge constitutionnel ou conventionnel, surtout si c’est une cour suprême, amplifie le phénomène en traduisant en exigences supra-législatives les pleurnicheries sociétales. Même les prudents du Palais-Royal ou du quai de l’Horloge y cèdent, sous la pression d’officines militantes (usant et abusant de leur capacité à se porter parties civiles), par concession à l’air du temps, de crainte d’être taxés de réactionnaires, pour jouer le jeu européen ou par panurgisme jurisprudentiel (puisque c’est à la seule aune de “l’audace” dans la défense des droits fondamentaux que les organes d’opinion jaugent les juges).
Du coup, le prétoire, plus encore que l’hémicycle, devient l’enjeu des groupes de pression et de leurs juristes (promus experts par les médias et par Bruxelles). Cercle vicieux car cet engouement pour le juge renforce l’hubris juridictionnelle et marginalise toujours plus les élus et gouvernants, réduits au rôle d’exécutants des arrêts ou à la fonction de souffre-douleur d’ailleurs consentants (masochisme attesté par la récurrence des lois de moralisation de la vie publique).
Comment rétablir l’équilibre entre contrôle juridictionnel et souveraineté populaire ? Je suis pour ma part partisan de la procédure dite du « dernier mot parlementaire », autrement dit du pouvoir donné au Parlement de faire prévaloir ses choix sur les arrêts des cours suprêmes, moyennant un vote de confirmation solennel acquis selon une majorité qualifiée.
Ainsi, la procédure pénale, la législation fiscale, les règles relatives aux traitements de données personnelles, la politique migratoire sont en grande partie dictées depuis une quarantaine d’années par la jurisprudence des cours suprêmes. De Gaulle aurait-il pu l’imaginer ? Dans tous les pays occidentaux, le pouvoir juridictionnel (ou para juridictionnel) décide désormais des politiques publiques sans en avoir ni la base légale, ni l’expertise, ni surtout la légitimité démocratique (qui – faut-il le rappeler ? – repose sur la responsabilité devant les électeurs).
Comment rétablir l’équilibre entre contrôle juridictionnel et souveraineté populaire ? Je suis pour ma part partisan de la procédure dite du « dernier mot parlementaire », autrement dit du pouvoir donné au Parlement de faire prévaloir ses choix sur les arrêts des cours suprêmes, moyennant un vote de confirmation solennel acquis selon une majorité qualifiée. Le « dernier mot parlementaire »permettrait au politique de reprendre la main en toute connaissance de cause, sans avoir (comme pour le droit d’asile en 1993) ni à convoquer le Congrès, ni à modifier la Constitution à chaque « lit de justice ».
Elle n’en paraîtra pas moins hérétique à tous ceux pour lesquels le respect des droits et libertés exclut que le politique – fût-ce à une majorité qualifiée – puisse priver d’effets une décision juridictionnelle. Les lois de validation ne sont-elles pas déjà, selon eux, un affront à l’État de droit ? En acceptant que les élus puissent avoir le dernier mot sur le juge, même au terme d’une procédure exigeante, ne livrerait-on pas les droits fondamentaux aux pulsions illibérales et populistes ?
Le scandale leur paraîtrait plus grand encore si le Parlement pouvait faire fi du jugement d’une cour supranationale. Ne serait-ce pas là violer les traités que nous avons souscrits et créer une contradiction inexpiable entre droit interne et droit international ? Le « passer outre » envisagé ne heurterait-il pas de front nos engagements européens ? N’entrerait-il pas en contradiction, au sein de la Constitution, avec la règle du « Pacta sunt servanda » ainsi qu’avec les articles 55 (supériorité des traités) et 88-1 (primauté du droit de l’Union) ?
La règle du passer outre parlementaire (ou dernier mot) serait cependant un remède moins brutal, pour restaurer la souveraineté populaire, que le Frexit, ou que la dénonciation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ou que la suppression pure et simple du contrôle de constitutionnalité.
LVSL – L’histoire a montré que les principes de 1789 ne suffisent pas seuls à garantir que la décision démocratique rencontre les exigences de l’intérêt général. La captation de l’État par les intérêts particuliers est d’autant plus forte lorsque l’État est empêché par son auto-limitation croissante, d’une part et par l’obligation qui lui est faite d’assurer toutes sortes de catégories contre les risques qu’ils identifient, réalité évoquée par le Conseil d’État en 2018. Quels sont les mécanismes de gouvernance qui vous paraissent propre à favoriser la rencontre entre la prise de décision démocratique et les exigences de l’intérêt général ?
J.-É. S. – Les fondements historiques de l’intérêt général sont anciens et divers (pensons à Jean Bodin), mais on n’a pas assez insisté sur ses fondements républicains
L’intérêt général – ou plutôt, pour employer la langue si parlante de l’époque, le « bien commun » – était une préoccupation essentielle des hommes de 1789. Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fait référence à des notions telles que le « bonheur de tous » ou « l’utilité commune ». La Déclaration proclame donc non seulement l’émancipation de la personne, mais encore la nécessité d’œuvrer au bien commun pour mener à bien cette émancipation. Ce n’est pas le manifeste d’individualisme bourgeois triomphant que nous a longtemps dépeint une certaine vulgate marxiste.
En témoignent ces passages de la Déclaration que je relis toujours avec émotion :
- Son Préambule : « afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous»,
- Ou son article 1er : « …les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » ;
- Ou encore son article 12 : « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force commune : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée».
Les mécanismes représentatifs ont cependant révélé des défaillances dans l’identification de l’intérêt général. Pour les hommes de 1789, la loi tend spontanément à la réalisation du bien public, car elle exprime la volonté générale. Cette tradition légicentriste fonde la souveraineté sur le suffrage. Les tragédies du siècle dernier devaient toutefois montrer que la démocratie exige plus que le suffrage universel : la majorité peut s’abuser ou être abusée.
Déjà, dans la conception classique de la souveraineté nationale, la volonté générale ne se réduisait pas à la sommation des opinions et des intérêts particuliers. Jean-Jacques Rousseau l’avait bien pressenti, pour qui : « Il y a bien souvent de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle‑ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, l’autre n’est qu’une somme de volontés particulières ».
En dehors même de telles circonstances, le principe majoritaire ne garantit qu’approximativement la prise en compte, dans la conduite des politiques publiques, des intérêts supérieurs de la collectivité et ce, pour diverses raisons. Les mécanismes démocratiques de prise de décision font souvent plus grand cas d’un intérêt catégoriel actuel, organisé et bruyant que d’un intérêt plus ample et plus éminent, mais aussi plus diffus. Autrement, ces mécanismes arbitrent avec difficulté lorsque la problématique devient complexe.
En outre, le mode de décision démocratique fait plus grand cas des intentions que des conséquences indirectes ou des effets pervers des politiques suivies. La griserie de l’annonce supplante souvent les contraintes austères de la prévision. Surtout, ces mécanismes se révèlent volontiers indifférents aux intérêts des générations futures. L’expérience montre en effet, hélas, que beaucoup de consensus présents se réalisent aux dépens de nos descendants.
Déjà, dans la conception classique de la souveraineté nationale, la volonté générale ne se réduisait pas à la sommation des opinions et des intérêts particuliers. Jean-Jacques Rousseau l’avait bien pressenti, pour qui : « Il y a bien souvent de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale : celle‑ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, l’autre n’est qu’une somme de volontés particulières ».
C’est encore plus vrai aujourd’hui, car la politique doit s’atteler aux problèmes ardus posés par la gestion de la société contemporaine, qu’il s’agisse de ses dimensions classiques (formation, santé, sécurité, aménagement du territoire, défense et relations internationales…), ou de préoccupations plus actuelles telles que l’environnement, les technologies de l’information, le développement durable, l’immigration, la lutte contre l’exclusion ou la bioéthique.
Ces préoccupations sont devenues si vives, et si relative la confiance accordée aux procédures de vote majoritaire classiques pour les prendre en compte que nous avons inscrit dans la Constitution elle-même une Charte de l’environnement. De même, nous envisageons de relayer la démocratie représentative par une démocratie participative fondée sur le référendum d’initiative populaire, ou sur le recours permanent à une « Agora électronique », ou encore sur des mécanismes d’implication directe de citoyens tirés au sort à la prise de décision publique, comme celui de la « Convention citoyenne Climat » expérimenté sous l’égide du CESE, mécanisme qu’un projet de loi organique prévoit de généraliser.
Mais la foi souvent naïve que beaucoup placent dans le dépassement de la démocratie représentative ne doit pas faire déraisonner. La raison est une notion constamment convoquée par les hommes de 1789, qui en font une sœur siamoise du « bien commun ». Intérêt général et raison sont en effet intimement liés pour les hommes de 89. Dès Condorcet, la pensée républicaine noue un lien étroit entre la raison d’une part, la liberté et la démocratie d’autre part.
L’autonomie de la personne, comme la participation à la vie publique, ne peuvent s’exercer à bon escient que si le libre arbitre du citoyen est éclairé par la raison, elle-même forgée dans le creuset de l’instruction. La raison doit non seulement éclairer le citoyen, mais guider le Représentant. Il s’en dégage un modèle de gouvernance fondé sur l’arbitrage réaliste entre ressources limitées et besoins infinis.
Cet arbitrage est soucieux de faisabilité et d’effectivité. Il se préoccupe des effets indirects, différés, collatéraux ou pervers des mesures prises. Il ne se contente pas de bonnes intentions. Il ne confond pas action et communication. Il pratique avec honnêteté l’évaluation des politiques publiques et les études d’impact. Il se défie des emballements émotionnels car il sait, avec Milan Kundera, que l’émotion, en évinçant le raisonnement, produit la tyrannie.
La recherche de l’intérêt général accorde plus d’importance aux résultats qu’aux intentions. Loin donc de s’écarter de l’éthique, la recherche de l’intérêt général se rattache à une éthique plus exigeante, qui est celle de la responsabilité. Cette dernière consiste non pas à se désintéresser des valeurs morales, mais à juger moralement une politique non au regard des intentions proclamées, mais en fonction des résultats raisonnablement escomptés (si on se place ex ante) ou des résultats objectivement obtenus (si on se place ex post).
Et comment ne pas évoquer à cet égard la figure tutélaire de Pierre Mendès France et sa République moderne ? Et comment ne pas parler, au travers de la figure de Pierre Mendès France, du courage en politique ? Courage et intérêt général vont en effet de pair. Est courageuse, au sens mendésien, une politique à la fois lucide dans la détermination de la meilleure conduite collective et entêtée dans la mise en œuvre de cette conduite.
Pierre Mazeaud, dans son discours de vœux de 2005 en qualité de président du Conseil constitutionnel, donnait quelques exemples de politiques courageuses et inspirées par l’intérêt général :
« L’intérêt général, en matière économique, c’est ne pas retarder l’adaptation des comportements par des artifices temporaires consistant à neutraliser, aux frais de la collectivité, le phénomène qui rend inéluctable une telle adaptation. L’intérêt général, en matière sociale, c’est ne vouloir un nouvel avantage ou une nouvelle prestation qu’en en assumant la contrepartie en termes de coûts, de bureaucratie ou d’effets secondaires.
L’intérêt général, en matière d’immigration, c’est mener de pair une intégration chaleureuse et volontariste des étrangers établis sur notre sol et une maîtrise effective du flux migratoire. Dans le domaine des libertés publiques, l’intérêt général consiste à concilier avec réalisme les droits potentiellement en conflit, sans oublier que la défense trop intransigeante d’un droit peut compromettre la protection des autres.
C’est compter le principe de réalité au nombre des grands principes et ne pas sacrifier la nécessité publique à une conception abstraite du droit. L’intérêt général, en matière de lutte contre la criminalité, c’est proportionner à la gravité des infractions non seulement les peines, mais encore les moyens de la justice et de la police. L’intérêt général, en matière d’institutions, c’est de préférer leur pérennité à leur adaptation à l’air du temps, au demeurant souvent illusoire…
L’intérêt général commande aux responsables des affaires nationales (et à ceux qui aspirent à les remplacer) de se consacrer aux problèmes de fond affectant la vie de nos concitoyens et, demain, celle de leurs enfants, plutôt qu’à désorienter le public et à disperser l’énergie de la classe politique en remettant inconsidérément en cause un équilibre institutionnel dont le fonctionnement se compare plus qu’honorablement à celui des précédentes Républiques…. »
La question du devenir de l’intérêt général, dans la conception et l’exécution de nos politiques publiques,est profondément liée à celle du respect du principe de réalité.
De façon générale, la recherche raisonnée du bien commun privilégie l’efficacité sur toute autre considération, même parée des atours de l’idéal ou inspirée par les roueries de l’habileté politique. Seuls valent les remèdes réels, y compris lorsqu’ils sont difficiles à exposer ou à mettre en œuvre. Les remèdes virtuels ou les demi-mesures n’apportent qu’une consolation éphémère. Sur le moment, ils permettent au responsable public de prendre une posture avantageuse ou d’apaiser les appréhensions. Mais, à terme, lorsque se révèle l’inefficacité de ces médications en trompe l’œil, la crédibilité du politique subit une nouvelle érosion.
Ennemi des mesures fallacieuses, l’intérêt général ne l’est pas moins des projets utopiques. La recherche du bien commun consiste à concentrer les efforts sur le possible et à prendre clairement acte de ce qui échappe à la volonté politique.
Le contexte actuel nous donne moult exemples de ce dévoiement de l’intérêt général. La loi revêt souvent une fonction cathartique ou propitiatoire, d’où l’emploi de termes particuliers et peu précis. Elle poursuit parfois des buts inconciliables, en voulant satisfaire tout le monde et son père ; elle confie, pour ce faire, une mission impossible à des décrets d’application…dont il ne faut pas s’étonner, dès lors, qu’ils ne paraissent jamais ! Les lois se veulent radicales, mais, par exemple, celle sur le « droit au logement opposable » n’a pas fait construire un logement de plus.
Que dire de l’inversion de la règle selon laquelle le silence de l’administration vaut refus ? L’usine à gaz que constitue la réglementation déclinant cette règle ajoute les exceptions aux exceptions, produisant un maquis d’insécurité juridique. L’accessibilité généralisée des lieux publics aux personnes handicapées est une idée généreuse, mais son application doit être sans cesse reportée… L’idée du bonus-malus énergétique a présenté aussi de redoutables difficultés d’application.
Ennemi des mesures fallacieuses, l’intérêt général ne l’est pas moins des projets utopiques. La recherche du bien commun consiste à concentrer les efforts sur le possible et à prendre clairement acte de ce qui échappe à la volonté politique.
Nous en avons une nouvelle illustration, dans la période actuelle : l’intérêt général commande, plutôt que de rêvasser à un monde d’après, de réparer et d’amender le monde d’avant pour résister aux chocs futurs. La crise sanitaire a moins remis en cause le monde d’avant qu’elle n’a renforcé certaines évolutions déjà à l’œuvre avant l’arrivée du virus (restauration de ce qu’il faut de frontière pour limiter les dégâts de la mondialisation ; modèle de développement plus respectueux de l’environnement et maîtrisant ses effets collatéraux négatifs ; État protecteur, dans sa dimension sociale comme dans sa dimension régalienne).
La restauration de la volonté politique n’est pas l’interventionnisme brouillon. A cet égard, je crains une relance se déclinant en trop de plans sectoriels et se donnant trop d’objectifs pour être pilotable…
LVSL – L’épidémie de Covid-19 a révélé l’extrême fragilité de la société française : inexistence d’une base industrielle propre à assurer notre autonomie stratégique, absence de structures de planification et de prospective à même de permettre à l’État de réagir aux chocs exogènes et dépendance à l’égard de l’étranger pour des produits essentiels. Sur quels principes un gouvernement soucieux de l’intérêt général fonderait son action pour réarmer la France dans « le monde d’après » ?
J.-É. S. – Après la fin de la guerre froide, nous avons cru que le Droit et le Marché suffisaient aux besoins des démocraties contemporaines. Nous découvrons aujourd’hui que la réponse aux crises répétitives qui,depuis une vingtaine d’années,assaillent notre sécurité, dans toutes les acceptions du terme « sécurité » (matérielle, sanitaire, économique, culturelle…), exige quelque chose de plus, qui relève de l’intérêt général, du courage politique, de la souveraineté, qui appelle l’intervention d’un État non pas interventionniste au sens tatillon du mot, mais agile et stratège.
Gouvernement, Parlement, élus locaux sont aujourd’hui trop contraints par des normes, des contre-pouvoirs, des procédures, des juridictions nationales et supranationales. Ils sont comme Gulliver ligoté par les Lilliputiens. Pour redonner à leur action la vigueur que la société attend d’eux, il faut dénouer ces liens et libérer la force des ambitions.
Le principal enseignement à tirer de la crise sanitaire est en effet le besoin d’État, mais d’un État plus anticipateur, plus souple et plus réactif. Nous avons observé le meilleur (dévouement, imagination facilitatrice), mais aussi le pire (bureaucratie, défections…) de la part tant des responsables que des agents publics. Comment redonner à l’État ce ressort et ce tonus que la société attend de lui, particulièrement en temps de crise, mais aussi dans ses relations habituelles avec les particuliers et les entreprises ? Comment réarticuler entre elles (et dans l’esprit des citoyens) les grandes dimensions de l’action de l’État (régalien, prestataire et gardien du long terme) ?
Plusieurs facteurs sont en jeu dans cette restauration. D’abord une vision. Il faut retrouver la foi dans la chose publique, renouer avec une transcendance républicaine. Je renvoie à cet égard à ce que j’ai dit plus haut. Nous ne pouvons non plus faire l’économie d’une transformation radicale de l’environnement institutionnel
Pour accomplir efficacement leurs missions et honorer le pacte qui les lie aux citoyens, les délégataires de la souveraineté populaire, Gouvernement, Parlement, élus locaux sont aujourd’hui trop contraints par des normes, des contre-pouvoirs, des procédures, des juridictions nationales et supranationales. Ils sont comme Gulliver ligoté par les Lilliputiens. Pour redonner à leur action la vigueur que la société attend d’eux, il faut dénouer ces liens et libérer la force des ambitions.
C’est un changement de paradigme tant il y aurait à faire (et à défaire) et tant cette idée de restaurer les marges de manœuvre du législateur, du Gouvernement, des ministres, des maires, des administrateurs, est contre-intuitive à une époque où il n’est question que de contre-pouvoirs, de démocratie participative et de procédures garantissant la moralisation de la vie publique, et où l’action publique est toujours soupçonnée, faute d’être surveillée, d’en faire trop contre les libertés, trop pour les privilèges et pas assez pour la satisfaction des droits.
Je vais donc faire un rêve régalien, en étant conscient que ce rêve est le cauchemar de tous ceux qui ont trouvé un intérêt matériel ou idéologique à ficeler Gulliver. Dans ce rêve, libérer Gulliver des liens qui l’enserrent impliquerait d’’œuvrer, y compris par la renégociation des traités, en faveur d’une Europe des coopérations plutôt que des institutions, d’une Europe des nations plutôt que fédérale et d’une Europe respectueuse des frontières nationales (Schengen ne doit plus être un carcan). Sans frontière, l’État est un ectoplasme. Pour la monnaie, hélas, c’est trop tard.
Un tel rêve supposerait de dénoncer ou renégocier nos engagements internationaux pour s’affranchir de tutelles juridictionnelles supranationales (CEDH, en partie CJUE) et recouvrer notre souveraineté en matière migratoire. Là encore, pas d’Etat sans frontière.
Il imposerait de mettre fin à la dyarchie entre le Président de la République et le Premier ministre en instaurant un régime parlementaire, avec un mode scrutin garantissant l’émergence d’une majorité. Il conviendrait d’inscrire dans la Constitution elle-même, pour l’élection des députés, le principe du scrutin majoritaire uninominal de circonscription : chaque député doit en effet représenter l’ensemble de la Nation et non pas seulement un parti (comme ce à quoi conduit la proportionnelle).
Il conviendrait de revoir, dans la Constitution, le partage entre la loi et le règlement dans un sens plus souple, conformément à l’esprit de 1958, de supprimer la QPC et de revoir les procédures de référé administratif dans un sens moins intrusif pour l’administration. Il faudrait également replacer la primauté de la loi au centre de notre édifice institutionnel (notamment avec un « dernier mot » parlementaire pour contrer le gouvernement des juges).
Il s’agirait de dépénaliser la vie publique (en mettant fin aux infractions non intentionnelles), afin notamment d’éviter que la tentation d’ouvrir un parapluie pénal ne produise des comportements prudentiels de type bureaucratique (évitement, segmentation des responsabilités etc) nuisant à la réactivité administrative. Cela nécessiterait de mettre fin à l’existence d’organes dont l’action s’est révélée concurrente et paralysante de celle des pouvoirs publics (Défenseur des droits, CNIL, Commission nationale consultative des droits de l’homme…).
Il serait également utile d’alléger drastiquement les obligations formelles de l’administration, notamment leurs obligations consultatives et de démanteler en grande partie le maquis de normes enserrant l’action tant des collectivités territoriales que de l’État lui-même et de l’ensemble des administrations publiques. Je suggérerais également d’assouplir la procédure budgétaire au-delà de ce qu’a fait la LOLF (pluriannualité, enveloppes globales et programmes globaux).
Les experts doivent être placés à leur juste place: éclairer, non co-décider. Il apparaît également nécessaire de déconcentrer l’action de l’État en laissant la bride sur le cou des responsables tant pour l’emploi des crédits (fongibilité) que pour l’organisation et le fonctionnement de leurs services et pour la gestion des ressources humaines et de mettre fin à la cogestion syndicale, en laissant à chaque responsable le soin de mettre en place les modes de consultation qu’il estime appropriées.
Les ministres devraient être nommés en petit nombre (mais assistés de secrétaires d’État techniques), ayant un profil les rendant aptes à se comporter comme les patrons de leur ministère et, sous réserve de la faisabilité des ambitions, à faire prévaloir la volonté politique sur les résistances de l’État profond.
Les pouvoirs d’arbitrage et de régulation des préfets devraient être renforcés et les administrations de mission transversales et les guichets administratifs territoriaux polyvalents devraient être développées. Un tel mouvement implique également d’assouplir les rapports entre État et particuliers dans le sens de la sécurité juridique (rescrit par exemple) et de permettre aux collectivités territoriales (plutôt que de leur donner plus d’attributions) d’exercer leurs compétences de façon plus libre, tout en renforçant leur autonomie fiscale et en assouplissant les règles de l’intercommunalité.
Il en découlerait la nécessité de développer, face aux problèmes et aux crises, sous la houlette du Premier ministre (au niveau national) et du préfet (au niveau local), le réflexe de coopération au sein des services de l’État, comme entre services de l’État, collectivités et acteurs privés (associations et entreprises). L’obligation de continuité des services publics devrait être inscrite dans le marbre constitutionnel. Un service national obligatoire devrait être créé.
Il conviendrait aussi de construire un système de santé publique associant hôpitaux publics et médecine libérale, avec des obligations de service public pour les personnels soignants libéraux et de prendre beaucoup plus en charge les élèves de l’enseignement public, en multipliant les internats et en y développant le civisme et le sentiment d’appartenance national.
Enfin, l’État doit assumer la part régalienne, unilatérale, de l’action publique.
Je propose aussi d’ouvrir la magistrature aux expériences extérieures en recrutant hors ENM des personnes expérimentées (et pas seulement des universitaires) dans une proportion sensiblement supérieure à l’actuelle ; de favoriser la mobilité des magistrats dans la fonction publique de l’État et dans la société civile ; de permettre à un CSM rénové et moins corporatiste, saisi par les chefs de juridiction ou par les justiciables au travers de filtres appropriés, de connaître des abus dans la manière de juger et notamment des atteintes au devoir d’impartialité.
Il faut rendre au garde des Sceaux, pourvu qu’elles soient écrites et versées au dossier du contradictoire, la possibilité de donner des instructions écrites au parquet dans les affaires individuelles. La frontière tracée depuis 2013 entre politique pénale générale (pour laquelle le ministre de la justice peut adresser des instructions aux procureurs de la république par voie de circulaire) et affaires individuelles (dans lesquelles il ne peut plus intervenir) est en effet trop ténue pour ne pas être artificielle. A terme, c’est la séparation du parquet et du siège qu’il faut envisager. D’ici là, rien ne doit être fait qui banalise le statut du parquet au sein de la magistrature. C’est au contraire dans une plus grande participation des officiers de police judiciaire à la mise en mouvement de l’action publique, autrement dit dans un rapprochement entre police judiciaire et parquet, qu’il faut chercher une riposte aux formes contemporaines de délinquance aujourd’hui non maîtrisées.
Enfin l’État doit assumer la part régalienne, unilatérale, de l’action publique et de restaurer l’autorité de l’État, les marges de manœuvre de la police administrative et la capacité d’action des forces de sécurité face à l’ensauvagement de certaines franges de la société.
Cette libération de l’action publique doit trouver sa contrepartie dans une beaucoup plus grande responsabilité ex post de chaque élément du système à l’égard de celui qui le contrôle (agent public à l’égard de sa hiérarchie, Gouvernement à l’égard du Parlement dont le pouvoir de contrôle doit être considérablement renforcé…). Cela vaut en particulier pour les agents publics : un statut protecteur certes, contrepartie de leurs obligations de disponibilité, mais une mobilité beaucoup plus grande et une possibilité beaucoup plus large qu’aujourd’hui de radiation en cas d’insuffisance, à l’initiative du responsable hiérarchique.
La restauration de l’État est aussi affaire de conscience individuelle, d’honneur professionnel, de capacités personnelles et de formation des agents publics. Là encore, la crise sanitaire en fournit l’illustration. Face à l’inconnu, et dans la crainte de voir leur responsabilité engagée, les responsables publics ont souvent été tentés d’ouvrir le parapluie : par exemple, en s’en tenant à la procédure orthodoxe de passation des marchés pour acquérir les masques dont le besoin était pourtant urgent ; ou en imposant aux écoles et aux branches professionnelles des règles de sécurité sanitaire trop vétilleuses pour ne pas nuire à la reprise effective de l’activité.
C’est essentiellement cette attitude prudentielle qui a pu faire parler de blocages bureaucratiques. Sa cause se trouve plus dans le manque d’agilité des esprits que dans la rigidité des structures, comme le montre la comparaison des comportements des différentes agences régionales de santé au printemps 2020. Les responsables (publics et privés) n’ont pas fait tous preuve, tant s’en faut, du même degré de disponibilité et d’imagination. Et ce qui est vrai des responsables l’est tout autant de la base : à côté de dévouements magnifiques, nous avons assisté à de lamentables démissions. Pour reprendre l’image de la guerre, le corporatisme a poussé à la désertion.
Nous touchons ici du doigt une dimension essentielle du redressement de l’action publique, qui est culturelle : l’intériorisation par chacun de l’intérêt général. Cette dimension me semble aussi importante que tout ce qui tient aux règles juridiques, à la gouvernance, à l’organisation et au fonctionnement de l’administration, aux mécanismes de prise de décision. Et, au travers de cette dimension culturelle, nous mesurons également l’éminence des questions de recrutement et de formation des agents publics.
LVSL – On peut également relever deux faits saillants s’imposant de manière croissante : la judiciarisation de la vie politique d’une part, ce risque pénal influant sur le comportement des responsables politiques et la multiplication des lois guidées par la dictature de l’émotionnel. Quel regard portez-vous sur cette évolution ?
J.-É. S. – Au modèle ambitieux – mais rationnel, réaliste et responsable – de gestion des affaires publiques, que je qualifierais de mendésien, s’opposent la prépondérance des droits subjectifs et des principes abstraits, la judiciarisation de la vie publique, le règne de la sensiblerie et de la moraline, qui, depuis que nous sommes entrés dans « l’Empire du Bien » de Philippe Muray, c’est-à-dire depuis une cinquantaine d’années produisent une « démocratie contentieuse» (Jean Paul Pagès).
Cette conception libérale de l’action publique préformate nos politiques publiques en réduisant toujours davantage, dans des domaines majeurs de l’action publique, la marge de manœuvre des pouvoirs exécutif et législatif et siphonnent la souveraineté populaire en dépouillant toujours plus le Gouvernement, le Parlement et l’Administration au profit d’organes non élus, de groupes de pression et de juges, tant nationaux que supranationaux, érigés par la clameur médiatique en chaperons de l’État et en protagonistes principaux des percées démocratiques.
Raviver le feu sacré pour la chose publique n’est qu’accessoirement affaire de structures et de méthodes. Il s’agit principalement d’état d’esprit, de critères de recrutement et de contenu des enseignements. Mieux et plus ambitieusement servir son pays, avec loyauté à l’égard des élus et avec la préoccupation constante de l’efficacité dans la recherche de l’intérêt général : voilà ce qui importe.
Prétendre faire advenir un idéal sans en cerner les voies et moyens conduit à l’émergence de ces lois bavardes d’autant plus difficiles à appliquer par l’administration et par le juge qu’elles instituent des obligations de résultat floues, équivoques ou inaccessibles. Le résultat, c’est l’assujettissent de la souveraineté à un droit qui déborde et contraint la loi, et dont la source se trouve ailleurs que dans la loi : plus particulièrement dans la jurisprudence des cours suprêmes, nationales et supranationales.
LVSL – Depuis le Consulat jusqu’à la Vème République, la République a fondé sa recherche de l’intérêt général sur un État fort et des serviteurs de l’État pour imposer sa puissance. On observe une interpénétration croissante entre les intérêts privés et les serviteurs de l’État : pantouflage entre le privé et le public, rôle croissant des cabinets de conseil et des groupes d’intérêt dans la décision publique. Dans ce contexte, comment faut-il envisager la réforme de l’ENA et, plus largement, l’évolution de la formation des fonctionnaires ?
J.-É. S. – La vraie réforme de l’ENA et des autres écoles de recrutement de la fonction publique consisterait à restaurer, dans le cœur des fonctionnaires, la ferveur du service public, l’amour de l’intérêt général et le souci de la cohésion sociale. Cela ne se décrète pas bien sûr : j’ai donc conscience de poursuivre mon rêve.
Raviver le feu sacré pour la chose publique n’est qu’accessoirement affaire de structures et de méthodes. Il s’agit principalement d’état d’esprit, de critères de recrutement et de contenu des enseignements. Mieux et plus ambitieusement servir son pays, avec loyauté à l’égard des élus et avec la préoccupation constante de l’efficacité dans la recherche de l’intérêt général : voilà ce qui importe.
A l’ENA comme dans les autres écoles de la fonction publique, par contagion avec l’évolution du reste la société, un certain individualisme, un certain désamour pour la Nation, une certaine ringardisation de l’État, une fascination inédite à l’égard du libéralisme économique et sociétal, un attrait accentué pour le pantouflage, ont fait leur nid depuis une trentaine d’années. Le service de l’État devient une forme comme une autre de management.
Le feu sacré ne s’est pas éteint, mais il a décliné. Le raviver est l’enjeu essentiel de la réforme des écoles de recrutement de la fonction publique.