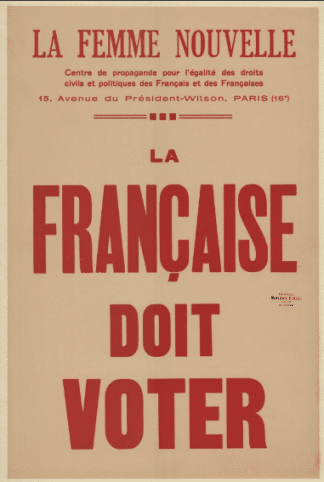Alors que la LPPR – Loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche, doit être adoptée par l’Assemblée nationale ce mardi 17 novembre, puis par le Sénat le 20, les critiques fusent. En cause, une réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche publique jugée fatale par la profession. Mais c’est surtout autour de deux amendements que les tensions se cristallisent : l’un supprimant le CNU -Conseil national des universités, et l’autre pénalisant les étudiants qui voudraient se mobiliser sur les campus à des peines de prison. Un couperet tombé sur l’université, qui était encore un des derniers lieu privilégié d’indépendance et de libertés. Par Guillemette Magnin et Manon Milcent.
Mardi 11 novembre, 170 enseignants-chercheurs lançaient l’idée d’une grève numérique de trois jours appelée « écrans noirs ». Sans image et sans son, cette forme confinée de la manifestation s’ajoute à la longue lutte contre la LPPR, qui devrait être définitivement adoptée ce vendredi 20 novembre au Sénat. La réforme, qui est loin de faire l’unanimité entend « porter la France à la pointe de la recherche mondiale » alors que beaucoup l’accusent d’entériner le retrait de l’investissement dans la recherche publique et d’accélérer la précarisation du personnel universitaire. Mais ce n’est pas la seule inquiétude émise par les enseignants-chercheurs. En effet, la progressive mise au ban du CNU, l’évocation d’une recherche devant se faire « dans le respect des valeurs de la République » ainsi que la pénalisation des futurs mouvements étudiants inquiètent. De quoi se questionner sur l’avenir de la démocratie dans les universités françaises.
Une réforme précarisant la recherche et son personnel
Dès les premiers rapports parus au printemps dernier (voir l’article sur le sujet ici), les premières orientations de la loi laissaient craindre une coupe dans les budgets de la recherche et un appauvrissement de la profession. La version finale de la loi, malgré de nombreuses critiques, confirme bien les inquiétudes initiales. Les budgets d’abord, ne sont finalement revenus que très peu à la hausse, avec une progression qui ne devrait se faire ressentir qu’en 2028. Une augmentation qui, selon l’ancien député LREM de
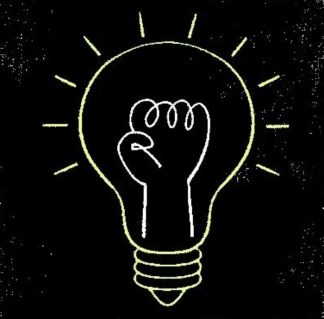
Haute-Garonne, Sébastien Nadot, ne serait « qu’un jeu de tiroirs dans le financement des retraites des personnels de la recherche »[1]. De plus, l’objectif d’atteindre les 3% du PIB promis par la ministre de l’Enseignement Supérieur ne sera finalement respecté qu’à l’aube de 2030, atteignant ainsi les 20 milliards d’euros ; une somme jugée insuffisante par une grande partie du corps universitaire. D’autant que, comme le souligne Marie Sonnette, maître de conférence en sociologie à l’université d’Angers : « Ils sont prévus sur dix ans, autant dire qu’on ne sait pas du tout si l’argent arrivera un jour. Et cela reste en deçà de ce dont on a vraiment besoin compte tenu de l’augmentation du nombre d’étudiants » [2].
« Ce n’est que la vitrine de la recherche que l’on veut améliorer, pas la recherche. » Sébastien Nadot
Cette réforme n’est finalement ni plus ni moins que la traduction d’un désengagement de l’État dans l’investissement pour la recherche au profit du privé. En favorisant son financement « projet par projet », mais aussi en limitant les budgets alloués par l’ANR (Agence nationale de la recherche), cette réforme ne fait qu’accroître la concurrence déjà existante entre les laboratoires et également entre les disciplines. Selon une logique libérale désormais bien huilée, le gouvernement confirme sa vision court-termiste et sa quête de la meilleure rentabilité. Pourtant, l’abandon des recherches sur le coronavirus à l’université de Grenoble, faute de moyens, aurait pu faire changer cette trajectoire suicidaire. À défaut de redonner du pouvoir et du budget à la recherche, « ce n’est que la vitrine de la recherche que l’on veut améliorer, pas la recherche », comme le déplore Sébastien Nadot.
Les orientations budgétaires vont aussi impacter directement les personnels universitaires. Aujourd’hui, la quête de rentabilité prend une place prépondérante au sein de l’université, alors même que l’on déplore 30 à 70 % de travailleurs précaires dans l’enseignement supérieur selon les secteurs [3]. Pourtant, plutôt que recruter de nouveaux maîtres de conférences, le gouvernement préfère créer de nouveaux statuts comme le CDI de mission scientifique ou encore « le Chair Junior ». Ce dernier, largement inspiré des « tenures tracks » à l’américaine, est en réalité un contrat de pré-titularisation, dans l’attente d’accéder à un poste de professeur des universités. Il permet de repousser le temps de la titularisation l’accès à une stabilité salariale. Face au rejet quasi-unanime de cette mesure, le gouvernement a néanmoins limité la part des« chairs juniors » à 15% des prochains recrutements.
Des questions sous tension
Mais les tensions se sont principalement cristallisées autour de trois principales questions. D’une part, le gouvernement prévoit de court-circuiter le CNU dans la qualification de maîtres de conférences et de professeurs. Auparavant, cet organe composé par 3480 membres, à deux-tiers élus et un tiers nommés, était chargé de se prononcer sur la « qualification » à la fonction de professeurs ou de maîtres de conférences par une procédure nationale. Pour accéder à cette qualification, un docteur devait obligatoirement obtenir l’appui du CNU de sa discipline (52 personnes au total) puis postuler à un poste. Cela permettait d’harmoniser les thèses et les critères de sélection des candidats provenant de différentes universités, mais aussi de différents pays [4]. Désormais, il ne sera plus obligatoire de passer cette qualification, une décision qui facilitera le « copinage » plus que la valorisation des capacités des postulants. « C’est une évolution désastreuse, qui ouvre la voie à des recrutements et à des promotions motivés par des préoccupations éloignées des mérites scientifiques et académiques qui, seuls, devraient en principe animer l’accès aux corps des enseignants-chercheurs, que garantit l’existence d’une instance nationale, indépendante et impartiale », comme l’explique un collectif de quarante universitaires dans les colonnes du JDD [5].
Les sénateurs ont également donné une occasion aux universitaires de s’insurger, en proposant d’inscrire dans la loi que « les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République ». Cet amendement, qui avait pourtant reçu l’avis « extrêmement favorable » de la ministre Frédérique Vidal, a finalement été supprimé – une des rares mais non moins notables victoires des universitaires dans la lutte contre la LPPR. Il a été remplacé par un article plus consensuel, selon lequel « les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs » [6].
« Cette loi restera peut-être dans l’histoire comme la loi qui aura réprimé le droit de manifester sur les campus. » Patrick Lemaire
Enfin, l’amendement 147 attire particulièrement l’attention, pour atteinte ouvertement portée à la liberté d’expression. Proposé en catimini lors de la commission mixte paritaire et alors même que la loi avait déjà effectué son aller-retour législatif, cet article sanctionne « d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende […] le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un [tel] établissement sans y être habilité […], dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci. » Ajoutons que la peine s’alourdit à trois ans d’emprisonnement et 45 000€ si l’entrave est considérée comme ayant été commise en réunion. Pour Patrick Lemaire, président de la société française de biologie du développement, cette « loi restera peut-être dans l’histoire comme la loi qui aura réprimé le droit de manifester sur les campus » [7].
Un débat en catimini
Si, sur le fond, cette réforme signe la déliquescence du service public de la recherche, le gouvernement est aussi parfaitement critiquable sur la forme. Alors que Frédérique Vidal disait faire « le pari de la confiance » [8] dans les colonnes du Monde, au lendemain de l’adoption du texte par la commission mixte paritaire, cela ne s’est pourtant pas ressenti tout au long de son élaboration. À chacun de ses déplacements dans les établissements d’enseignement supérieur, la ministre s’est montrée frileuse au dialogue et à la concertation. Par ailleurs, le gouvernement a dûment ignoré le rapport du CESE (Conseil économique, social et environnemental), qui dénonçait un « décrochage français de l’effort de recherche » et un texte « pas à la hauteur des défis considérables auxquels notre pays doit faire face »[9].

Plus marquant encore, l’empressement avec lequel s’est effectuée l’étude de la loi. La ministre a ainsi choisi de faire passer le texte en procédure accélérée, qui conditionne l’adoption du texte à une seule lecture par chambre. L’avenir de la recherche publique française aura donc été scellé en trois jours de débats à l’Assemblée nationale et deux jours du côté du Sénat. Dans ce bref laps de temps, la Commission mixte paritaire – qui réunit à huis clos sept députés et sept sénateurs – aura non seulement adopté mais aussi amendé le texte, donnant lieu au désormais tristement célèbre amendement 147 et à la quasi-suppression du CNU.
Une mobilisation inédite de la profession
Sans surprise, nous assistons à une nouvelle levée de boucliers de la part des universitaires qui accusent ce coup supplémentaire porté à la profession. Dès octobre dernier, le ton monte entre le CNU et leur ministre de tutelle. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, les auteurs rappellent leurs inquiétudes, exprimées massivement depuis la publication du premier rapport en novembre 2019. Celles-ci n’avaient vraisemblablement pas été entendues puisque le texte, examiné en urgence le 19 juin dernier, n’a pas permis de rassurer les universitaires. Le gouvernement avait joué l’ignorance à la perfection lors de la grève des revues de sciences sociales, le 30 janvier 2020 [10] ou encore pendant la manifestation du 5 mars dernier, qui avait rassemblé plus de 25 000 personnes dans les seules rues parisiennes [11]. Pour cette raison, les signataires déclarent que « Mme Frédérique Vidal ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour parler au nom de la communauté universitaire et pour agir en [sa faveur] »[12]. Face à l’ignorance du chef de l’État, de nombreuses pétitions ont été lancées sur les réseaux sociaux. Parmi elles, le collectif Rogue – en référence à la révolte des académiques états-uniens à l’occasion de la « march for science » – réclame la suspension pure et simple d’une loi vouée à augmenter les « déserts universitaires » et exacerber des inégalités territoriales et socio-économiques toujours plus profondes [13]. Le site Academia dénonce quant à lui « la fin pure et simple des contestations sur les campus et la porte ouverte à toutes les dérives autoritaires » [14]. En effet, le texte pose les bases d’une politique de la dissuasion par la répression des blocages et perturbations au sein des établissements, une définition volontairement floue des « entraves » désormais passibles de sanction ou encore la possibilité pour un procureur d’engager lui-même des poursuites à l’encontre des perturbateurs, indépendamment des présidents d’université. Par ailleurs, la SMF (Société mathématique de France), dénonce les ultimes amendements, adoptés sans la moindre concertation. Dans un communiqué de presse du 31 octobre 2020, elle réclamait leur retrait et rappelait que : « Les libertés académiques sont garantes d’une capacité d’analyse de notre monde, indépendante de toute pression économique, politique, religieuse ou autre » [15].
Pourquoi ce tel décalage entre l’obstination de nos dirigeants à préserver le contenu du texte et les craintes maintes fois exprimées par la communauté universitaire ? Un simple désir autoritaire d’imposer une décision verticale et d’encadrer sans entrave une profession jugée trop indépendante et trop libre ? Probablement, aussi, la volonté d’aller au plus vite, tant pour masquer les voix discordantes que pour ignorer les besoins criants de financement des universités, dans un contexte que l’on sait particulièrement incertain et précaire. À ce titre, notons que la concession accordée cet été par la ministre Frédérique Vidal de répartir le budget prévu sur sept ans au lieu de dix a été finalement abandonnée. Inaudible dans les couloirs des assemblées, le corps enseignant entend une fois de plus faire entendre sa détresse par ses propres moyens. Malgré les tentatives de leur ministre de désamorcer les tensions, précisant par exemple que l’amendement 147 « ne s’applique qu’aux personnes extérieures à l’établissement, et donc ni à ses étudiants, ni à ses personnels » [16], plusieurs organisations étudiantes et d’enseignants-chercheurs appellent à la manifestation ce mardi, 17 novembre, devant la Sorbonne.
Une défiance du pouvoir envers les scientifiques
Comment ne pas faire le lien entre une loi ouvertement punitive et l’attaque adressée par Emmanuel Macron le 10 juin dernier, rendant l’université coupable de « l’ethnicisation de la question sociale » et de la prolifération de la pensée « sécessionniste » [17] ? La défiance du chef de l’État envers les sciences humaines et sociales a de quoi intriguer. Celui qui, candidat, se vantait d’avoir été un intime du philosophe Paul Ricœur, ne cache plus son aversion pour une profession d’intellectuels, accusée de véhiculer des idéologies et de « casser la République en deux ». Mais les désaccords entre le monde académique et le pouvoir politique ne datent pas d’aujourd’hui. En 2016, la formule du premier ministre Manuel Valls, « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser », visait déjà les chercheurs et le choix de leurs objets d’étude. Selon lui, certains travaux liés aux questions de religion, de laïcité, de radicalisation se risquaient à jouer le jeu du terrorisme et de le justifier dans le débat public. Dans le contexte agité des derniers attentats, qui ont donné lieu à un durcissement du discours dans les rangs de l’exécutif, le parallèle entre les deux prises de position n’est guère étonnant. Interrogée sur France culture, Sylvie Bauer, présidente de la commission permanente du CNU, y voit une forme de censure [18].
“Comment un texte qui remet ainsi en cause le débat public et l’expression du dissensus peut-il être adopté dans l’indifférence – ou du moins la méconnaissance – quasi-générale ?”
Surfer sur une interprétation purement idéologique et partisane de la recherche c’est, à l’image de Jean-Michel Blanquer et de ses propos contre « l’islamo-gauchisme », nier la dimension scientifique des travaux en sciences sociales. Une fois de plus, le gouvernement porte une loi lourde de sens et de conséquences, puisqu’elle délégitime tout savoir, expertise ou argumentation qui ne serait pas conforme à sa propre vision de la société. Comment un texte qui remet ainsi en cause le débat public et l’expression du dissensus peut-il être adopté dans l’indifférence – ou du moins la méconnaissance – quasi-générale ? Pour la spécialiste de l’histoire des sciences à l’EHESS Christelle Rabier, cette loi constitue une menace inédite au principe de franchise universitaire, acquis en 1253 par Robert de Sorbon et permettant à l’université d’échapper au contrôle de l’État et de l’Église [19]. Garante de l’indépendance de l’université et de la liberté d’étudier et d’enseigner, la franchise universitaire risque bien d’être limitée à l’interprétation arbitraire du « délit d’entrave » au nom de la « tranquillité » et du « bon ordre » prônés par la nouvelle LPPR.
Une actualisation des lois scélérates ?
De pareils textes, permettant au pouvoir de multiplier les mesures de contrainte et d’attenter aux libertés individuelles sans contrôle d’un juge sont apparues pendant la IIIe République sous le nom de « lois scélérates ». Ces lois d’exception qui visaient en 1893 et 1894 les anarchistes se sont étendues, dans les années suivantes, aux militants politiques de gauche dans leur ensemble. Au nom de la lutte contre les attentats, les mesures répressives se sont rapidement banalisées, visant toutes opinions et paroles discordantes.

À l’instar de quelques personnalités publiques de l’époque, Léon Blum en a livré l’interprétation suivante : « Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens » [20]. Soulignant l’offense portée aux principes généraux de l’État de droit, celui qui n’était alors qu’un jeune auditeur au Conseil d’État craignait qu’aux termes de ce nouveau texte, « la simple résolution, l’entente même [prenne] un caractère de criminalité ». À l’heure des discours de fermeté et de la tension extrême entre la société civile et les forces de police générée par les luttes sociales de ces derniers mois et par le mépris affiché et croissant de nos dirigeants pour toutes formes de contestations, les mots de Blum trouvent un écho particulier. Nos élus s’apprêtent, peut-être, à poser une pierre supplémentaire à l’édifice prédateur du macronisme.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=9j__hGbT-tU&feature=youtu.be&ab_channel=S%C3%A9bastienNADOT%2CD%C3%A9put%C3%A9-France
[2] https://www.bastamag.net/Universites-LPPR-loi-enseignement-superieur-recherche-precarite-attaque-liberte-academique-petition
[3] https://universiteouverte.org/2020/02/10/la-precarite-dans-lenseignement-et-la-recherche/
[4] https://afs-socio.fr/la-qualification-par-le-cnu/
[5] https://www.lejdd.fr/Societe/Education/tribune-il-faut-defendre-le-conseil-national-des-universites-4005651
[6] https://www.franceinter.fr/societe/la-future-loi-programmation-de-la-recherche-va-t-elle-rendre-illegales-les-occupations-d-universites
[7] https://www.liberation.fr/france/2020/11/11/quand-le-gouvernement-prevoit-la-penalisation-des-mobilisations-etudiantes_1805266
[8] https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/12/frederique-vidal-entre-instance-nationale-et-universites-autonomes-le-pari-de-la-confiance_6059511_3232.html
[9]https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_13_programmation_pluriannuelle_recherche.pdf
[10] https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-emission-du-lundi-03-fevrier-2020
[11] https://universiteouverte.org/2020/03/06/aujourdhui-luniversite-et-la-recherche-sarretent/
[12] https://www.liberation.fr/debats/2020/11/08/frederique-vidal-ne-dispose-plus-de-la-legitimite-necessaire-pour-agir-en-faveur-de-l-universite_1804958
[13] http://rogueesr.fr/une_autre_lpr/
[14] https://academia.hypotheses.org/28130
[15] https://smf.emath.fr/actualites-smf/311020-3-amendements-lppr
[16] https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-contestation-contre-le-projet-de-loi-recherche-relancee-dans-les-universites-1265195#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-links_twitter
[17] https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/30/comment-emmanuel-macron-s-est-aliene-le-monde-des-sciences-sociales_6044632_3224.html
[18] https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-mercredi-11-novembre-2020
[19] https://djalil.chafai.net/blog/2020/03/09/franchise-universitaire/
[20] https://www.monde-diplomatique.fr/2020/01/KEMPF/61188