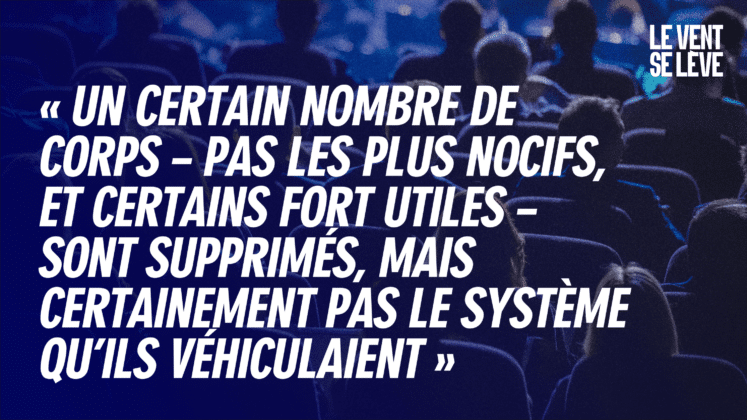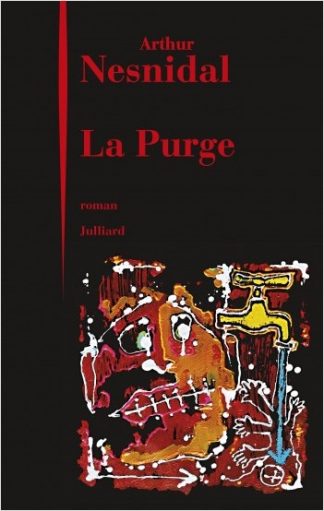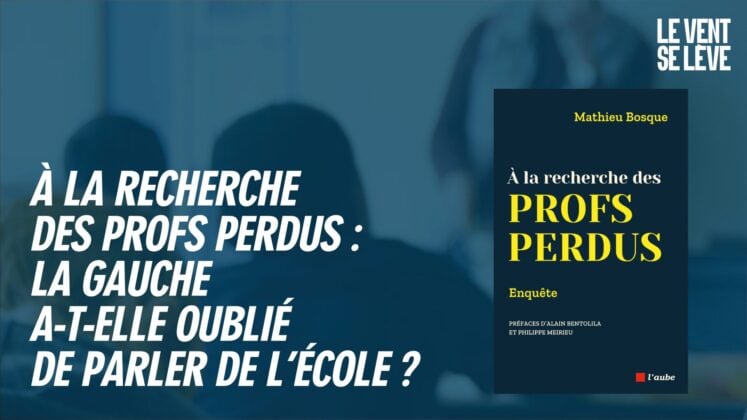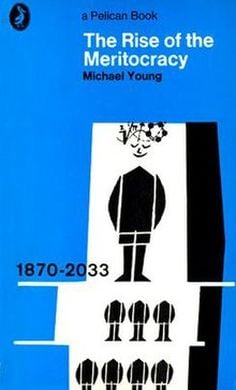Paul Pasquali est chercheur au CNRS en sociologie, spécialiste de la mobilité sociale. Il vient de publier Héritocratie. Les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite (1870-2020), un ouvrage à propos duquel nous avons souhaité l’interroger.
LVSL – Comme vous le montrez dans votre ouvrage, il n’y a jamais eu d’« âge d’or de la méritocratie », ni non plus une augmentation progressive de l’ouverture sociale des grandes écoles, mais bien plutôt une alternance de phases de hausse et de baisse de celle-ci. Pouvez-vous nous en décrire plus précisément les évolutions ainsi que leurs causes ?
Paul Pasquali – Effectivement, le recrutement social des grandes écoles ne suit pas une évolution linéaire. D’abord, il varie selon les écoles, selon leur position dans l’espace des grandes écoles, qui est un espace structuré avec un pôle dominant et un pôle dominé. Ensuite, il n’y a pas d’époque plus ou moins lointaine où il y aurait eu énormément de boursiers. Il y a eu des épisodes, souvent brefs, de relative ouverture, pour telle ou telle école, dans les années 1920-1930, à la Libération ou après 1968, comme je le détaille dans mon livre au sujet de l’ENS Ulm, de l’ÉNA ou de Sciences Po. Mais il n’y a jamais eu d’ouverture sociale massive ni durable. Le fait dominant, sur le long terme, c’est plutôt la fermeture sociale que l’ouverture. Il y a une constante : quelle que soit l’école, quelle que soit la politique menée, il y a toujours eu une tendance à la reproduction sociale, y compris au lendemain des brèves parenthèses dont j’ai parlé. Et même dans les phases d’ouverture, ce ne sont jamais les enfants de milieux les plus populaires qui en ont bénéficié. Ça, c’est très important : quand il y a des progrès en termes d’ouverture sociale, cela concerne plus la petite bourgeoisie que les familles ouvrières.
D’autre part, quand il y a ouverture, ça ne correspond pas nécessairement à une volonté ou un programme qui est mis en place par l’école, cela peut traduire des changements structurels qui concernent l’ensemble de la société ou l’ensemble de l’institution scolaire, par exemple la politique des bourses dans les années 1920-1930 : avec la multiplication des bourses dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement primaire supérieur voulue par des gouvernements de gauches, beaucoup plus d’éléments venant des classes populaires ont fait des études longues et cela a ensuite rejailli sur l’enseignement supérieur et, dans certains cas, sur les effectifs des grandes écoles. Il ne faut pas croire cependant que les grandes écoles ont été la cause de leur ouverture ou de leur fermeture. Surtout, ce que je montre dans le livre, c’est l’importance, dans l’histoire, des moments de crise et de guerre qui souvent désorganisent le système de reproduction sociale – pas forcément très longtemps certes, mais en tout cas, on constate des variations au niveau des statistiques dans le recrutement social des élites, qui ont tendance à s’ouvrir plus après une guerre, après une tentative de révolution ou un grand vent réformateur comme le Front populaire ou la Libération par exemple.

LVSL – Vous montrez que le constat du recrutement socialement très fermé des grandes écoles, de même que les discours sur la « panne de l’ascenseur social », ne sont pas nouveaux. Pourtant, les grandes écoles ont « toujours démontré une redoutable capacité à résister aux critiques et aux attaques, même les plus virulentes », et à s’organiser afin de défendre leurs intérêts communs, par exemple à travers la Conférence des grandes écoles. Comment y parviennent-elles ?
Paul Pasquali – À chaque époque, les grandes écoles ont dû se mobiliser pour défendre leur modèle et leurs intérêts, pour garantir leurs privilèges et leurs prérogatives. La Conférence des grandes écoles est la principale organisation qui les réunit. Elle a été créée en 1968 – officiellement 1973, mais en réalité, les premières réunions des écoles fondatrices de la CGE datent de 1968, en réaction précisément à une déstabilisation brutale et massive du système universitaire et des grandes écoles en particulier, puisque celles-ci étaient menacées dans leur existence même. Depuis sa création, elle a défendu les intérêts des grandes écoles, notamment quand les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1981, les grandes écoles ont tout fait pour montrer que non seulement elles avaient bien des raisons d’exister, mais qu’en plus leur modèle était le meilleur par rapport aux universités et qu’il fallait donc s’en inspirer pour l’ensemble de l’enseignement supérieur.
Dans mon livre, je montre comment ce discours apparemment neutre laisse dans l’ombre un malthusianisme qui assumait des pratiques d’une extrême sélectivité sociale et parfois économique – on l’oublie parfois – pour les écoles de commerce notamment, au-delà de la sélection scolaire sur laquelle les grandes écoles préfèrent souvent insister. Enfin, au-delà des discours, il y a des soutiens, notamment politiques, souvent très haut placés : quand un projet de réforme de l’enseignement supérieur et des grandes écoles en particulier est dans les cartons, les dirigeants des grandes écoles ou leurs relais politiques – souvent des anciens élèves de telle ou telle école – font bloc, soit au Parlement, soit auprès des médias, soit au sein de leur parti, pour que cette défense soit efficace. En fait, ce qu’on appelle en sociologie la « multipositionnalité » des élites fait que quand on est diplômé de telle ou telle école, on a aussi des intérêts ou des valeurs qui font qu’à la fin, sans qu’il s’agisse nullement d’un complot – c’est très important – il y a des affinités, des regroupements, du « cela va sans dire », une forme de sens commun pro grandes écoles qui fait que les élites issues des grandes écoles font bloc si nécessaire.
LVSL – Par exemple ?
Paul Pasquali – Par exemple, la troisième voie de l’ÉNA créée en 1983 par le ministre communiste Anicet le Pors afin de démocratiser l’ÉNA, notamment au bénéfice de syndicalistes, a été combattue par l’Association des anciens élèves de l’ÉNA, qui se sont beaucoup mobilisés pour faire échouer cette réforme, y compris après son adoption par la voie législative. Ils ont perdu dans un premier temps, mais finalement ont obtenu sa suppression quand la droite est revenue au pouvoir en 1986. J’évoque aussi l’exemple d’un texte de l’A.X., l’association des anciens polytechniciens, en 1977 dans son bulletin officiel, La Jaune et la Rouge, qui lança un appel très alarmiste à tous les polytechniciens pour les enjoindre de mobiliser leurs réseaux afin d’éviter la fusion des grandes écoles et des universités prévue dans le Programme commun du PS et du PCF (proposition qui disparaîtra des 110 propositions du candidat Mitterrand).
“Le pouvoir des grandes écoles repose avant tout sur leur propension à se soustraire au droit commun”
LVSL – Déjà, en 1968, vous montrez que les grandes écoles ont su repousser la tentative d’Edgar Faure de réduire leur autonomie en les mettant dans une même loi que les universités…
Paul Pasquali – Oui, l’idée était alors de recréer l’enseignement supérieur sur de nouvelles bases ; s’était ainsi posée la question de la sélection, et Edgar Faure, une partie de la gauche et du centre voulaient faire une loi où il n’y aurait pas de sélection à l’entrée de l’université, en tout cas pas de sélection formelle et organisée comme telle. Certains allaient plus loin et voulaient inclure les grandes écoles pour qu’il n’y ait plus de sélection du tout, ou plus sur concours : il y a eu une toute une réflexion menée là-dessus, le recours aux sélections sur dossier ou à l’oral commençait à entrer dans l’air du temps mais ça n’a guère duré. Finalement, le camp le plus attaché au maintien du statu quo a réussi à sortir les grandes écoles de la loi, in extremis. Je raconte comment cela s’est passé et par quelles menaces des ministres ont dû en passer pour dissuader Edgar Faure de se mêler du sort des grandes écoles. Le pouvoir des grandes écoles repose avant tout sur leur propension à se soustraire au droit commun, d’exister de façon singulière par rapport aux universités mais aussi par rapport à chaque autre grande école. Si elles perdent cette double singularité, elles n’ont plus l’excellence qui leur permet d’être au centre des réseaux de reproduction de la classe dominante. Et au-delà de cet aspect défensif, il y a dans cette défense du corps une dimension autopromotionnelle : comme l’excellence de chaque ancien élève dépend de son appartenance à cette sociabilité d’exception, il est de leur intérêt d’entretenir cette excellence en en faisant la promotion de toutes les manières possibles.

LVSL – Quel regard portez-vous sur les réformes récentes de l’enseignement supérieur ?
Paul Pasquali – La réforme de la loi ORE et le système Parcoursup tirent un trait définitif sur l’université héritée de la loi Faure et de la loi Savary, qui a pris sa suite en 1984 et est restée en vigueur pendant près de trois décennies. Ça, c’est très clair, il suffit de lire les textes de ces différentes lois pour s’en rendre compte – et je ne parle même pas des déclarations des élus ou des ministres. Le principe d’une logique sélective assumée avait déjà été tentée du temps de Valérie Pécresse avec la loi LRU, puis entériné par la loi Fioraso sur l’enseignement supérieur, qui a instauré pour la première fois des quotas de bacheliers technologiques en IUT et de bacheliers professionnels en BTS. Mais avec la loi ORE, cela va bien plus loin. Parcoursup étant conçu sur une logique beaucoup plus sélectionniste et élitiste que APB, le système précédent, il s’agit désormais non seulement de consacrer mais d’universaliser le modèle des grandes écoles à l’ensemble de l’enseignement supérieur, puisque l’idée c’est que plus une filière est demandée, ou en tension, moins on a de chance d’y accéder, alors que jusqu’alors l’État avait pour mission officielle de tout mettre en œuvre au plan budgétaire pour qu’il n’y ait pas de gros déséquilibres entre l’offre et la demande de formation dans les universités. Avec Parcoursup on considère que ces déséquilibres sont normaux, qu’il suffit de laisser le marché des orientations se faire sans intervenir dans l’adéquation entre offre et demande, en considérant que c’est le meilleur modèle, que ça va écrémer et que cet écrémage profitera à tout le monde, aux étudiants, aux familles, à l’économie, à la société, etc. Mais en fait, il est évident que cela renforce les hiérarchies initiales et qu’il n’y a en réalité pas de véritables dispositifs compensatoires, contrairement à ce qui a été annoncé.
Une propédeutique en début d’année pour les étudiants en difficulté est loin d’être suffisante : il faudrait un accompagnement massif, bien au-delà du tutorat, et surtout un accompagnement financier – le grand problème de beaucoup d’étudiants à la fac, c’est qu’ils doivent travailler à côté. L’idée de la non-sélection a toujours fait débat, y compris à gauche. Par contre, avec Parcoursup, il n’y a plus de débat, la politique se dissout dans une procédure qui assure aux meilleurs élèves qu’ils accéderont aux meilleures formations, qui font elles-mêmes leur sélection grâce aux algorithmes dits « locaux » – mais derrière les algorithmes, il y a des êtres humains qui font leurs choix selon certains critères – et surtout, le classement se fait en continu depuis la seconde, pour tout le monde, et ça, c’est un vrai changement, car ce qui existait auparavant dans les lycées les plus sélectifs devient la norme pour l’ensemble des établissements à partir de la seconde. La réforme du nouveau bac fait que l’on commence à classer les élèves beaucoup plus tôt qu’avant, et surtout que tous les classements comptent, y compris des classements non scolaires, puisque désormais on valorise le CV et la lettre de motivation dans le dossier Parcoursup. Tout cela est logique : le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer a été directeur de l’ESSEC – après avoir échoué à devenir celui de Sciences Po Paris, dont il est diplômé. Quand on passe d’une grande école à un ministère et qu’on a en tête que le bon modèle, c’est celui des prépas et des grandes écoles, on ne peut pas défendre une politique favorable aux universités et des mesures égalitaires, conçues pour la réussite du plus grand nombre.

LVSL – Les propositions sur l’enseignement supérieur des mouvements et partis politiques actuels vous paraissent-ils ambitieux et pertinents ?
Paul Pasquali – Quand on regarde ce que proposent les partis politiques au sujet des grandes écoles, c’est souvent vague ou inexistant, alors que bon nombre de leurs élus, porte-parole ou conseillers en sont issus. La plupart des propositions faites sont superficielles ou consensuelles, à un degré de généralité suffisamment élevé pour ne fâcher personne. L’exception à tout ça est bien sûr l’ÉNA, car c’est l’école la plus politique, et la critiquer permet de montrer qu’on est contre le système, les élites, etc. alors même qu’on en sort – l’exemple typique étant celui d’Emmanuel Macron. Ces dernières années, la focalisation régulière des partis politiques sur le cas de l’ÉNA permet de noyer le poisson en en faisant un symbole, voire un prétexte pour ne pas parler du reste, de Polytechnique et HEC par exemple, plutôt que d’y voir un révélateur, puisque parler de l’ÉNA permet d’économiser une véritable réflexion sur les grandes écoles en général et de leur place au sein de l’enseignement supérieur.
Parler de « l’endogamie des élites » sans voir le lien avec la marginalisation croissante et le sous-financement des universités, c’est se condamner à traiter le problème sans le prendre à la racine. Réduire toute la question de la reproduction sociale ou de l’enseignement supérieur à une école, aussi importante soit-elle dans la formation des élites d’État et des élites tout court, c’est voir vraiment les choses par le petit bout de la lorgnette et ne pas voir à la fois la similitude des problèmes dans l’ensemble des très grandes écoles, et l’enchaînement institutionnel qui se fait en amont avec les prépas, ou dans le cas de l’ÉNA avec Sciences Po. À quoi bon s’en prendre à l’ÉNA sans toucher au fait que l’immense majorité des énarques vient de Sciences Po Paris, alors même que l’ÉNA avait à l’origine été créée en 1945 pour éviter justement le monopole de ce qui était alors l’École libre des sciences politiques ? Suffit-il de créer des prépas « Talents » à côté des vraies prépas, et de créer quelques places supplémentaires à l’ÉNA, si on ne change rien au fond des choses ? On a un point aveugle ici et force est de constater que les partis de gauche ne sont pas à la pointe sur ce sujet.
“Ce n’est pas un hasard si le rêve d’un enseignement supérieur démocratique et libéré des réflexes de caste n’a plus cours aujourd’hui, au moment même où l’on remet aussi en cause les retraites, la Sécurité sociale et d’autres acquis majeurs de la Résistance”
LVSL – Que reste-t-il aujourd’hui de cette étape importante de la réflexion sur l’enseignement supérieur que fut le plan Langevin-Wallon, dont vous rappelez les conditions dans lesquelles il a été élaboré à la Libération puis finalement abandonné faute de volonté politique ?
Paul Pasquali – Le simple fait que plus personne ne parle de ce Plan aujourd’hui montre, plus qu’une méconnaissance de l’histoire du mouvement ouvrier, une panne idéologique inquiétante, en tout cas un symptôme supplémentaire de l’affaiblissement du camp progressiste depuis une trentaine d’années. En examinant étape par étape sur ces 150 ans d’histoire du mérite et de la mal nommée méritocratie française, on voit bien l’importance qu’ont eue la critique de la reproduction sociale des grandes écoles, des élites, etc. et les alternatives qui ont pu exister, notamment avec le plan Langevin-Wallon, dans des époques de bouillonnement intellectuel et politique fort, comme sous le Front populaire, à la Libération, après mai 68 ou même au début des années Mitterrand.
À partir du moment où toute une partie de la gauche s’est recentrée, au milieu des années 1980, les alternatives au grand partage de l’enseignement supérieur sont devenues des sortes d’utopies, et on s’est contenté de faire au mieux pour bâtir une université adaptée aux nouveaux publics, sans se soucier de la montée en puissance simultanée des filières d’élite, qui elles ont tout fait depuis 30 ans pour éviter ces nouveaux étudiants, dont beaucoup étaient issus des milieux populaires. Certes, il y a tout de même, à gauche, une part non négligeable de gens qui pensent que les universités devraient être le centre de gravité de l’enseignement supérieur. Certains proposent d’augmenter le recrutement sur dossier plutôt que sur concours pour faciliter plus de diversité sociale, mais on est quand même très loin du temps où il y avait une gauche combative, avec par exemple le plan Langevin-Wallon qui date de l’immédiat après-guerre.
Ce plan reprenait des propositions de la Résistance, avec un poids non négligeable du Parti communiste, alors premier parti de France, dans la composition de la commission. Ce plan, on l’a oublié, est resté durant 25 ans la référence absolue de beaucoup de gens à gauche, au-delà des communistes. Il proposait notamment la fin des classes préparatoires et leur fusion dans des propédeutiques qui interviendraient entre la terminale et la licence et qui seraient ouvertes dans d’autres lieux que les universités, sous la responsabilité d’enseignants agrégés. Il préconisait aussi de remplacer les grandes écoles par des instituts universitaires spécialisés, donc concrètement de mettre un terme au dualisme dans l’enseignement supérieur en repoussant au niveau du troisième cycle l’accès à ces instituts universitaires spécialisés, autrement dit en redonnant aux universités toute leur place puisque c’est dans les universités qu’on apprendrait l’essentiel des dimensions théoriques et techniques requises pour ensuite se spécialiser et accéder à des postes. Le seul genre de grande école que le plan Langevin-Wallon épargnait, c’étaient les écoles normales supérieures. Mais il y avait déjà à l’époque une critique du recrutement social très étroit, très bourgeois, de l’École normale supérieure, et l’idée était d’organiser un recrutement au terme d’une licence, donc avec un passage obligé par l’université quoi qu’il arrive après le bac, et d’ouvrir un second concours pour des salariés et notamment les fonctionnaires qui viennent de l’éducation nationale afin que, comme pour l’ÉNA, il y ait deux concours, et que le peu de places qui sont mises au concours ne soient pas monopolisées par une jeunesse aisée d’héritiers.
Malheureusement, ce plan n’a eu aucune postérité, tout simplement parce qu’il était porté par des communistes et que la quatrième République a tourné le dos avec le début de la guerre froide à toute société nouvelle, contrairement aux desseins de la Résistance, et notamment aux ambitions réformatrices d’un Marc Bloch, comme je le rappelle dans mon livre. Le Plan est ensuite devenu une sorte d’étendard contre le pouvoir. Je ne pense pas qu’il faille revenir à la lettre du plan Langevin-Wallon, il est inutile de le déterrer et d’en faire un nouveau fétiche. En revanche, il serait intéressant qu’on s’en inspire dans les réflexions actuelles et qu’on évite de toujours faire comme si on repartait totalement à zéro. Ce serait un bon moyen de contrer l’amnésie sélective qui consiste à oublier les effets ravageurs du recentrage idéologique de la gauche, depuis trois décennies, et les conséquences de l’abandon de certaines utopies réalistes. À force d’être dans le moins-disant progressiste, on s’enferme dans une logique défensive (par exemple, vouloir plus de moyens pour les facs sans contester le financement public des grandes écoles) qui laisse le champ libre aux filières d’élite qui ont beau jeu de revendiquer les premiers rôles dans la lutte pour l’égalité des chances et contre les autocensures.
Il faut se souvenir que le Conseil national de la Résistance était très critique envers l’élitisme des grandes écoles et leur esprit de corps, quand on évoque un peu vaguement un « modèle français » à défendre, sans voir que ce modèle date pour l’essentiel de 1945 et qu’il devait initialement redonner aux universités un rôle démocratique qu’elles n’ont jamais pu jouer vraiment. Ce n’est pas un hasard si le rêve d’un enseignement supérieur démocratique et libéré des réflexes de caste n’a plus cours aujourd’hui, au moment même où l’on remet aussi en cause les retraites, la Sécurité sociale et d’autres acquis majeurs de la Résistance, y compris la garantie d’une haute fonction publique de qualité et diversifiée, qui aurait pu devenir une réalité si justement les grandes écoles et les grands corps n’avaient pas tout fait pour défendre leur autonomie, étendre leur influence et empêcher de véritables remises en cause. Cette capacité des filières d’élite à résister au changement, à contourner les critiques à se poser en acteurs de leurs propres réforme, c’est précisément ce que j’appelle l’héritocratie.
“Le terme même de méritocratie fait écran, car si le fait majeur reste l’héritage et que finalement, le mérite et l’héritage ne constituent pas dans les faits deux entités ou phénomènes absolument distincts, alors il faut cesser de parler la langue des dominants afin de les montrer tels qu’ils sont et agissent réellement.”
LVSL – Pourquoi avez-vous forgé ce néologisme d’« héritocratie » ?
Paul Pasquali – Quand on regarde sur le temps long, le fait social qui se dégage, par-delà les crises économiques, les guerres et les alternances politiques, c’est la reproduction sociale en tant que pouvoir de l’héritage sur nos vies. Je pars donc de cette question : que peut signifier « mériter » dans une société où le mérite appartient en premier lieu aux héritiers ? Ce qui m’intéresse, en tant que sociologue et socio-historien, c’est qu’alors même que depuis des décennies il y a une reproduction sociale forte, certains individus dont le parcours n’a absolument rien à voir avec le stéréotype du boursier méritant estiment qu’ils sont tout à fait méritants, voire plus que des boursiers. Je l’ai entendu quelques fois, et je l’ai retrouvé à maintes reprises lors des polémiques sur les quotas de boursiers dans les propos d’internautes anonymes ou non, en réaction à un article de presse ou sur les réseaux sociaux, qui criaient au « piston », au « favoritisme » voire à la « baisse de niveau » induite par la hausse, même faible, du taux de boursiers dans telle ou telle école réputée.
D’un autre côté, dans mon enquête sur les étudiants bénéficiaires de programmes d’ouverture sociale, dont il est question dans mon premier livre, Passer les frontières sociales, j’ai très vite constaté que beaucoup de boursiers doutent de leur mérite, même quand ils ont d’excellentes notes et peu de difficultés à acquérir la culture légitime. Ces doutes ne viennent pas de nulle part : bien sûr, cela a à voir avec une forme d’humilité liée à leur socialisation dans des familles populaires, mais aussi, et peut-être surtout, avec le reproche ou la crainte d’être moins méritants parce qu’ils auraient été aidés, contrairement à ceux qui ne devraient leur réussite qu’à eux-mêmes – comme si les héritiers n’avaient pas été aidés par leur famille, leurs parents, ou leur naissance au bon endroit, etc. Il y a une sorte de lutte symbolique qui se joue : c’est très intéressant que les héritiers réclament toujours leur mérite, le revendiquent, et tendent à imposer une définition consensuelle qui leur évite d’avoir à se justifier sur la réalité de leurs mérites. Pas tous, évidemment, car il y a des dominants qui ont une réflexivité suffisante pour comprendre que tout mérite est une construction socio-historique et doit une part de son évidence à la croyance des « méritants » en leur propre légitimité, donc au jeu qui les rend légitimes.
En forgeant le terme d’héritocratie, j’ai cherché à faire pivoter le regard : on parle tellement de méritocratie, qu’elle soit « inaboutie », « inachevée » ou « dévoyée », qu’on en finit par penser qu’elle existe tout de même ou qu’elle a pu exister un jour, en tous cas qu’elle pourrait exister « si »… Le thème de la méritocratie imparfaite s’est imposé et on a pris l’habitude d’assimiler méritocratie et grandes écoles, en estimant que de toutes façons l’excellence, par définition, ne saurait être démocratique. Et donc chaque fois qu’on constate que le recrutement social des grandes écoles varie peu, le débat est relancé et on fait comme si le fait d’ouvrir leurs portes à quelques boursiers allait changer vraiment la donne. En fait, le terme même de méritocratie fait écran, car si le fait majeur reste l’héritage et que finalement, le mérite et l’héritage ne constituent pas dans les faits deux entités ou phénomènes absolument distincts, alors il faut cesser de parler la langue des dominants afin de les montrer tels qu’ils sont et agissent réellement. Ce qui m’intéresse, aussi, c’est de marquer une continuité et en même temps un écart, une progression par rapport à une époque pas si lointaine, celle des années 1960, où pour la première fois les héritiers et l’héritage culturel ont été mis au centre du débat public sur l’enseignement supérieur. Mon titre est en partie un clin d’œil à l’ouvrage de Bourdieu et Passeron sur Les Héritiers (1964). Entre Héritocratie et Les Héritiers, il y a eu La Noblesse d’État (publié par Bourdieu en 1989) donc pour moi, l’héritocratie c’est en quelque sorte la troisième phase.
Les Héritiers, c’était sur l’ensemble de l’enseignement supérieur, mais avec un focus sur les universités qui étaient à l’époque peuplées surtout d’héritiers. Ça, ça a changé. Les universités ont un recrutement beaucoup moins bourgeois qu’auparavant, et les grandes écoles ont pris une place énorme et se sont non seulement fermées, mais ont aussi récupéré la grande majorité des enfants de bourgeois qui allaient auparavant à la fac en plus fortes proportions. En utilisant ce terme d’héritocratie, j’ai voulu marquer clairement le fait qu’on était toujours dans une problématique d’héritage mais dans un contexte différent, caractérisé par l’ascension fulgurante des grandes écoles – des écoles de commerce, des IEP, de Sciences Po, des ENS, etc. et qu’il fallait la décrire avec un regard objectif, rompre avec les prénotions au sens de Durkheim, et en particulier avec cette prénotion aux allures de concept qu’est la méritocratie. L’héritocratie, ça n’est pas juste un système aux mains des héritiers, ça n’est pas non plus une méritocratie qui fonctionnerait moins bien que ce qu’elle devrait : c’est la capacité d’agir et de résister que les filières d’élite exercent et dont bénéficient les classes dominantes dans leur ensemble. C’est donc une manière d’expliquer par des faits historiques avérés pourquoi on observe un haut niveau de reproduction sociale sur le temps long, y compris malgré de brefs moments de relative ouverture sociale ou même, comme c’est le cas depuis une quinzaine d’années, malgré des politiques volontaristes en faveur des bons élèves de milieux populaires. Au lieu de rester focalisés sur les lacunes ou les autocensures de ces jeunes boursiers qui n’osent pas, ou pas assez, je propose avec ce terme de regarder comment les héritiers persévèrent dans leur être social, très concrètement, en participant à des débats parlementaires, à des contre-mobilisations lorsque leurs intérêts sont menacés, aux activités de diverses associations d’anciens élèves, à des événements médiatiques ou des réseaux professionnels qui se targuent de promouvoir la « diversité », etc.
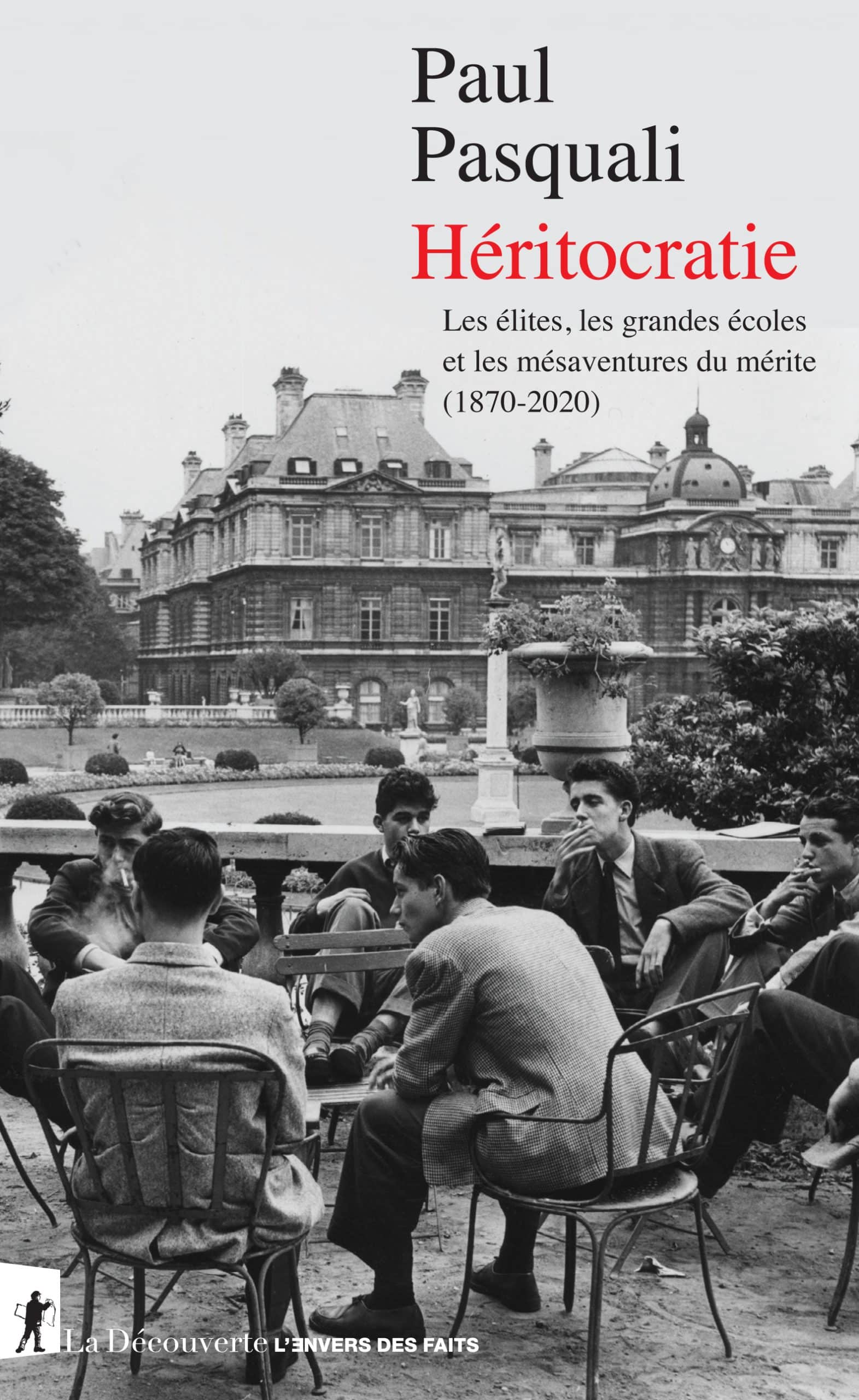
LVSL – Dans votre ouvrage, vous parlez d’« historiciser le mérite ». Que cela signifie-t-il ?
Paul Pasquali – Historiciser le mérite, c’est aller au-delà des définitions usuelles – ce qui rend une personne ou une conduite digne d’estime ou de récompense, comme disent les dictionnaires – de sortir des définitions abstraites et de regarder comment la notion de mérite s’incarne dans des relations sociales, dans des moments historiques, dans des situations concrètes bien plus complexes et problématiques que ce que laisse penser la rhétorique consensuelle de l’égalité des chances. On se tromperait en pensant que le mérite signifie la même chose, quelle que soit l’époque, quel que soit le contexte et le groupe social auquel on appartient. À chaque époque, dans chaque groupe social et dans chaque fraction de classe, correspondent différents types de définitions sociales du mérite. En fait, les définitions du mérite et des méritants sont forcément engagées dans la pratique et donc toujours liées à des intérêts, à des rapports de force.
On n’est jamais méritant innocemment. D’une part, le revers de tout mérite est qu’il laisse dans l’ombre tous ceux qui ont démérité, verdict violent et définitif qui oublie que sans égalité au départ il n’y a pas de mérite possible, au sens rigoureux du terme ; d’autre part, l’absolutisation du mérite tend à inférioriser d’autres critères étrangers au monde scolaire et plus largement à la performance individuelle. Sans parler du fait que les succès des « méritants » reposent toujours sur une part de chance ou de hasard que vient occulter la croyance au mérite comme substance magique ou qualité singulière attachée à la personne. Par ailleurs, il y a des façons plus légitimes que d’autres de mériter. Le grand résultat de mon enquête socio-historique, c’est qu’il a fallu beaucoup de temps, plus d’un siècle, pour que les grandes écoles revendiquent avec succès le monopole de la définition légitime du mérite. Cela n’a pas toujours été le cas : auparavant, était méritant quelqu’un qui sortait de l’enseignement primaire ou primaire supérieur, quelqu’un qui sortait du lycée sans aller dans l’enseignement supérieur, quelqu’un qui sortait diplômé d’une université, quelqu’un qui faisait un métier avec ses codes, ses exigences, sans nécessairement réussir scolairement, etc. ; il y avait aussi l’idée de mériter sur le tas, de faire ses preuves. Toutes ces définitions alternatives du mérite correspondent plus ou moins aux intérêts de tel groupe ou telle partie de groupe social et elles ont des fonctions justificatrices, légitimatrices de l’ordre social, bien entendu. Mais dans la mesure où tous les groupes sociaux n’ont pas les mêmes ressources ni les mêmes positions dans l’espace social, les dominants ont plus de chances d’imposer leur propre définition du mérite, et si possible de gommer leur héritage en exagérant des sacrifices scolaires ou des traits biographiques qui les rendent plus « méritants ». Historiciser ces discours dominants permet de montrer que le mérite n’est pas qu’une idée ou un idéal, c’est d’abord un enjeu de luttes, une arme souvent redoutable, et le produit d’une certaine histoire inscrite dans l’inconscient collectif des élites et, sans doute, dans celui d’une partie non négligeable du corps enseignant et des étudiants français.

LVSL – Quelles définitions alternatives du mérite vous semblent intéressantes ? Pourquoi revenez-vous à la fin de votre ouvrage sur l’une de celles proposées par Condorcet il y a deux siècles ?
Paul Pasquali – C’est un peu provocateur, car Condorcet est le penseur auquel se sont constamment référés les défenseurs du mérite républicain, dont je parle au début de mon ouvrage, à gauche et même à droite. Le Condorcet auquel on se réfère le plus souvent, dans les débats sur le système éducatif, c’est celui du Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, très beau texte plein de lyrisme qui inspirera un siècle après la IIIe République conquérante, et dans lequel il est question de ces « élèves de la patrie » dont les études seraient prises en charge par l’État afin de garantir leur accession à tous les niveaux de l’édifice scolaire. Outre les bourses, c’est cet idéal qui donne lieu à la création de Polytechnique et de la première École normale supérieure, puisqu’il y avait l’idée qu’en finançant les élèves pauvres entrant dans ces écoles, et la gratuité intégrale des enseignements primaires et secondaires, les gens seraient enfin reconnus par rapport à ce qu’ils font et non qui ils sont. C’est la définition moderne de la méritocratie républicaine, même si le mot de méritocratie est arrivé bien après, dans les années 1960.
Or on oublie qu’il y a un deuxième Condorcet, un Condorcet plus exigeant politiquement et philosophiquement, et c’est celui du Premier mémoire sur l’instruction publique, texte lumineux dans lequel il attaquait cette fâcheuse habitude en vigueur dans les collèges d’ancien régime – l’équivalent des filières d’élite d’aujourd’hui – de vouloir toujours être le premier. Il y distinguait le mérite comme « lutte où des rivaux se disputent des prix », du mérite comme « voyage que des frères font en commun ». Condorcet y critiquait la vanité puérile d’être le meilleur et y valorisait au contraire la saine émulation entre camarades, où l’idée n’est pas d’afficher sa supériorité ou d’écraser son concurrent, mais de développer, de fortifier des sentiments moraux qui sont bons pour le bien-être commun. Ce que j’aime dans cette idée de revenir à une autre définition du mérite, c’est qu’elle va à l’encontre de la philosophie au fond très conservatrice de Parcoursup, du discours de l’excellence à tout prix, de la consécration dans l’ensemble du système scolaire de la logique qui prévalait jusque-là dans les classes prépas et les grandes écoles. Parce que Condorcet, tout marquis qu’il était, osait aller contre sa classe d’origine pour dire que ce n’est pas tellement le fait d’être premier qui compte, mais plutôt le « besoin de mériter l’estime des autres » pour goûter, selon ses termes, à « cette paix intérieure qui seule rend le bonheur possible et la vertu facile ». C’est extrêmement intéressant pour relativiser les discours sélectionnistes en vogue aujourd’hui.
“Le mérite cesse d’être une arme des dominants dès lors qu’on le distingue de la performance à tout prix, du culte de l’excellence et de toutes les stratégies permettant de maintenir de l’entre-soi.”
Si je cite ce texte de Condorcet à la fin de mon livre, ce n’est pas par plaisir, mais parce que je ne voulais pas faire une énième réfutation du mérite. La critique sociale a pris l’habitude de s’en tenir à la dénonciation du mérite comme illusion individuelle ou comme mythe collectif. Mais cela pose plusieurs problèmes : premièrement, comment se fait-il que cette illusion soit si tenace et que le mythe fonctionne plutôt bien globalement ? Deuxièmement, quand on replace les choses dans le temps long, il faut se souvenir que le mérite, à l’origine, est un acquis de la Révolution française, ça n’est pas simplement un voile. C’est à maints égards un acquis, parce que c’était à l’origine une manière de mettre fin à l’arbitraire généralisé, au régime de la faveur et au fait du Prince, bref à tout ce qui ramène à ce que les gens sont et non pas à ce qu’ils font. Et ça, c’est très important, aujourd’hui encore.
Le problème, c’est que cet acquis n’est pas suffisant. Et donc se contenter d’organiser des concours précédés de classes préparatoires publiques et gratuites n’a rien d’une panacée, surtout quand ce dispositif parfaitement méritocratique sur le papier profite en grande majorité à ceux qui héritent l’essentiel de leurs ressources culturelles et matérielles de leurs parents ou de leur entourage social. Multiplier les modes d’accès, développer la sélection par dossier, par des épreuves orales, ne suffit pas non plus à repenser en profondeur le mérite. Il faut aller au-delà et mettre en question l’idée selon laquelle la sélection suffit à garantir l’excellence, et l’ouverture sociale l’égalité des chances. Le mérite cesse d’être une arme des dominants dès lors qu’on le distingue de la performance à tout prix, du culte de l’excellence et de toutes les stratégies permettant de maintenir de l’entre-soi.
LVSL – Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais est-il selon vous possible, plutôt que de dénoncer l’idéal méritocratique, de « resignifier » la méritocratie afin de critiquer l’oligarchie, comme le défend Íñigo Errejón dans nos colonnes ? Ou encore, vaut-il mieux reprendre la critique, historiquement portée par les communistes, de la méritocratie comme favorisant des ascensions individuelles au détriment des solidarités de classe, supposées seules à même de permettre l’émancipation collective des dominés ?
Paul Pasquali – Le mouvement ouvrier – donc les communistes à une époque, mais aussi les socialistes avant eux, les anarchistes, etc. – a traditionnellement regardé avec suspicion les ascensions individuelles. L’émancipation par l’école, c’était avant tout l’aliénation par l’école bourgeoise. Mais cette vision est rendue caduque par un bon demi-siècle de conversion des familles populaires aux études supérieures – d’ailleurs, ce changement a anticipé l’érosion des capacités militantes et électorales du parti communiste. En réalité, il n’y a pas de loi sur ce que deviennent les transfuges de classe. Quand on change de milieu social, il n’y a pas de loi qui dirait que si on change de milieu, on oublie sa classe sociale d’origine et on devient forcément un suppôt de la bourgeoisie : c’est beaucoup plus compliqué que cela. Tout dépend de la manière dont on en sort, dont on y rentre, comment se passe le processus d’acclimatation, etc.
Par contre, défendre la méritocratie comme le fait de reconnaître, au terme d’un concours ou de tel ou tel type d’examen – ça peut être même sur dossier, en réalité, ça n’est pas moins problématique – que le mérite, c’est cela et seulement cela, et donc faire fi de toutes les inégalités qui sont posées en amont, faire fi de toutes les autres définitions possibles du mérite et faire fi de la part d’arbitraire que contient toute définition légitime du mérite, donc s’en tenir à la définition dominante du mérite, c’est problématique parce que cela contribue à ratifier l’ordre des choses et à dépolitiser ce que mériter veut dire. En revanche, il est tout à fait possible d’utiliser à des fins émancipatrices le critère du mérite quand il s’agit de critiquer le piston ou l’incompétence qui permet aux élites de se reproduire, ne serait-ce que pour relativiser ce que j’appelle la « grandeur » des grandes écoles, c’est-à-dire le niveau et le prestige que toutes aiment à afficher, même quand la réalité de leur niveau et prestige est moins idyllique. Certaines écoles, parfois très chères, se font passer pour des temples de l’innovation, de la créativité et de l’ouverture à la diversité alors que leurs enseignements sont très en deçà de ceux qu’on trouve à l’université.
LVSL – En même temps que Héritocratie, va être republié chez La Découverte en poche votre premier ouvrage Passer les frontières sociales. Comment les « filières d’élite » entrouvrent leurs portes, qui s’intéresse à des jeunes « transfuges de classe ». Ceux-ci sont-ils des « exceptions » qui feraient « mentir » les déterminismes sociaux, ou y a-t-il au contraire des raisons sociologiques qui peuvent expliquer leurs trajectoires singulières ? Comment vivent-ils cette expérience, portent-ils en général un regard réflexif sur leur propre trajectoire sociale ?
Paul Pasquali – Est-ce que ce sont des exceptions qui font mentir les déterminismes sociaux ? Non, parce que ce sont des exceptions statistiques que l’on peut expliquer. En réalité, il s’agit en général d’exceptions non seulement dans leur univers social d’arrivée mais également dans leur milieu d’origine. Souvent, ils viennent de fratries plutôt réduites, leurs parents sont plutôt dans des classes populaires stabilisées, et ce sont souvent de bons voire de très bons élèves qui sont passés par une option européenne, ont fait des langues rares, etc. Au-delà de ça, il ne s’agit pas seulement du niveau scolaire, mais aussi d’un type de socialisation : quand on se met dans une anticipation assez forte de l’avenir, déjà, on se met un peu à l’écart du reste de ses camarades, surtout dans des lycées défavorisés où on regarde beaucoup à court terme, et d’autre part, quand vous êtes dans un une classe par exemple en section artistique, en classe européenne ou internationale, souvent, vous êtes dans un petit groupe, il y a de l’émulation, il y a du capital culturel qui circule. On vous reconnaît dans tous les sens du terme, on vous encourage, ce qui crée un effet d’entraînement. Par ailleurs, il y a ce que j’appelle les capitaux cachés, c’est-à-dire tout ce qui n’apparaît pas dans les statistiques mais que j’ai pu retrouver par entretien ou en analysant les dossiers scolaires des candidats à la prépa d’ouverture sociale que j’ai étudiée.
En plus des parents, beaucoup de gens interviennent dans la socialisation et dans l’éducation d’un futur transfuge de classe : une tante, un oncle, un cousin, les frères et sœurs peuvent participer à l’acquisition de dispositions et de capitaux qui vont être très importants dans la réussite scolaire, puis dans le fait de se repérer au moment de l’orientation, de prendre la « bonne » filière, etc. Donc il ne faut pas trop tôt dire que ces exceptions font mentir les déterminismes : le rôle du sociologue, c’est d’abord d’essayer de les expliquer. Et une fois qu’on a fait le maximum pour les expliquer, on peut juger à quel point cela fait mentir, ou pas, les déterminismes sociaux. Les étudiants que j’ai suivis pendant cinq ans voyaient bien qu’ils avaient des choses qui les différenciaient fortement de leurs camarades dans leur milieu d’origine ; quand on leur parle des déterminismes sociaux, 90 % ou peut-être même 95 % d’entre eux répondront que leur cas personnel ne les fait pas du tout mentir et qu’ils sont aussi l’arbre qui cache la forêt : ils en sont parfaitement conscients. Ils voient bien autour d’eux la faible mobilité sociale.
Pour la réédition de l’ouvrage, j’ai ajouté une postface inédite dans laquelle je reviens notamment sur ce que sont devenus chacun des enquêtés dont je parle dans le livre. Souvent, quand on regarde les bilans de tel ou tel dispositif, on a l’impression que tout se résume à des chiffres, à des diplômes, à des postes, à des qualifications. Or, dans les vies des intéressés, c’est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a un vécu, il y a une trame biographique à restituer pour comprendre ce que l’ouverture sociale fait réellement en positif comme en négatif à ceux qui en ont bénéficié. Ils n’ont pas le même discours à 18 ans, à 22 ans ou à 30 ans sur leurs espoirs et leurs expériences, et c’est important de comparer leur situation à différents moments de leur trajectoire pour sortir des formules creuses sur « les boursiers » ou les « transfuges » en général.
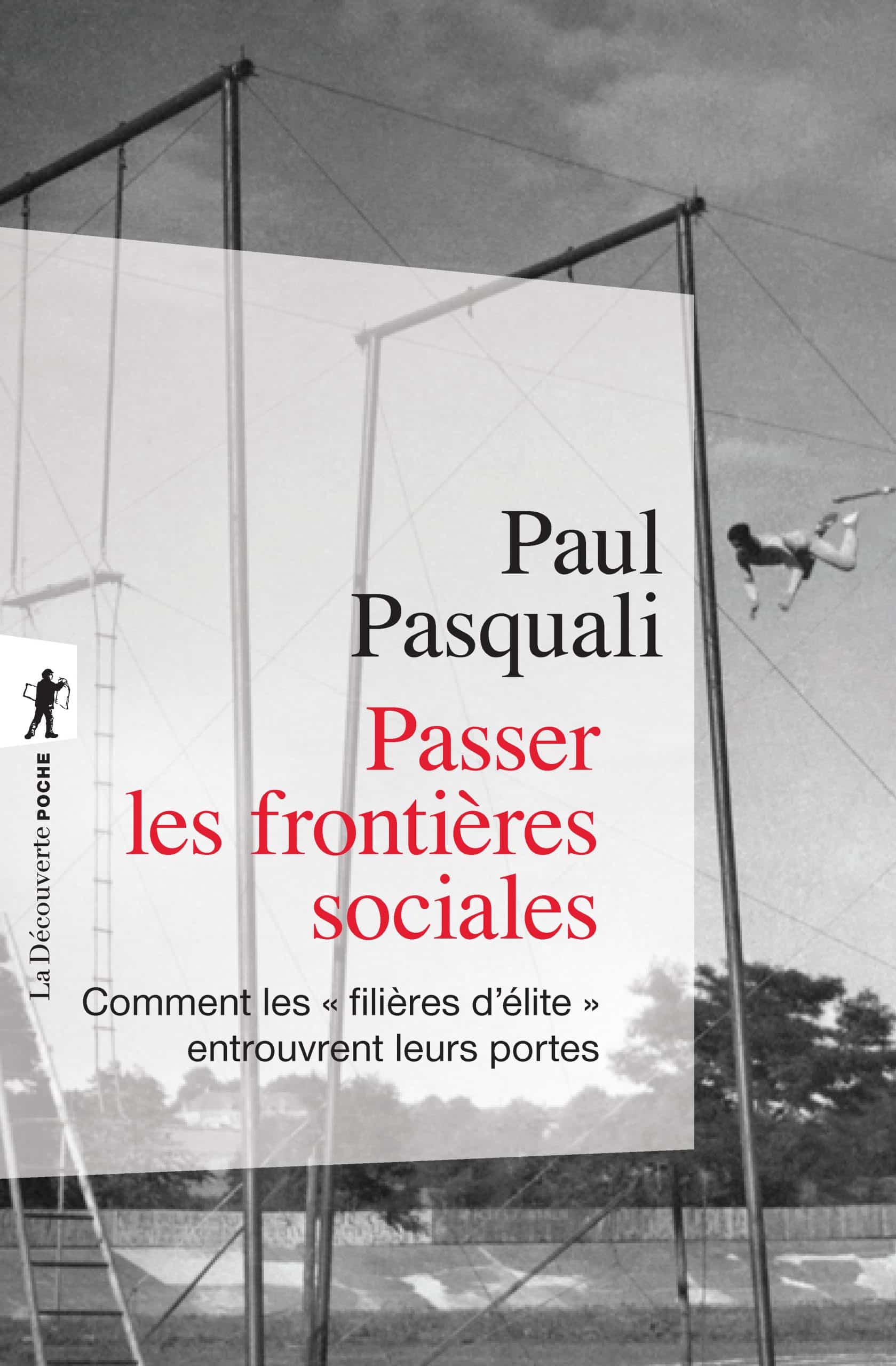
LVSL – Vous codirigez aux éditions La Découverte, avec Fabien Truong, une collection intitulée « L’Envers des faits ». Quelle en est la philosophie ? Comment concevez-vous le rôle du sociologue dans la Cité ?
Paul Pasquali – Cette collection a la particularité d’insister beaucoup sur la narration et l’explicitation des conditions de l’enquête, dans une langue accessible. Chaque ouvrage que nous éditons raconte à la fois une enquête, son sujet et son auteur, spécificité dans le paysage éditorial qui se retrouve dans des ouvrages comme Ceux qui restent, de Benoît Coquard et Se Ressaisir, de Rose-Marie Lagrave. Le nom de la collection fait ainsi non seulement référence aux coulisses d’un fait social et d’une enquête sociologique, mais aussi au cœur du métier de sociologue, puisqu’il n’est pas de sociologie sans un effort de rupture avec le sens commun, à condition de ne pas confondre objectivation critique et surplomb savant. Au contraire, dans cette collection, les auteurs s’assument comme faisant partie prenante de leur objet, aucun ne se tient à distance ni au-dessus de ses enquêtés. Si le travail de la science exige un travail rigoureux auquel tout le monde ne peut pas satisfaire, cela ne signifie pas selon nous que les résultats de ce travail doivent rester confinés aux petits cercles savants. Il y a donc un vrai enjeu dans la manière d’écrire et, plus encore, de « parler » en écrivant à un public qui n’a pas forcément l’habitude d’écrire.
Montrer l’envers des faits, c’est donc montrer ce que tout le monde n’a pas les moyens, ni le temps, ni intérêt de voir, mais à condition de rendre la lecture aussi agréable et captivante que possible. Des livres comme Qui a tué les verriers de Givors ? de Pascal Marichalar ou Nos mères, de Christine Détrez et Karine Bastide, visent à dépasser les oppositions factices entre sciences sociales et littérature. Mais on part toujours d’un matériau empirique : on ne publie que des enquêtes, pas des essais, et nous tenons beaucoup à cette distinction-là, car sans enquête la sociologie n’a plus grand-chose d’intéressant à raconter.