À l’occasion de la sortie de son ouvrage Mélenchon : la chute – Comment la France insoumise s’est effondrée aux éditions du Rocher, nous avons souhaité interroger Hadrien Mathoux, journaliste politique en charge du suivi de la gauche et de la France insoumise pour Marianne sur la trajectoire et les ressorts des difficultés auxquelles la France insoumise n’échappe pas, à la fois sur le plan stratégique mais surtout sur le plan politique. Pour le journaliste, en dépit du caractère hors norme de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon dans le paysage politique français, la France insoumise, avant tout fondée comme locomotive pour la présidentielle, est traversée par trop de contradictions pour espérer rééditer, selon lui, le succès enregistré en 2017. Propos recueillis par Valentin Chevallier et Léo Rosell.
LVSL – Quelles ont été vos motivations pour écrire un ouvrage dédié au fonctionnement de la France insoumise ?
Hadrien Mathoux – Elles étaient nombreuses. Lorsque je me suis mis au travail, au printemps 2018, une seule année nous séparait de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, passionnante par ses innovations de forme et de fond, mais également fructueuse électoralement. Grâce à son excellent résultat électoral, mais aussi en raison des premières orientations du quinquennat Macron, il était envisageable que les Insoumis s’imposent comme la première force d’opposition du pays.
D’un autre côté, l’on pressentait déjà les tendances que je décris dans mon ouvrage, les tiraillements entre plusieurs lignes politiques aux aspirations diverses, les ambiguïtés stratégiques à résoudre, le rapport mouvant à la gauche et au peuple etc. Ajoutez à cela une panoplie de personnalités charismatiques et un mouvement au fonctionnement atypique, et vous obtenez un matériau idéal pour tout journaliste.
J’essaie, par ailleurs et autant que possible, de privilégier un journalisme politique qui s’attache davantage aux débats idéologiques qu’aux petites manœuvres politiciennes ou à une vision excessivement psychologisante des événements et des acteurs. Les Insoumis sont bien adaptés à cette vision des choses ; je leur reconnais une certaine sincérité dans la défense de leurs idéaux, et chez eux, la vision stratégique revêt une importance primordiale.
LVSL – Vous revenez très souvent sur cette dichotomie entre une ligne populiste/républicaine versus une ligne de rassemblement de la gauche/culturelle. N’est-ce pas le problème originel de la France insoumise que d’avoir misé sur la possibilité de concilier ces deux lignes ? Est-ce qu’aujourd’hui, comme vous semblez l’indiquer, l’une de ces deux lignes l’a définitivement emporté sur l’autre ?
H.M – Tout mouvement politique ambitieux se doit d’élargir son socle, de cadres, de militants, d’électeurs. La pureté idéologique absolue convient à des groupuscules, mais lorsqu’il s’agit de conquérir le pouvoir, il est inévitable de devoir faire cohabiter des personnes qui ne pensent pas pareil sur tous les sujets. Deux questions se posent alors : quels sont les fondamentaux idéologiques sur lesquels tout le monde doit être d’accord, et quelle méthode de gestion adopte-t-on pour gérer les divergences ? C’est peut-être sur ces deux points, et notamment le second, que la France insoumise a pu commettre des erreurs.
Il est impossible de déclarer la victoire définitive d’une ligne sur l’autre, notamment car tout cela ne tient finalement quasiment qu’aux décisions de Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, il est évident que la ligne de gauche culturelle a remporté beaucoup de victoires décisives : départ ou exclusion des principaux défenseurs de la ligne populiste et républicaine, amendement du discours sur la laïcité, l’immigration ou l’Europe, prolifération du discours intersectionnel, etc.
LVSL – De l’immigration à la question européenne, en passant par le positionnement par rapport aux Gilets jaunes, vous montrez que le mouvement est traversé par de nombreuses ambiguïtés, qui renvoient à la difficulté de trancher sur des sujets clivants, au risque de perdre en clarté auprès de l’opinion. N’est-ce pas là une limite fondamentale liée aux principes organisationnels si particuliers de la FI, que vous résumez à travers le concept d’« autocratisme gazeux » ?
H.M – Effectivement, il semble y avoir un lien clair entre l’incapacité de trancher sur certains sujets clefs et la forme organisationnelle adoptée par la FI. On peut néanmoins comprendre la réticence de Jean-Luc Mélenchon envers le modèle pyramidal adopté par le Parti socialiste, qui possède lui aussi de nombreux défauts et consume l’essentiel de l’énergie des cadres et des militants dans des batailles picrocholines.
L’ennui, c’est qu’à cette organisation imparfaite, les Insoumis ont substitué une forme “gazeuse” dépourvue de structures démocratiques, dans laquelle les militants sont à la fois autonomes et impuissants, et où tout le pouvoir décisionnel est concentré dans les mains de quelques cadres, pour ne pas dire Jean-Luc Mélenchon lui-même. Passée la période d’unanimisme de la campagne présidentielle 2017, lorsque les débats internes ont refait surface, LFI n’a disposé d’aucune instance pour les régler sereinement. Cela a été fait dans la confusion et la brutalité. Mais il ne faut pas non plus réduire les difficultés des Insoumis à la forme du mouvement : les principaux écueils restent de nature politique.
LVSL – Vous n’abordez que de manière parcellaire les élections municipales. La direction nationale semble d’ailleurs avoir accordé peu d’importances aux élections intermédiaires. La faiblesse des relais et de l’implantation locale n’est-elle pas un frein à la remobilisation des cercles insoumis, déjà affaiblis par l’essoufflement militant post-2017 et la crise interne du mouvement ?
H.M – Les élections municipales ont bien montré que même si les nouveaux mouvements politiques sont sans doute plus adaptés aux réseaux sociaux et à la communication numérique, rien ne remplace la bonne vieille implantation d’élus locaux et l’implication militante pour remporter des mairies. La République En Marche, le parti au pouvoir, a ainsi éprouvé les pires difficultés lors de ces municipales, au contraire de formations pourtant moribondes au plan national comme le PS ou Les Républicains.
Du côté de la France insoumise, s’y est ajoutée la volonté pas totalement assumée “d’enjamber” ce scrutin, jugé peu adapté au mouvement. Il semble de plus en plus clair que la FI se conçoive comme une machine électorale au service des ambitions présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. Ceci étant dit, il est difficile de contester que la vie politique française en général ne semble tourner qu’autour de cette élection.
LVSL – Jean-Luc Mélenchon a vu son image s’abîmer depuis 2017. Pour autant, comment avez-vous analysé l’émergence de Nous Sommes Pour ? Pensez-vous que ce nouveau mouvement peut lui permettre de faire un meilleur score en 2022, voire de l’emporter ?
Je suis assez sceptique, tout d’abord parce que le résultat de Jean-Luc Mélenchon en 2017, lié à une campagne très réussie mais également à une conjonction de facteurs favorables, était en réalité assez exceptionnel. Pour ce qui est de 2022, Mélenchon va davantage s’inscrire dans la continuité que lors des deux échéances précédentes, où il avait présenté des innovations esthétiques et de fond à chaque fois.
C’est assez logique, son score de 2017 l’a définitivement installé dans le paysage et ses qualités en campagne sont indéniables. Ceci étant, Nous Sommes Pour ne fera pas oublier que depuis trois ans, les Insoumis connaissent de grandes difficultés. Les piètres résultats électoraux, des choix idéologiques douteux et l’effondrement de l’image de Jean-Luc Mélenchon après l’épisode des perquisitions en octobre 2018 ne s’effaceront pas par magie, même si le nom de la plateforme et l’habillage changent.
LVSL – Ne risque-t-il pas d’être gêné par une candidature probable d’Arnaud Montebourg, tant par un choix de « fédération populaire » que par une campagne populiste ?
H.M – Difficile de le contester. On ne sait pas si Arnaud Montebourg sera bel et bien candidat, mais s’il y parvient, son profil politique, son programme et son positionnement en candidat “de la France plutôt que de la gauche” risquent immanquablement de séduire une partie de ceux qui avaient voté pour Mélenchon en 2017. Arnaud Montebourg présenterait une candidature encore plus proche de celle de Mélenchon que Benoît Hamon cinq ans plus tôt. Ce dernier étant toujours jugé comme l’un des responsables de la non-qualification au second tour par certains Insoumis.
LVSL – Le programme l’Avenir en commun sera celui de la FI en 2022, mâtiné de quelques ajustements. L’absence de nombreux cadres ayant joué un rôle central dans la campagne de 2017 peut-il changer en profondeur le programme ?
H.M – Un changement massif de l’Avenir en commun m’apparaît très peu probable. Parce qu’il s’agit d’un texte très complet et travaillé, mais aussi parce que les Insoumis, militants compris, entretiennent un rapport passionnel, presque fétichiste, à ce programme. Toutefois, il sera intéressant d’observer les tendances idéologiques à l’œuvre au sein de la France insoumise, et notamment le départ massif des cadres souverainistes et laïques, se traduire par petites touches dans le texte.
On peut déjà se livrer à quelques constatations de forme, en prenant comme exemple le chapitre consacré à la laïcité : le programme de 2017 vilipendait ses « adversaires historiques, intégristes religieux et racistes qui veulent aussi en faire un prétexte pour flétrir les musulmans ». La nouvelle version, rédigée dans un esprit bien plus accommodant, appelle à faire cesser « les polémiques vaines et futiles qu’agitent les diviseurs de tout crin, souvent ses ennemis hier, et qui s’en servent pour flétrir les musulmans. » Il y a là comme un changement de ton, non ?
LVSL – Adrien Quatennens, en tant que coordinateur de la France insoumise, joue un rôle central au sein du mouvement. Apparaît-il selon vous comme l’héritier naturel de Jean-Luc Mélenchon, ou peut-il être concurrencé par d’autres figures du mouvement comme François Ruffin, Alexis Corbière voire Mathilde Panot ?
H.M – Adrien Quatennens n’a pas été nommé coordinateur de la FI par hasard : il est talentueux, a fait ses preuves, et montre une extrême loyauté à Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin est également très populaire mais présente un profil plus atypique et franc-tireur que Quatennens. Alexis Corbière joue davantage un rôle d’appui que de leader potentiel. Mathilde Panot fait partie des figures montantes de la FI au même titre qu’Adrien Quatennens, mais il me semble qu’elle n’a pas autant “percé” que lui aux yeux du grand public.
Gardons tout de même à l’esprit deux éléments : on ne sait pas si la France insoumise survivra à l’élection présidentielle de 2022, et si oui, on ne sait pas non plus quelle sera la modalité de sélection du prochain chef de file. Personne, à la France insoumise, ne s’impose comme le successeur évident d’un Jean-Luc Mélenchon qui, si sa personnalité est clivante, reste une figure d’une dimension hors normes dans le paysage politique.
LVSL – Le populisme de droite semble l’avoir davantage emporté que le populisme de gauche dans de nombreux pays. Quelles leçons en tirez-vous au vu de vos enquêtes sur la FI ? Pensez-vous que le fait que le populisme de droite n’ait pas de mal à attaquer de manière frontale ses ennemis, et ne s’encombre pas de nuances ni de questions morales, y joue un rôle ?
H.M – Pour être complet, cette question devrait être précédée d’un long et fastidieux débat sur les contours de la notion de populisme, ainsi que sur la pertinence d’une distinction entre un “populisme de gauche” et un “populisme de droite” !
Je vais tenter d’être synthétique, et donc forcément un peu caricatural : le populisme, qu’on peut résumer en un mécontentement des catégories populaires envers les élites jugées coupables d’avoir trahi leurs intérêts, se décline en plusieurs dimensions. Une dimension politique, qui se traduit par une aspiration à plus de souveraineté populaire et nationale ; une dimension économique, visant à restaurer de la redistribution, de la justice sociale et des services publics ; une dimension culturelle enfin, qui peut se résumer par une crainte de voir son quotidien, ses traditions et les coutumes auxquelles on est attaché être balayées par la mondialisation, cette insécurité ayant pour corollaire une demande d’ordre et de sécurité.
Vous l’aurez noté, je ne fais pas mention des « chaînes d’équivalence » dont parle Chantal Mouffe, qui sont supposées être mises en place pour créer un lien entre les revendications matérialistes des classes populaires et les aspirations progressistes des couches moyennes. J’avoue être circonspect sur cette notion, qui me paraît être une tentative de remplumer la deuxième gauche avec les habits du populisme en s’appuyant sur une lecture artificielle des dynamiques sociales. Sans nécessairement les opposer, il n’existe pas de complémentarité naturelle entre le populisme et les aspirations progressistes.
La majorité de la gauche, y compris la France insoumise qui se revendiquait du populisme, a fait depuis 2017 le choix délibéré de complètement ignorer la dimension culturelle que j’évoque un peu plus haut, voire, pour certains, de renvoyer toute volonté de prise en compte de ces problèmes à l’expression d’un fascisme rampant.
Influencée par une petite-bourgeoisie intellectuelle surreprésentée parmi les cadres et les militants, elle a défendu une vision promouvant la fragmentation de la société en minorités et en causes à défendre, incompatible avec la dynamique unitaire que porte intrinsèquement toute stratégie populiste. Au sein des catégories populaires, des orientations perçues comme “laxistes” sur des sujets comme l’immigration, la sécurité ou la laïcité sont des repoussoirs absolus, dans un contexte de raidissement généralisé sur ces thématiques.
Le populisme de droite a davantage infléchi son discours sur l’économie que la gauche ne l’a fait sur le culturel, c’est avant tout dans cette dichotomie qu’il faut chercher l’origine du succès supérieur du premier sur le second. Le cas du Royaume-Uni est un exemple très parlant de cela. Par ailleurs, on peut le déplorer, mais l’intransigeance de l’électorat est moindre en ce qui concerne les sujets économiques : des populistes de droite peuvent prospérer auprès des catégories populaires tout en continuant à promouvoir des politiques économiques contraires à leurs intérêts.
LVSL – La publication de votre ouvrage a-t-elle changé votre relation de journaliste avec les dirigeants et parlementaires de la France insoumise ?
H.M – J’aimerais répondre “non” à cette question ! De mon côté, je traite la France insoumise exactement de la même manière qu’avant la parution du livre. Néanmoins, force est de constater que les choses ont changé à mon égard, puisque Jean-Luc Mélenchon me consacre des attaques personnelles dans son blog ou ses vidéos, de même que certains cadres et évidemment plusieurs dizaines de militants virulents, au comportement quelque peu robotique. Il est désagréable — même si un peu comique — de se voir repeint en “militant politique”, “histéro-facho”, “collabo”, à la fois “pro-Macron, fervent défenseur de l’ultralibéralisme”, “facho” et membre de la “droite catho”. Je ne fais ici que citer quelques amabilités qui m’ont été adressées.
Même s’il faut toujours prendre du recul, je dois avouer avoir été un peu déçu sur ce plan. Je croyais que les Insoumis, parfois injustement décrits en staliniens invétérés (le comble pour ceux qui viennent du trotskisme !), se plaçaient du côté de l’exercice de la raison critique. Depuis, je les ai vus adopter des méthodes agressives relevant du sectarisme le plus obtus dès lors qu’on n’allait pas dans leur sens. Jean-Luc Mélenchon, victime de tant de caricatures, se réfugie lui-même dans la caricature en traitant le moindre contradicteur de fasciste. Pourtant, mon ouvrage est fort nuancé et ne succombe jamais à l’attaque gratuite. L’ont-ils seulement lu ?
Paradoxalement, en adoptant ce comportement, les Insoumis illustrent tout un passage du livre, qui évoque le fait que « la moindre critique est considérée comme une trahison » et que toute discussion est devenue impossible en interne. Cette campagne de dénigrement fait peut-être plaisir aux militants, mais je doute qu’elle convainque grand monde au-delà. En tout cas, ce n’est pas parce que les Insoumis ont choisi cette stratégie que je serais plus négatif à leur égard dans mes articles, mon travail est de décrire les choses de la manière la plus objective possible.

































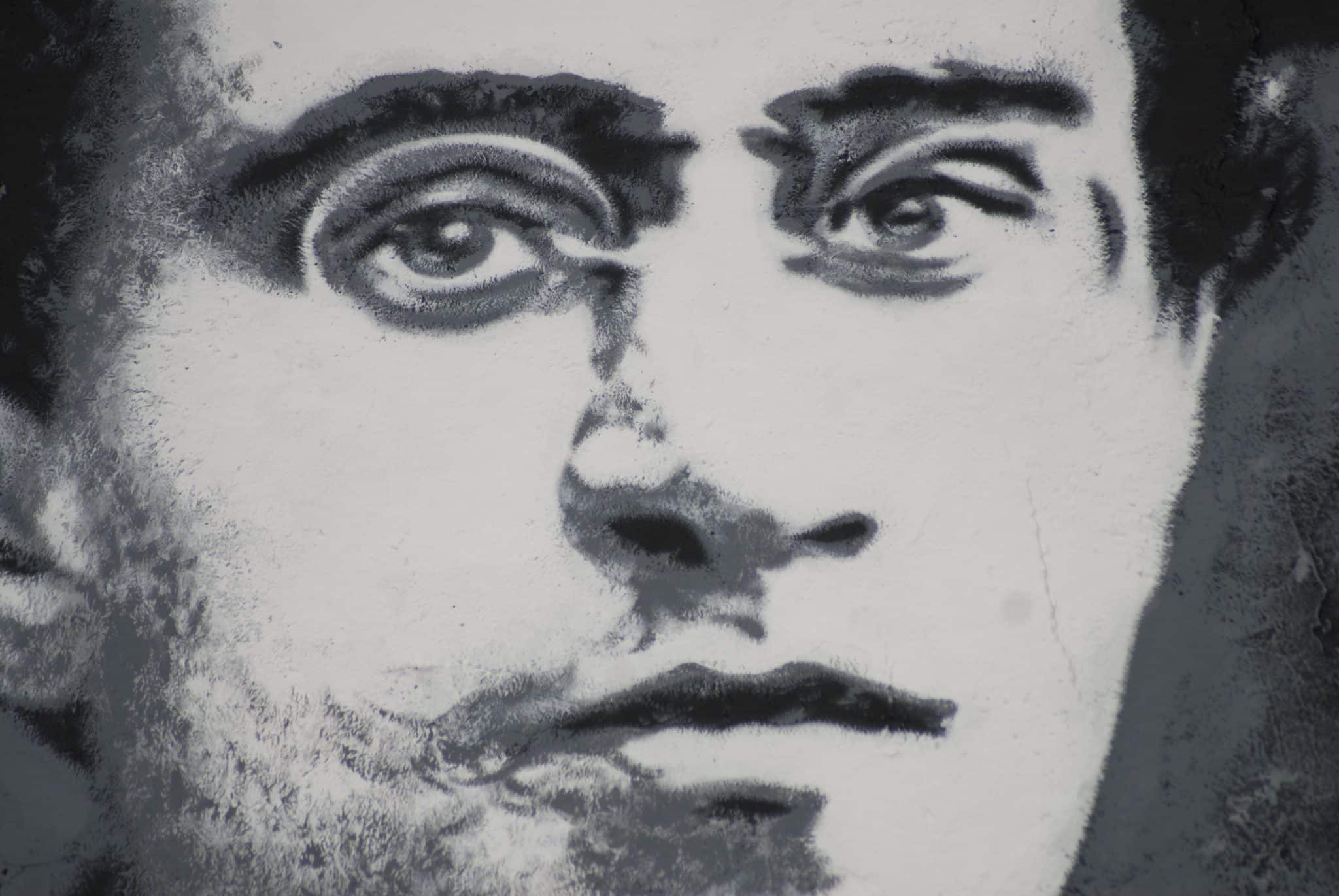





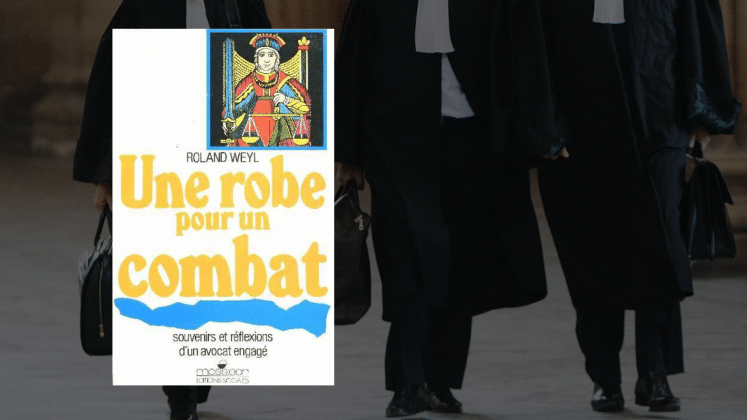








 Dans le cadre de la sortie de l’édition française du livre Construire un peuple (en librairie le 7 avril), dialogue entre Chantal Mouffe (philosophe théoricienne du populisme de gauche) et Íñigo Errejón (co-fondateur et stratège de Podemos), nous nous sommes entretenus avec Christophe Ventura, qui a mené la publication de cette édition. Christophe Ventura est animateur de l’association
Dans le cadre de la sortie de l’édition française du livre Construire un peuple (en librairie le 7 avril), dialogue entre Chantal Mouffe (philosophe théoricienne du populisme de gauche) et Íñigo Errejón (co-fondateur et stratège de Podemos), nous nous sommes entretenus avec Christophe Ventura, qui a mené la publication de cette édition. Christophe Ventura est animateur de l’association 




 Europe, année zéro. C’est là où nous en sommes. Chapitre 2 veut contribuer à la reconstruction, à tous les niveaux où il faut le faire. Admettons que la tâche est rude et incertaine. C’est pour cela qu’elle vaut la peine d’être relevée.
Europe, année zéro. C’est là où nous en sommes. Chapitre 2 veut contribuer à la reconstruction, à tous les niveaux où il faut le faire. Admettons que la tâche est rude et incertaine. C’est pour cela qu’elle vaut la peine d’être relevée.

