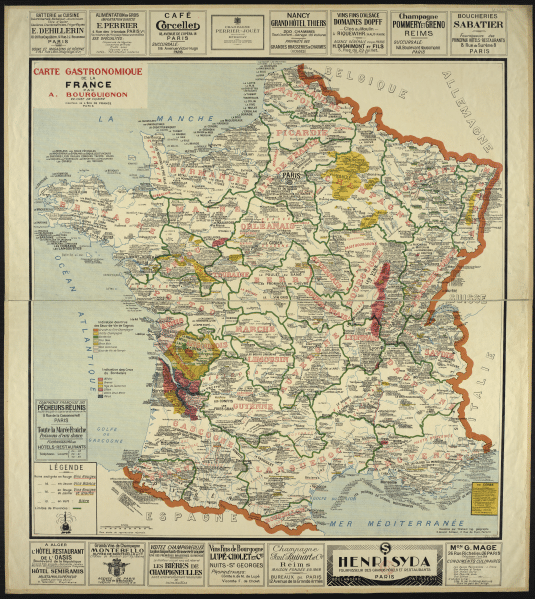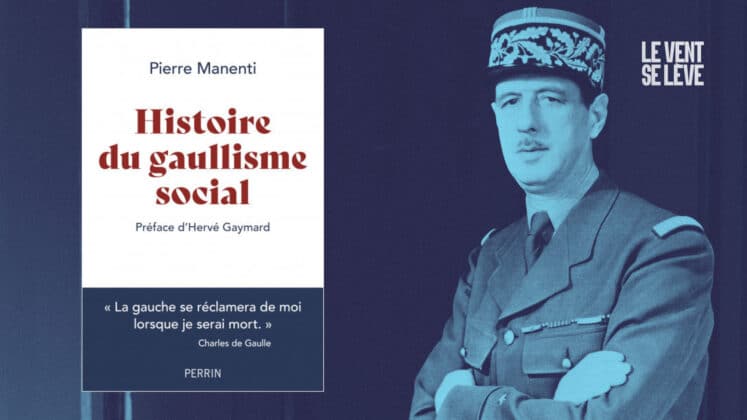Le monde du spectacle vivant s’est remarquablement adapté au confinement. Concerts à la maison diffusés en live sur les réseaux sociaux, orchestres montés en duplex, ou encore cette magnifique vidéo des danseurs de l’Opéra de Paris qui s’étaient déjà illustrés dans les mouvements sociaux d’avant l’épidémie. L’impressionnante créativité déployée a permis de lumineux moments dans une sombre atmosphère. Toutefois, alors que la récession s’avance, les inquiétudes et interrogations des artistes et techniciens se font nombreuses. Il convient alors de s’interroger sur les conditions matérielles et sociales qui permettent à la créativité de se déployer. L’intermittence du spectacle est une de ces conditions, et son modèle de fonctionnement porte en lui les germes d’un modèle de protection sociale apte à faire face aux défis du 21ème siècle.
Le secteur de la culture en général, et le spectacle vivant en particulier, sont parmi les plus touchés par les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19. Difficile en effet d’imaginer rassembler plusieurs dizaines, centaines, ou milliers de personnes dans un lieu clos, parfois à quelques centimètres les unes des autres et dans des situations propices à créer du contact. Il en résulte un arrêt brutal d’activité pour de nombreux intermittents du spectacle, plongés du jour au lendemain dans une grande incertitude.
Le régime d’assurance-chômage des intermittents du spectacle
Contrairement à ce que peut laisser penser un abus de langage courant, être « intermittent du spectacle » n’est pas une profession. Le terme désigne, en réalité, une forme de relation d’emploi discontinue propre aux artistes et techniciens du spectacle vivant. Une forme originale de sécurité sociale est attachée à cette relation d’emploi. Son principe est assez ancien. En 1936, le gouvernement du Front Populaire crée le régime d’assurance chômage des salariés intermittents du spectacle, salariés à employeurs multiples, à destination des techniciens de l’industrie du cinéma. Ce régime est étendu à l’ensemble du secteur du spectacle vivant en 1965 par l’ajout de deux annexes au régime d’assurance chômage de l’Unédic créé en 1958, appelées annexes 8 et 10. Ces annexes définissent les conditions d’accès et la liste des professions techniques (annexe 8) et artistiques (annexe 10) éligibles au régime d’assurance chômage de l’intermittence du spectacle.
Le principe est le suivant : dans une société où l’embauche en emploi permanent est la règle, le droit français reconnaît la nécessité d’une exception pour le secteur du spectacle vivant. L’emploi dans ce secteur est considéré comme devant s’effectuer auprès d’employeurs multiples et sur de courtes périodes en raison de la nature de l’activité [1]. En contrepartie de cette flexibilité à l’embauche, il est créé une assurance chômage ad hoc pour garantir des revenus stables à des travailleurs alternant par définition des périodes travaillées et des périodes chômées.
Là où le régime général donne accès à une indemnisation du chômage à partir de 910 heures travaillées en 24 mois, l’accès au régime d’intermittent du spectacle est plus strict. Il faut en effet avoir travaillé au minimum 507 heures sur les 12 derniers mois pour avoir accès à une indemnité, soit 52 heures de plus par an par rapport au régime général. En revanche, le salarié intermittent peut cumuler sans limite de durée les revenus de son travail et son indemnité chômage pour peu qu’il « renouvelle son statut », c’est-à-dire qu’il travaille à nouveau 507 heures dans les 12 mois suivant l’ouverture de ses droits. En gros, alors que la personne affiliée au régime général est soit en emploi, soit au chômage, l’intermittent du spectacle est à la fois en emploi et au chômage.
En France, le statut d’intermittent du spectacle permet aux travailleurs du secteur de bénéficier d’une sécurité sociale plus efficace que dans d’autres pays.
Ce régime d’assurance chômage crée deux particularités fortes. Tout d’abord, les artistes et techniciens travaillant en France sont systématiquement salariés : ils sont engagés sur la base d’un contrat de travail où un employeur verse une rémunération comprenant des cotisations sociales pour la santé, la retraite, le chômage, etc. Il s’agit d’une situation exceptionnelle sur le plan international. Si des formes a minima de l’intermittence du spectacle existent en Belgique ou en Suisse, les artistes et techniciens du spectacle à l’étranger sont généralement des prestataires offrant leurs services à des clients dans une logique entrepreneuriale. La protection sociale est alors beaucoup plus réduite.
La seconde particularité découle de la première, au sens où le statut d’intermittent du spectacle permet aux travailleurs du secteur de bénéficier en France d’une sécurité sociale plus efficace que dans d’autres pays. Aux Pays-Bas, par exemple, le prix élevé d’une couverture maladie privée implique que la vigilance dans l’exercice de son métier est souvent – en particulier pour les travailleurs les plus jeunes – la seule protection contre les conséquences économiques d’une blessure incapacitante. Or, la manutention et le travail en hauteur sont systématiques dans les métiers techniques. Des formes d’assurance plus accessibles se développent dans les broodfund, des mutuelles locales permettant de couvrir quelques dizaines de personnes contre les aléas sanitaires. En Italie, des coopératives de portage salarial permettent de salarier les artistes et techniciens et de cumuler leurs heures de travail sur un seul et même contrat. Dans ces deux pays, la protection contre le risque de chômage est quasi-inexistante.
Les raisons économiques d’un recours systématique à l’emploi discontinu : une question de productivisme
L’emploi intermittent est donc une caractéristique systématique, au niveau international, du secteur du spectacle vivant, quelles que soient les diverses modalités contractuelles dans lesquelles il s’exerce ou le régime de sécurité sociale en place pour assurer les travailleurs. Cela dit, pourquoi ? Comment se crée la nécessité, étonnamment acceptée, d’un recours systématique à l’emploi temporaire dans le secteur ?
La réponse à cette question est bien évidemment multi-factorielle et répond à des logiques qui dépassent le champ économique. Toutefois, il existe une dynamique économique propre au secteur du spectacle vivant qui contribue sans aucun doute à nourrir ce recours à l’emploi temporaire. Celle-ci a été décrite dans Performing Arts : The Economic Dilemma, écrit en 1966 par les économistes William Baumol et William Bowen. Ce livre résulte d’une commande de la Fondation Ford qui souhaitait alors comprendre pourquoi les orchestres et théâtres qu’elle finançait se retrouvaient systématiquement en déficit. En étudiant plusieurs orchestres et théâtres importants aux États-Unis ainsi que plusieurs théâtres de Broadway, les économistes sont parvenus à la conclusion suivante : le secteur du spectacle vivant souffre d’une augmentation permanente et incontrôlée de ses coûts de personnel. Ces coûts représentent l’essentiel de ses dépenses, en raison des hausses importantes et constantes de productivité dans le gros de l’économie états-unienne.
Le mécanisme est le suivant : les progrès technologiques permettent à l’industrie, formant alors le gros du PIB états-unien, de faire exploser sa productivité. L’industrie produit plus et vend plus, elle augmente ses bénéfices et potentiellement ses marges. Elle redistribue une part de ces nouveaux bénéfices aux salariés qui voient donc leurs revenus augmenter indépendamment de l’inflation. En conséquence, le coût de la vie augmente au niveau national. Le secteur du spectacle vivant, en revanche, ne bénéficie pas de gains de productivité induits par les progrès technologiques : les moyens humains nécessaires à la mise en place d’une représentation restent à peu près les mêmes. Le secteur est en revanche contraint d’augmenter les rémunérations de ses employés. En effet, l’élévation du coût moyen de la vie implique une hausse de celles-ci afin qu’elles puissent garantir la subsistance des artistes et techniciens. Les dépenses des théâtres et orchestres augmentent alors sans qu’elles puissent être compensées par des hausses de revenu. Il se crée alors un déficit budgétaire systématique dans ces structures que les économistes nomment la « maladie des coûts ».
Baumol et Bowen ne mettent jamais en question l’usage des gains de productivité vers une augmentation de la production et des bénéfices.
Conclusion : pour assurer leur viabilité économique, ces structures doivent être soutenues financièrement par des acteurs prêts à renoncer à un bénéfice économique au profit d’un bénéfice symbolique et culturel. Les acteurs publics peuvent subventionner les arts de la scène ou des fondations privées peuvent faire du mécénat. Si ces conclusions n’ont pas été contredites jusqu’à aujourd’hui, plusieurs de leurs implications peuvent être discutées. Notamment l’une de leurs prémisses, à savoir que les auteurs ne mettent jamais en question l’usage des gains de productivité vers une augmentation de la production et des bénéfices plutôt que vers une diminution du temps de travail à salaire constant. Or, en dernière analyse, c’est cet usage – que l’on peut qualifier de productiviste – qui provoque les augmentations incontrôlées des coûts de personnel dans le secteur du spectacle vivant. Baumol et Bowen interprètent la corrélation qu’ils observent comme une « maladie » du secteur du spectacle vivant, celui-ci étant perçu comme « archaïque » car peu réceptif aux améliorations de productivité permises par les progrès technologiques. Cette interprétation implique une conception naturelle de l’usage productiviste des gains de productivité technologiques, c’est-à-dire que cette forme d’usage est perçue comme allant de soi. Mais la « maladie » devient plus difficilement localisable si l’on conçoit cet usage comme un choix stratégique et social situé dans l’histoire et la géographie.
En effet, plus de 40 ans après la sortie de Performing Arts : The Economic Dilemma, la tendance à augmenter les volumes de nos productions diverses et variées sans questionner leur impact écologique nous a plongés dans une crise environnementale existentielle. Ce choix de société, perçu comme naturel dans les années 60, est donc de plus en plus questionnable aujourd’hui. Par ailleurs, si l’on interprète cette corrélation sur un plan anthropologique, elle permet de constater empiriquement que le productivisme a pour conséquence d’assécher économiquement notre capacité à produire des rituels dans lesquels se construisent une part non négligeable de nos identités culturelles et de nos liens sociaux.
L’intermittence du spectacle, une politique de redistribution qui répond aux effets de la loi de Baumol-Bowen
Cette ouverture nous ramène à l’intermittence du spectacle. Quoi de plus « rationnel » économiquement face à des coûts qui augmentent de façon incontrôlable que de chercher à les réduire ? Or, c’est exactement ce que permet une organisation intermittente de l’emploi. Le personnel n’est embauché que lorsque le besoin s’en fait le plus sentir et les employeurs n’ont pas à assumer les rémunérations en cas de baisse conjoncturelle de l’activité, comme lors d’une épidémie interdisant les rassemblements culturels. Le risque de perte de revenus est donc placé sur les salariés et les systèmes de protection sociale jouent à plein pour assurer la continuité de l’activité post-crise. Alors qu’aux Pays-Bas, les artistes et techniciens en freelance ou embauchés sur des contrats 0 heure se retrouvent du jour au lendemain sans revenus, les intermittents français disposent de quelques mois de répit et leurs inquiétudes se portent sur des échéances à plus long terme. Une situation qui reste peu enviable, mais assurément moins cauchemardesque.
Résumons : il y a donc une pression systémique sur la viabilité économique du spectacle vivant, créée par les stratégies productivistes d’une majorité d’acteurs économiques. Baumol et Bowen affirment que ce problème ne se résout que par des apports financiers publics ou privés à perte, c’est-à-dire rémunérés en capital symbolique et culturel mais certainement pas économique. Mais l’on peut aller plus loin et percevoir l’individualisation du marché du travail dans le secteur du spectacle vivant comme résultant au moins partiellement et indirectement de choix de sociétés productivistes. Cette individualisation n’est pas forcément un problème dans la mesure où des garanties de sécurité sociale peuvent être apportées aux travailleurs par des systèmes de protection adaptés. La question est alors : comment financer ces systèmes de protection ?
Comme tout salarié, les intermittents payent des cotisations sociales pour leur assurance chômage, d’ailleurs plus élevées que pour les personnes affiliées au régime général. Mais cela n’empêche pas le régime d’être en déficit systémique. Si les débats sur la taille de ce déficit font rage, le fait qu’il existe souffre peu de contestation. Et si l’on repense à la loi de Baumol et aux coûts croissants de personnel du secteur, comment pourrait-il en être autrement ? Les employeurs ont recours à l’embauche par projet pour diminuer leurs dépenses, lesquelles ne font de toutes façons qu’augmenter mécaniquement alors que la productivité augmente. Le déficit est donc, en soi, inévitable.
Il est compensé par la solidarité interprofessionnelle. Les caisses de chômage des secteurs bénéficiant d’un bon taux d’emploi sont excédentaires et ces excédents viennent compenser le déficit de la caisse du régime intermittent. Or, ces caisses sont précisément celles des secteurs dont les pratiques productivistes provoquent le besoin d’un recours à l’emploi temporaire systématique dans le spectacle vivant, et donc la nécessité de l’existence même du régime d’intermittence du spectacle. La solidarité interprofessionnelle constitue donc une réponse alternative aux effets de la loi de Baumol-Bowen. Ce ne sont pas les pouvoirs publics ou les acteurs privés qui viennent subventionner le secteur. Ce sont les secteurs économiques dont les pratiques de production rendent impossible la viabilité économique du spectacle vivant qui lui transfèrent une part de leur valeur ajoutée, compensant ainsi indirectement les effets délétères de leurs choix stratégiques. En d’autres termes, c’est une politique de redistribution.
Il faut dès aujourd’hui promouvoir activement la généralisation du régime de l’intermittence du spectacle à tous les emplois précaires.
A l’heure où les rapports entre employeurs et employés sont de plus en plus individualisés et où fleurissent des statuts précaires comme « auto-entrepreneur » ou « CDI intermittent », le régime d’intermittence du spectacle – bien qu’il soit évidemment améliorable en bien des aspects – constitue un exemple réussi de flexibilisation d’un marché du travail avec une perte de sécurité de l’emploi limitée. Mais il a cette caractéristique qui le rend peu avenant aux yeux des prophètes de la start-up nation : il se finance sur de la valeur ajoutée qui, par conséquent, n’est pas distribuée au capital. S’il est évidemment difficile de savoir vers quoi la récession présente va nous amener, il y a fort à parier que l’atomisation et l’ubérisation du marché du travail vont continuer leur dynamique. Il y a donc de fortes chances pour que l’intermittence soit perçue dans quelques décennies comme le sont aujourd’hui les régimes spéciaux de retraite des cheminots, gaziers, électriciens et autres. Alors qu’ils ont été conçus pour être l’avant-garde de la protection sociale, ils sont hélas majoritairement considérés aujourd’hui comme des archaïsmes iniques dont la suppression serait une mesure de justice sociale.
Il faut donc, dès aujourd’hui, promouvoir activement la généralisation du régime de l’intermittence du spectacle à tous les emplois précaires tombant sous le régime de l’auto-entrepreneuriat, de la pige, du CDI intermittent ou autre… Certes, l’intendance ne peut que blêmir à l’idée d’élargir la couverture d’un régime structurellement déficitaire. Cette idée ne manquera donc pas de subir des procès en inconséquence. Mais ne nous laissons pas berner par les illusions de l’obsession budgétaire caricaturale qui caractérise l’idéologie dominante de notre époque. Le Covid-19 est une cruelle démonstration de ce à quoi mène une politique qui réduit les dépenses publiques pour réduire les recettes publiques. Par ailleurs, il est essentiel de rappeler contre cette même idéologie que la différence entre salaire brut et net n’est pas une « charge » qui ne sert qu’à nourrir une bureaucratie inerte mais bien un salaire différé qui assure les travailleurs contre les aléas de l’existence qu’aucune innovation disruptive ne saura jamais supprimer.
En somme, rappelons-nous que la politique n’est pas qu’une affaire de comptabilité et que la définition des priorités d’une société ne peut se limiter au calcul localisé des entrées et sorties. Notre productivité est aujourd’hui colossale, décuplée depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La vraie question de principe est donc : que faisons-nous de cette productivité ? L’utilisons-nous pour inonder les sociétés de biens et services et pour distribuer des dividendes, et cela au mépris des conséquences environnementales et sociales de ces pratiques ? Ou en réservons-nous une part croissante à l’amélioration des conditions d’existence, en diminuant le temps de travail à salaire constant, en permettant à des activités culturelles de fleurir et en cherchant à protéger l’environnement ? Y a-t-il vraiment besoin de poser la question ?
[1] Article D1242-1 du code du travail
Références utilisées pour cet article :
Baumol, W. J., & Bowen, W. G. (1966). Performing arts – the economic dilemma: A study of problems common to theater, opera, music and dance; a twentieth century fund study. Cambridge, Mass. M.I.T. Press.
Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton, N.J: Princeton University Press.
Grégoire, M. (2012). Le plein-emploi comme seule alternative à la précarité ? : Les intermittents du spectacle et leurs luttes (1919-2003). Savoir/Agir, 21(3), 29. https://doi.org/10.3917/sava.021.0029
Grégoire, M. (2013). Les intermittents du spectacle : Le revenu inconditionnel au regard d’une expérience de socialisation du salaire. Mouvements, 73(1), 97. https://doi.org/10.3917/mouv.073.0097
Menger, P.-M. (2015). Les intermittents du spectacle : Sociologie du travail flexible (Nouv. éd). Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
Certaines affirmations sont basées sur la thèse de l’auteur, en attente de soutenance :
Battentier, A. (2020). Making The Show Go On. A Study of Sound Engineers in the French and Dutch fields of Music Production. Universiteit van Amsterdam/Università degli Studi di Milano