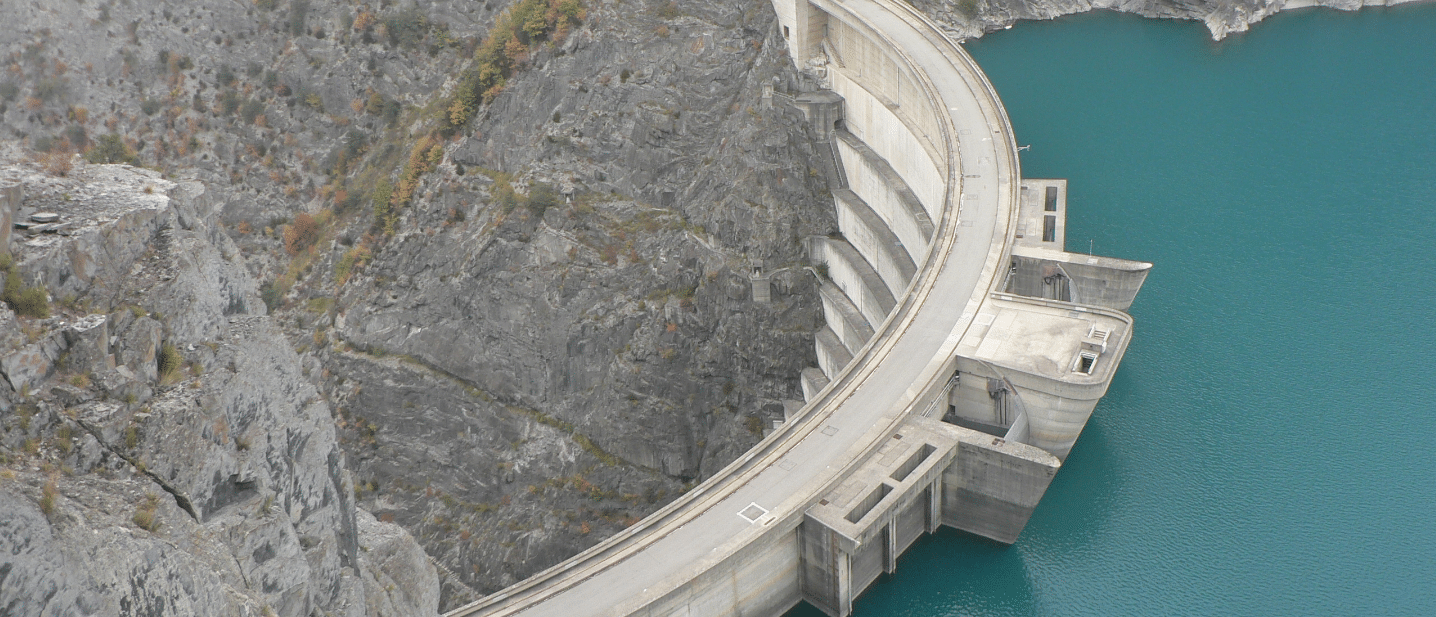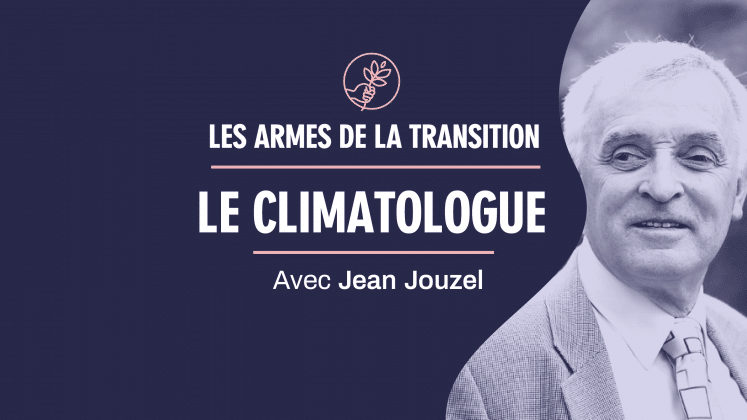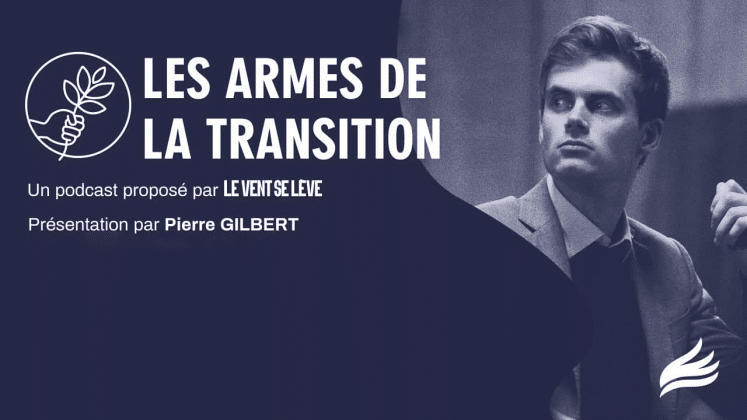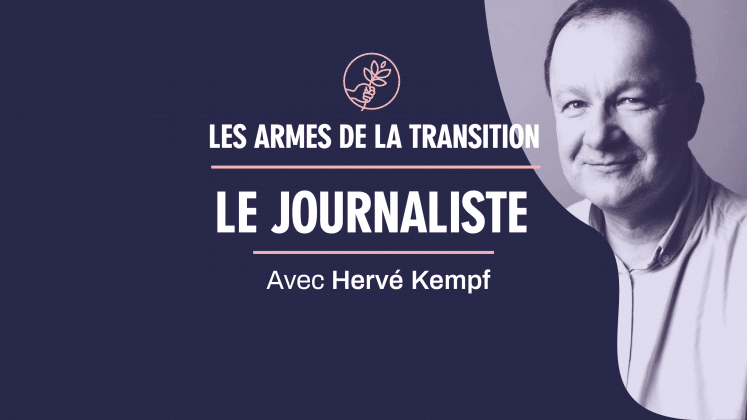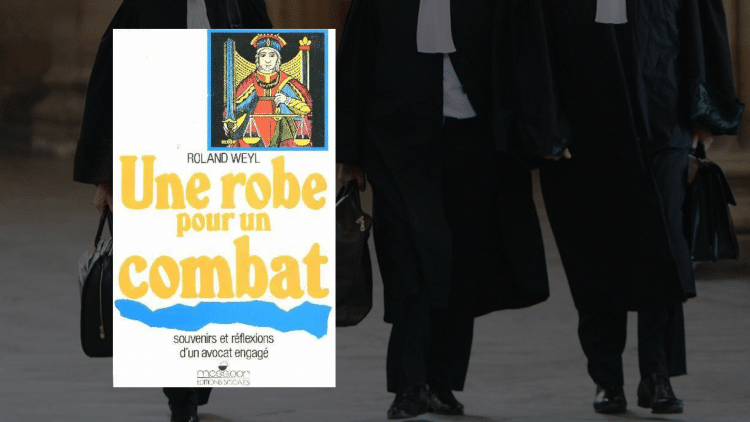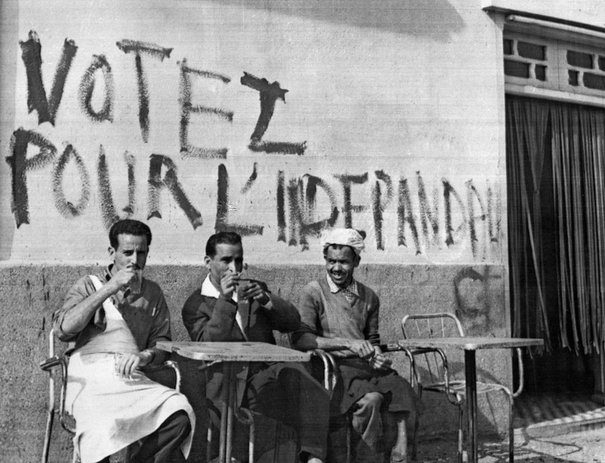Piles de dossiers entassées dans son bureau, la députée Clémentine Autain nous accueille quelques heures avant son passage dans Zemmour & Naulleau, où elle a croisé le fer avec Marlène Schiappa et les deux polémistes. L’atmosphère est optimiste, la mobilisation sociale bat son plein. L’occasion est bonne pour aborder son nouvel ouvrage sur Mai 68 intitulé Notre liberté contre leur libéralisme qui rappelle les fondamentaux du mouvement et en critique les récupérations. Mais aussi pour discuter de son rôle comme députée et de son opinion sur la stratégie de la France insoumise, et des rapports avec les autres mouvements comme le PCF et Generation.s.
LVSL – Lors de la dernière élection, Jean-Luc Mélenchon a adopté une stratégie et une esthétique qui ont surpris un certain nombre de militants habitués aux marqueurs traditionnels de la gauche que sont la couleur rouge, l’Internationale, la référence permanente aux « valeurs de la gauche », etc. Que pensez-vous de ces choix ?
Il a fait un choix stratégique gagnant en considérant qu’il ne suffisait pas de brandir le terme de “gauche” comme un étendard pour convaincre. Il est parti du fait que le bilan de la gauche au pouvoir, et notamment sous François Hollande, était catastrophique, et que le terme de “gauche” se trouvait associé à ce bilan, un bilan notamment détestable du point de vue des catégories populaires. Je l’ai vu très concrètement en faisant campagne aux législatives sur un territoire de banlieue en Seine-Saint-Denis. Le mot “gauche” était associé à François Hollande. Il fallait donc cesser de l’asséner tel un sésame puisque « la gauche » au gouvernement a mené une politique de droite, et donc contribué à faire exploser les catégories classiques “gauche” et “droite”. Depuis trente ans les gouvernements qui se succèdent, qu’ils se disent “de gauche” ou “de droite”, mènent une politique malheureusement très proche. D’où le brouillage des clivages traditionnels.
Pour autant, Jean-Luc Mélenchon n’a pas abandonné la gauche dans le contenu propositionnel comme dans les valeurs mises en avant. Pendant sa campagne, il a parlé d’égalité, de bien commun, de justice sociale, de démocratie véritable : autant de thèmes, de mots, de propositions qui s’inscrivent bel et bien dans une filiation qui est celle de la gauche. Se départir de l’esthétique traditionnelle de la gauche et ne pas employer le terme de “gauche” à tout bout de champ était un moyen de permettre à de nouveaux publics, en particulier les jeunes – qui se repèrent moins que d’autres dans les catégories traditionnelles pour des raisons générationnelles évidentes –, d’être audibles sur ces thématiques au-delà d’un a priori. Au fond, Jean-Luc Mélenchon n’a pas brandi le mot gauche mais il l’a rempli, lui a donné du sens, a ancré ses principes dans une forme de modernité.
Alors que certains rêvaient d’une “primaire de toute la gauche” pour 2017, Mélenchon s’en est tout de suite écarté pour se démarquer de toute responsabilité, proximité ou confusion vis-à-vis du bilan gouvernemental Hollande/Valls. Je constate que Benoît Hamon, qui a pourtant remporté la primaire du Parti Socialiste sur une ligne de contestation de la politique gouvernementale, a été lesté par une sorte de sparadrap du capitaine Haddock : on l’a associé au bilan gouvernemental puisqu’il y avait participé et qu’il avait encore le PS, Jean-Marie Le Guen ou Jean-Christophe Cambadelis dans ses bagages.
Mélenchon a effectué un second choix qui s’est avéré opérant : il s’est émancipé de la forme traditionnelle du parti. Il a trouvé un nom, “la France Insoumise”, qui n’est pas en “isme”, qui ne ressemble pas à un nom habituel du vocabulaire politique. Cette forme de mouvement fut un atout pour donner à voir du neuf, si attendu en raison de la déception et de la défiance nourrie à l’égard de la politique institutionnelle.
Ces choix stratégiques se sont révélés pertinents : notre famille politique s’est hissée à un score historique frôlant les 20%. Maintenant, une chose est d’avoir gommé quelques marqueurs anciens et d’avoir impulsé un nouveau mouvement, une autre serait de tirer comme conclusion qu’il faudrait jeter aux oubliettes tout rapport avec la gauche, ses symboles, sa culture, ses réseaux constitués. Je ne partage pas l’idée selon laquelle il faudrait choisir entre “fédérer le peuple” et “rassembler à gauche”. Au fond, ce qui a été réussi dans la campagne, c’est me semble-t-il le fait d’avoir réussi à tenir ces deux bouts : parler à la fois à celles et ceux qui sont écœurés de la politique, qui ne se reconnaissent pas dans des codes qui ne fonctionnent plus comme avant notamment auprès de la jeunesse et des catégories populaires, et dans le même temps, c’est bien sur une base de gauche, au sens d’un contenu politique, des valeurs, que Jean-Luc Mélenchon a fait sa campagne et son programme. Il me semble que c’est cet alliage de deux objectifs, fédérer le peuple sur une base de gauche, qui a porté ses fruits. Si l’on s’affranchit de toute référence à la gauche, le chemin peut nous mener bien loin des objectifs émancipateurs qui, pour ma part, donnent sens à mon engagement mais surtout la clé pour que soient transformées, améliorées, libérées, les conditions de vie du grand nombre.
« Je ne partage pas l’idée selon laquelle il faudrait choisir entre “fédérer le peuple” et “rassembler à gauche”. »
N’oublions pas que c’est notamment grâce à des territoires qui ont un ancrage historique bien à gauche que Jean-Luc Mélenchon a obtenu son succès. Il a su réveiller la “France rouge”. Il y a bien des racines historiques qui ont à voir avec cette histoire. Il fallait moderniser le discours, renouveler les formes, dans ses mots et ses références, non pas pour balayer le passé mais pour s’inscrire dans une filiation. C’est une première étape. Nous avons encore du pain sur la planche pour faire naître les majorités de demain, dans les têtes, dans la rue, dans les urnes, qui permettront les ruptures progressistes, sociales et écologistes. La contestation sociale qui s’aiguise est un point d’appui prometteur.
LVSL – La France Insoumise est certainement le groupe parlementaire d’opposition qui a le plus fait parler de lui ces derniers mois. Quel bilan tirez-vous du travail du groupe parlementaire insoumis ? Certains observateurs reprochent à la France Insoumise de rester enfermée dans une rhétorique d’opposition et une stratégie de conflit permanent et systématique qui nuit à sa crédibilité. Qu’en pensez-vous ?
L’histoire est là pour le montrer : ce qui rend une idée crédible, c’est le nombre de personnes qui la portent. La revendication des congés payés, qui a émergé après la formation du gouvernement du Front Populaire, est devenue crédible parce qu’il y avait des mobilisations de masse qui portaient cette idée-là. La démocratie qui apparaissait très utopiste à l’époque où la monarchie était le système politique dominant, devient crédible à partir du moment où il y a la mobilisation massive du peuple qu’on a connue pour la faire advenir. L’égalité entre les hommes et les femmes n’était en rien crédible au début du XXe siècle : elle s’est imposée à la faveur des mouvements féministes et de l’appropriation grandissante de cette volonté émancipatrice qui semblait au départ contraire à l’ordre naturelle, risible ou inaccessible. Je me méfie donc des réflexions portant sur ce qui serait “crédible” ou non a priori, comme si la validation d’experts ou d’énarques était le sésame d’une idée « crédible » !
Il ne faut pas croire que la crédibilité est liée à l’accumulation de notes de technocrates que l’on a dans les tiroirs tant celles-ci ressemblent trop souvent au monde tel qu’il est. Une idée devient crédible lorsque le grand nombre en est convaincu et se mobilise pour la porter.
LVSL – On pourrait vous objecter que n’importe quelles idées ne peuvent pas convaincre le grand nombre…
Je pense que ce n’est pas la bonne perspective. Si on part seulement du potentiel majoritaire d’une idée à l’instant T dans la société, je ne suis pas sûre qu’on donne naissance à un projet cohérent et porteur d’émancipation humaine… Car on risque alors vite de se caler sur des enquêtes d’opinion qui donnent le pouls des idées en vogue liées à l’état du débat public et des rapports de force politiques. D’où l’importance à mon sens de continuer à fédérer le peuple sur la base d’une orientation de gauche. Il faut maintenir cette tension. Sinon, nous risquons par exemple d’épouser de tristes thèses sur l’immigration ou la sécurité, pour ne prendre que deux exemples. C’est pourquoi je me méfie d’un neuf qui mépriserait tout ancrage historique, escamoterait toute réflexion intellectuelle, se donnerait pour seul objectif de refléter d’une certaine manière les désirs prétendus du peuple contemporain. Sur la scène politique, on se dispute le peuple parce que c’est l’interprétation du sens de ses intérêts qui est en jeu.
Pour en revenir au groupe parlementaire, ce qui nous rend crédible, c’est notre cohérence et notre détermination face à la politique d’Emmanuel Macron. Nous sommes aussi des proposants même si cela s’entend moins. L’un n’exclut pas l’autre mais se renforce. Chaque refus est déjà le début d’un “oui”. Savoir dire “non” ouvre la possibilité et la nécessité de faire autre chose. Et si vous écoutez les discours des députés du groupe de la France Insoumise, vous verrez qu’il y a des critiques mais aussi beaucoup de propositions alternatives !
En même temps, peut-être que ce que l’on a besoin de fortifier, c’est l’espérance. Je crois profondément qu’on se bat d’autant plus et d’autant mieux qu’on s’appuie sur les colères – et pas sur le ressentiment, registre sur lequel joue le Front National -, et qu’on parvient à les transformer en espoirs de changement. On se bat d’autant plus et d’autant mieux qu’on donne corps à une vision qui nous projette positivement dans l’avenir.

LVSL – Que pensez-vous de la stratégie du conflit de la France Insoumise ? Vous avez critiqué, par exemple, l’emploi de l’expression “parti médiatique” pour désigner les grands médias…
Il y a une conflictualité à assumer avec les grands médias, c’est évident, puisque nous contestons l’idéologie dominante qu’ils véhiculent largement, mais je n’utilise pas pour ma part l’expression de “parti médiatique”, et ce pour deux raisons. D’abord, je ne crois pas qu’il y ait un “parti unique” des médias. Les médias sont multiples : vous existez, Regards existe comme bien d’autres médias critiques, et à l’intérieur même des rédactions des grands médias, la pensée dominante y est parfois contestée, elle n’est pas celle de tous les journalistes même si une chape de plomb a tendance à les marginaliser. Prenons un exemple significatif : Elise Lucet, sur France 2, grand média s’il en est, fait un travail d’éveil critique des consciences remarquable. Elle a levé des lièvres sur l’évasion fiscale, mis en cause des multinationales. Je ne pense donc pas qu’il y ait un “tout” médiatique si homogène même si je constate, évidemment, la force de l’idéologie dominante que les grands médias diffusent avec abondance. Que nous dénoncions la concentration dans les médias ou les modalités d’attribution de l’aide à la presse est de ce point de vue essentiel. Les conditions de la production d’information constituent un enjeu démocratique majeur. Le système économique et les politiques publiques doivent garantir le pluralisme et la vitalité de la production d’informations de qualité et indépendantes des pouvoirs en place.
Si je suis exaspérée par bien des questions que posent les journalistes, si je vois bien les relais dont dispose Macron, si je suis convaincue que les dirigeants des grands médias sont en guerre contre nous et défendent les intérêts des possédants, je pense néanmoins que, pour progresser et gagner des majorités d’idées, nous avons intérêt à nous appuyer sur des médiations, et donc sur les contradictions et nos points d’appui dans l’univers des médias.
LVSL – La France Insoumise place au cœur de ses critiques l’hyper-présidentialisation de la pratique macronienne du pouvoir, et l’hyper-personnalisation de la fonction présidentielle opérée par Emmanuel Macron. Pensez-vous que proposer le retour à un régime plus parlementaire et critiquer la personnalisation du pouvoir soit une stratégie efficace ? La France Insoumise a pourtant frôlé les 20% grâce (en partie) à la figure charismatique de Jean-Luc Mélenchon et à ses talents tribuniciens…
C’est un fait, la politique s’incarne. Si on choisit de compter dans la vie politique institutionnelle française, nous devons avoir un candidat à la présidentielle. Et ce même si nous prônons une VIe République pour en finir avec la monarchie républicaine. Il y a bien sûr une forme de dissonance mais nous sommes contraints de l’assumer. Et tant qu’à candidater, il vaut mieux choisir une personnalité qui ait du verbe et du charisme, ce qui est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Mais s’il avait été élu, nous avions pour projet d’en finir avec les pires travers de la Ve que vous avez cités. Par ailleurs, le groupe parlementaire a permis de faire émerger de nouvelles figures pour notre famille politique, et c’est heureux. Car je crois qu’il faut tenter de déjouer les pièges d’une hyperpersonnalisation de notre famille politique. Une force politique large doit chercher à avoir plusieurs visages connus du grand nombre – et ce n’est pas facile. C’est une façon de faire vivre la diversité des styles et des profils de nature à élargir notre audience. C’est aussi le gage d’un certain pluralisme, nécessaire à tout mouvement politique vivant et large. Mais il faut bien se rendre compte que le monde politique et médiatique a une fâcheuse tendance à favoriser la parole centrée autour d’un leader. Jouer des codes qui sont imposés par les règles du jeu de notre époque, et notamment la présidentielle qui donne une place prépondérante à une personnalité, tout en essayant de les déjouer : comment faire autrement ?
Macron, lui, n’a pas été seulement la personnalité de la présidentielle : il se moule depuis son élection dans les pires travers de la Ve République. C’est ce bonapartisme que nous rejetons, ce mépris pour le Parlement et la démocratie, que la réforme institutionnelle à venir s’apprête à dramatiquement renforcer. Je suis très inquiète, par exemple, de son approche sur les fake news : ce n’est pas à l’État de décider ce qui est, ou non, une vérité. À partir du moment où le président de la République prétend que c’est à l’État que revient la gestion de cette question, je pense qu’on peut entrer dans des dérives gravissimes. Macron est aussi l’homme des ordonnances et de la répression violente à l’égard des étudiants et des occupants de Notre-Dame-Des-Landes… Au pouvoir, c’est bien lui qui occupe sa fonction par un hyper-présidentialisme et de l’autoritarisme. Nous nous battons pour une toute autre vision de la politique et de la démocratie, pour les libertés, les pouvoirs et les savoirs partagés.
LVSL – Nous aimerions revenir sur l’affaire Weinstein et ses suites – “mee too”, “balance ton porc”. Considérez-vous que cet élan de libération de la parole a permis des avancées en France ? Le gouvernement se donne-t-il selon vous les moyens de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes ?
Ce qu’on attend des pouvoirs publics, c’est qu’ils accompagnent concrètement cette formidable libération de la parole. Cette vague de parole a été soutenue dans le discours par les représentants du gouvernement. On ne peut pas le retirer à Marlène Schiappa qui, je le crois, a des convictions sur le terrain de l’égalité hommes/femmes. Mais celles-ci semblent s’être arrêtées aux cas Darmanin et Hulot… Là, la ministre est curieusement sortie de son devoir de réserve et n’a pas respecté la séparation nécessaire des pouvoirs entre exécutif et judiciaire. Non seulement le gouvernement par la voix de son porte-parole a renouvelé sa confiance envers Darmanin et Hulot après les mises en cause rendues publiques mais Marlène Schiappa a pris la défense de ses collègues ministres. Sidérant. Lorsqu’on lui a demandé sur France Inter si elle n’était pas mal à l’aise vis-à-vis des accusations qui venaient d’être formulées à l’encontre de Gérald Darmanin, elle a répondu : “non pas du tout, pourquoi le serais-je?”. Je pense qu’elle aurait pu l’être a minima, sans même prendre parti sur les faits. Elle s’est surtout fendue d’une lettre au Journal du Dimanche en faveur de Nicolas Hulot en expliquant que c’était un homme charmant. Je rappelle que Nicolas Hulot était mis en cause pour un viol qui échappe à la justice en raison du délai de prescription… que pourtant la ministre entend allonger dans la loi qu’elle va tout prochainement présenter devant Parlement !
Maintenant, que vont faire les pouvoirs publics pour accompagner cette libération de la parole ? On a en la matière des besoins énormissimes. Deux permanences téléphoniques qui accueillent les femmes victimes, l’AVFT et le CFCV, ont été fermées parce qu’elles n’avaient plus les moyens de répondre aux appels qui ont explosé avec la vague #MeToo ! C’est symptomatique. On attend du gouvernement les moyens pour que la parole puisse être entendue.
« Même avec les meilleures intentions, la lutte contre les violences faites aux femmes ne rentre pas dans les clous de l’austérité budgétaire. »
Les pouvoirs publics doivent agir à plusieurs niveaux. En matière d’éducation, je regrette qu’ils aient renoncé aux “ABCD de l’égalité” abandonnés sous le précédent quinquennat, et que le nouveau gouvernement n’ait rien fait de plus pour apprendre aux enfants à lutter contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge. Nous avons aussi besoin de formation dans la police. Le goupe F et la page “paye ta police” du réseau Trumbl vient de rendre public des éléments dont j’avais connaissance depuis très longtemps, qui témoignent de la manière dont les femmes sont reçues dans les commissariats de police. Lorsque j’ai moi-même porté plainte pour viol, je n’ai par exemple pas eu le choix entre un homme ou une femme. Ne pas pouvoir choisir de raconter une telle histoire à une femme, et se trouver contrainte de le dire le détail de ces faits à un homme, ça ne va pas. En l’occurrence, j’étais face à un policier qui n’avait pas été formé à recevoir ce type de plainte, il était jeune. En plein milieu du dépôt de plainte, il m’a demandé si cela ne m’ennuyait pas si on s’arrêtait pour qu’il fume une cigarette. Il était ému, visiblement ébranlé par ce que je lui disais, je ne lui en veux absolument pas, je dis juste qu’il faut former les policiers pour que les femmes puissent déposer leur plainte dans les meilleures conditions. Dans certains commissariats, vous avez des calendriers de femmes nues sur les murs, dans d’autres des remarques déplacées parfois au point de faire renoncer des femmes au dépôt de plainte. Il faut aussi des moyens pour la justice. Plusieurs années sont parfois nécessaires pour que la justice puisse faire son travail, pour que l’indemnisation de la victime soit effective alors que c’est dans l’immédiat que vous avez besoin de soins et d’aide lorsque vous avez été victime d’un viol. Enfin, les campagnes de sensibilisation doivent recevoir un soutien des pouvoirs publics : en argent sonnant et trébuchant, et on n’a rien pour le moment. Le budget, à ce stade, n’est en rien à la mesure de ce qui s’est passé et des besoins. Même avec les meilleures intentions, la lutte contre les violences faites aux femmes ne rentre pas dans les clous de l’austérité budgétaire.

Nous sommes d’accord avec certains éléments de modifications législatives prévus par le gouvernement, comme le fait de repousser le délai de prescription pour les viols – le viol est un crime particulier qui impacte la mémoire, le phénomène d’amnésie est courant chez les personnes victimes de viol. Le cheminement est parfois long entre l’acte et la décision d’aller porter plainte. Il faut un délai de prescription qui soit élargi. J’ai posé à l’automne une question d’actualité à l’Assemblée suite au non-lieu prononcé par la justice au sujet d’une fillette de onze ans qui avait été violée. Un âge minimal de présomption de non-consentement, en vertu duquel une personne n’est pas en mesure de consentir à un rapport sexuel, doit être instauré, ce que nous avons proposé et qui devrait être contenu dans cette loi contre les violences débattue tout prochainement au Parlement.
Ces améliorations sont donc nécessaires et bienvenues, mais si tout cela n’est pas accompagné de moyens financiers pour appuyer tout le processus de libération de la parole, leurs effets seront très limités. Je pense aussi, par exemple, aux besoins en matière de logement pour les femmes victimes de violences conjugales. On sait comment fonctionnent ces violences. Parfois, lorsqu’une femme a envie de partir, si on ne l’accompagne pas tout de suite et qu’elle doit attendre trois ou quinze jours pour pouvoir le faire, elle peut ne plus jamais partir et donc subir encore plus de violences, voire mourir. Nous serons donc au rendez-vous pour dire et redire combien l’égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les violences nécessite un investissement public inédit.
LVSL – Au-delà de ces aspects législatifs, l’égalité hommes-femmes ne peut se passer de profondes transformations culturelles afin de mettre un terme au phénomène d’auto-censure, d’intériorisation de normes implicites qui placent les femmes dans des positions de dominées. Je voulais donc savoir comment, en tant que députée, vous pensez que ce combat culturel peut se mener, dans la mesure où il est plus difficile à visibiliser que les luttes concrètes contre le harcèlement ou le viol, par exemple.
Tout se tient. Associer systématiquement le rose aux filles et le bleu aux garçons dès la naissance a un lien avec la normalisation sexuée des métiers, avec les insultes sexistes dans la rue, avec la sous-représentation des femmes dans les lieux du pouvoir, avec les violences conjugales. Le féminisme fait le lien entre tous ces aspects en remettant en cause l’ordre des sexes. La bataille est économique, sociale, culturelle. Il faut changer l’organisation de la société toute entière et modifier les représentations hommes-femmes. C’est long et difficile. Mais nous avons parcouru un chemin incroyable en un siècle ! Une révolution. Ce temps n’est pas si loin où une femme ne pouvait pas porter un pantalon, ni ouvrir un compte en banque sans l’autorisation de son mari, ni voter, ni avorter ! On a donc déjà fait un bond incroyable. Mais il faut passer au stade supérieur pour passer de l’égalité formelle, conquise dans la loi, à l’égalité réelle. Celle-ci implique effectivement de modifier les représentations dominantes, mais pas seulement : ne faisons pas de l’égalité hommes-femmes une question uniquement cantonnée à la sphère des représentations, même si c’est très important. Il y a aussi des mesures concrètes à prendre. Le partage des tâches domestiques et parentales, c’est concret et décisif. Si on ne fait pas un service public d’accueil gratuit de la petite enfance, si on ne diminue pas le temps de travail pour tout le monde, on aura toujours un plafond de verre dans le monde professionnel, des femmes à bout et des tâches – et des joies – non partagées. Les femmes gagnent moins que les hommes et sont attendues sur le terrain de la maternité : c’est pourquoi ce sont si majoritairement elles qui « choisissent » un temps partiel ou renoncent à leur emploi pour s’occuper des enfants. Il y a bien des enjeux matériels et de représentations que les pouvoirs publics doivent enfin considérer pour combattre réellement les inégalités. Je pense qu’on va y arriver, mais à quel rythme ? Il ne faut rien lâcher de notre mobilisation : il n’y a pas de pente naturelle vers l’égalité.
LVSL – Pour parler du passé, dans votre ouvrage sur Mai 68 intitulé Notre liberté contre leur libéralisme, vous revendiquez une filiation historique dans le mouvement 68 et critiquez les récupérations officielles du mouvement auxquelles on assiste en ce moment. Vous expliquez notamment que Macron serait de droite, et vous associez libéralisme économique et contrôle social. Cependant, une part substantielle de l’électorat de Macron vient de l’ex-électorat du Parti Socialiste, qu’on peut qualifier de plutôt progressiste. Certains observateurs considèrent d’ailleurs que le macronisme est une combinaison entre un progressisme modernisateur et néolibéral et une symbolique conservatrice. Ils parlent à ce propos de “populisme néolibéral”. Que pensez-vous de cette analyse ? Croyez-vous que les métaphores “gauche” et “droite” ne sont pas devenues inopérantes pour qualifier l’action d’Emmanuel Macron ?
La politique que mène Emmanuel Macron sous nos yeux est une politique de droite, sans aucune ambiguïté. De droite, parce qu’elle favorise dans les faits les plus riches, les possédants, les dominants. LREM fait l’éloge du mérite, de la théorie du ruissellement, des premiers de cordée. Toute cette rhétorique se campe à droite toute. Sur un autre plan, Macron semble avoir déstabilisé une partie de son électorat qui vient de la gauche. Si ces électeurs sont acquis au libéralisme économique, ils restent soucieux des droits humains et des libertés. Sur la question du droit d’asile par exemple, on a pu voir des prises de position étonnement critiques de Macron issues de Terra Nova, think thank ultralibéral proche de la hollandie. Certains soutiens de Macron ont l’air aujourd’hui de s’émouvoir que, avec sa modernité en bandoulière et son style jeune et sympathique, le Président se mue finalement en personnage autoritaire, dialoguant amicalement avec des dictateurs, renforçant l’état d’urgence, méprisant le Parlement et les médias. En fait, je suis étonnée de leur étonnement car je pense qu’il y a une cohérence à tout cela. Il y a une logique à l’alliance entre libéralisme économique et contrôle social accru. Quand l’État se désengage de la sphère économique, il se dépossède des leviers qui lui permettraient d’agir sur l’économie. Pour compenser cette perte de pouvoir, le gouvernement et l’État cherchent alors à s’affirmer sur un autre terrain, celui des libertés et de la démocratie. La dérégulation libérale est d’une telle violence qu’il faut du contrôle social pour l’imposer. En effet, comme leur politique libérale se révèle impopulaire parce qu’elle creuse les inégalités et génère de la précarité, le pouvoir a besoin de contrôler et de pénaliser ceux qui se rebellent. On le voit avec la répression toujours plus forte des mobilisations sociales et des syndicalistes. On vit quand même dans une société où, pour avoir jeté des confettis dans un bureau de direction, un syndicaliste peut écoper de 17,000€ d’amende ! Au fond, c’est un profil politique qui est bien connu en Europe depuis Margaret Thatcher qui a allié un libéralisme débridé à un contrôle social accru. Margaret Thatcher a donné le maître mot en privatisant les chemins de fer, en détricotant les retraites et les acquis sociaux britanniques, dans le même temps qu’elle considérait Nelson Mandela comme un terroriste et laissait mourir de faim Bobby Sands.
Ce qui me frappe, c’est aussi la technocratisation et la déshumanisation qui va avec. Gérard Collomb en est un exemple tristement parfait. Le ministre de l’Intérieur parle d’immigration de façon comptable, sans jamais restituer la réalité de celles et ceux qui fuient la guerre et la misère. Et l’on se souvient de ces ministres et députés LREM qui nous ont expliqué que ceux qui dorment dans la rue le font par choix. Ainsi va la liberté en macronie… ! L’indécence n’est jamais loin.
La commémoration de Mai 68 dépasse très largement Macron : elle concerne tous ces éditorialistes et figures médiatiques, comme Romain Goupil, qui font figure d’éternels révoltés pour reprendre le titre du Monde 2, comme si on pouvait passer de Mai 68 à Macron dans un mouvement continu. La volonté de récupération par les libéraux de l’esprit de Mai 68 est un piège mortifère. Elle vise à produire un récit dominant qui tente d’inclure l’héritage soixante-huitard dans la macronie. Or, Macron tourne le dos à la liberté, car pour être libre, il faut avoir un toit sur la tête, manger à sa faim, se cultiver, avoir accès à l’éducation et à la santé, et ce gouvernement attaque tous les leviers permettant de rendre effectifs ces droits fondamentaux. Il fait donc reculer les conditions de la liberté concrète, dans le même temps qu’il diminue les libertés individuelles et collectives par le biais d’un contrôle social accru. C’est dire si nous sommes loin des revendications de Mai 68…
LVSL – Plus largement, Eve Chiapello et Luc Boltanski ont montré dans Le nouvel esprit du capitalisme comment le capitalisme a su digérer la critique “artiste” qui émanait du moment 68, en développant de nouvelles formes managériales qui favorisent “l’autonomie” et la “créativité”. Est-ce que les récupérations actuelles ne sont pas l’aboutissement de ce processus d’incorporation de la critique par le capitalisme ?
Je pense que Macron a saisi cette aspiration qui existe fortement aujourd’hui à l’autonomie, à gagner en liberté. Chiapello et Boltanski ont raison. Emmanuel Macron nous raconte une fable – la politique, c’est du récit –, selon laquelle nous allons, dans le monde d’Emmanuel Macron, être plus libre : c’est ce conte pour enfant du statut d’auto-entrepreneur érigé comme le comble de la liberté. Beaucoup en sont amèrement revenus, faisant l’expérience concrète de la perte en termes de droits et de revenus qu’engendre ce statut. Cette liberté proclamée, cette prétendue autonomie nouvelle se traduit finalement par de la précarité, et donc moins de liberté. Je pense qu’il faut que l’on se soucie de ces enjeux d’autonomie, de liberté, d’aspiration à être moins corseté dans sa vie quotidienne. Nous sommes les meilleurs défenseurs de ce désir de mobilité, de mouvement, de salariés pleinement sujets. Ce qui rend les gens figés dans leur travail et malheureux, c’est le chômage de masse, qui n’invite pas à aller et venir mais au contraire à rester enfermé dans son travail même quand on y souffre ardemment. Quand on parle de réduction du temps de travail, de sécurité tout au long de la vie, c’est une façon de lutter contre la précarité, qui est l’ennemie absolue de l’autonomie et de la liberté.
Il me semble que nous avons un récit possible qui se raccorde à cette aspiration légitime. Sans doute nous faut-il davantage parler du contenu du travail qui subit une phase de prolétarisation. Les normes libérales débouchent sur une perte d’autonomie dans le travail. Je pense par exemple à ces caissières qui sont obligées d’appeler leur supérieur hiérarchique dès qu’un blocage s’opère sur leur caisse. Cette prolétarisation du travail ne concerne pas que les catégories populaires. Elle touche également les cadres, avec des tâches qui sont de plus en plus bureaucratisées et hiérarchisées, provoquant une diminution toujours plus grande de l’autonomie, de la prise d’initiative. Le phénomène de sous-traitance y contribue également. Avant, lorsqu’on construisait un objet, même si on n’en fabriquait que l’une des parties, on voyait l’ensemble du travail fini. On participait à une entreprise collective dont on pouvait apprécier le résultat. Avec la sous-traitance, vous ne voyez plus quel est l’objet fabriqué en bout de course. C’est une perte de sens et cela participe à la prolétarisation du travail. La participation active de celles et ceux qui travaillent à ce que l’on produit est l’un de nos grands objectifs, là où le libéralisme économique précarise et fait perdre le sens.
LVSL – Pour aborder un autre aspect de Mai 68 qui est l’internationalisme, votre mouvement Ensemble se revendique de l’internationalisme. Comment concevez-vous l’internationalisme aujourd’hui ?
L’internationalisme situe notre enjeu, qui n’est pas simplement de réussir l’émancipation à l’intérieur d’un territoire fermé mais de la rechercher pour l’humanité toute entière. C’est partir du principe que l’émancipation humaine n’a pas de frontières, que nous sommes concernés par l’intérêt des peuples sur toute la planète. Cela suppose évidemment de développer des solidarités. Je me sens plus proche des femmes polonaises qui luttent pour l’avortement que des Français qui défilent dans la Manif pour Tous ou des travailleurs grecs qui se battent pour leurs droits que des banquiers français qui les étranglent. Se revendiquer de l’internationalisme induit aussi que nous avons pleinement conscience que toute une série d’enjeux ne peuvent se régler qu’à une échelle planétaire. Le réchauffement climatique est évidemment de ceux-là. Et nous sommes engagés pour la paix dans le monde. Nous exigeons la création de biens communs de l’humanité. Nous contestons le capitalisme mondialisé et la concurrence qui abaisse les droits et protections comme les normes sanitaires. Sans hésiter, je dirais que mon combat, notre combat, est résolument internationaliste.
LVSL – La France Insoumise a mobilisé des signifiants patriotiques dans sa campagne de 2017 et promu une défense de la souveraineté de la France. Comment concevez-vous la place des États-nations à l’intérieur de cet internationalisme ? La souveraineté nationale peut-être elle selon vous une protection face à l’offensive néolibérale portée par l’Union européenne ?
Oui je le crois, dès lors qu’elle pose la question de la souveraineté, et qu’elle considère que l’enjeu de souveraineté doit être vrai à tous les échelons. Je suis pour la souveraineté nationale retrouvée, je pense que c’est un échelon qui reste pertinent aujourd’hui. Mais je pense aussi que la souveraineté doit vivre à l’échelle des villes comme à l’échelle internationale car il s’agit de la manière dont les peuples décident. La souveraineté doit se décliner à tous les échelons.
Dans le cadre international actuel, retrouver de la souveraineté nationale est un levier pour permettre du changement, et dès lors qu’elle n’est pas pensée comme un simple repli sur nos frontières. Un gouvernement élu demain en France doit pouvoir mener une politique progressiste, voilà l’exigence, qui se confronte aux traités européens actuels. Mais un grand nombre de défis auxquels nous sommes confrontés se jouent à une échelle plus grande que la nation. Ceux qui veulent s’enfermer dans l’État-Nation ne prennent par exemple pas au sérieux le défi environnemental car il n’y a pas de solution écologique uniquement dans le cadre des frontières nationales. C’est la même chose sur la question des réfugiés, qui vont d’ailleurs être de plus en plus nombreux en raison des catastrophes climatiques à venir. Sans parler bien sûr du capital qui a depuis longtemps su évoluer en traversant les frontières. Pour le combattre, il y a besoin d’alliances à l’échelle européenne et internationales. Ce ne sont là que quelques exemples de questions qui doivent être traitées à des échelles qui ne sont pas simplement nationales.
« Un gouvernement élu demain en France doit pouvoir mener une politique progressiste, voilà l’exigence, qui se confronte aux traités européens actuels. »
L’échelon national est légitime, dès lors qu’il cherche à créer des sous-ensembles pour coopérer avec les autres peuples, à l’échelle européenne et mondiale. Je n’abandonnerai pas la recherche de coopération à des échelles plus grandes que la nation au motif qu’aujourd’hui les peuples veulent retrouver leur souveraineté nationale, ce qui est légitime. On en a bien sûr besoin, ne serait-ce que parce que demain, un gouvernement qui arrive à la tête de la France doit pouvoir mener une politique émancipée de la règle d’or et de la concurrence libre et non faussée, sans s’entendre dire que “l’Union européenne a décidé que…” ; où l’a-t-elle décidé ? selon quel processus démocratique ? Il y a dans son fonctionnement un déni évident de démocratie, et donc de souveraineté.
LVSL – La logique du “Plan B” vous convient donc potentiellement ?
Si demain nous sommes gagnants aux élections françaises, il faut que nous puissions appliquer notre programme sans se laisser contraindre par l’Union européenne et ses dogmes néolibéraux. Cette exigence n’est pas négociable. Dans le même temps, nous mènerons la bataille pour ne pas être enfermé simplement dans le cadre de l’échelle nationale – c’est l’une de nos différences majeures avec l’extrême-droite –, mais pour modifier les rapports de force à l’échelle européenne, travailler à des convergences et à des coopérations pour mener des batailles plus grandes. Si nous remportons les élections françaises, notre responsabilité sera de faire ce que l’on a à faire dans le cadre national pour protéger notre économie, partager les richesses, assurer la transition énergétique, faire vivre des logiques d’égalité, développer la démocratie. Mais il ne faut cependant jamais perdre de vue que les défis auxquels nous sommes confrontés supposent nécessairement des alliances qui dépassent ce cadre.

LVSL – L’an prochain auront lieu les élections européennes. Nous aimerions revenir sur l’entretien que vous aviez donné à Politis, dans lequel vous disiez que la France Insoumise devait “s’élargir sans humilier”, en faisant référence au PCF et à Génération-s notamment. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Pensez-vous qu’un nouveau front, tel que l’a été le Front de Gauche, est à l’ordre du jour ?
Je n’ai pas proposé de se lancer dans un nouveau cartel des gauches, je voulais plus précisément parler du fait qu’un mouvement large doit être capable d’agréger des forces qui sont, forcément, en partie différentes du noyau de base. Pour agréger, il faut faire vivre du pluralisme. Il y a déjà du pluralisme au sein de la France Insoumise, où viennent des gens d’horizons très divers. Il faut maintenir la tension entre une cohérence d’ensemble et la capacité à agréger ce qui n’est pas immédiatement soi. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la séquence des européennes mais de la mobilisation sociale, avec la recherche d’un large front social et politique pour faire reculer le gouvernement. Cette séquence est décisive dans le bras de fer avec Macron. En ce qui concerne les élections européennes, il faut être ouvert au dialogue tout en prenant en compte les divergences.
Le PCF a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et a soutenu le programme l’Avenir en commun. Cela crée de réelles proximités de fond, que j’observe à l’Assemblée avec le groupe GDR dont les positions sont souvent les mêmes que celles du groupe LFI. Mais des divergences stratégiques se sont exprimées avec la France Insoumise, et des concurrences, des rancœurs de part et d’autre ont laissé des traces. Quelle est la stratégie du PCF pour l’avenir ? Sans doute y verrons-nous plus clair après son Congrès.
Benoît Hamon est, quant à lui, tout récemment sorti du PS et sans doute faut-il encore un peu de temps pour connaitre plus précisément les enseignements qu’il tire de la gauche au gouvernement. Son bilan critique amène-t-il au fond simplement à renouer avec le programme de Hollande en 2012 ou celui de la gauche plurielle, ou est-il plus profond sur la nature de la rupture nécessaire pour ne pas retomber dans les mêmes impasses que celles de Jospin ou Hollande ? Par ailleurs, avec Génération.s, il y a une divergence sur l’appréciation de ce que nous pourrions faire dans le cadre des traités européens. Ce qui s’est passé en Grèce nous a tous profondément percutés, et il faut le digérer. A ce stade, je constate que nous n’en tirons pas les mêmes conclusions.
Sur la question du “front” à construire, je pense qu’on se renforce en s’agrégeant à la condition, évidemment, de garder une cohérence d’ensemble. Sans quoi cela devient une auberge espagnole qui n’a plus grand sens. Mais ma conviction est que, si l’on veut être majoritaire demain, il va falloir créer davantage de passerelles que de murs.
Propos recueillis par Lenny Benbara pour LVSL
Crédit photo Une et entretien : Ulysse GUTTMANN-FAURE pour LVSL