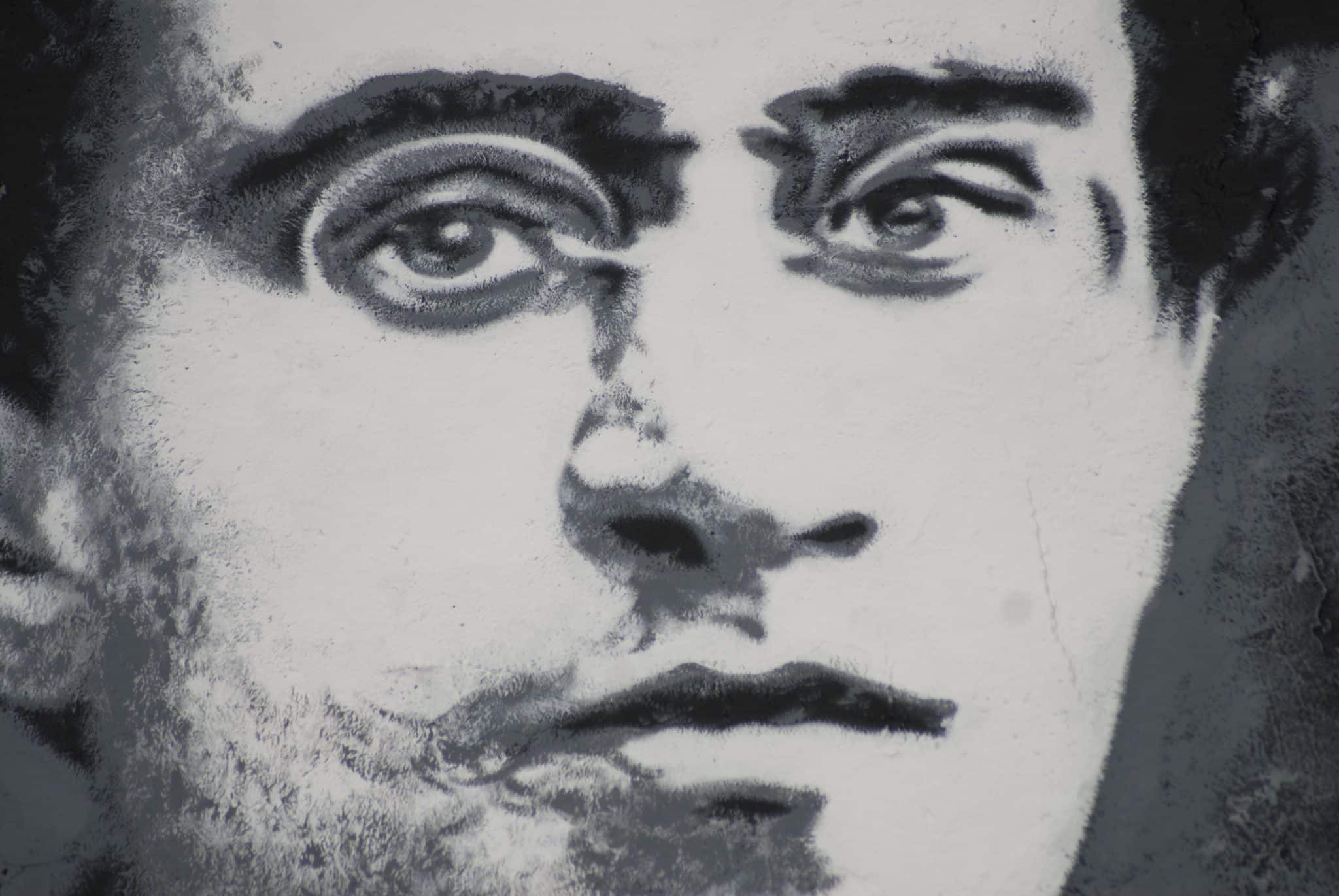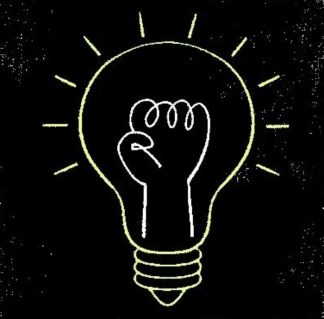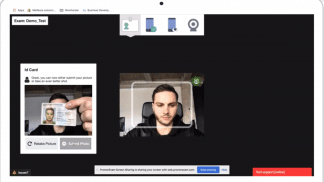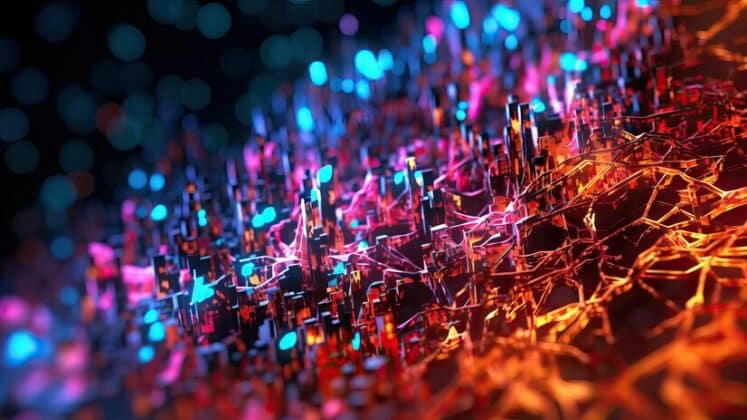Marx a largement influencé de nombreux grands intellectuels français ; cette importance ne se dément pas aujourd’hui. Cet héritage est pluriel, il l’est même nécessairement si l’on tire pleinement les conséquences de ce constat : toute pensée originale est multiple. Mais une pensée originale comme celle de Marx ne saurait pas donner naissance qu’à des processus créateurs, comme en témoignent les tendances institutionnelles à l’image de celles de l’Université entraînant souvent routinisation et momification d’une œuvre vivante.
Influence de Marx sur les grandes figures intellectuelles françaises
L’œuvre de Marx a influencé la plupart des grands intellectuels français du siècle passé. Les « marxistes » tout d’abord, penseurs rangés dans cette catégorie pour des raisons diverses : identité parfois revendiquée, parfois imposée par d’autres dans des luttes de concurrence pour des positions de prestige et d’hégémonie d’école. Ainsi, depuis le début du XXe siècle, et sans que le fil soit jamais entièrement rompu, des intellectuels « marxistes » connus et reconnus se succèdent : Simone Weil, Georges Politzer et Henri Lefebvre, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Lucien Goldmann, Louis Althusser et Nicos Poulantzas, Guy Debord, Cornelius Castoriadis, Alain Badiou, Étienne Balibar et Jacques Rancière.
Certains ont été élèves des autres, comme Badiou, Balibar et Rancière, normaliens formés par Althusser dans les murs de la rue d’Ulm ; puis, cherchant à tuer le père, à dépasser le maître, pour des raisons à la fois politiques – avec l’effet de mode maoïste autour de Mai 68 – et théoriques – pour s’émanciper d’Althusser qui les avait d’abord libérés de la philosophie universitaire sclérosée et du carcan du marxisme stalinisé du Parti communiste français (PCF) – et pouvoir ainsi continuer à s’élever en tant que philosophes libres.
Certains ont abandonné l’identité « marxiste », s’affranchissant encore davantage de toute affiliation théorique stricte, comme Castoriadis qui construit une pensée de l’imaginaire marquée par sa lecture de Freud et des philosophes antiques, ou Rancière et Balibar qui ont depuis longtemps construit leur univers original et exercé une force d’attraction propre. On peut souligner que Balibar et Rancière ont mis des années à s’extirper de l’étiquette « marxiste » en s’étant fait connaître d’abord comme contributeurs à l’ouvrage collectif dirigé par Althusser Lire Le Capital 1.
Marx a également influencé des intellectuels français non « marxistes » bénéficiant d’une immense notoriété de leur vivant, tels André Gide, Raymond Aron, Albert Camus, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, ou encore Pierre Bourdieu. Tous reconnaissant leur dette à l’égard de la pensée de Marx.
Au début des années 2010, alors que Marx et les « marxistes » constituent des références clivantes, voire prohibées, « la maison Thomson Reuters […] a passé au crible les livres de sciences humaines – essentiellement en langue anglaise – les plus cités dans le monde ». Les trois auteurs arrivant en tête du classement sont, dans l’ordre, Foucault, Bourdieu et Derrida 2. Les idées marxiennes 3 infusent donc encore à une très large échelle, même si de façon moins directe et visible qu’auparavant.
On doit noter que Marx a aussi eu une influence certaine sur des intellectuels contemporains non français importants, tels les théoriciens du populisme Ernesto Laclau et Chantal Mouffe qui constituent des références politiques et théoriques pour Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise (LFI)4. Laclau et Mouffe refaçonnent le concept d’hégémonie d’Antonio Gramsci et tentent de l’articuler avec celui de « signifiant vide », inspiré par l’œuvre de Lacan, pour proposer une stratégie d’union politique transclassiste reposant sur le concept volontairement non délimité objectivement et chargé en affects de « peuple ». Si Laclau et Mouffe font partie des rares personnalités théoriques ayant exercé une influence sur des organisations politiques de gauche, on doit préciser que l’héritage des penseurs français étudiés, passionnant d’un point de vue intellectuel, a eu un impact bien limité sur les mouvements d’émancipation – innocuité notée avec soulagement par la CIA à l’époque pour « les successeurs de Sartre 5 ».
Aujourd’hui encore, les intellectuels dominants dans l’espace des sciences humaines et sociales critiques – des nouvelles figures telles que Frédéric Lordon, ou Pierre Dardot et Christian Laval, exerçant désormais une influence comparable sur la vie intellectuelle française à celle de philosophes de la génération précédente comme Étienne Balibar, Jacques Rancière et Alain Badiou – se placent dans un héritage critique vis-à-vis de Marx pour proposer des interprétations théoriques originales de notre histoire contemporaine, marquée par le néolibéralisme. Outre l’importance de Marx dans leur développement intellectuel, tous ces penseurs ont un autre point commun : celui de confronter des traditions théoriques diverses, de jouir de multiples influences, souvent contradictoires.
Au-delà de cet amoncellement de noms, si l’on reprend uniquement les intellectuels critiques dominants de ces dernières décennies en France, on se retrouve avec une lignée Sartre-Foucault-Bourdieu-Lordon 6 qui se revendique toute entière de la pensée de Marx, confrontée principalement à Husserl pour Sartre, Nietzsche pour Foucault, Weber et Durkheim pour Bourdieu et Spinoza pour Lordon.
Mais dans la bataille des idées, les penseurs critiques sont largement dominés dans l’influence de masse en France par les « demi-savants », « demi-habiles » et « intellectuels-journalistes » 7, des « nouveaux philosophes », ou du moins ce qu’il en reste à travers les figures de Bernard-Henri Lévy, d’André Glucksmann, ou encore d’Alain Finkielkraut et de Michel Onfray, qui ont tous rejeté Marx en bloc et ne cessent de le fustiger lors de leurs passages télévisés et dans leurs pamphlets déguisés en études.
Cependant, il existe différents niveaux d’influence. Si la diffusion quantitative demeure une dimension primordiale, il ne faut pas pour autant négliger l’importance de l’influence qualitative. En effet, si un Onfray vend beaucoup plus d’exemplaires qu’un Lordon aujourd’hui en France, on peut penser que les lecteurs de Lordon feront une analyse plus poussée de ses écrits, qui auront ainsi une influence plus profonde sur leurs réflexions et que leurs positions sociales – militants politiques, associatifs, universitaires, etc. – leur assureront via une diffusion secondaire un destin plus complexe et pénétrant.
Généalogie des penseurs classiques : l’éclectisme rigoureux comme condition nécessaire à l’originalité théorique
« Dire que l’on peut penser à la fois avec et contre un penseur, c’est contredire radicalement la logique classificatoire dans laquelle on a coutume – presque partout, hélas, mais surtout en France – de penser le rapport aux pensées du passé. Pour Marx, comme disait Althusser, ou contre Marx. Je pense qu’on peut penser avec Marx contre Marx ou avec Durkheim contre Durkheim, et aussi, bien sûr, avec Marx et Durkheim contre Weber, et réciproquement. C’est comme ça que va la science. Par conséquent, être marxiste ou ne pas l’être est une alternative religieuse et pas du tout scientifique. […] La phrase de Sartre selon laquelle le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps n’est sans doute pas la plus intelligente d’un homme au demeurant très intelligent. Il y a peut-être des philosophies indépassables, mais il n’y a pas de science indépassable. Par définition, la science est faite pour être dépassée. Et Marx a assez revendiqué le titre de savant pour que le seul hommage à lui rendre soit de se servir de ce qu’il a fait et de ce que d’autres ont fait avec ce qu’il avait fait pour dépasser ce qu’il a cru faire. 8»
Si ces propos tenus par Pierre Bourdieu en 1983 apparaissent pertinents dans leur globalité, il nous semble qu’ils tombent dans l’excès quand ils font de l’identité marxiste une « alternative religieuse et pas du tout scientifique ». On perçoit aisément l’absurdité d’une définition classificatoire du « marxisme », permettant de tracer des frontières fixes selon une liste de critères à remplir, mais Marx a mis en place une méthode de recherche dialectique spécifique et a laissé un édifice conceptuel monumental qui justifie pleinement la possibilité scientifique de se revendiquer de son héritage et de sa tradition théorique : le marxisme.
Les chercheurs en sciences humaines et sociales se doivent d’être à la fois ambitieux et modestes. Sans ordre chronologique préétabli, ils ont à réaliser un aller-retour permanent entre formation théorique et travail empirique. Le moment théorique nécessite l’étude des grands auteurs de l’histoire des idées, la plupart philosophes pour des raisons disciplinaires historiques 9. Il permet de s’approprier des concepts, boîtes à outils qui servent à tester des hypothèses sur son terrain.
La modestie et la patience de l’étude théorique sont des conditions indispensables de possibilité de la réalisation concrète et rigoureuse empiriquement de toute ambition théorique. Des penseurs nous ont précédés, nous offrant des édifices conceptuels monumentaux. Quelle présomption de ne pas tenter de se hisser sur les épaules de ces colosses avant de proposer ses propres analyses. Ils se condamnent à tirer à blanc au lieu de s’armer de scalpels.
Actuellement, la répartition des tâches universitaires apparaît claire en sciences humaines et sociales : aux philosophes le quasi-monopole de la théorie et aux autres le labeur d’accumuler et trier les données les plus significatives du réel, respectant ainsi l’arbitraire de cette division du travail. Les philosophes formés à des pensées souvent spéculatives et hypothético-déductives n’utilisent que faiblement les précieuses ressources empiriques ordonnées par leurs collègues non-philosophes, préférant disserter à l’infini sur des questions métaphysiques – même si elles ne prennent plus que rarement une apparence religieuse – tandis que leurs collègues sont cantonnés à des études de terrain souvent dépourvues d’une forte dimension théorique 10. Il serait temps de rejeter enfin ces tendances institutionnelles, néfastes à la création théorique concrète et au développement de pulsions au service d’une quête de connaissance probe et donc fatalement ambitieuse.
À l’aide de Marx et de Nietzsche, commençons par tenter de proposer une distinction claire entre théorie et philosophie, trop souvent confondues. La théorie consiste à interpréter la totalité dialectique, constituée d’infinis éléments réels liés entre eux de façon contradictoire. Cette contradiction est une conflictualité possible constante dans le devenir, les différents éléments bénéficiant d’une autonomie relative. À proprement parler, tout écrit est théorique puisque la formalisation écrite repose sur l’utilisation du langage, création humaine entièrement conceptuelle et interprétative. Cependant, les auteurs peuvent se différencier dans leur distanciation du sens commun et leur maîtrise d’un vocabulaire propre et ainsi réaliser un effort théorique supplémentaire. Toute théorie contrôlée comporte une dimension épistémologique d’où découle l’usage d’une certaine méthodologie. La philosophie serait d’une part cet exercice épistémologique spécifique, d’autre part l’acte propositionnel affirmateur civilisationnel, politique, esthétique et moral.
On rejoint l’hypothèse de l’historien de la philosophie Léo Strauss, selon laquelle il existerait un patrimoine théorique de l’humanité se transmettant d’une époque à une autre et notamment d’un grand théoricien à un autre. On se positionne ainsi contre ce qui nous apparaît constituer un relativisme excessif, en vogue chez certains adeptes d’une « histoire sociale des idées » où la tâche principale résiderait dans une reconstitution du contexte historique de production théorique des différents auteurs. « Le jeune Marx n’était-il pas convaincu que les philosophes avaient ceci de commun avec les champignons qu’ils étaient les fruits de leur temps ? Cent ans de multitude après, demeure cette ultime leçon. 11 » Ces propos tenus par Georges Labica gardent toute leur pertinence. L’histoire sociale des idées est intéressante pour comprendre l’influence des idées comme force historique, notamment politique. Mais si les philosophes, et plus généralement les hommes, appartiennent toujours à leur époque, il n’en est pas moins possible d’atteindre un degré élevé de vérité dans son interprétation du réel, par une rigueur épistémologique nécessitant une réflexivité constante du chercheur sur ses préjugés et sur les prénotions du vocabulaire employé.
La grandeur de ces bâtisseurs théoriques est rendue possible par le fait d’avoir su confronter différents courants intellectuels pour proposer une interprétation cohérente de multiples dimensions du réel. Mais de nombreux philosophes ont succombé au fétichisme de la Vérité et ont présumé l’existence d’un ordre causal au vivant. Ainsi, Nietzsche montre comment les doctrines de Platon, Descartes, Spinoza ou Kant comportent des axiomes absolument indémontrables, métaphysiques, sur lesquels reposent tous leurs édifices conceptuels. Refusez tel ou tel préjugé idéaliste et l’ensemble menace de s’écrouler. Pour Nietzsche, une bonne théorie se rapproche de la vérité chaotique du monde, humain et non humain ; elle est une quête d’un certain niveau générique. Elle nécessite une logique dialectique non hypothético-déductive et une éthique sans faille de l’explorateur qui ne doit se permettre aucune concession vis-à-vis de son être propre en matière de recherche, afin de s’élever au-dessus de soi vers une certaine forme d’objectivité. Un bon travail théorique doit ainsi permettre d’entretenir un rapport intense de puissance au monde et un non-dogmatisme profond, curiosité continue face à la magie du réel.
Dans cette généalogie théorique en sciences humaines et sociales – épistémologique et psycho-sociologique – Freud fait figure d’exception. En effet, il existe un fil rouge reliant les grands penseurs entre eux. Aristote a influencé Descartes, qui a influencé Spinoza, qui a influencé Hegel, qui a influencé Marx, qui a influencé Weber, qui a influencé Gramsci, etc. Mais, même s’il est connu que Freud a suivi des cours d’initiation à la pensée d’Aristote, il a construit l’édifice de la psychanalyse à partir de l’utilisation d’une méthode d’investigation psychologique originale et non axiomatique, sur un matériau d’une valeur inestimable : les discours non censurés de ses patients. Admettons alors qu’il s’agit de l’exception qui confirme la règle.
La pensée même de Marx a par exemple diverses sources, dont la plus célèbre exposition réside sans doute dans un exposé de Lénine : « La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu’elle est juste. Elle est harmonieuse et complète ; elle donne aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec toute superstition, avec toute réaction, avec toute défense de l’oppression bourgeoise. Elle est le successeur légitime de tout ce que l’humanité a créé de meilleur au XIXe siècle : la philosophie allemande, l’économie politique anglaise et le socialisme français12. »
Sans aller jusqu’à considérer à la suite de Lénine la doctrine de Marx comme « toute-puissante », il apparaît difficilement contestable que les travaux de Marx constituent une synthèse originale hautement créative, démontrant ainsi en acte la puissance de la confrontation dynamique menée avec exigence. Sur le contingent d’intellectuels français influencés par Marx cité précédemment, Politzer a confronté la méthode dialectique marxienne à la psychanalyse, Lefebvre a confronté la pensée de Marx à celles de Hegel et Nietzsche, Lucien Goldmann a construit sa méthode du « structuralisme génétique » à l’aide de Marx, Georg Lukács et Jean Piaget 13, Raymond Aron a proposé ses analyses de la société industrielle en s’appuyant conjointement sur Marx et Tocqueville, etc. Cette dimension dynamique de la confrontation se retrouve également chez Gide, Camus, de Beauvoir ou Sartre qui, à partir de diverses sources d’inspiration théoriques, exaltent leur soif de savoir en sublimant leurs pulsions en création artistique.
L’influence unique de l’œuvre d’un auteur, Marx ou un autre, peut aboutir à des propositions originales d’interprétation du réel, toujours mouvant ; car, même sans apports conceptuels, l’extension d’une méthode et de notions à de nouveaux objets est susceptible de présenter un véritable intérêt. Le plus grand legs de Marx ne serait-il pas alors sa méthode dialectique, débarrassée de ses excès économiciste, mécanistes et positivistes ?
Tendances institutionnelles : exégèse et fétichisme
Le cas de Georges Politzer apparaît intéressant afin d’illustrer les tendances dogmatiques et fétichistes pouvant provenir d’un parti politique (ici, le PCF) : « L’œuvre de Georges Politzer porte témoignage de ce rendez-vous manqué. Il suffit de comparer sa Critique des fondements de la psychologie de 1928 à ses articles des années Trente sur Diderot et Descartes, ou à ses Principes élémentaires de philosophie, pour mesurer l’étendue du désastre. De pionnier du marxisme vivant, parti à la rencontre constructive de la psychanalyse, il se transforme peu à peu en un artisan du « front populaire » en philosophie. Face à la montée inquiétante de l’irrationalisme, il s’emploie alors à creuser les tranchées statiques et dérisoires des Lumières et de la raison cartésienne 14. »
Cette « transformation » délétère dont parle Daniel Bensaïd ne peut se comprendre en-dehors de l’appartenance de Politzer au Parti communiste français (PCF), dont les cadres se font, durant les années 1930, les promoteurs de la version rigidifiée du marxisme par Staline : une dialectique matérialiste mécaniste érigée en philosophie officielle. Si le totalitarisme stalinien n’est pas une conséquence nécessaire de la théorie et de la pratique de Lénine, cette déification de Marx par Staline et le Komintern se retrouve néanmoins au niveau idéel dans la formule écrite par Lénine en 1913 : « La doctrine de Marx est toute-puissante, parce qu’elle est juste 15. »
Loin du fétichisme potentiel porté par les partis politiques, la tendance institutionnelle universitaire serait celle de l’exégèse. Il est d’autant plus important de saisir les logiques académiques que les nouveaux intellectuels critiques sont pour la quasi-totalité des universitaires n’exerçant pas de fonction politique majeure, contrairement aux « marxistes classiques », tels Marx, Engels, Lénine, Trotski, Rosa Luxemburg, ou Gramsci, qui cumulaient les rôles de dirigeants politiques et de théoriciens 16. Ces nouveaux intellectuels critiques sont donc bien davantage soumis aux tendances universitaires qu’à celles partisanes.
En 2015, Marx était au programme de l’agrégation de philosophie, en compagnie de Platon, pour l’épreuve écrite d’ « histoire de la philosophie » où deux œuvres sont étudiées toute une année par les agrégatifs. Marx serait-il donc devenu un auteur canonique ? Un « classique » ? Il nous a semblé qu’un des indicateurs les plus pertinents pour analyser l’importance universitaire d’un penseur était le doctorat 17: les choix de sujet de thèse, de discipline, d’Université et de directeur ayant des conséquences déterminantes sur le parcours ultérieur.
On peut noter que la philosophie est la discipline où Marx est le plus étudié au niveau du doctorat en France, loin devant les sciences économiques 18. Il existe peu de sujets sur la pensée politique de Marx, et très peu sur sa pensée psychologique. Cependant, le constat le plus important est que la quasi-totalité des thèses soutenues sur Marx en France se trouve étrangère à toute ambition confrontationnelle 19. Soit, de nombreuses thèses comportent une multiplicité d’auteurs dans leur intitulé. Mais ces thèses en question n’en constituent pas pour autant – tout du moins au prisme de la prise de connaissance limitée des sujets résumés – des tentatives de confrontation dynamique et contradictoire, voire conflictuelle, cherchant à articuler plusieurs théories dans un processus de dépassement créateur, d’amélioration interprétative du réel. La plupart de ces thèses semble rester à un niveau d’études assez académiques, dans un travail d’exégèse qui sera au mieux une retranscription rigoureuse et intelligente de telle ou telle dimension de la foisonnante théorie marxienne 20.
Pour contrer ces tendances à l’exégèse, il semblerait possible de lancer des chantiers de réflexion sur les pratiques scientifiques et leurs conséquences sur la valeur de la production théorique, posant tout particulièrement la question de la transdisciplinarité des laboratoires de recherche et de l’hétérogénéité théorique de leurs membres ; ce qui est souvent le cas en philosophie mais bien moins en sociologie ou en science politique par exemple, où des Écoles peuvent régner sans partage sur des îlots de pouvoir.
Loin de cette technicisation sur-spécialisée et statique, Lucien Sève illustre parfaitement le gai savoir nietzschéen, remède à l’académisme monotone. Élu au Comité central du PCF de 1961 à 1994 et directeur des Éditions sociales de 1970 à 1982 auxquelles il confère de nouveau diversité et liberté éditoriales. Chercheur infatigable et prolifique ayant évolué en-dehors de l’Université française, non par choix mais par ostracisme politique, Lucien Sève a publié de nombreuses études dynamiques où il confronte la pensée psychologique de Marx avec celles de Nietzsche, Vygotski ou Freud, pour proposer une théorie originale de la personnalité marxiste 21. Lucien Sève est une incarnation du caractère potentiellement créatif d’un chercheur appartenant à un parti politique, confirmant et infirmant simultanément les positions de Bourdieu.
Ce dernier considère en effet jusqu’à la fin des années 1980 que l’autonomie du champ scientifique exige un non-engagement politique des chercheurs, impropre à un travail « axiologiquement neutre », en reprenant la terminologie wébérienne. Cette posture s’explique sans doute largement par le regard critique porté par Bourdieu sur de nombreux intellectuels affiliés au Parti communiste français (PCF) qui, dans leur double appartenance universitaire et partisane, font souvent primer les exigences de la seconde sur la première. Mais Bourdieu revient ensuite radicalement sur ses préconisations antérieures : « En fait, on peut dire, en simplifiant un peu, que les sciences sociales ont payé leur accès (d’ailleurs toujours contesté) au statut de sciences d’un formidable renoncement : par une auto-censure qui constitue une véritable auto-mutilation, les sociologues – et moi le premier, qui ai souvent dénoncé la tentation du prophétisme et de la philosophie sociale – s’imposent de refuser, comme des manquements à la morale scientifique propres à discréditer leur auteur, toutes les tentatives pour proposer une représentation idéale et globale du monde social. 22 »
Ici, Bourdieu parle de cette perte comme d’un sacrifice regrettable en termes personnels autant que professionnels. Dès la fin des années 1980, il n’accepte plus cette « abdication scientiste, qui ruine la conviction politique », et objecte que « le moment est venu où les savants se doivent d’intervenir dans la politique, avec toute leur compétence, pour imposer des utopies fondées en vérité et en raison 23 ».
1 Louis Althusser, Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey et Jacques Rancière Lire le Capital, Paris, Maspero, coll. « Théorie », 2 volumes, 1965 ; réed. Maspero, coll. « Petite Collection Maspero », 4 volumes, 1968 ; réed. Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1 volume, 1996
2 « Ces philosophes que le monde nous envie », par Didier Raoult, publié le 15 janvier 2013 sur le site du Point.
3 A savoir les idées de Marx. L’adjectif « marxien » peut également être utilisé pour désigner ceux qui se réclament de la pensée de Marx, se distinguant des « marxistes » qui se revendiquent de Marx et de certains développements du matérialisme historique, très nombreux et divers, parfois même contradictoires (Lénine et Rosa Luxemburg sur de nombreux points, pour ne citer qu’un exemple). Maximilien Rubel, spécialiste de Marx en charge de la publication de ses œuvres pour la prestigieuse collection La Pléiade, a quant à lui proposé le terme de “marxologue” pour désigner tout chercheur travaillant à l’interprétation de la pensée de Marx.
4 Et de manière bien plus conséquente encore pour Íñigo Errejón et la formation de gauche radicale espagnole Podemos à laquelle il appartenait avant de lancer son propre parti en 2019, Más País (succédant à son mouvement Más Madrid).
5 Le document de la CIA date de 1985, voir : https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/03/23/quand-la-cia-s-interessait-de-pres-a-foucault-derrida-et-althusser_5099574_4832693.html
6 Si Sartre, Foucault puis Bourdieu sont largement reconnus comme ayant été objectivement dominants dans l’espace des pensées critiques en France, le choix qui est le nôtre de placer Frédéric Lordon dans leur continuité est nettement plus original, mais loin d’être arbitraire pour autant. Il est évident que le prestige de Lordon n’égale pas celui de ses prédécesseurs de leur vivant, en France comme dans le monde. Mais malgré l’affaiblissement de l’édition spécialisée en Sciences humaines et sociales (SHS) ces dernières décennies en France – phénomène illustré par la baisse des tirages et l’augmentation du nombre des titres, handicapant ainsi les intellectuels/chercheurs –, on trouve presque systématiquement plusieurs ouvrages de Lordon exposés sur les tables consacrées aux SHS dans les librairies indépendantes.
De plus, Lordon bénéficie de médiums auxquels n’avaient pas accès ses prédécesseurs, lui offrant une influence parfois considérable. La vidéo « L’Économiste (Frédéric Lordon) » du youtubeur à succès Usul postée le 30 octobre 2014 atteint plus de 800 000 vues (Usul, « Mes chers contemporains. L’Économiste (Frédéric Lordon) », 30 octobre 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=87sEeVj057Q&t=731s). Comme indicateur de la fonction que Lordon assume actuellement dans la vie intellectuelle française, on peut mentionner la place occupée par ses articles dans Le Monde diplomatique, mensuel français le plus diffusé dans le monde avec 2,4 millions d’exemplaires (voir https://www.monde-diplomatique.fr/diplo/apropos/) : affichage au sommet de la première page, comme ceux de Bourdieu avant lui.
7 On reprend ces expressions à Pierre Bourdieu qui les utilisait face à la médiocrité intellectuelle des « nouveaux philosophes » et la confusion croissante entre essayistes médiatiques et éditorialistes essayistes.
8 Pierre Bourdieu, « Repères », octobre 1983, dans Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1987, pp. 63-64.
9 La constitution d’une méthodologie propre à la sociologie ne remonte par exemple qu’au XIXe siècle avec des auteurs comme Comte, Tocqueville ou Marx. La discipline sociologique ne s’institutionnalise qu’au début du XXe siècle avec des personnalités structurantes comme Weber et Durkheim.
Voir Marc Joly, La Révolution sociologique, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Laboratoire des sciences sociales », 2017.
10 Même si un intellectuel comme Bourdieu est parvenu à proposer des modèles théoriques exigeants dans une matière autre que la philosophie. On peut néanmoins préciser que Bourdieu a suivi une formation en philosophie à l’ENS avant de se tourner vers la sociologie et le travail empirique.
11 Entretien avec Georges Labica dans Courrier de l’UNESCO, octobre 1983.
12 Lénine, « Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme », marxists.org (site gratuit proposant de nombreux textes marxistes) : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1913/03/19130300.htm
13 Georges Politzer, Critique des fondements de la psychologie, La psychologie et la psychanalyse, Paris, Les Éditions Rieder, 1928 ; rééd. Paris, PUF, 1967 ; rééd. Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2003 ;
Henri Lefebvre, Hegel, Marx, Nietzsche, ou le royaume des ombres, Paris, Tournai, Casterman, coll. « Synthèses contemporaines », 1975 ;
Lucien Goldmann, Sciences humaines et philosophie. Suivi de structuralisme génétique et création littéraire, Paris, Gonthier, 1966 ; reed., Paris, Delga, 2014.
14 Daniel Bensaïd, « Visages et mirages du marxisme français », publié sur le site de Daniel Bensaïd.http://danielbensaid.org/Visages-et-mirages-du-marxisme-francais
On peut préciser que les Principes élémentaires de philosophie sont la retranscription de cours donnés par Politzer à l’Université Ouvrière du PCF durant l’année 1935-1936, et qu’il est par conséquent un peu facile de les comparer à d’autres œuvres du philosophe pour Daniel Bensaïd, dirigeant trotskiste en désaccord politique avec Politzer et la stratégie de Front populaire à laquelle adhérait alors ce dernier.
15 Lénine, « Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme », marxists.org: https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1913/03/19130300.htm
16 Perry Anderson, Sur le marxisme occidental, Paris, Maspero, 1977
Voir également Razmig Keucheyan, Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, Éditions La Découverte, coll. « Zones », 2010
17 Pour cette section, nous avons eu recours à la plateforme thèses.fr afin d’établir des tendances des doctorats sur Marx. Cette plateforme recense toutes les thèses soutenues en France depuis 1985, mais de nombreuses thèses en cours ne sont pas visibles. Nous avons réalisé un tableau regroupant l’ensemble des thèses avec « Marx » dans l’intitulé (et de façon marginale « Marx » dans le résumé de thèse). On a recensé 98 thèses : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K8sAfd5IcXXx7KaNGjCL6G6YPPOsCqb7OgX0Vo_nft0/edit#gid=0
Il ressort de cette recension plusieurs enseignements. L’Université Paris 10 Nanterre a été le lieu du plus grand nombre de thèses sur Marx depuis 1985, l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis arrivant largement en deuxième position. Plusieurs universitaires ont dirigé trois thèses ou plus sur Marx à partir de 1985 : Georges Labica (4), Jean-Marie Vincent (5), Stéphane Haber (5), Frank Fischbach (5), Jean-François Kervégan (3) et Guillaume Sibertin-Blanc (3). On noter que deux de ces enseignants-chercheurs (Labica et Haber) ont dirigé tous leurs doctorants à Paris 10.
18 65 contre 18. Quant à la répartition des dates de soutenance, elle souligne une assez grande continuité sur la période, malgré un nombre nettement plus important dans la seconde moitié des années 1980. On peut émettre l’hypothèse que ces variations, tournant autour de la chute de l’URSS et du début de l’hégémonie néolibérale, sont liées aux changements géopolitiques et aux effets de (dé)légitimation théorique qui leur sont liés.
19 thèses ont été soutenues de 1985 à 1990, 22 durant les années 1990, 17 pour les années 2000 et 26 dans les années 2010, tandis que 14 thèses au moins sur Marx sont en cours de rédaction. On peut penser que ce nombre est nettement plus élevé, du fait de l’absence de nombreuses thèses en préparation sur la plateforme. Par exemple, aucune thèse en cours sur Marx n’est recensée à Nanterre, ce qui apparaît surprenant et pourrait relever d’un défaut de communication de l’Université.
19 À notre avis, 2 thèses au moins font figure d’exception : « De la société à l’histoire » soutenue en 1986 par Tony Andréani sous la direction de Georges Labica, en philosophie à Paris 10 et « De la thématique du conflit à l’exploration de l’entre Hegel et Marx » soutenue en 1993 par Solange Mercier-Josa sous la direction de Georges Labica, en philosophie à Paris 10 (surlignées en bleu).
Il n’est sans doute pas un hasard que ces deux travaux aient été réalisés sous la direction du même directeur, Georges Labica, dont la femme Nadya Labica nous confiait en entretien : « Georges, il était marxiste et matérialiste mais il s’est toujours beaucoup référé à la philosophie classique et à la philosophie grecque, d’ailleurs il avait fait latin-grec. Et ces philosophes qui prétendaient faire de la philosophie sans étudier la philosophie classique, lui, il n’admettait pas ça. […] Spinoza était très important pour lui, son premier mémoire de maîtrise c’était le problème de l’erreur chez Descartes et Spinoza [en 1952, Georges avait alors 22 ans]. »
Entretien avec Nadya Labica, réalisé le 28 février 2017 en compagnie d’Antoine Aubert, politiste dont le doctorat portait sur les marxistes française des années 1968 aux années 1990.
20 On peut esquisser quelques pistes permettant d’interpréter ce phénomène. Les doctorants qui s’intéressent à l’œuvre de Marx sont pris, tous comme les autres, dans des logiques institutionnelles où la spéculation sur son parcours professionnel après sa soutenance de thèse a toute son importance. Ces logiques sont souvent incorporées de façon infra-consciente par les acteurs et ne relèvent pas de choix « rationnels », les doctorants se conformant ainsi spontanément aux pratiques scientifiques en vigueur. L’expérience de thèse, puissante dans ses effets logiques et affectifs de long terme, forme de futurs « experts », critère central dans l’employabilité universitaire. Les chercheurs qui ont travaillé en doctorat sur Marx, par rapport à un travail équivalent sur Descartes ou Kant, auront sans doute plus de difficulté à décrocher par la suite un poste de maître de conférences puis de professeur, pour des raisons de légitimité à la fois théoriques et politiques. En cela, Marx n’est toujours pas un auteur canonique.
21 Voir notamment Lucien Sève, Marxisme et théorie de la personnalité, Paris, Éditions Sociales, 1969 (5e édition 1981) ; Lucien Sève, Penser avec Marx aujourd’hui. II. L’homme?, Paris, Éditions La Dispute, 2008.
Sur la trajectoire intellectuelle et militante de Lucien Sève, voir l’entretien « Marx, toute une vie », de Alain Badiou, Étienne Balibar, Jacques Bidet, Michael Löwy, Lucien Sève, entretiens sous la direction d’Alexis Cukier et Isabelle Garo, Avec Marx, philosophie et politique, Paris, La Dispute, 2019, pp. 139-169
Voir également le documentaire de Marcel Rodriguez sorti en décembre 2018 « Les trois vies de Lucien Sève, philosophe» (https://gabrielperi.fr/librairie/dvd/les-trois-vies-de-lucien-seve-philosophe/) et sa notice accessible en ligne sur le site du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Le Maitron (https://maitron.fr/spip.php?article173192).
Sur les activités éditoriales de Sève, on renvoie à « Un éditeur communiste ‘‘heureux’’. Entretien de Jean-Numa Ducange avec Lucien Sève », dans Jean-Numa Ducange, Julien Hage, et Jean-Yves Mollier (dir.), Le Parti communiste français et le livre, Écrire et diffuser le politique en France au XXe siècle (1920-1992), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2014, pp. 107-137. Lucien Sève est décédé le 23 mars 2020 du Covid-19, laissant derrière lui une œuvre théorique importante et le souvenir d’un engagement enflammé.
22 Pierre Bourdieu, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2000, pp. 104-105.
23 Ibidem.