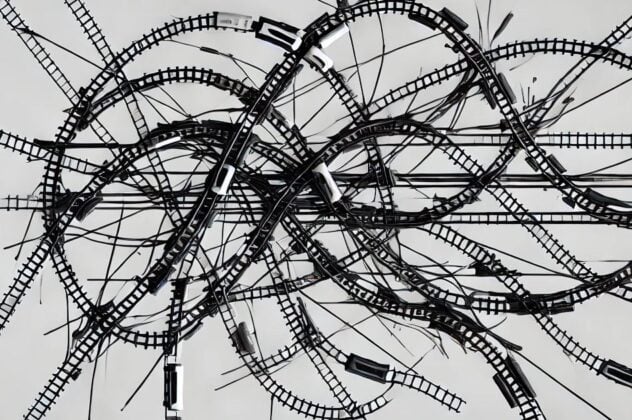Après des élections générales ayant largement renouvelé le paysage politique belge, les négociations de gouvernement et les recompositions ont débuté. Contrairement aux scrutins précédents, le pays paraît moins divisé entre Flandre et Wallonie : si le Nord du pays penche toujours clairement à droite, l’extrême-droite indépendantiste n’a pas réussi à gagner les élections et la gauche radicale y progresse fortement. Au Sud, bastion historique de la gauche, la tendance est inverse : les libéraux conservateurs du MR remportent une grande victoire, tandis que le PS est sanctionné. Par-delà les divisions partisanes, le fait que la droite reprenne une partie de la rhétorique de gauche et que le Parti du Travail de Belgique (PTB) ait imposé son agenda à toute sa famille politique est révélateur d’une tendance de fond : la défense des travailleurs gagne à nouveau du terrain et peut s’imposer, dans les années qui viennent, comme un projet majoritaire.
Le 9 juin dernier, tandis que tous les citoyens des pays de l’Union européenne élisaient leurs représentants au sein du Parlement européen, les Belges ont également eu à choisir leurs représentants dans les Parlements régionaux et communautaires (flamand, francophone et germanophone) et au niveau fédéral. Cette séquence politique particulièrement intense, qui sera suivie d’élections communales le 13 octobre prochain, a ainsi redéfini les rapports de force en Belgique pour les cinq prochaines années.
La perspective d’un nouveau « dimanche noir » qui planait lourdement sur le pays, avec la victoire annoncée du parti d’extrême-droite séparatiste Vlaams Belang (« Intérêt flamand », ndlr) au Nord du Pays, n’est finalement que partiellement réalisée. Malgré un score en légère augmentation (+4% au Parlement flamand et +1,8% au Parlement fédéral), le Vlaams Belang n’a pas réussi à dépasser la N-VA (Nieuwe Vlaams Alliance, droite nationaliste flamande, ndlr) et à devenir le premier parti de Flandre.
Au sud du pays, en Wallonie et dans la région de Bruxelles-Capitale, la droite libérale a triomphé. Pour la première fois de son histoire, le Mouvement Réformateur (MR) devient la première force politique francophone et s’arroge ainsi un rôle incontournable dans les négociations de coalition à venir. Très rapidement après les élections, il a décidé de s’allier avec le parti de centre-droit Les engagés, qui a réalisé des scores inespérés, et, moyennant davantage de concessions, cet attelage devrait pouvoir construire une alliance avec la droite nationaliste flamande au niveau fédéral.
Le souhait d’une politique plus radicale de la part des électeurs de gauche a entraîné de nouveaux équilibres au sein de ce camp politique.
Enfin, le souhait d’une politique plus radicale de la part des électeurs de gauche a entraîné de nouveaux équilibres au sein de ce camp politique. Le Parti socialiste, traditionnellement dominant, concède ainsi « une érosion » de son score en Wallonie, tandis que les Écolos subissent une lourde défaite. Ces contre-performances sont compensées par la poussée du Parti du Travail de Belgique (PTB – PVDA, gauche radicale), devenu la quatrième force politique au niveau fédéral, notamment grâce à sa percée en Flandre.
En Flandre, la poussée de l’extrême-droite indépendantiste difficilement contenue
Si la victoire de l’extrême droite flamande tant annoncée par les différents sondages n’a donc finalement pas eu lieu, la N-VA est plus talonnée que jamais par le Vlaams Belang. Ensemble, la droite nationaliste et l’extrême-droite indépendantiste flamandes réunissent près de 45 % de l’électorat néerlandophone, soit 30 % de l’électorat belge. Le maintien en seconde position de la formation d’extrême-droite tient en bonne partie à la stratégie de la N-VA, qui a su contenir l’hémorragie de son électorat en démontrant l’ineptie du plan d’indépendance de la Flandre lors d’un débat entre Bart de Wever (leader de la N-VA, ndlr) et Tom Van Grieken (leader du Vlaams Belang, ndlr). À l’instar de Jordan Bardella, régulièrement mis en difficulté sur son programme, Van Grieken a démontré toute son incompétence sur le cœur de son projet politique. Contrairement à son concurrent, la N-VA ne porte plus un projet indépendantiste mais aspire à régionaliser davantage de compétences et faire progressivement de la Belgique un État confédéral. Bart de Wever s’est ainsi posé comme étant l’homme politique flamand le plus à même de mener la Flandre vers plus d’autonomie.
À l’instar de Jordan Bardella, régulièrement mis en difficulté sur son programme, Van Grieken a démontré toute son incompétence sur le cœur de son projet politique.
D’autre part, alors que la question d’un éventuel accord de gouvernement entre la N-VA et le Vlaams Belang a dominé toute la campagne, De Wever a probablement été influencé par la situation politique aux Pays-Bas. Dans ce pays voisin, les négociations de coalition ont en effet été très compliquées suite à la victoire de l’extrême-droite dominée par Geert Wilders. Pour éviter un scénario similaire, De Wever a longtemps laissé planer le doute quant à une éventuelle alliance de son parti avec le Vlaams Belang, avant d’exclure formellement cette possibilité à moins de trois semaines du scrutin.
Quoi qu’il en soit, depuis l’élection de 2019, le Vlaams Belang est parvenu à faire rompre le cordon sanitaire dont il était l’objet jusqu’alors, en particulier dans les médias. La multiplication de ses interventions médiatiques lui a donné l’occasion de mettre sur le devant de la scène son thème de prédilection : l’immigration. En Wallonie, ce cordon médiatique reste cependant strictement maintenu : jamais un représentant de l’extrême-droite flamande ne peut s’exprimer en direct sur une chaîne de la télévision francophone, même au soir des élections de 2024. Les discours xénophobes et racistes n’ont donc pas pu faire des émules en Wallonie et à Bruxelles, quand bien même un petit parti d’extrême-droite, Chez Nous, existe depuis 2021 dans ces deux régions.
Si les digues tiennent pour l’instant au Sud de la Belgique, le maintien du « cordon sanitaire » en Flandre est de plus en plus remis en question. À la suite de l’obtention en 1992 par le Vlaams Blok (prédécesseurs du Vlaams Belang, ndlr) de 10 sièges au parlement fédéral, les partis démocratiques flamands s’engagent alors à ne jamais former une coalition gouvernementale avec les partis d’extrême-droite. Cette exclusion est désormais questionnée, certains estimant qu’il serait salutaire pour la démocratie de confronter le Vlaams Belang à l’exercice du pouvoir afin de décrédibiliser la force d’attraction de son discours antisystème. Toutefois, le refus de Bart de Wever ne tient pas à sa volonté de sauver le cordon sanitaire, mais plutôt à des calculs politiques. Tous les partis francophones ayant fait savoir à Bart de Wever qu’une telle alliance au niveau du gouvernement flamand rendrait impossible toute négociation au niveau fédéral avec le N-VA. Son parti étant le grand gagnant des élections, Bart de Wever a maintenant de bonnes chances de devenir le futur premier ministre belge.
Cette victoire a un gout de revanche pour le leader nationaliste vis-à-vis du premier ministre sortant, Alexander de Croo. De Wever avait en effet pris comme une trahison le fait que le gouvernement fédéral sortant n’inclue pas son parti, pourtant première force politique de Flandre. Les rapports de force ont changé : sanctionné pour avoir formé un gouvernement avec les socialistes et les écologistes francophones et néerlandophones, De Croo a subi une sévère défaite. Son parti libéral néerlandophone, l’Open-VLD, est rétrogradé au rang de neuvième force politique du pays. C’est là tout le paradoxe de ces élections de 2024 : tandis que les libéraux flamands ont été balayés, le parti libéral francophone, le Mouvement réformateur (MR) devient pour la première fois depuis trente ans le premier parti à Bruxelles et en Wallonie et relègue le parti socialiste en deuxième position.
En Wallonie, victoire d’une droite de plus en plus conservatrice
La victoire du MR renforce considérablement au sein du parti de droite son président controversé George-Louis Bouchez. À sa prise de pouvoir, celui avait annoncé vouloir hisser sa formation politique à hauteur des 30 % en Wallonie ; c’est désormais chose faite. Mais comment expliquer cette progression de 9 % alors que le MR participait au gouvernement précédent, dont le leader a été rejeté dans les urnes ? Cette performance semble liée à la stratégie cynique de George-Louis Bouchez, qui n’a cessé de fustiger certaines décisions du gouvernement fédéral et de la fédération Wallonie Bruxelles alors même que son parti était dans la coalition dirigeante. Si ces prises de position ont exaspéré ses partenaires et ont entamé leur confiance pour l’avenir, elles ont réussi à faire passer le MR pour un parti d’opposition, d’où son score de 29,6 % en Wallonie et de 26 % à Bruxelles.
Cette victoire du parti libéral tient également à son repositionnement politique et à sa transformation interne délaissant la ligne du libéralisme social pour un conservatisme réactionnaire.
Cette victoire du parti libéral tient également à son repositionnement politique et à sa transformation interne délaissant la ligne du libéralisme social pour un conservatisme réactionnaire. Voyant ce changement s’opérer, le parti de centre droit Les Engagés a repris la doctrine de libéralisme social qu’incarnait longtemps le MR et engagé un processus de revitalisation « démocratique » en convaincant de nombreuses personnalités de la société civile à rejoindre ses rangs. Un pari gagnant pour les centristes qui réalisent une percée historique et se placent comme le second parti incontournable en Wallonie. Délaissant la veine social-libérale impulsée par Charles Michel, le Mouvement réformateur s’est attelé à droitiser sa ligne politique pour mieux capter cet électorat sensible aux discours d’une droite conservatrice et réactionnaire orphelin depuis la disparition du Parti populaire de Mischaël Modrikamen et des Libéraux Démocrates de Alain Destexhe (qui fait partie de l’équipe de campagne de Eric Zemmour, ndlr).
Sous la houlette de Georges-Louis Bouchez, les libéraux francophones ont ainsi donné un ton davantage conservateur à leur discours. Dans une étude récente, l’Antwerpen Universiteit et l’université catholique de Louvain ont montré à quel point le paysage politique belge s’était droitisé. Sur l’économie comme sur les questions questions sociales et culturelles, le MR s’est rapproché des positions de la droite flamande nationaliste. Un des exemples les plus manifestes de cette droitisation a été donné par le président sortant de la fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Lors d’un face à face télévisuel avec le député fédéral du PTB, Nabil Boukili, le libéral n’a pas hésité à inviter son interlocuteur à quitter la Belgique si celui-ci ne voulait pas respecter la neutralité de l’État et l’interdiction du port de signes religieux pour les fonctionnaires des administrations publiques, y compris en back office. Tous les partis démocratiques wallons ont demandé à Pierre-Yves Jeholet de présenter ses excuses, mais ces demandes sont restées lettre morte. Jeholet fut même ardemment soutenu par son parti et par son président.
Le pouvoir d’achat au centre de la campagne
Autre symptôme de cette évolution : le positionnement du MR sur le conflit israélo-palestinien. Le parti libéral s’est toujours refusé à critiquer l’action du gouvernement d’extrême-droite de Netanyahou et s’est évertué à justifier l’offensive militaire à Gaza. Il rejette également en bloc les accusations de génocide, qu’il assimile à du communautarisme. Le parti a néanmoins soutenu à demi-mot l’émission des mandats d’arrêts internationaux par la Cour Pénale Internationale (CPI) contre le Premier Ministre et le Ministre de la défense israéliens et les trois dirigeants du Hamas. Le MR a également réussi à jouer sur les deux tableaux concernant la reconnaissance de l’État de Palestine : si la ministre MR des Affaires Étrangères sortante Hadja Lahbib s’y est montré favorable, elle n’est pourtant pas passé à l’acte, comme l’ont fait l’Espagne, la Norvège et l’Irlande. Pour se justifier, celle-ci a invoqué son souhait de rassembler un large groupe de pays européens.
Le parti libéral a su également tirer profit de l’importance de la question de la sécurité en région bruxelloise. La Belgique étant devenue l’un des principales portes d’entrée des stupéfiants sur le sol européens via ses ports : plusieurs fusillades liées au trafic de drogue ont eu lieu dans les mois précédant les élections, y compris dans le centre-ville de Bruxelles. Le discours sécuritaire de la droite francophone selon lequel « la peur devait changer de camp » a donc trouvé rapidement de l’écho.
Sur l’un des enjeux phares de cette campagne électorale, le pouvoir d’achat, la droite n’a cessé d’opposer chômeurs et travailleurs. Le parti considère ainsi les personnes sans emploi comme agissant selon la logique simple du coût-bénéfice de l’économie classique, c’est-à-dire préférant les allocations chômage au salaire. Pour y répondre, le parti a donc mis en avant un changement de « mentalité » en plaidant pour une différence d’au moins 500 euros net entre le salaire minimal et le montant de l’allocation de chômage. Pour financer l’augmentation des bas salaires, le MR a suggéré de limiter les allocations de chômage dans le temps, la Belgique étant l’un des seuls pays européens où cette protection sociale existe sans limite dans le temps. Dans un sondage pré-électoral, près de 50 % des Belges étaient favorables à cette mesure, ce qui pourrait en partie expliquer le succès du MR.
La droite francophone a ainsi su habilement reprendre une rhétorique issue de la gauche alors qu’elle veut toujours s’attaquer aux droits des chômeurs.
Mais la question du chômage a également été utilisée par le MR pour attaquer frontalement le Parti Socialiste, qui dominait le paysage politique wallon depuis plusieurs décennies. Bouchez et ses alliés ont ainsi présenté les personnes sans emploi comme des victimes d’un système installé par le PS, notamment le FOREM (équivalent de Pôle emploi, ndlr), dépeint comme inefficace. En présentant les chômeurs comme incapable de s’accomplir en tant qu’individus de par la faute de l’administration, le MR a fait coup double. D’une part, il a pu séduire des électeurs attachés à la « valeur travail » mais rejetant la stigmatisation des chômeurs « assistés ». D’autre part, cela permet d’éviter d’aborder de nombreux sujets centraux comme le durcissement des conditions de travail et la violence d’un marché de l’emploi de plus en plus globalisé. La droite francophone a ainsi su habilement reprendre une rhétorique issue de la gauche alors qu’elle veut toujours s’attaquer aux droits des chômeurs.
Quand le Parti Socialiste adopte la stratégie de la droite nationaliste
Face à l’offensive de la droite conservatrice, la gauche est partie en rangs dispersés, malgré de nombreux points de convergence programmatique, notamment la taxation des riches. Si, à l’instar de la droite, l’ensemble de la gauche voulait également revaloriser les bas salaires, elle entendait le faire via une taxe des millionnaires. Il revient clairement au PTB d’avoir mis à l’agenda cette taxe et à forcer les autres partis progressistes de plancher sur l’élaboration de leurs propres mesures en la matière. Initialement, la proposition du PTB était d’instaurer une taxe de 2% sur tout patrimoine de plus d’un million d’euros. Finalement, à trois mois des élections, le PTB a fait passer le seuil à 5 millions d’euros et fixé un taux de 3 % pour les patrimoines de plus de 10 millions d’euros, afin de tenir compte des effets de l’inflation. L’objectif du parti a en effet toujours été de cibler les 1 % les plus riches et d’épargner les classes moyennes aisées.
Le Parti Socialiste, concurrencé sur sa gauche par le PTB, n’a cessé d’attaquer le parti marxiste sur le remaniement de cette mesure, dénoncé comme un manque de courage. À l’instar de la N-VA vis-à-vis du projet indépendantiste porté par le Vlaams Belang, le Parti Socialiste a cherché à décrédibiliser et à faire croire irréalisable le programme de rupture défendu par le PTB et ce malgré de nombreuses convergences. Symptomatique de l’attitude du PS vis-à-vis d’un potentiel partenaire gouvernemental, son président, Paul Magnette, n’a pas hésité lors d’un débat entre les présidents de parti francophones à qualifier de « couillon » (peureux, ndlr) le parti marxiste en raison des conditions préalables posées par le PTB pour toute participation à un gouvernement. Clairement, socialistes francophones et néerlandophones ont fait le choix de la désunion tout au long de la campagne.
Le président du PTB, Raoul Hedebouw, a au contraire multiplié les mains tendues en direction des socialistes et des écologistes tant francophones que néerlandophones, tout en posant des conditions claires pour entrer dans une coalition. Cette main tendue a été fermement rejetée par les autres partis de gauche durant la campagne électorale. Au soir des élections, le Parti Socialiste a pu constater avec amertume toute l’inefficacité de sa stratégie : il perd sa première place en Wallonie et devient la deuxième force politique francophone. Paul Magnette a pourtant refusé d’inculper sa stratégie de campagne, préférant invoquer la progression de l’extrême-droite en Europe, alors même que celle-ci n’existe pratiquement pas en Wallonie. Après cette défaite amère, le Parti Socialiste a choisi de siéger dans l’opposition à tous les niveaux de pouvoirs.
Au-delà du décret paysage, l’agenda politique de la gauche, voire du paysage politique francophone, a été largement dicté par les combats menés par le PTB tant au niveau parlementaire et aux côtés des syndicats, en particulier la FGTB.
Avec les écologistes, le Parti Socialiste a sans doute été sanctionné pour sa gestion calamiteuse de la réforme dite du « décret Paysage », qui encadre le financement de l’enseignement supérieur et son accès pour les étudiants. Initialement, cette réforme portée par la ministre libérale de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles a été votée par le PS et les écologistes, membres de la majorité au sein du gouvernement de la Fédération. Face à la pression du mouvement étudiant très opposé à cette réforme qui accroît les inégalités, le PS et le parti écolo ont finalement mis en cause cette réforme qu’il avait votée deux auparavant en en proposant une version amendée. Celle-ci a finalement été adoptée, grâce au renfort de voix du PTB. En s’associant à la proposition plus protectrice formulée par le PS et les Ecolos, le PTB a su se présenter comme un parti prenant ses responsabilités et non comme « un parti restant au balcon », comme aime à le répéter le Parti Socialiste.
Le PTB poursuit sa progression
Au-delà du décret paysage, l’agenda politique de la gauche, voire du paysage politique francophone, a été largement dicté par les combats menés par le PTB tant au niveau parlementaire et aux côtés des syndicats, en particulier la FGTB. La défaite des socialistes et des écologistes ne signe donc pas la défaite totale de la gauche. Comme le disait Sophie Merckx, présidente du groupe PTB au Parlement fédéral, le parti marxiste a sauvé l’honneur de la gauche lors de ses élections. Le PTB est ainsi devenu, au niveau national, la quatrième force politique. À la chambre, elle envoie 15 députés – 3 de plus que lors de la précédente législature tandis que le PS en compte désormais 16. Néanmoins, il convient également de relever qu’en Wallonie, le PTB a connu un léger recul et perd 2 sièges au sein du Parlement wallon. Cette déception côté wallon est cependant largement contrebalancée par les résultats en région bruxelloise et flamande.
En région bruxelloise, avec 20,9 % des voix, le PTB-PVDA rafle 16 sièges sur 89 et devient ainsi la quatrième force politique. Le parti marxiste y a largement bénéficié de son positionnement clair et déterminé vis-à-vis du conflit au Proche-Orient par son soutien à la population gazaouie. Outre une réforme des institutions politiques régionales, le PTB a largement mis en avant des thèmes liés au pouvoir d’achat lors de sa campagne dans la capitale. Sur le plan des transports, il s’est fermement opposé au projet d’une taxe kilométrique pour circuler en voiture à Bruxelles, tout en défendant la gratuité des transports publics afin d’offrir des alternatives à l’automobile. Le droit au logement était également au cœur de la campagne, à travers la réduction du pouvoir des promoteurs immobiliers privés, l’encadrement des loyers et la création d’une société publique gérant les projets immobiliers.
En région flamande, le parti marxiste progresse et se hisse au même niveau que le parti du Premier ministre sortant. Il gagne cinq sièges au Parlement flamand. Figure extrêmement populaire en Flandre mais candidat à Liège, Raoul Hedebouw, a passé une partie importante de sa campagne en Flandre, œuvrant à offrir au désarroi d’une partie importante de la population flamande une alternative au vote d’extrême droite. Le PVDA n’a eu de cesse de marteler que le Vlaams Belang n’allait pas mettre un terme les privilèges de la classe politicienne – régulièrement dénoncés par le parti d’extrême-droite – puisque ceux-ci en avait bénéficié, notamment lors de la mise en place d’un mécanisme permettant aux députés flamands de percevoir une pension au-delà du plafond autorisé. Plus globalement, la stratégie du PVDA consistant à se présenter comme le véritable parti antisystème a trouvé un vrai écho. Avec 22,5 %, le PVDA devient même le second parti à Anvers, grand centre industriel et portuaire et berceau historique du Vlaams Belang.
Certes un peu moins éclatante qu’espérée, la progression du parti marxiste constitue un motif d’espoir pour les années à venir pour l’ensemble de la gauche belge.
Certes un peu moins éclatante qu’espérée, la progression du parti marxiste constitue un motif d’espoir pour les années à venir pour l’ensemble de la gauche belge. À côté de la progression en Flandre du PTB-PVDA et de la chute des socialistes au Sud du pays, le parti socialiste flamand Vooruit connaît une progression similaire, qui le place troisième force politique en Flandre. Ce succès des socialistes flamands était quelque peu inattendu après le dérapage raciste et sexiste de son ex-président, Conner Rousseau, qui a démissionné à la suite de cet incident. Toujours populaire au Nord du Pays, Conner Rousseau pourrait utiliser ce résultat pour revenir en politique et reprendre la direction de son parti. Quoi qu’il en soit, cette progression de concert des socialistes et des marxistes offre une alternative au projet du Vlaams Belang.
Une difficile alliance des droites wallonnes et flamandes
La victoire de la droite conservatrice en Wallonie avec celle inattendue du parti de centre-droit Les engagés a profondément redistribué les cartes dans le champ politique régional et national. En devenant les deux forces majeures au Sud du pays, ces deux partis – qui se présenteront désormais dans un même bloc tant au niveau fédéral que régional – mettent à mal la rhétorique sur laquelle reposait le projet confédéraliste de la droite nationaliste flamande. Depuis plusieurs années, le président de la N-VA, Bart de Wever, défendait son projet confédéraliste en arguant que la Belgique avait deux démocraties, une au Sud qui votait toujours à gauche et une au Nord, résolument attachée aux valeurs défendues par la droite.
Bart de Wever, grand vainqueur des élections, a fait savoir lors de ses discours pré-électoraux qu’il refuserait pour cinq années supplémentaires un gouvernement fédéral sans majorité flamande, c’est-à-dire n’incluant pas la N-VA. Compte tenu des résultats, la constitution d’un gouvernement fédéral pourrait se faire via une coalition « suédoise » bis, c’est-à-dire comprenant des libéraux et centristes francophones et néerlandophones (MR et Les Engagés), les chrétiens démocrates flamands (CD&V) et la droite nationaliste flamande (N-VA). Cette coalition a déjà existé entre 2014 et 2018, sous la direction de Charles Michel, avant d’exploser à cinq mois des élections lors de la signature par le Premier ministre du Pacte de Marrakech sur l’immigration. Cette fois-ci, une telle coalition ne pourra voir le jour qu’à la condition de la participation des socialistes flamands qui, pour l’instant, refusent d’y prendre part.
Autre problème de la reconduction d’une coalition suédoise avec Bart de Wever en tant que premier ministre – il vient d’être sélectionné pour conduire les négociations par le roi belge – est que cette coalition, en l’absence des socialistes flamands, n’a pas la majorité en Flandre. Aussi, le leader nationaliste flamand a très clairement fait savoir qu’il refuserait de reconduire une coalition suédoise sans faire figurer dans l’accord de gouvernement la question d’une nouvelle réforme institutionnelle de l’état fédéral, point sur lequel le MR et Les engagés semblent peu enthousiastes. Les deux partis se sont dits ouverts à repenser certaines structures de l’État fédéral pour en améliorer l’efficacité mais sans pour autant régionaliser davantage de compétences fédérales.
Côté francophone, la question d’une union des forces de gauche ne manquera pas de se poser à nouveau.
Si au niveau de la région wallonne, la coalition MR et Les engagés permet d’avoir la majorité confortable (43 des 75 sièges) au parlement wallon), la coalition gouvernementale, au niveau flamand, s’avère plus indécise ; l’option la plus probable serait celle unissant la N-VA, avec le CD&V et Vooruit. Les socialistes flamands acceptent une telle coalition compte tenu du fait que les chrétiens démocrates flamands défendent historiquement une ligne politique de centre-gauche, même si celle-ci tend de plus en plus à suivre le mouvement de la droitisation. Toutefois, Vooruit sait qu’une participation à ce type d’alliance pourrait lui coûter cher dans les urnes. Les tractations au niveau flamand et à l’échelle fédérale s’annoncent donc longues.
Face à ce gouvernement fédéral qui penchera de toute façon clairement à droite, la question d’une union des forces de gauche ne manquera pas de se poser à nouveau. Un appel en ce sens – du moins concernant la gauche francophone – avait déjà été lancé par le président du syndicat FGTB, Thierry Bodson, lors de la rentrée politique du PTB au festival Manifiesta. L’évolution du positionnement de ce syndicat est d’ailleurs représentatif de celui de nombreux électeurs de gauche : les années passant, la FGTB renforce ses liens avec la formation marxiste et devient de plus en plus distante du Parti Socialiste, qui a mené de nombreuses réformes libérales. Mais Bodson a également repris en partie les reproches du PS au PTB, à savoir que le parti apprécierait trop le fait d’être dans l’opposition. Le PS étant désormais dans l’opposition et sanctionné par les électeurs pour son libéralisme, on peut espérer que la victoire du PTB puisse amener les autres parties de gauche à reprendre ses points de ruptures majeurs : fin du blocage des salaires, taxe sur les millionnaires, retour de la pension à 65 ans et fin de l’austérité européenne. De manière comparable à la gauche française, il est désormais plus envisageable pour la gauche belge de s’unir autour d’un programme de rupture grâce à la percée du PTB-PVDA. De quoi voir un front populaire belge émerger dans les années à venir ?