Le néolibéralisme ne consiste pas dans le simple retrait de l’État au profit du marché : il est l’institution, par l’État, d’une logique de marché. Mais au-delà de ce lieu commun, est-il une simple idéologie, un régime économique ou un paradigme de gouvernance ? Amy Kapczynski, professeur de droit à l’Université de Yale et co-fondatrice du « Law and Political Economy Project », se concentre sur ce troisième aspect. Selon elle, le néolibéralisme consiste en un « reformatage du pouvoir de l’État », qui accouche d’un cadre institutionnel favorable à la maximisation du profit des grandes sociétés dont les géants de la tech et les entreprises pharmaceutiques constituent deux des manifestations les plus emblématiques. Entretien réalisé par Evgeny Morozov et Ekaitz Cancela, édité par Marc Shkurovich pour The Syllabus et traduit par Alexandra Knez pour LVSL.
Evgeny Morozov et Ekaitz Cancela – Comment définissez-vous le néolibéralisme dans votre travail?
Amy Kapczynski – Comme une logique de gouvernance orientée vers l’accroissement du pouvoir des acteurs du marché, et la diminution de l’autorité publique sur ces acteurs. Wendy Brown utilise un terme charmant, le « reformatage du capitalisme ». Il s’agit d’un reformatage du capitalisme qui vise non seulement à accroître le pouvoir des acteurs privés – et donc leur capacité à extraire du profit – mais aussi à combattre le contrôle démocratique sur ces acteurs.
Pour moi, c’est ainsi qu’il faut voir les choses, plutôt que, par exemple, comme un mouvement de déréglementation. Le néolibéralisme est en réalité très régulateur. Il est régulateur avec un paradigme et un objectif particuliers comme horizon. Il est important de garder à l’esprit la manière dont l’économie a été réglementée – par un droit du travail défavorable aux salariés ou une législation antitrust, entre autres – pour d’optimiser la recherche de profit.
Il est également important de comprendre les liens entre cette régulation et les paradigmes réglementaires de l’État-providence, de l’État carcéral, etc. En un mot, la période néolibérale n’est pas une période de déréglementation générale – en particulier aux États-Unis.
EM et EK – Si l’on s’en tient à cette définition du néolibéralisme, que vous explorez dans votre excellente conversation avec Wendy Brown, observe-t-on des changements au sein de cette logique au cours des dix ou quinze dernières années ? Ou observe-t-on une continuité depuis les années 1970 ?Quelque chose de distinct est-il apparu à l’horizon, notamment avec l’essor des GAFAM?
AK – Le néolibéralisme a, d’une certaine manière, suspendu les anciennes formes de réglementation juridique pour les grandes entreprises technologiques, puis a amplifié certains aspects de la recherche du profit. Ces intermédiaires technologiques, du paysage des réseaux sociaux à Amazon, contrôlent la vie publique et l’économie d’une manière distincte et nouvelle.
Mais je ne pense pas que ces changements reflètent une mutation dans la logique néolibérale elle-même, mais plutôt sa portée lorsqu’elle est appliqué à un secteur qui peut être transformé à la vitesse d’un logiciel. Aujourd’hui, les processus mis en place par le néolibéralisme peuvent fonctionner avec une vitesse stupéfiante. Et la capacité de ces formes de pouvoir concentré à sillonner les domaines ostensiblement publics et privés est extraordinaire.
EM et EK – Les efforts intellectuels pour penser au-delà du néolibéralisme, sur lesquels vous avez attiré l’attention, se sont concrétisés de deux manières différentes – et vous êtes critique à l’égard des deux. Dans un essai, vous vous concentrez sur le « productivisme », ou libéralisme de l’offre, tel qu’il est défendu par Dani Rodrik et d’autres membres de la gauche progressiste. Dans un autre essai, vous vous attaquez à un mouvement de droite connu sous le nom de « constitutionnalisme du bien commun ».Commençons par le premier. Pouvez-vous nous parler des pièges que vous voyez dans le productivisme ?
Des mutations ont lieu dans la doctrine du droit constitutionnel. Le premier amendement a été interprété dans un sens favorable aux entreprises, qui revendiquent un statut constitutionnel
AK – Le productivisme et le libéralisme de l’offre évoquent tous deux un aspect important de l’incapacité des logiques néolibérales et de la gouvernance économique à produire une économie que nous souhaitons réellement. Ils nomment quelque chose qu’il est important d’aborder. Mais je pense également qu’ils ne doivent pas être considérés comme une réponse au néolibéralisme. Si l’on pense que « là où il y avait le néolibéralisme, il y a maintenant la politique industrielle et le productivisme », alors ce sera un changement très limité…
Le productivisme tel que l’exprime Rodrik – et je pense que le libéralisme de l’offre possède cette même qualité – donne le sentiment que nous nous tournons vers une gestion gouvernementale plus directe des chaînes d’approvisionnement, vers un investissement gouvernemental plus important dans nos secteurs manufacturiers. Le problème est que le secteur des services est bien plus important pour l’avenir des travailleurs américains que le secteur manufacturier. L’ancien concept de « production » ne dit pas grand-chose de l’économie actuelle.
Ainsi, l’idée selon laquelle nous devrions miser sur un nouveau productivisme semble laisser de côté beaucoup de nombreuses dimensions de la critique du néolibéralisme. Qu’en est-il de l’agenda de la santé ? Que fait-on des salariés du secteur des services ? Quid des liens que l’on établit entre le capitalisme et la question environnementale ?
Le productivisme pourrait suggérer, par exemple, que les technologies vertes constitueraient la solution au changement climatique – et on peut bien sûr considérer qu’elles font partie de la solution, si l’on ajoute qu’elles ne seront pas suffisantes. En réalité, le productivisme et le libéralisme de l’offre s’appuient sur des fondements contestables – battus en brèche, par exemple, par les approches féministes et écologistes.
Tout dépend de votre compréhension de l’objectif du productivisme. S’agit-il d’une tentative de fonder une alternative au néolibéralisme ? C’est ainsi que j’ai interprété l’utilisation du terme par Rodrik. Et si c’est le cas, il semble négliger de nombreuses critiques du néolibéralisme en le traitant comme s’il s’agissait uniquement d’un mode de production, et non pas également d’un mode de gouvernement. Si l’on ne voit dans le néolibéralisme qu’un mode étroit de production – dans le sens d’uen consolidation des marché -, on ne comprend rien à la gouvernance à laquelle il est lié. Le néolibéralisme, en effet, consiste également à contraindre certains pour que d’autres puissent être libres.
C’est la raison pour laquelle nous avons investi dans l’État carcéral comme moyen de discipliner les travailleurs et d’éviter les obligations sociales, la raison pour laquelle nous investissons davantage dans la police que dans les travailleurs sociaux, etc.
EM et EK – L’autre approche que vous mentionnez, le constitutionnalisme du bien commun, est mise en avant par certaines franges de la droite théocratique. Avant de discuter de son contenu, pouvez-vous nous parler du rôle de ces écoles juridiques conservatrices dans la consolidation du modèle néolibéral ?
AK – Je considère que le droit, et dans une certaine mesure les écoles de droit et les institutions dans lesquelles elles naissent, assurent la cohésion entre les idées néolibérales et la gouvernance. Ces idées sont toujours reflétées à travers des champs de pouvoir et changent à mesure qu’elles s’intègrent dans la gouvernance.
Le loi relative aux ententes et abus de position dominante en est un bon exemple. Les idées sur les pratiques antitrust introduites dans les facultés de droit sous le titre « Law & Economics » sont devenues très puissantes. Elles ont été utilisées pour normaliser une idée du fonctionnement des marchés. Selon ce point de vue, tant qu’il n’y a pas de barrières à l’entrée érigées par le gouvernement, la concurrence se manifestera toujours et les monopoles seront intrinsèquement instables. Les monopoles étaient considérés comme un signe d’efficacité d’échelle. De nombreuses modifications ont donc été apportées à la législation afin de faciliter les fusions-acquisitions. L’application de la loi antitrust a été soumise à une économétrie extrêmement précise, plutôt qu’à des règles qui auraient pu, par exemple, limiter la taille ou l’orientation structurelle de certaines industries.
La législation antitrust repose également sur une autre idée importante, à savoir que ce domaine juridique ne doit servir qu’un seul objectif : l’efficacité. Dans ce contexte, l’efficacité est définie en grande partie par les effets sur les prix. Les conséquences pour la structuration de notre politique, ou pour les travailleurs en général, n’étaient plus considérées comme importantes. Ce qui importait, c’était de réduire les prix pour les consommateurs. Ainsi, de nombreux modèles d’entreprise se sont bâtis sur l’idée de rendre leurs produits gratuits – comme les réseaux sociaux – ou générer les prix les plus bas possibles pour les consommateurs – comme Amazon. Que le secteur génère un pouvoir structurel démesuré, entre autres effets néfastes, n’est pas pris en compte.
En ce qui concerne le droit de la propriété intellectuelle, de nombreuses modifications ont également été apportées pour faciliter la capitalisation dans l’industrie de l’information. La création de nouveaux types de propriété, les brevets logiciels, les brevets sur les méthodes commerciales, l’extension des droits exclusifs associés à ces types de propriété sont autant de moyens de permettre la capitalisation dans l’industrie. Ils sont apparus en même temps que les formes de réglementation qui auraient pu être utilisées pour limiter la manière dont les entreprises de ces secteurs exerçaient leur autorité. Le Communications Decency Act en est un exemple.
On observe également des changements internes au gouvernement lui-même, comme la montée en puissance de l’analyse coûts-bénéfices.
Enfin, des mutations importantes ont lieu dans la doctrine du droit constitutionnel : que l’on pense à la manière dont le premier amendement est compris. Ce n’est qu’à partir de 1974 qu’il est interprété dans un sens favorable aux entreprises, ce qui revient à revendiquer, pour elles, un statut constitutionnel. Les changements apportés à la loi sur le premier amendement ont eu des répercussions multiformes, des syndicats aux financement de campagnes.
EM et EK – Certaines des caractéristiques que vous critiquez – l’accent mis sur l’efficacité ou l’analyse coût-bénéfice – pourraient également être attribuées au fétichisme de l’économie elle-même. Je ne les attribuerais pas nécessairement au néolibéralisme en tant que tel. Au sein de ce courant, on peut trouver des penseurs – comme James Buchanan – qui refusent de prendre l’efficacité comme horizon. Il semble donc que certaines de ces critiques concernent davantage la pratique que la logique. Lorsqu’il s’agit de la manière dont les tribunaux ou les organismes de réglementation prennent leurs décisions, ils doivent faire appel à certains outils – l’analyse coût-bénéfice étant l’un d’entre eux – mais cette passerelle vers la logique néolibérale pourrait être attaquée par les néolibéraux eux-mêmes…
AK – C’est l’occasion de s’interroger sur ce que signifie appeler le néolibéralisme une « logique ». Plus précisément, nous devons parler du néolibéralisme comme d’un reformatage du pouvoir de l’État. En ce sens, il s’agit d’une politique et non d’une logique pure, je suis tout à fait d’accord.
Lorsque vous examinez de près la logique de l’efficience telle qu’elle est utilisée en droit, il s’avère qu’elle est en réalité utilisée pour signifier de nombreuses choses différentes dans de nombreux contextes juridiques différents. En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le type d’efficacité dont on parle donne la priorité à l’innovation sur tout le reste ; mais il n’a pas grand-chose à voir avec le type d’efficacité dont il est question dans la législation antitrust, ou avec le type d’efficacité exprimé par l’analyse coût-bénéfice. En fait, elles sont toutes différentes.
Et elles sont toutes différentes parce qu’elles répondent en fin de compte à des idées sur la prédominance d’un certain type de pouvoir : le pouvoir des marchés sur les formes démocratiques de gouvernance. Ces conceptions de l’efficacité s’expriment alors de différentes manières, en fonction des avantages que procurent ces formes de pouvoir. En ce sens, je suis tout à fait d’accord pour dire que nous ne sommes pas face à l’expression pure d’une certaine logique, mais plutôt de nombreuses expressions d’un projet politique qui prennent des formes différentes dans des contextes différents.
EM et EK – Vous avez également écrit sur la relation entre le néolibéralisme et les droits humains, plus particulièrement sur le droit à la santé. Que nous révèle cette focalisation sur la santé quant à la relation plus large entre les droits de l’homme et le néolibéralisme ?
AK – J’ai écrit l’article que vous évoquez en raison de la frustration que m’inspiraient à la fois la forme de la législation et du discours dominants en matière de droits de l’homme et certaines critiques de ce discours, comme celles de mon collègue Sam Moyn. Ayant participé au mouvement mondial pour l’accès au traitement du VIH et à d’autres médicaments, il est clair que la revendication d’un droit à la santé implique nécessairement des questions d’économie politique. Comment peut-on parler de droit à la santé si les sociétés pharmaceutiques, par exemple, se voient accorder des droits de monopole – des brevets – qui leur permettent d’augmenter les prix de produits vitaux, même sans la moindre justification que cela génère de l’innovation ? Regardez les hausses de prix de l’insuline, ou les hausses de prix du vaccin Moderna (qui a été massivement financé par des fonds publics et qui a clairement amorti tous les coûts d’investissement privés) contre le Covid durant la pandémie.
Si vous vous souciez de la santé, vous devez vous attaquer à la structure du secteur et à son pouvoir. Il existe des moyens de structurer l’industrie (notamment en donnant un rôle plus important à l’investissement public et à la réglementation des prix) qui pourraient conduire à la fois à un meilleur accès aux soins et à plus d’innovation. Les tribunaux et les institutions de défense des droits de l’homme devraient s’en préoccuper, tout comme les militants qui luttent pour le droit à la santé. Mais la plupart du temps ils rejettent cette perspective, parce qu’ils considèrent les brevets et la structure industrielle comme quelque chose d’entièrement distinct de la sphère des droits de l’homme.
C’est la frustration que j’éprouve à l’égard des approches fondées sur les droits de l’homme : ils ont pris forme à une époque de néolibéralisme exacerbé, où l’on pensait que les questions d’économie étaient totalement distinctes des questions de droits. Les droits de l’homme sont même revendiqués au nom des entreprises, qui affirment – parfois avec succès, comme dans l’Union européenne – que leurs droits de propriété intellectuelle méritent d’être protégés dans le cadre des droits de l’homme !
Mais il y a également eu des dissidences dans cette tradition – les organisations de lutte contre le sida soutenant que le droit à la santé pourrait permettre aux tribunaux de limiter le droit des brevets, par exemple. En ce sens, les critiques des droits de l’homme comme celle de Sam Moyn atténuent ou négligent parfois les initiatives inédites visant à utiliser cette tradition, y compris pour contribuer à la mobilisation de l’opinion publique, comme l’a fait le mouvement en faveur d’un meilleur accès aux médicaments.
EM et EK – Quels sont les principaux héritages du néolibéralisme dans la gouvernance mondiale de la santé ? Qu’est-ce que le Covid nous a appris sur leur pérennité et leur contestabilité ?
AK – Nous sommes face à un régime de gouvernance mondiale de la santé qui n’a pas contesté le pouvoir du secteur privé, et qui s’est accommodé de discours et de pratiques marchnades qui nuisent gravement à la santé. Dans le contexte du Covid, nous avons pu produire des vaccins extrêmement efficaces – une merveille scientifique – grâce à un soutien public considérable, y compris un soutien à la recherche sur les coronavirus qui a eu lieu de nombreuses années avant la pandémie, ainsi qu’un soutien à la surveillance mondiale des maladies et à l’analyse génomique qui ont été essentiels pour le processus.
Mais au cours des dernières années, des gouvernements ont décidé de ne pas imposer aux entreprises des conditions qui auraient contribué à garantir la possibilité d’utiliser les vaccins obtenus pour faire progresser la santé de tous. Nous avons autorisé un monopole de production des vaccins ARNm les plus efficaces au sein de chaînes d’approvisionnement privées auxquelles le Nord avait un accès privilégié, et nous avons autorisé les entreprises à refuser toute assistance aux efforts critiques de fabrication de ces vaccins dans le Sud.
Bien qu’il y ait eu une nouvelle prise de conscience que l’ordre commercial mondial et l’accord ADPIC (qui fait partie de l’OMC et protège les brevets sur les médicaments) posaient un réel problème, et qu’il y ait eu de petites tentatives de réforme, nous n’avons finalement pas réussi à surmonter la capacité de l’industrie à dicter les termes de la production et de l’accès aux vaccins – ce, en dépit de subventions publiques massives. Il s’agit d’un héritage de l’ordre néolibéral dans le domaine de la santé.
EM et EK – Vous avez expliqué en détail comment le système actuel des brevets actuel profite aux pays riches et aux entreprises. Y a-t-il des raisons d’être optimistes quant à la possibilité de changer la donne ?
AK – Je vois des raisons d’espérer. Le fait que le gouvernement américain se soit prononcé en faveur de la suspension d’au moins certaines parties de l’accord sur les ADPIC concernant le Covid était sans précédent. J’aurais aimé qu’ils aillent plus loin et que l’Europe ne soit pas aussi récalcitrante, mais il s’agit d’une étape importante et nouvelle. Cela reflète le fait que l’ordre commercial néolibéral est réellement remis en question, même si ce qui le remplacera n’est pas encore clairement défini.
Il s’agit de s’éloigner du principe selon lequel les marchés suivent leurs propres lois. Nous établissons les lois, les formes de pratiques sociales qui donnent leur forme aux marchés
Je fonde encore plus d’espoir sur des expériences comme cette nouvelle installation de production d’ARNm en Afrique du Sud, qui est soutenue par l’Organisation mondiale de la santé, et dans le fait que l’État de Californie travaille maintenant à la fabrication de sa propre insuline. Pour contester l’autorité des entreprises, il faudra non seulement modifier les droits de propriété intellectuelle, mais aussi procéder à de véritables investissements matériels comme ceux-ci, afin de modifier l’équilibre des pouvoirs sur les biens essentiels.
Il existe une coalition, petite mais solide, de groupes de pression dans les pays du Nord qui s’efforcent de remettre en cause le pouvoir et les prix des entreprises pharmaceutiques, et dont beaucoup ont commencé à travailler dans ce domaine en tant que militants pour un meilleur accès aux médicaments à l’échelle mondiale. Ce sont finalement ces liens entre les mouvements qui me donnent le plus d’espoir, parce qu’ils impliquent des personnes brillantes et créatives qui se penchent sur les questions les plus difficiles, comme la manière d’améliorer à la fois l’innovation et l’accès, et parce qu’ils le font d’une manière qui peut être réellement bénéfique pour les populations du Nord comme du Sud.
EM et EK – Nous avons parlé plus tôt du bagage ontologique que les économistes apportent à ce débat.Pensez-vous que l’on puisse effectuer une analyse similaire dans le domaine du droit? Que lorsque le néolibéralisme est abordé dans les facultés de droit, on passe souvent à côté du sujet ?
AK – Inversons les rôles. Qu’en pensez-vous ?
EM – Je pense que certaines réalités sont invisibilisées. Mais je ne pense pas qu’il s’agisse uniquement d’un problème spécifique aux juristes. Même dans le cas de Wendy Brown, il y a une certaine réticence à aborder le néolibéralisme comme quelque chose qui pourrait réellement jouir d’une légitimité – même parmi ses victimes, pour ainsi dire. Pour expliquer cela, je pense qu’il faut reconnaître que dans le néolibéralisme il existe des éléments réellement excitants, voire utopiques – ce qui n’est pas le cas si l’on se concentre uniquement sur le reformatage du pouvoir de l’État. Au niveau de la vie quotidienne, il est difficile de s’enthousiasmer pour les réglementations..
Quelqu’un comme Hayek pense que le marché est un outil de civilisation. Ce n’est pas seulement un outil d’agrégation des connaissances ou d’allocation des ressources, mais plutôt un moyen d’organiser la modernité et de réduire la complexité. Ce qui empêche la société de s’effondrer, compte tenu de sa multiplicité, c’est cette gigantesque boîte noire qu’est le marché, qui nous fait aussi avancer.
Si l’on n’en tient pas compte, si l’on n’introduit pas une sorte d’utopie parallèle et alternative, j’ai beaucoup de mal à imaginer comment une logique alternative pourrait voir le jour. Et je ne vois pas comment cette logique pourrait voir le jour en se concentrant uniquement sur la redistribution, les réparations ou la restauration du pouvoir de l’État administratif.
AK – Je suis d’accord pour dire que qu’à certains égards le néolibéralisme exerce un réel attrait. Les analyses historiques sur la manière dont la gauche, ou du moins les libéraux « progressistes », en sont venus à adopter le néolibéralisme, sont instructives. Ce dernier prétendait revitaliser certaines parties de la société américaine. Il possédait un élan libérateur.
Il allait discipliner un État qui était profondément bloqué, incapable de fournir les choses que les gens souhaitaient. Ayant été formé dans une école de droit, j’ai entendu, en tant qu’étudiante, l’histoire du rôle que le tournant vers cette efficacité était censé jouer, en tant que technologie neutre qui nous permettrait à tous de nous entendre et d’avoir les choses que chacun d’entre nous désirait. À ce titre, je pense qu’il a exercé un attrait puissant.
La question qui se pose alors est la suivante : si nous voulons critiquer le néolibéralisme, quelles sont ses alternatives ? Je suis très intéressée par les écrits de l’un de mes collègues de Yale, Martin Hägglund, en particulier par son livre This Life. Ce livre propose une vision laïque de la libération – être libre d’utiliser son temps comme on l’entend, et avoir une obligation envers les autres, pour partager le travail que personne ne veut faire – qui comporte des aspects de gouvernance très intéressants.
Mais ce n’est pas fondamentalement basée sur l’idée, par exemple, d’un État administratif plus fort. Il s’agit plutôt d’une idée de ce que nous devrions attendre d’un État et de ce que nous devrions attendre de notre politique. Pour moi, c’est passionnant parce que cela correspond bien aux mobilisations politiques contemporaines, qu’il s’agisse des mouvements en faveur la généralisation des soins de santé ou des mouvements visant à remplacer les réponses carcérales par des réponses plus solidaires, enracinées dans des formes de soins.
En d’autres termes, les critiques du néolibéralisme devraient prendre au sérieux une partie de son attrait populaire. Critiquer le néolibéralisme ne dit pas grand-chose sur les alternatives possibles. Avoir une idée de ces alternatives me semble très important.
EM – Dans l’un de vos récents essais, vous parlez de la nécessité de démocratiser la conception des marchés. Qu’est-ce que cela implique ?
AK – Il s’agit notamment de s’éloigner du principe selon lequel les marchés suivent leurs propres lois. Nous devons admettre que nous établissons les lois, les formes de pratiques sociales qui donnent aux marchés leur forme et leurs conséquences. Nous devrions comprendre que nous avons un pouvoir sur la conception des marchés et ne pas nous contenter de dire que l’offre et la demande sont à l’origine de telle ou telle chose.
Les produits pharmaceutiques constituent une manifestation indéniable de la manière dont notre pouvoir collectif, par l’intermédiaire de l’État, est utilisé pour façonner ce que l’on appelle les résultats du marché. Nous conférons une grande autorité aux entreprises pour fixer les prix, puis nous constatons que les prix des médicaments augmentent. Cette situation est en profonde contradiction avec l’idée que nous devrions tous avoir un accès à ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé.
EM et EK – Mais toutes les alternatives proposées ne relèvent pas de positions aussi progressistes, y compris cette idée de constitutionnalisme du bien commun, pour finalement y revenir.
AK – C’est vrai. Le constitutionnalisme du bien commun est une évolution du raisonnement juridique qu’un groupe de penseurs essentiellement catholiques est en train de consolider, afin de réinjecter une morale catholique dans le discours constitutionnel. Une manifestation très concrète de ceci dans le contexte politique américain est l’abandon par la droite de l’originalisme, une approche historique de l’interprétation de la Constitution qui revient à ce que voulaient les « pères fondateurs », au profit d’un ordre constitutionnel plus musclé et plus affirmé, fondé sur des principes religieux.
Par exemple, les originalistes ont remporté une victoire célèbre dans la récente bataille autour de l’avortement en soutenant que le texte de la Constitution ne protégeait pas l’avortement et qu’il laissait donc cette question à la discrétion des États. Les constitutionnalistes du bien commun, quant à eux, sont beaucoup plus intéressés par une Constitution qui protégerait la vie du fœtus. Plutôt que de laisser les États choisir de protéger l’avortement, la Constitution du bien commun leur interdirait de le faire. Cette imprégnation de l’ordre constitutionnel américain par des valeurs religieuses est l’expression d’un mouvement plus large que j’observe dans la droite post-néolibérale.
Une caractéristique très forte de ce mouvement est de reconnaître les problèmes posés par le fondamentalisme du marché et le néolibéralisme – ils utilisent même ce terme – et d’affirmer que nous devons réintroduire des valeurs dans la vie américaine. Pour eux, cela devrait prendre la forme d’un retour au salaire familial, d’un retour aux familles normatives et hétérosexuelles, d’un retour à des formes de soutien de l’État pour des modes de vie ordonnés par la religion, d’un retour aux valeurs religieuses même sur le marché.
Aux États-Unis, on peut en observer des manifestations économiques à travers une entreprise comme Hobby Lobby, qui souhaite imprégner le marché d’un caractère religieux – et aller à l’encontre, aussi bien, du progressisme marchand que de la couverture des moyens de contraception. Ce qui me préoccupe à ce sujet – bien qu’il ne s’agisse que d’une petite partie d’une droite très large et diversifiée – c’est que cette mouvance possède une idée assez nette de la manière dont elle pourrait parvenir à la prééminence, c’est-à-dire par le biais de la Cour suprême, étant donné le pouvoir dont celle-ci dispose dans ce pays. Il s’agit donc d’une évolution très importante…
EM et EK – Pour revenir aux thèmes du néolibéralisme et de l’utopie, il semble que nous devrions essayer d’élaborer une théorie sociale capable de nous montrer quelles autres institutions permettent de créer un monde aussi diversifié et dynamique que celui qui est médiatisé par les marchés et le droit – ce qui correspond à la vision de Jürgen Habermas, avec quelques mouvements sociaux en plus.
Il y a vingt ans, les écoles de droit américaines étaient très douées pour imaginer cette dimension utopique, même s’il s’agissait d’une utopie naïve. Mais cette dimension a disparu de l’analyse du néolibéralisme aujourd’hui, ce qui est troublant. Les plus utopistes ont-ils été tellement traumatisés par l’essor de la Silicon Valley qu’ils ont renoncé à réfléchir à ces questions ?
AK – Je pense qu’il y a des idées utopiques – certainement des idées progressistes et ambitieuses – dans les facultés de droit de nos jours. Regardez certains travaux sur l’argent. Les gens réfléchissent à ce que cela signifierait de créer toutes sortes de choses, depuis des autorités nationales d’investissement jusqu’à une Fed fonctionnant selon des principes très différents, en passant par la réorganisation de la structure bancaire afin de permettre de nouvelles formes d’aide sociale et de lutter contre le changement climatique. C’est un exemple de quelque chose d’assez nouveau.
Nous voyons également de nombreuses demandes pour ce que l’on pourrait appeler la démarchandisation : des garanties de logement, des garanties de soins de santé, et même des expressions institutionnelles qui pourraient participer à ce que vous décrivez. En d’autres termes, comment gérer un système complexe tel qu’un établissement de santé en se basant sur les besoins plutôt que sur le profit ? Les gens ont vraiment réfléchi à cette question. Nous avons des expressions réelles de ces principes dans le monde, et elles inspirent des idées sur ce que cela signifierait de faire évoluer d’autres pouvoirs institutionnels dans cette direction.
Si vous deviez rassembler un grand nombre de ces éléments – des idées sur la façon dont les investissements pourraient être dirigés plus démocratiquement, sur la façon dont le logement pourrait être organisé plus démocratiquement, sur la façon dont les soins de santé pourraient être organisés plus démocratiquement ; tous ces éléments font l’objet de discussions au sein des facultés de droit, ainsi qu’en dehors de celles-ci – ils constitueraient les éléments d’une vision beaucoup plus affirmée d’un avenir qui n’est pas organisé selon des lignes néolibérales. C’est l’assemblage de toutes ces pièces, et le fait de leur donner un nouveau nom, qui n’a pas encore été accompli.
Mais je pense que ces éléments sont beaucoup plus intéressants que ce qu’on avait dans les années 2000, par exemple les mouvements autour du libre accès et des Creative Commons auxquels vous avez fait allusion, parce qu’ils abordent aussi directement la nécessité de disposer de certaines formes de pouvoir public pour créer ces choses. Et ils ne reposent pas sur une idée purement volontariste de ce que nous pouvons attendre ou réaliser.
EM – Je suis d’accord pour dire qu’il s’agit d’une vision radicale, mais elle est conservatrice à mon goût en ce qui concerne son mélange institutionnel. Je reconnais que la démarchandisation est radicale après 50 ans de néolibéralisme, mais elle n’est pas radicale si on la compare à l’État-providence britannique des années 1940.
AK – Je vous propose à présent de vous interroger sur les alternatives.
EM – La personne qu’il faut convaincre que le règne du marché est révolu n’est pas tant le juge ordinaire que quelqu’un comme Habermas. Or, il n’y a pas grand-chose qui puisse le convaincre que nous nous sommes éloignés du marché et du droit comme les deux formes dominantes à travers lesquelles la modernité prend forme.
Je ne vois pas beaucoup de réflexion sur les autres façons de formater la modernité. Sans elles, la seule chose que nous pouvons changer est l’équilibre entre les deux formes – que, bien sûr, je préférerais du côté de l’État plutôt que du côté du marché.
AK – Quels sont les nouveaux véhicules qui vous viennent à l’esprit ? Un rapport avec le socialisme numérique ?
EM – En fin de compte, je pense qu’il s’agit de formes alternatives de génération de valeur, à la fois économique et culturelle. Et cela implique de comprendre la contrepartie progressiste adéquate au marché. Pour ma part, je ne pense pas que le pendant progressiste du marché soit l’État. Je pense qu’il devrait s’agir de la culture, définie de manière très large – une culture qui englobe les connaissances et les pratiques des communautés.
AK – En ce sens, vous vous situez davantage dans la lignée des biens communs que dans celle de l’État ?
EM – Oui, c’est un moyen de fournir des infrastructures pour susciter la nouveauté et s’assurer que nous pouvons ensuite nous coordonner pour appréhender les effets qui s’ensuivent. La technologie est un élément clé à cet égard.





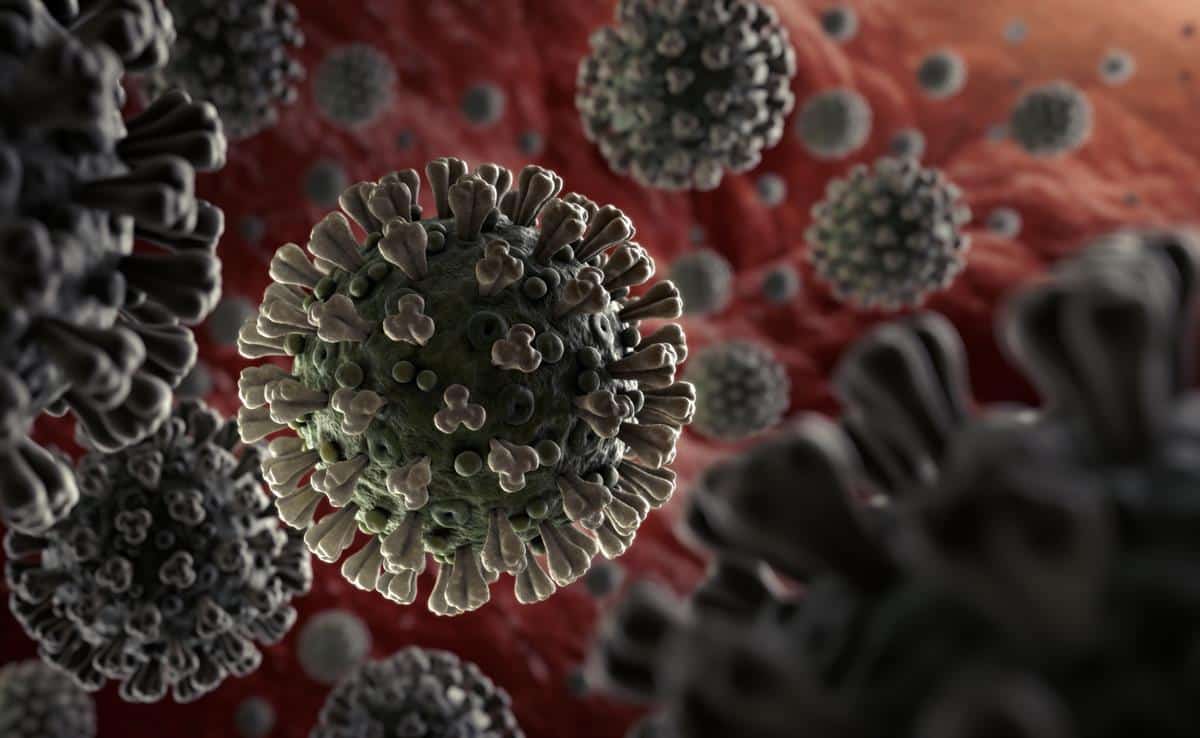









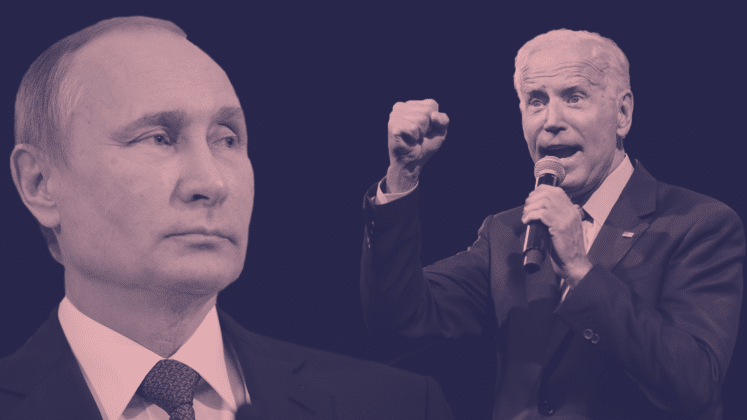



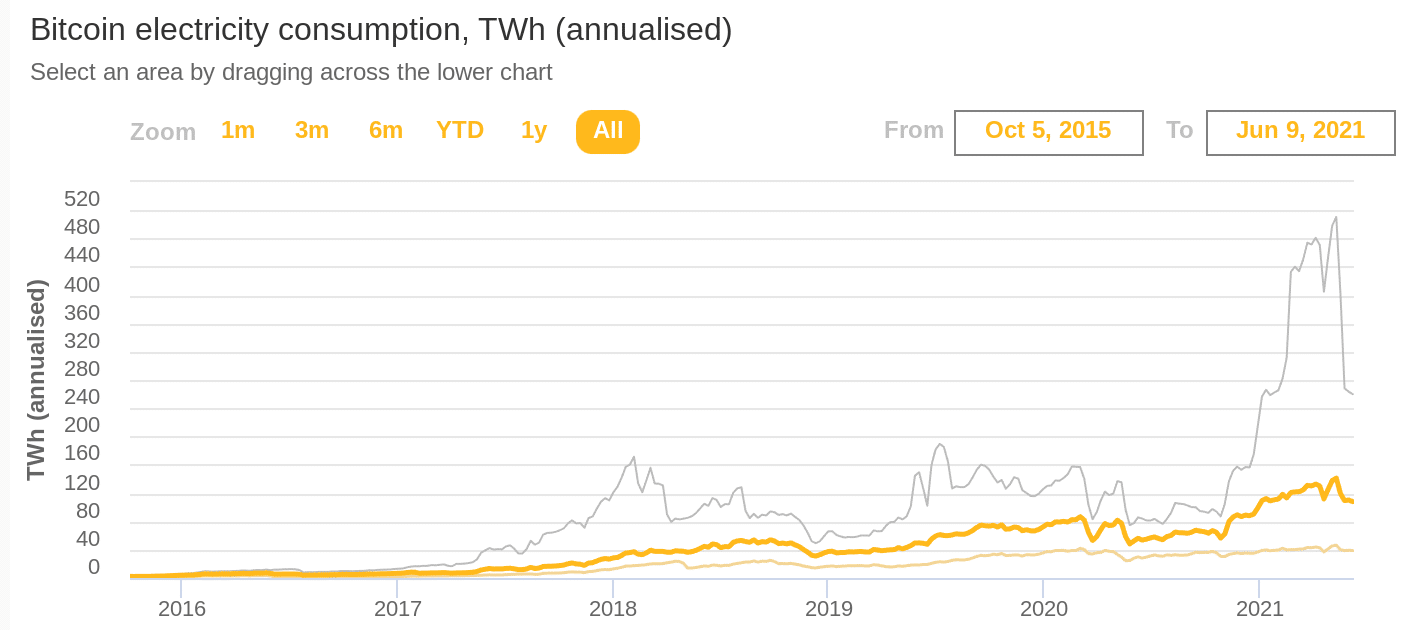







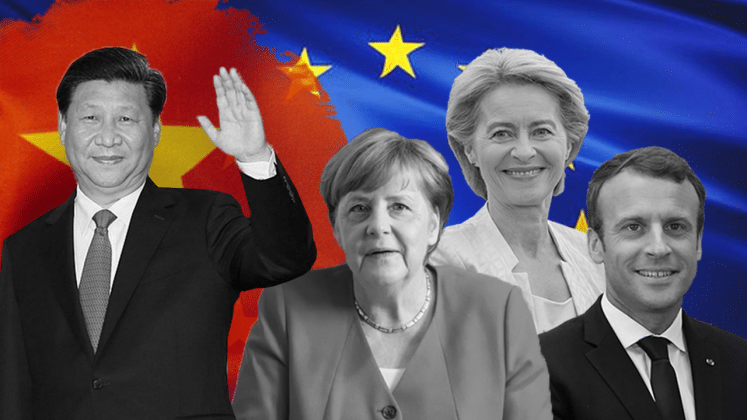




 La guerre sociale en France, Aux sources économiques de la démocratie autoritaire. Romaric Godin.
La guerre sociale en France, Aux sources économiques de la démocratie autoritaire. Romaric Godin.

