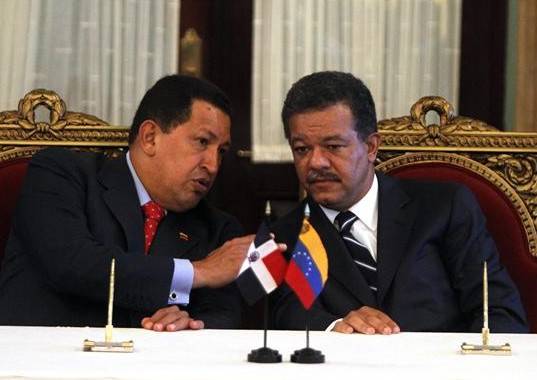Le 8 juin, au Parlement européen, un sommet réunissait des membres du Grupo de Puebla (coalition de leaders de gauche d’Amérique latine) et du groupe des eurodéputés socialistes. Relativement alignés sur les questions touchant à l’écologie ou aux valeurs défendues, ils ont davantage divergé lorsqu’il s’est agi d’aborder les enjeux géopolitiques. Nous avons rencontré Cecilia Nicolini, secrétaire d’État argentine à la lutte contre le changement climatique. Avec elle, nous discutons de l’intégration régionale latino-américaine, du traité de libre-échange UE-Mercosur, ou encore de la posture de « non-alignement » revendiqué par son gouvernement. Entretien réalisé par Pierre Lebret.
LVSL – Comment concevez-vous l’intégration régionale ? Pensez-vous qu’elle doive s’opérer sur des fondements idéologiques minimaux ? Ou estimez-vous que la région est unie par une communauté d’intérêts suffisamment forte pour que l’on fasse abstraction de ceux-ci ?
Cecilia Nicolini – L’une des fonctions du Grupo de Puebla est de concrétiser cette intégration régionale latino-américaine, qui est en suspens depuis un certain temps. Comme région, nous souffrons du défaut d’intégration, qui est nécessaire face aux crises globales, par rapport auxquelles les États nationaux peuvent difficilement, seuls, apporter des réponses. Nous parlons depuis le Parlement européen, et nous fondons bien sûr sur l’expérience de l’Union européenne – en gardant à l’esprit ses déficiences, sa complexité et ses problèmes – comme espace commun.
En Amérique latine, cette intégration se décline d’une part via le marché commun, le MERCOSUR. C’est une dimension que l’on doit approfondir, qui est surtout économique en l’état, mais à laquelle on doit adjoindre un aspect social. Via l’UNASUR d’autre part. Comme membre historique de cette institution, l’Argentine a pour vocation de la réactiver. Il faut aller au-delà des questions idéologiques : une intégration institutionnelle qui prendrait en compte les divergences entre États-membres est tout à fait possible.
LVSL – La place du Venezuela fait toujours débat. Comment analysez-vous les frictions qui se sont produites à Brasilia, entre le président chilien Gabriel Boric et le président Lula ? Le premier avait critiqué la politique interne de Nicolas Maduro, le second s’était refusé à le faire, et considère Maduro comme un partenaire dans le processus d’intégration.
CN – Je crois qu’il y a une confusion quant aux espaces dédiés à ces débats. Le sommet réuni par Lula à Brasilia était destiné promouvoir l’intégration régionale, au-delà de la coloration idéologique des gouvernements. D’autres espaces qui permettent de débattre de ces questions idéologiques relatives à la politique interne des États. Le gouvernement chilien, en confondant ces deux espaces, entrave la possibilité d’une intégration plus institutionnelle…
Le conflit ukrainien nous heurte quant au prix de l’alimentation, de l’énergie, et même des devises (…) de là la position latino-américaine : au-delà de la condamnation de l’invasion, le conflit doit se terminer le plus vite possible
LVSL – Il a été question, lors de ce sommet, de la place de l’Amérique latine dans l’affrontement entre l’Occident et la Russie. Les eurodéputés du groupe socialiste souhaitaient manifestement que la gauche latino-américaine se rapproche de leurs positions. L’Argentine défend-elle, comme le Brésil, une position de « non-alignement » ?
CN – Notre analyse du conflit est conditionnée par la manière dont il affecte notre région. Si l’on s’attend à ce qu’un Latino-américain raisonne comme un Européen, cela génère des mécompréhensions.
L’Amérique latine est une région sévèrement affectée par cette guerre, quand bien même elle ne se situe pas sur le territoire des affrontements. Nous ne sommes absolument pas indifférents aux pertes en vies humaines : l’Amérique latine est un continent traditionnellement pacifique qui s’est toujours opposé aux violations du droit international. Mais la guerre nous heurte quant au prix de l’alimentation, de l’énergie, et même des devises : la pénurie induit une difficulté d’investissements, ce qui favorise à son tour la dépréciation et l’inflation – vous comprenez le cercle vicieux qui s’ensuit.
De là notre position : le conflit doit se terminer le plus rapidement possible. Au-delà de la condamnation de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, nous souhaitons mettre l’accent sur cet objectif. Le conflit prolonge, pour l’Amérique latine, les terribles dynamiques induites par la pandémie – endettement, basse croissance, inflation.
L’Argentine et le Brésil ont été frappé par une sécheresse historique ces trois dernières années, et un accroissement inquiétant de certains indicateurs comme celui de l’anémie. Je rappelle que nous ne sommes pas les principaux responsables de la crise climatique. Ce sont les pays du Nord global – Europe, Amérique, Russie et Chine – qui y contribuent le plus. Je pense qu’on ne peut comprendre la position latino-américaine sans ces coordonnées à l’esprit.
LVSL – L’Argentine et le Brésil ont annoncé la mise en place d’une devise commune, destinée à contrebalancer l’hégémonie du dollar. S’inscrit-elle dans le cadre de cette intégration régionale ?
CN – L’intégration ne peut rester cantonnée à l’accroissement des flux de biens et de services. Elle doit avoir trait aux forces de travail, à la mobilité et aux questions financières – qui peut déboucher sur une intégration par la monnaie. L’Europe s’est fondée sur ce principe, ce qui a eu pour avantage de stabiliser les économies autour d’une monnaie commune stable – même si cela a pris cinquante ans. Pouvons-nous aspirer à un horizon similaire ? Pourquoi pas ! Il faut bien sûr prendre en compte les spécificités monétaires de chaque pays, mais si l’intégration par la monnaie peut accroître le bien-être des pays, en l’occurrence le Brésil et l’Argentine, alors c’est un chemin qu’il faut suivre.
LVSL – Que pensez-vous de la proposition d’accord de libre-échange entre le MERCOSUR et l’UE ? N’irait-il pas à l’encontre de cette volonté d’indépendance régionale ? Ne compromettrait-il pas les ambitions écologiques affichées par les membres du Grupo de Puebla ?
CN – Tout dépend de la manière dont on pose le problème. Il faut songer à un traité qui ne soit pas simplement un accord de libre-échange. C’est presque systématiquement le cas lorsqu’on parle des accords entre blocs régionaux, et c’est un problème : il faut des règles, qui d’une manière ou d’une autre bénéficient à tout le monde.
Il faut ainsi veiller aux intérêts de chaque partie, et s’attarder sur les questions qui sont sensibles pour les uns et les autres : la politique agraire pour l’Union européenne et le degré de protection qu’elle requiert, des investissements dans notre région qui nous permettraient de développer des filières correspondant aux critères écologiques de l’Europe en matière d’émissions carbone ou de lutte contre la déforestation.
LVSL – Comme secrétaire d’État à la lutte contre le changement climatique d’Argentine, que pensez-vous du concept de « d‘endettement pour cause écologique », proposé par le président colombien Gustavo Petro ?
CN – Je l’approuve, bien sûr. Le président Nestor Kirchner, en son temps, avait déjà avancé que nous étions les créanciers environnementaux de nos créanciers financiers : l’Amérique latine est riche de ressources écosystémiques sur lesquelles l’économie du nord est fondée ! On peine cependant à voir un système financier qui émergerait sur ces principes, quand bien même des avancées sont faites ici et là. Elles ne sont pas à la hauteur des investissements dont nous avons besoin pour transformer notre matrice productive – surtout si nous voulons le faire de manière socialement acceptable.
LVSL – Comment définiriez-vous l’attitude de l’administration Biden à l’égard de l’Amérique latine ? L’arrivée au pouvoir des démocrates a-t-elle changé la donne par rapport à l’ère Trump ?
CN – Si nous partageons davantage de valeurs avec l’administration Biden quant à sa politique interne – une attention portée aux classes défavorisées, aux travailleurs -, le problème réside dans le fait que la politique étrangère des États-Unis, quant à l’Amérique latine, repose souvent sur des principes distincts. Ainsi, je pense que la politique latino-américaine des États-Unis n’a pas tellement changé.
Bien sûr, Trump a causé d’immenses dommages en soutenant, pour des raisons idéologiques, des gouvernements de droite. C’est quelque chose de relativement clair si l’on considère le prêt historique de 44 milliards de dollars accordé par le FMI à l’Argentine, sous la présidence de Mauricio Macri, ce qui était totalement irresponsable. Les yeux rivés sur sa seule réélection, Macri a accru l’endettement de générations et de générations d’Argentins. Cette administration est sensiblement plus responsable, mais disons que d’une manière générale, les changements ne sont pas structurants.
LVSL – Un mot sur la montée en puissance d’une forme libertarienne d’extrême droite au Brésil ?
CN – Dans ce contexte de polarisation, notre rôle est plus important que jamais. Non pour accroître les crispations déjà existantes, mais pour défendre la conception que nous nous faisons de la société. Cette extrême droite n’a pas de projet cohérent : ce sont surtout des cris et des slogans, qu’il ne coûte rien de déclamer. En Argentine, le leader d’extrême droite Javier Milei prétend rien de moins que dollariser l’économie – ce qui n’a pas le début du commencement d’un fondement théorique ! -, instituer un marché des organes, ou encore mettre fin à l’investissement dans la santé et l’école publique. C’est contre ces discours que nous sommes utiles, moins pour apporter des informations que des certitudes dans ce contexte si incertain. En Argentine, où nous avons réussi à instituer un filet de sécurité qui permette aux plus pauvres d’avoir accès une fraction, même infime, de la richesse nationale : nous ne pouvons permettre que l’on menace notre tissu social de la sorte.