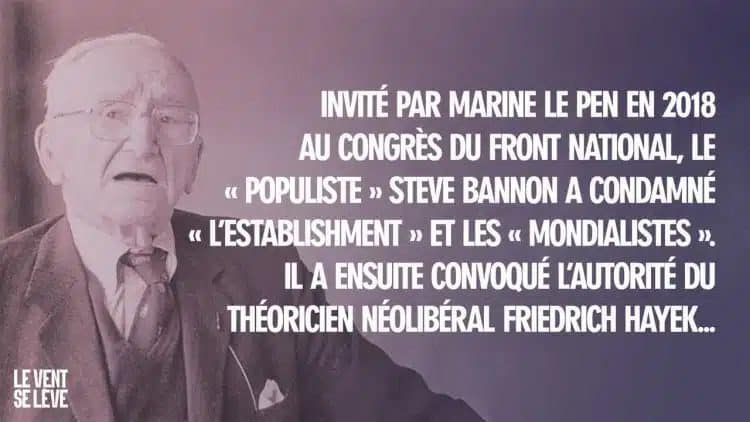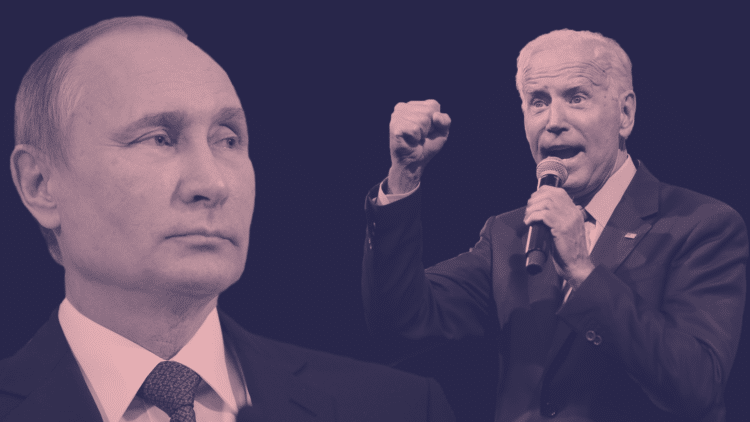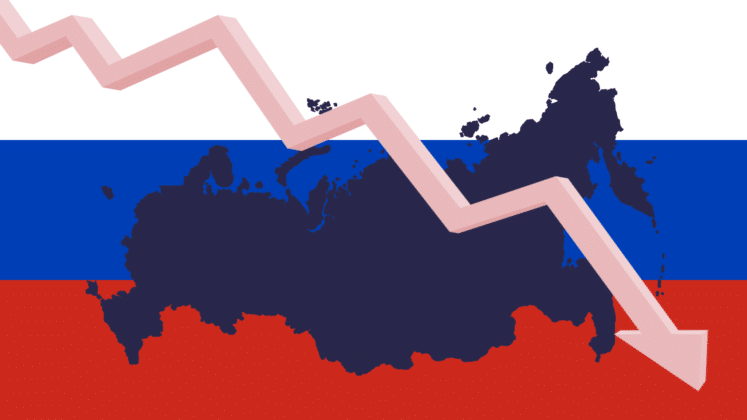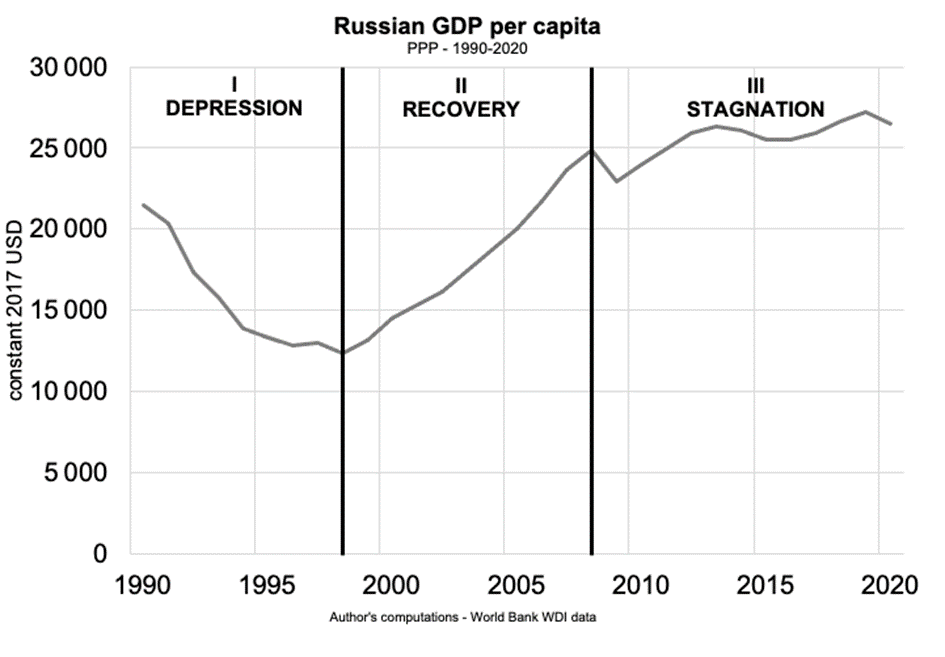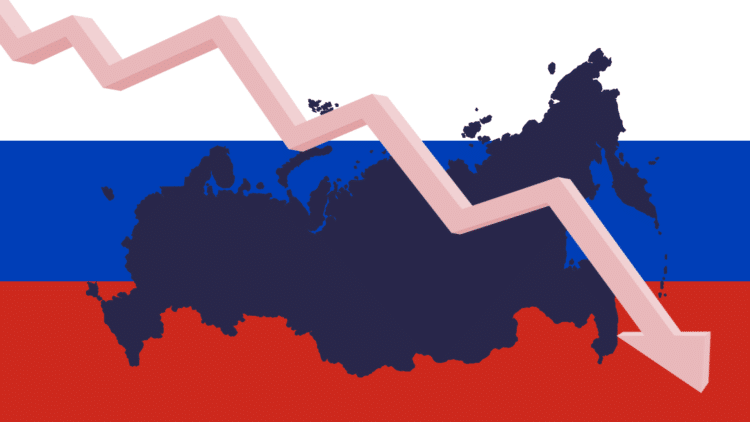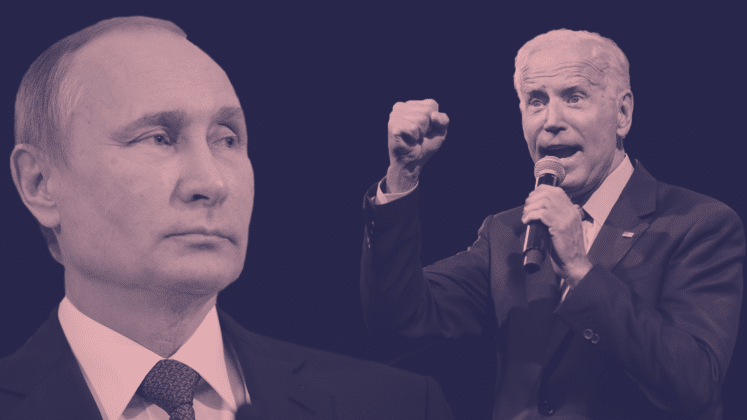Marquée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, puis par la partition de la Guerre Froide, l’Allemagne a longtemps été un pays pacifiste. En quelques mois à peine, la guerre en Ukraine a totalement rebattu les cartes. Alors que le conflit présente un risque de dégénérer en guerre nucléaire, les discours appelant à la retenue et à la diplomatie passent désormais pour un soutien à la dictature de Poutine. Les Verts, pourtant historiquement pacifistes, sont à l’avant-garde de cette évolution inquiétante, fruit de décennies de soft power américain. Article du sociologue Wolfgang Streeck, publié par la New Left Review, traduit par Alexandra Knez et édité par William Bouchardon.
Le 17 octobre, le Chancelier fédéral Allemand Olaf Scholz a invoqué le privilège constitutionnel que lui confère l’article 65 de la Grundgesetz (la Constitution allemande) pour « définir les orientations » de la politique de son gouvernement. Les chanceliers ne le font que rarement, voire pas du tout ; la sagesse politique veut que vous soyez éliminé à la troisième tentative. Il en allait de la durée de vie des trois dernières centrales nucléaires allemandes. L’objet de ce recours au « 49.3 allemand » ? Revenir sur la fermeture prévue des centrales nucléaires d’ici la fin 2022, inscrite dans la loi en 2011 par le gouvernement d’Angela Merkel à la suite de l’accident de Fukushima et destiné à attirer les Verts dans une coalition avec son parti. Désormais au gouvernement avec le SDP (centre-gauche) et le FDP (libéraux), les Verts ont refusé de lâcher leur trophée, craignant les accidents et les déchets nucléaires, mais aussi leurs électeurs de la classe moyenne aisée. Le FDP a quant à lui demandé, compte tenu de la crise énergétique actuelle, que les trois centrales – qui représentent environ 6 % de l’approvisionnement électrique de l’Allemagne – soient maintenues en activité aussi longtemps que nécessaire, c’est-à-dire indéfiniment. Pour mettre un terme aux disputes, Scholz a transmis un ordre aux ministères concernés, déclarant officiellement que la politique du gouvernement était de maintenir les centrales en activité jusqu’à la mi-avril de l’année prochaine. Les deux partis ont plié l’échine, ce qui a permis de sauver la coalition pour le moment.
Or, si les Verts sont vent debout contre l’énergie nucléaire, ils semblent bien moins préoccupés par l’arme atomique. Alors que la menace nucléaire dans le cadre du conflit en Ukraine est réelle, les Verts n’hésitent en effet pas à participer pleinement à la surenchère guerrière qui fait monter les tensions. Un positionnement qui leur a valu des critiques acerbes de la part de Sahra Wagenknecht, figure de la gauche allemande, qui les a récemment qualifié de « parti le plus hypocrite, le plus distant, le plus malhonnête, le plus incompétent et, à en juger par les dégâts qu’il cause, le plus dangereux que nous ayons actuellement au Bundestag ».
Pour eux, le renversement du régime Poutine est nécessaire, afin de livrer ce dernier à la Cour Pénale Internationale de La Haye pour qu’il y soit jugé. Une perspective non seulement fantaisiste (la Russie, tout comme les Etats-Unis, n’a pas ratifié le statut de Rome, qui en est à l’origine, ndlr), mais également très risquée au vu des dommages qu’une escalade nucléaire en Ukraine causerait, et ce qu’elle signifierait pour l’avenir de l’Europe et, en l’occurrence, de l’Allemagne. À quelques exceptions près, les élites politiques allemandes, tout comme leurs médias de propagande, ignorent ou font semblant d’ignorer l’état actuel de la technologie des armes nucléaires ou le rôle attribué à l’armée allemande dans la stratégie et la tactique nucléaires des États-Unis.
La menace nucléaire sous-estimée ?
Or, après le tournant historique de la politique étrangère allemande (Zeitenwende) décidé par Scholz, l’Allemagne se déclare de plus en plus prête à devenir la nation phare de l’Europe. Dès lors, sa politique intérieure devient plus que jamais une question d’intérêt européen. La plupart des Allemands se représentent la guerre nucléaire comme une bataille intercontinentale entre la Russie (anciennement l’Union soviétique) et les États-Unis, avec des missiles balistiques porteurs d’ogives nucléaires traversant l’Atlantique ou le Pacifique. L’Europe pourrait être touchée ou non, mais comme le monde serait de toute façon plongé dans un abîme, il semble inutile d’envisager cette possibilité. Craignant peut-être d’être accusés de « Wehrkraftzersetzung » (subversion de la force militaire, passible de la peine de mort pendant la Seconde Guerre mondiale, ndlr), aucun des « experts en défense » allemands, soudainement très nombreux, ne semble disposé à prendre au sérieux les avertissements de Joe Biden, qui évoque un « Armageddon » en cas d’usage de l’arme nucléaire.
Si une escalade nucléaire venait à avoir lieu, une arme de choix est une bombe nucléaire américaine appelée B61, conçue pour être larguée depuis des avions de chasse sur des installations militaires au sol. Bien qu’ils aient tous juré de se consacrer « au bien-être du peuple allemand [et] de le protéger contre tout danger », aucun membre du gouvernement allemand ne souhaite parler des possibles retombées que pourrait produire l’utilisation d’une B61 en Ukraine. Au vu du risque d’élargissement du conflit récemment posé par l’explosion d’un missile en Pologne, la question mérite pourtant d’être posée : où donc les vents porteraient-t-ils les retombées radioactives ? Combien de temps la zone entourant un champ de bataille nucléaire serait-elle inhabitable ? Combien d’enfants handicapés naîtrait-il à cet endroit et aux alentours dans les années qui suivrait une telle attaque ? Tout cela pour que la péninsule de Crimée puisse rester ou redevenir propriété de l’Ukraine…
Il est assez remarquable que les Verts, défenseurs invétérés du « principe de précaution », n’aient toujours pas appelé à des précautions pour protéger la population allemande ou européenne contre la contamination nucléaire.
Ce qui est en revanche clair, c’est que, comparé à une guerre nucléaire, même localisée, l’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 (qui a accéléré la progression des Verts en Allemagne) apparaît tout à fait négligeable dans ses effets. Il est assez remarquable que les Verts, défenseurs invétérés du « principe de précaution », n’aient d’ailleurs toujours pas appelé à des précautions pour protéger la population allemande ou européenne contre la contamination nucléaire, par exemple en constituant des stocks de compteurs Geiger ou de comprimés d’iode. Après l’expérience du Covid-19, un tel silence est pour le moins surprenant.
Pourtant, l’Occident se prépare à l’éventualité d’une guerre nucléaire. À la mi-octobre, l’OTAN a organisé un exercice militaire appelé « Steadfast Noon », décrit par le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) comme un « entraînement annuel aux armes nucléaires ». L’exercice a réuni soixante avions de chasse de quatorze pays et s’est déroulé au-dessus de la Belgique, de la mer du Nord et du Royaume-Uni. « Face aux menaces russes d’utiliser des armes nucléaires », explique le FAZ, « l’Alliance a activement et intentionnellement diffusé des informations sur l’exercice pour éviter tout malentendu avec Moscou, mais aussi pour démontrer son état de préparation opérationnelle ». Au cœur de l’opération se trouvaient les cinq pays qui ont conclu un « accord de participation nucléaire » avec les États-Unis : l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la Turquie. Cet accord prévoit que certains de leurs avions de chasse transportent des bombes B61 américaines vers des cibles désignées par le Pentagone. Une centaine de B61 seraient stockés en Europe, sous la garde de troupes américaines. L’armée de l’air allemande maintient ainsi une flotte de bombardiers Tornado consacrée à la « participation nucléaire ». Mais ces avions sont considérés dépassés et vieillots. Lors des négociations pour la formation de la coalition actuellement au pouvoir Outre-Rhin, l’actuelle ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock (écologiste), a exigé que les Tornados soient remplacés dès que possible par trente-cinq bombardiers furtifs américains F35. Ceux-ci sont désormais commandés et seront probablement livrés dans environ cinq ans, pour un prix de huit milliards d’euros, au grand dam des Français qui avaient espéré obtenir une part du marché. L’entretien et les réparations devraient coûter deux ou trois fois ce montant pendant la durée de vie des avions.
Il est important de préciser en quoi consiste « Steadfast Noon » : les pilotes apprennent à abattre les avions intercepteurs de l’ennemi et, lorsqu’ils sont suffisamment proches de la cible, à effectuer une manœuvre compliquée, le fameux lancement « par-dessus l’épaule ». S’approchant à très basse altitude, avec une bombe nucléaire attachée sous leur fuselage, les avions inversent soudainement leur direction en effectuant une boucle avant, libérant la bombe au sommet de leur ascension. La bombe continue alors dans la direction initiale de l’avion, jusqu’à ce qu’elle tombe dans une courbe balistique éradiquant ce qu’elle est censée éradiquer au bout de sa trajectoire. L’avion est alors déjà sur son chemin de retour supersonique, ayant évité la vague provoquée par l’explosion nucléaire. Terminant sur une note positive pour ses lecteurs, le FAZ a par ailleurs révélé que des « bombardiers stratégiques à longue portée B-52 » des États-Unis, « conçus pour les missiles nucléaires pouvant être largués à haute altitude », ont également participé à l’exercice.
Les discours militaristes ont le vent en poupe
Derrière les déclarations publiques de la coalition au pouvoir, les partis au pouvoir en Allemagne débattent en coulisses de la meilleure façon d’éviter que le peuple ne se mèle d’enjeux aussi cruciaux. Le 21 septembre, l’un des rédacteurs en chef du FAZ, Berthold Kohler, un partisan de la ligne dure, a noté que même parmi les gouvernements occidentaux « l’impensable n’est plus considéré comme impossible ». Selon lui, au lieu de se soumettre au chantage nucléaire de Poutine, les « hommes d’État » occidentaux doivent faire preuve de « plus de courage… si les Ukrainiens insistent pour libérer leur pays tout entier », une insistance qui semble aujourd’hui interdit de contester, faute de passer pour un soutien de Poutine. Tout « arrangement avec la Russie aux dépens des Ukrainiens » – sans doute inévitable lorsque s’engageront des négociations de paix – équivaudrait selon Kohler à « trahir les valeurs et les intérêts de l’Occident ». Pour rassurer ceux de ses lecteurs qui préfèrent néanmoins vivre pour leur famille plutôt que de mourir pour Sébastopol – et à qui l’on raconte que Poutine est un fou génocidaire imperméable aux arguments rationnels – Kohler rapporte qu’à Moscou, la crainte d’un « Armageddon nucléaire dans lequel la Russie et ses dirigeants brûleraient également » est suffisante pour que l’Occident soutienne à fond la vision de Zelensky concernant l’intérêt national ukrainien.
Quelques jours après cet article, l’un des rédacteurs de Kohler, Nikolas Busse, rappelait toutefois que « le risque nucléaire augmente », soulignant que « l’armée russe dispose d’un grand arsenal d’armes nucléaires plus petites, dites tactiques, adaptées au champ de bataille ». Selon Busse, la Maison Blanche « a averti la Russie, par des voies directes, de lourdes conséquences » si elle les utilisait. Il n’est toutefois pas certain que la tentative américaine « d’accroître la pression sur Poutine » ait l’effet escompté. « L’Allemagne », poursuit l’article, « sous la protection présumée de la stratégie de Biden, s’est permis un débat étonnamment frivole sur la livraison de chars de combat à l’Ukraine », faisant référence à des chars qui permettraient à l’armée ukrainienne de pénétrer en territoire russe, outrepassant ainsi le rôle assigné aux Ukrainiens dans cette guerre par procuration des Américains contre la Russie et provoquant probablement une réponse nucléaire : « Plus que jamais, il ne faut pas s’attendre à ce que les États-Unis risquent leur peau pour les aventures solitaires de leurs alliés. Aucun président américain ne mettra le destin nucléaire de sa nation entre les mains des Européens » notait très justement le journaliste. On peut d’ailleurs ici noter que les dirigeants européens mettent en revanche pleinement le destin de leurs nations entre les mains des Américains.
Les mises en garde de Busse correspondent à la limite de ce que l’establishment politique allemand est prêt à laisser entrevoir aux sections les plus éduquées de la société allemande sur les conséquences que l’Allemagne pourrait avoir à endurer si la guerre se poursuit. Mais cette frontière est en train de se déplacer rapidement. Une semaine à peine après l’article de Busse, Kohler exprimant également ses doutes sur la volonté des États-Unis de sacrifier New York pour Berlin et appelait en conséquence l’Allemagne à acquérir ses propres bombes nucléaires. Or, depuis 1945, une telle proposition a toujours paru en dehors des limites de la pensée politique admissible en Allemagne. Selon Kohler, l’acquisition de l’arme nucléaire par l’Allemagne serait à la fois une assurance contre l’imprévisibilité de la politique intérieure américaine et de sa stratégie mondiale et une condition préalable à un leadership allemand en Europe. Disposer de la bombe permettrait en effet à Berlin d’être véritablement indépendant de la France et de renforcer ses liens avec les pays d’Europe centrale comme la Pologne.
Propagande de guerre
Francfort, disait Goethe de sa ville natale, « est pleine de bizarreries ». On peut en dire de même de Berlin, ou même de l’Allemagne tout entière, aujourd’hui : ce qui semblait hier encore tabou ne l’est plus. L’opinion publique est étroitement influencée par l’alliance des partis centristes et des médias, et soutenue dans des proportions étonnantes par une censure auto-imposée de la société civile. L’Allemagne, puissance régionale de taille moyenne, apparemment gouvernée démocratiquement, est en train de se transformer en une dépendance transatlantique des grandes machines de guerre américaines que sont l’OTAN, les chefs d’état-major interarmées, le Pentagone, la NSA, la CIA et le Conseil national de sécurité. Lorsque, le 26 septembre, les deux gazoducs Nord Stream ont été touchés par une attaque sous-marine, les tenants du pouvoir ont tenté pendant quelques jours de convaincre le public allemand que l’auteur de l’attaque ne pouvait être que Poutine, dans le but de démontrer aux Allemands qu’il n’y aurait pas de retour au bon vieux temps du gaz russe bon marché. Une affirmation crédible seulement pour les plus crédules : pourquoi Poutine se serait-il volontairement privé de la possibilité, aussi minime soit-elle, d’attirer à nouveau l’Allemagne vers la dépendance énergétique, et ce dès que les Allemands auraient été incapables de payer le prix faramineux du gaz naturel liquéfié (GNL) américain ? Et s’il est vraiment le commanditaire de ce sabotage, pourquoi n’aurait-il pas fait sauter les gazoducs dans les eaux russes plutôt que dans les eaux internationales, ces dernières étant plus fortement surveillées que tout autre espace maritime à l’exception, peut-être, du golfe Persique ? Pourquoi risquer qu’un escadron de troupes de choc russes soit pris en flagrant délit de sabotage, déclenchant ainsi une confrontation directe avec plusieurs États membres de l’OTAN en vertu de l’article 5 ?
L’Allemagne est en train de se transformer en une dépendance transatlantique des grandes machines de guerre américaines que sont l’OTAN, les chefs d’état-major interarmées, le Pentagone, la NSA, la CIA et le Conseil national de sécurité.
En l’absence d’un « narratif » un tant soit peu crédible, l’affaire fut vite abandonnée une semaine plus tard. Deux jours après l’explosion, le reporter d’un journal local qui se trouvait à l’entrée de la mer Baltique déclarait avoir aperçu l’USS Kearsarge – un « navire d’assaut amphibie » capable de transporter jusqu’à 2 000 soldats – quitter la Baltique en direction de l’Ouest, accompagné de deux chaloupes de débarquement ; une photo de deux des trois navires a été diffusée sur Internet. Une information qui n’a suscité absolument aucune réaction. Personne dans le monde politique allemand ou dans les médias nationaux n’y a prêté attention, en particulier publiquement. À la mi-octobre, la Suède, actuellement candidate à l’adhésion à l’OTAN, a annoncé qu’elle garderait pour elle les résultats de son enquête sur l’événement ; le niveau de sécurité de ses conclusions était trop élevé « pour être partagé avec d’autres États comme l’Allemagne ». Peu de temps après, le Danemark s’est également retiré de l’enquête menée conjointement.
Le 7 octobre, le gouvernement a dû répondre à la question d’un député Die Linke (gauche) sur ce qu’il savait des causes et des responsables des attaques sur les gazoducs. Après avoir déclaré qu’il les considérait comme des « actes de sabotage », le gouvernement a affirmé ne disposer d’aucune information, ajoutant qu’il n’en disposerait probablement pas non plus à l’avenir. En outre, « après mûre réflexion, le gouvernement fédéral est parvenu à la conclusion que des informations supplémentaires ne peuvent être fournies pour des raisons d’intérêt public ». Et ce, poursuit la réponse, parce que « les informations demandées sont soumises aux restrictions de la ‘règle du tiers’, qui concerne l’échange interne d’informations par les services de renseignement » et, par conséquent, « porte atteinte au respect du secret qui doit être protégé de telle sorte que l’intérêt supérieur de l’Etat, le Staatswohl, l’emporte sur le droit parlementaire à l’information, si bien que le droit des députés de poser des questions doit exceptionnellement passer après le respect du secret par le gouvernement fédéral ». Malgré la gravité du sabotage de Nord Stream, cette invocation du secret défense par le gouvernement allemand n’a pratiquement pas été évoquée dans les médias.
Censure et auto-censure
D’autres événements sinistres de ce genre se sont produits. Dans le cadre d’une procédure accélérée qui n’a duré que deux jours, le Bundestag (Parlement allemand, ndlr), s’appuyant sur les éléments de langage fournis par le ministère de la Justice aux mains du soi-disant libéral FDP, a modifié l’article 130 du code pénal qui considère comme un crime le fait « d’approuver, de nier ou de diminuer » l’Holocauste. Le 20 octobre, une heure avant minuit, un nouveau paragraphe a été adopté, caché dans un projet de loi bien plus large, pour ajouter les « crimes de guerre » à ce qui ne doit pas être approuvé, nié ou diminué. La coalition au pouvoir (SPD, Verts et libéraux) et la CDU/CSU ont voté pour l’amendement, Die Linke (gauche) et l’AfD (extrême-droite) ont voté contre. Aucun débat public n’a eu lieu. Au dire du gouvernement, l’amendement était nécessaire pour la transposition en droit allemand d’une directive de l’Union européenne visant à lutter contre le racisme. À deux exceptions près, la presse n’a pas rendu compte de ce qui n’est rien d’autre qu’un coup d’État juridique.
Quelles conséquences aura cette modification ? Le procureur fédéral va-t-il entamer des poursuites judiciaires contre quelqu’un pour avoir comparé les crimes de guerre russes en Ukraine aux crimes de guerre américains en Irak, « minimisant » ainsi les premiers ou des seconds ? De même, le Bureau fédéral pour la protection de la Constitution pourrait bientôt commencer à placer les « minimiseurs » de « crimes de guerre » sous observation, ce qui inclurait la surveillance de leurs communications téléphoniques et électroniques. Dans un pays où presque tout le monde, le matin suivant la Machtübernahme (prise de pouvoir par les Nazis), a salué son voisin en s’écriant « Heil Hitler » plutôt que « Guten Tag », le plus grave est qu’il y aura ce qu’on appelle aux États-Unis un « effet de refroidissement ». Quel journaliste ou universitaire ayant à nourrir une famille ou souhaitant faire avancer sa carrière risquera d’être « observé » par la sécurité intérieure comme un « minimiseur » potentiel des crimes de guerre russes ?
Les limites du politiquement correct se rétrécissent rapidement, et de manière effrayante. Comme pour la destruction des gazoducs, les tabous les plus tenaces concernent le rôle des États-Unis, tant dans l’histoire du conflit que dans son actualité.
À d’autres égards également, les limites du politiquement correct se rétrécissent rapidement, et de manière effrayante. Comme pour la destruction des gazoducs, les tabous les plus tenaces concernent le rôle des États-Unis, tant dans l’histoire du conflit que dans son actualité. Dans le discours public autorisé, la guerre ukrainienne est entièrement décontextualisée : tous les citoyens loyaux sont censés l’appeler « la guerre d’agression de Poutine », elle n’a pas d’histoire en dehors du « narratif » d’une décennie de rumination d’un dictateur fou du Kremlin pour trouver la meilleure façon d’exterminer le peuple ukrainien, tout ceci rendue possible par la stupidité, combinée à la cupidité, des Allemands qui ont succombé à son gaz bon marché. Comme je l’ai découvert lors d’une interview que j’avais donnée à l’édition en ligne d’un hebdomadaire allemand de centre-droit, Cicero, qui a été coupée sans me consulter, certains faits historiques ne semblent pas avoir droit de cité : le rejet américain de la « maison européenne commune » proposée par Gorbatchev, la destruction par les parlementaires américains du projet de « partenariat pour la paix » de Clinton avec la Russie, ou encore le rejet, pas plus tard qu’en 2010, de la proposition de Poutine d’une zone de libre-échange européenne « de Lisbonne à Vladivostok ». Autant de tentatives de dépasser l’hostilité héritée de la Guerre froide pour ouvrir une nouvelle ère de coopération entre Russie et Occident. De même, il semble interdit de rappeler que les États-Unis ont, durant la première moitié des années 1990, décidé que la frontière de l’Europe post-communiste devait être identique à la frontière occidentale de la Russie post-communiste, qui serait également la frontière orientale de l’OTAN, à l’Ouest de laquelle il ne devait y avoir aucune restriction sur le stationnement de troupes et de systèmes d’armes. Il en va de même pour les vastes débats stratégiques américains concernant les manières possibles de pousser la Russie a viser trop haut pour la déstabiliser, tels que documentés dans les rapports publics de la RAND Corporation (think tank militariste, ndlr).
Parmi d’autres exemples, citons notamment le programme d’armement sans précédent des États-Unis pendant la « guerre contre le terrorisme » qui s’est accompagné de la résiliation unilatérale de tous les accords de contrôle des armements encore en vigueur avec l’ancienne Union soviétique et les pressions américaines incessantes exercées sur l’Allemagne depuis l’invention de la fracturation hydraulique pour qu’elle remplace le gaz naturel russe par du gaz de schiste américain, d’où la décision américaine, bien avant la guerre, de mettre fin à Nord Stream 2 de quelque manière que ce soit. Citons aussi les négociations de paix qui ont précédé la guerre, y compris les accords de Minsk entre l’Allemagne, la France, la Russie et l’Ukraine, qui se sont effondrés sous la pression de l’administration Obama et de son envoyé spécial pour les relations américano-ukrainiennes, le vice-président de l’époque Joe Biden, et coïncidant avec une radicalisation du nationalisme ukrainien. Et surtout n’oublions pas le lien entre les stratégies européennes et sud-est asiatiques de Biden, notamment les préparatifs américains de guerre contre la Chine.
Un aperçu de ces intentions a été fourni par l’amiral Michael Gilday, chef des opérations navales américaines, qui, lors d’une audition devant le Congrès le 20 octobre, a fait savoir que les États-Unis devaient être prêts « pour un créneau 2022 ou potentiellement 2023 » à une guerre avec la Chine au sujet de Taïwan. Malgré l’obsession pour les États-Unis du grand public allemand, le fait qu’il soit de notoriété publique outre-Atlantique que la guerre ukrainienne est au fond une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie lui échappe complètement. Les voix de Niall Ferguson (grand historien britannique, ndlr) ou de Jeffrey Sachs (économiste américain reconnu, ndlr) mettant en garde contre la surenchère nucléaire passent inaperçues ; le premier écrivant dans Bloomberg un article intitulé « Comment la Seconde Guerre froide pourrait se transformer en Troisième Guerre mondiale », qu’aucun éditeur allemand soucieux du Staatswohl n’aurait accepté.
Les écologistes, anciens pacifistes devenus pro-guerre
Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, toute tentative de replacer la guerre en Ukraine dans le contexte d’une réorganisation du système étatique mondial apparu depuis la fin de l’Union soviétique et du projet américain de « nouvel ordre mondial » défendu par George Bush père est suspecte. Ceux qui osent le faire courent le risque d’être qualifiés de « Poutineversteher » (Poutinophile) et d’être invités dans l’un des talk-shows quotidiens de la télévision publique, pour un pseudo-équilibre face à une armada de va-t-en-guerre bien-pensants qui leur crient dessus. Au début de la guerre, le 28 avril, Jürgen Habermas, philosophe de cour des Verts, a publié un long article dans le Süddeutsche Zeitung, sous le long titre de « Tonalité criarde, chantage moral : Sur la bataille d’opinions entre les anciens pacifistes, un public choqué et un chancelier prudent après l’attaque de l’Ukraine ». Il s’y opposait au moralisme exalté et au bellicisme qui s’emparait de ses partisans, exprimant prudemment son soutien à ce qui, à l’époque, semblait être une réticence de la part du chancelier à s’engager tête baissée dans la guerre en Ukraine. Pour avoir simplement appelé au calme et à la retenue, Habermas a été férocement attaqué au sein de son propre camp, celui des écolos et progressistes pro-européens, et est resté silencieux depuis.
Ceux qui auraient pu espérer que la voix encore potentiellement influente de Habermas contribue aux efforts de plus en plus désespérés pour empêcher la politique allemande de défendre coûte que coûte sur une victoire totale de l’Ukraine sur la Russie se sont rabattus sur le leader du groupe parlementaire SPD, Rolf Mützenich, un ancien professeur d’université en relations internationales. Mützenich est devenu une figure détestée de la nouvelle coalition de guerre, à l’intérieur comme à l’extérieur du gouvernement, qui tente de le présenter comme une relique d’avant la « Zeitenwende », lorsque les gens croyaient encore que la paix pouvait être possible sans recourir à la destruction militaire de n’importe quel empire maléfique pouvant se mettre en travers du chemin de l’« Occident ». Dans un article récent publié à l’occasion du trentième anniversaire de la mort du chancelier Willy Brandt (dont le mandat avait été marqué par l’Ostpolitik, un rapprochement avec la RDA et l’URSS, ndlr), glissé dans un bulletin d’information social-démocrate, M. Mützenich mettait en garde contre l’imminence de la « fin du tabou nucléaire » et affirmait que « la diplomatie ne doit pas être limitée par la rigueur idéologique ou l’enseignement moral. Nous devons reconnaître que des hommes comme Vladimir Poutine, Xi Jinping, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan, Mohammed bin Salman, Bashar al-Assad et bien d’autres encore influenceront le destin de leur pays, de leur voisinage et du monde pendant plus longtemps que nous ne le souhaiterions ». Il sera intéressant de voir combien de temps les partisans de Mützenich, dont beaucoup de jeunes députés SPD nouvellement élus, parviendront à le maintenir à son poste.
Ce qui est tout à fait étonnant, c’est le nombre de va-t-en-guerre qui sont sortis de leur niche ces derniers mois en Allemagne. Certains se présentent comme des « experts » de l’Europe de l’Est, de la politique internationale et de l’armée et estiment qu’il est de leur devoir d’aider le public à nier la réalité proche d’explosions nucléaires sur le territoire européen. D’autres sont des citoyens ordinaires qui prennent soudain plaisir à suivre les combats de chars sur Internet et à soutenir « notre » camp. Certains des plus belliqueux appartenaient autrefois à la gauche au sens large; aujourd’hui, ils sont plus ou moins alignés sur le parti des Verts et, en cela, très bien représentés par Annalena Baerbock, aujourd’hui ministre des Affaires étrangères. Combinaison étrange de Jeanne d’Arc et d’Hillary Clinton, Baerbock est l’un des nombreux « Global Young Leaders » sélectionnés par le Forum économique mondial. Venant d’un parti supposé être pacifiste, Baerbock est pourtant totalement alignée sur les États-Unis, de loin l’État le plus enclin à la violence dans le monde contemporain. Pour comprendre cela, il peut être utile de se rappeler que ceux de sa génération n’ont jamais connu la guerre, pas plus que leurs parents. En ce qui concerne les Verts, on peut également supposer que les hommes les plus âgés ont évité le service militaire en tant qu’objecteurs de conscience jusqu’à sa suspension, notamment du fait de leur pression électorale. En outre, aucune génération précédente n’a autant grandi sous l’influence du soft power américain, de la musique pop au cinéma et à la mode, en passant par une succession de mouvements sociaux et de modes culturelles. Tous ces phénomènes ont été promptement et avidement copiés en Allemagne, comblant ainsi le vide causé par l’absence de toute contribution culturelle originale de la part de cette classe d’âge remarquablement épigone (une absence que l’on appelle par euphémisme le cosmopolitisme).
L’influence du soft power américain
En y regardant de plus près, l’américanisme culturel, y compris son expansionnisme idéaliste, s’articule autour de la promesse d’un individualisme libertaire qui, en Europe, contrairement aux États-Unis, est ressenti comme incompatible avec le nationalisme, ce dernier se trouvant être l’anathème de la gauche verte. Il ne reste donc comme seule possibilité d’identification collective qu’un vague « occidentalisme », compris à tort comme un universalisme fondé sur des « valeurs ». En réalité, il ne s’agit que d’un américanisme déployé à grande échelle qui nie les réalités peu enviables de la société américaine. L’occidentalisme est inévitablement moraliste ; il ne peut vivre qu’en hostilité avec un non-occidentalisme autrement moral, et donc immoral à ses yeux, qu’il ne peut laisser vivre et doit donc détruire. En adoptant l’occidentalisme, cette sorte de nouvelle gauche peut pour une fois espérer être non seulement du bon côté mais aussi du côté gagnant : celui de la puissance militaire américaine.
L’occidentalisme équivaut à l’internationalisation, sous un leadership américain, des guerres culturelles qui se déroulent aux Etats-Unis.
En outre, l’occidentalisme équivaut à l’internationalisation, sous un leadership américain, des guerres culturelles qui se déroulent aux Etats-Unis. Dans l’esprit occidentalisé, Poutine et Xi Jinping, Trump et Liz Truss, Bolsonaro et Meloni, Orbán et Kaczyński sont tous les mêmes, tous des « fascistes ». L’histoire riche et complexe de chaque pays se retrouve soumise aux humeurs de la vie individualiste et déracinée de l’anomie capitaliste tardive : il y a à nouveau une chance de se battre, et même de mourir pour, au minimum, les « valeurs » communes de l’humanité. Enfin se présente à nouveau une opportunité d’héroïsme qui semblait à jamais disparue dans l’Europe occidentale d’après-guerre et postcoloniale. Ce qui rend cet idéalisme encore plus attrayant, c’est que les combats et les morts peuvent être délégués à des intermédiaires, des êtres humains aujourd’hui (les soldats et civils ukrainiens), bientôt peut-être des algorithmes. Pour l’instant, on ne vous demande pas grand-chose, juste de réclamer que votre gouvernement envoie des armes lourdes aux Ukrainiens – dont le nationalisme ardent aurait, il y a quelques mois encore, répugné les cosmopolites écolos – tout en célébrant leur volonté à sacrifier leur vie, non seulement pour la reconquête de la Crimée par leur pays, mais aussi pour l’occidentalisme lui-même.
Bien sûr, pour rallier les gens ordinaires à la cause, il faut concevoir des « narratifs » efficaces pour les convaincre que le pacifisme est soit une trahison, soit une maladie mentale. Il faut également faire croire aux gens que, contrairement à ce que disent les défaitistes pour saper le moral des Occidentaux, la guerre nucléaire n’est pas une menace : soit le fou russe s’avérera ne pas être assez fou pour donner suite à ses délires, soit, s’il ne le fait pas, les dégâts resteront locaux, limités à un pays dont les habitants, comme leur président nous rassure tous les soirs à la télévision, n’ont pas peur de mourir pour leur patrie ou, comme le dit Ursula von der Leyen, pour « la famille européenne » – laquelle, le moment venu, les accueillera tous frais payés.