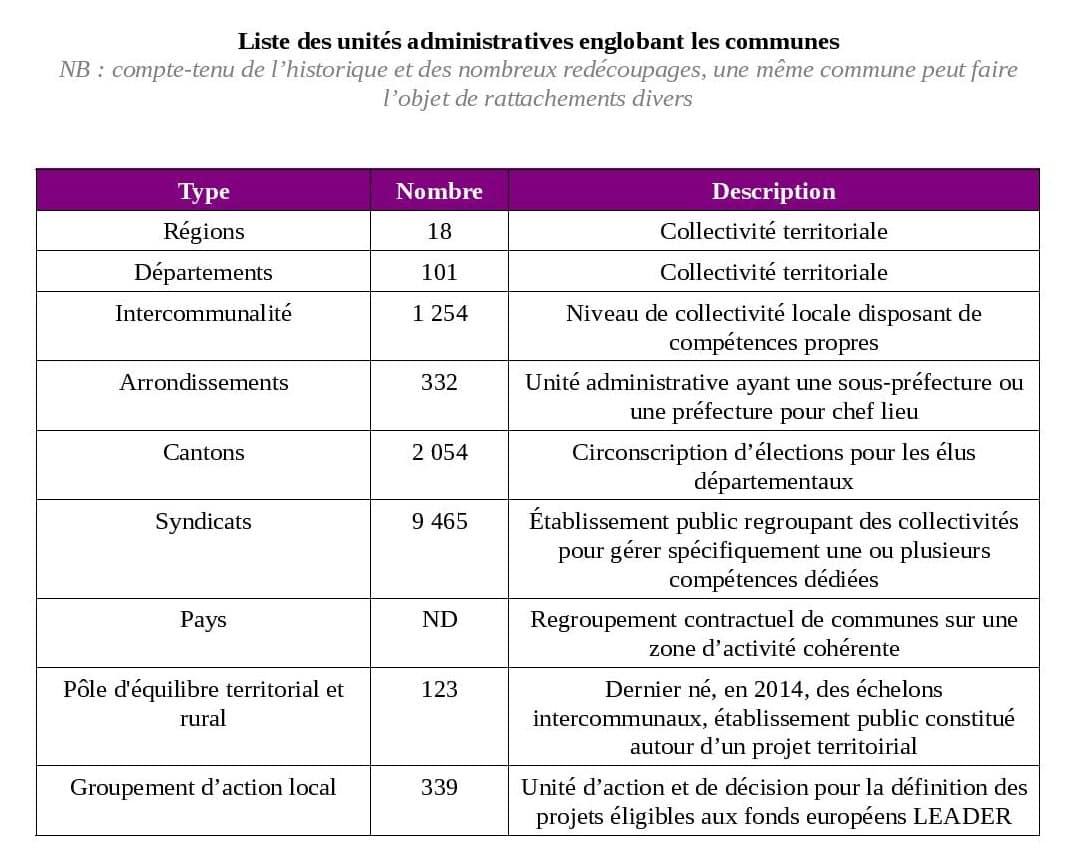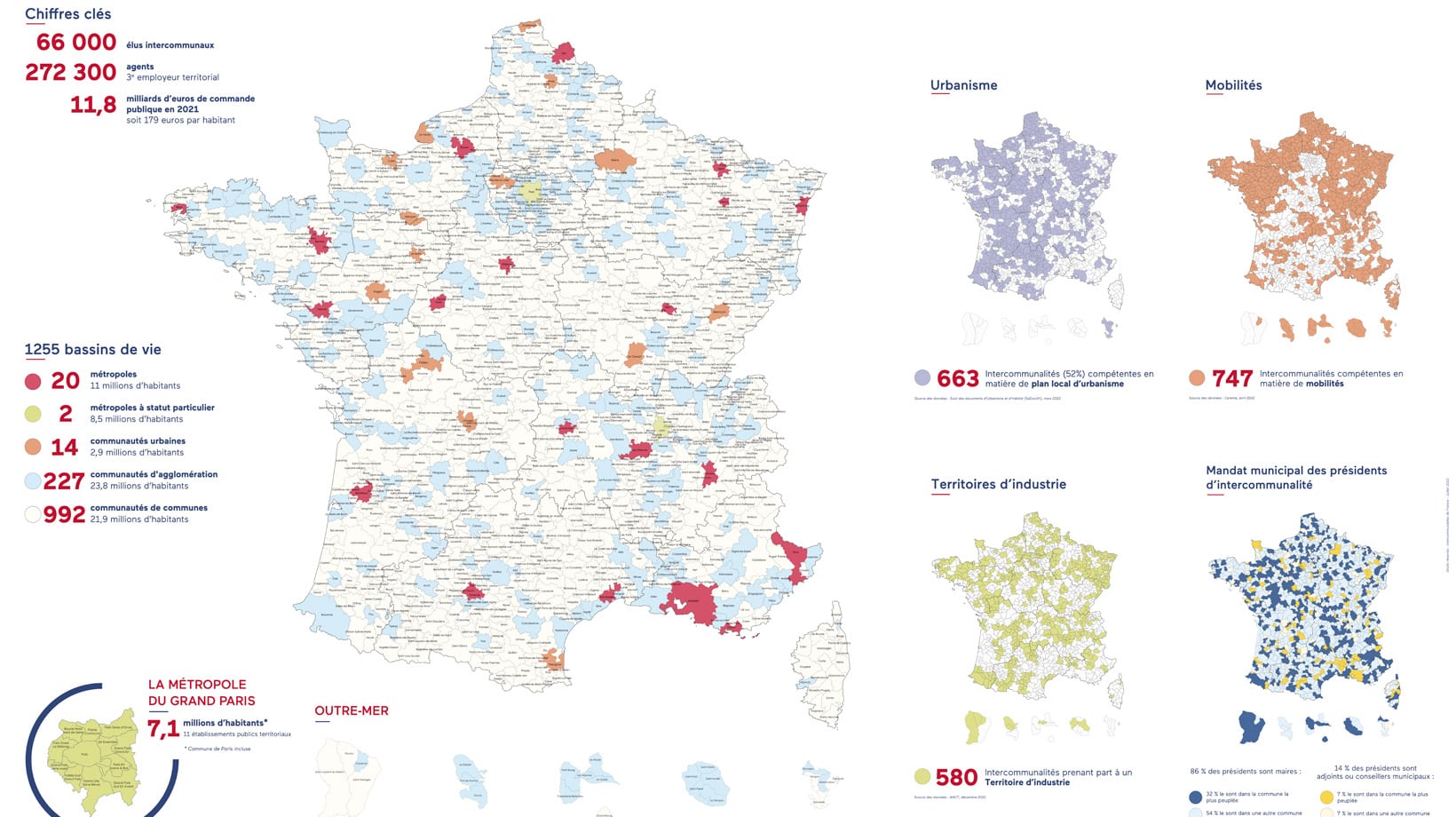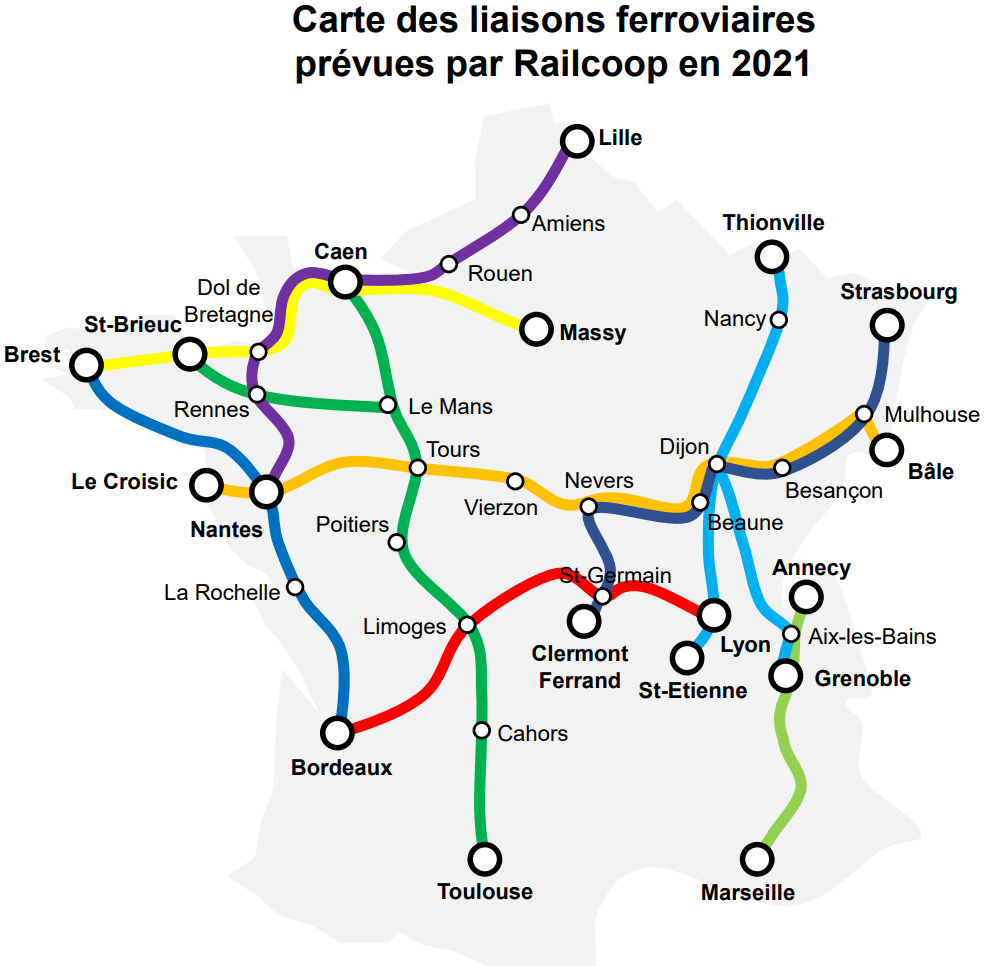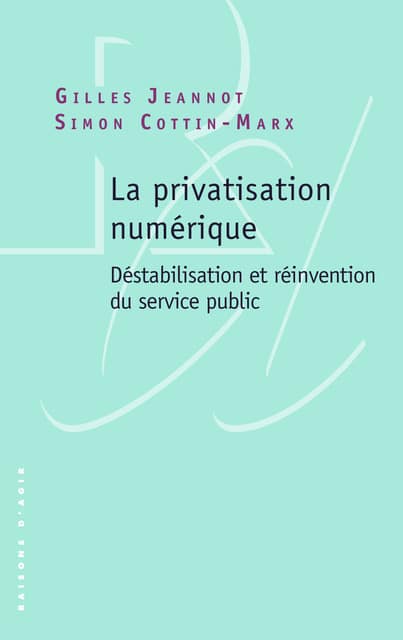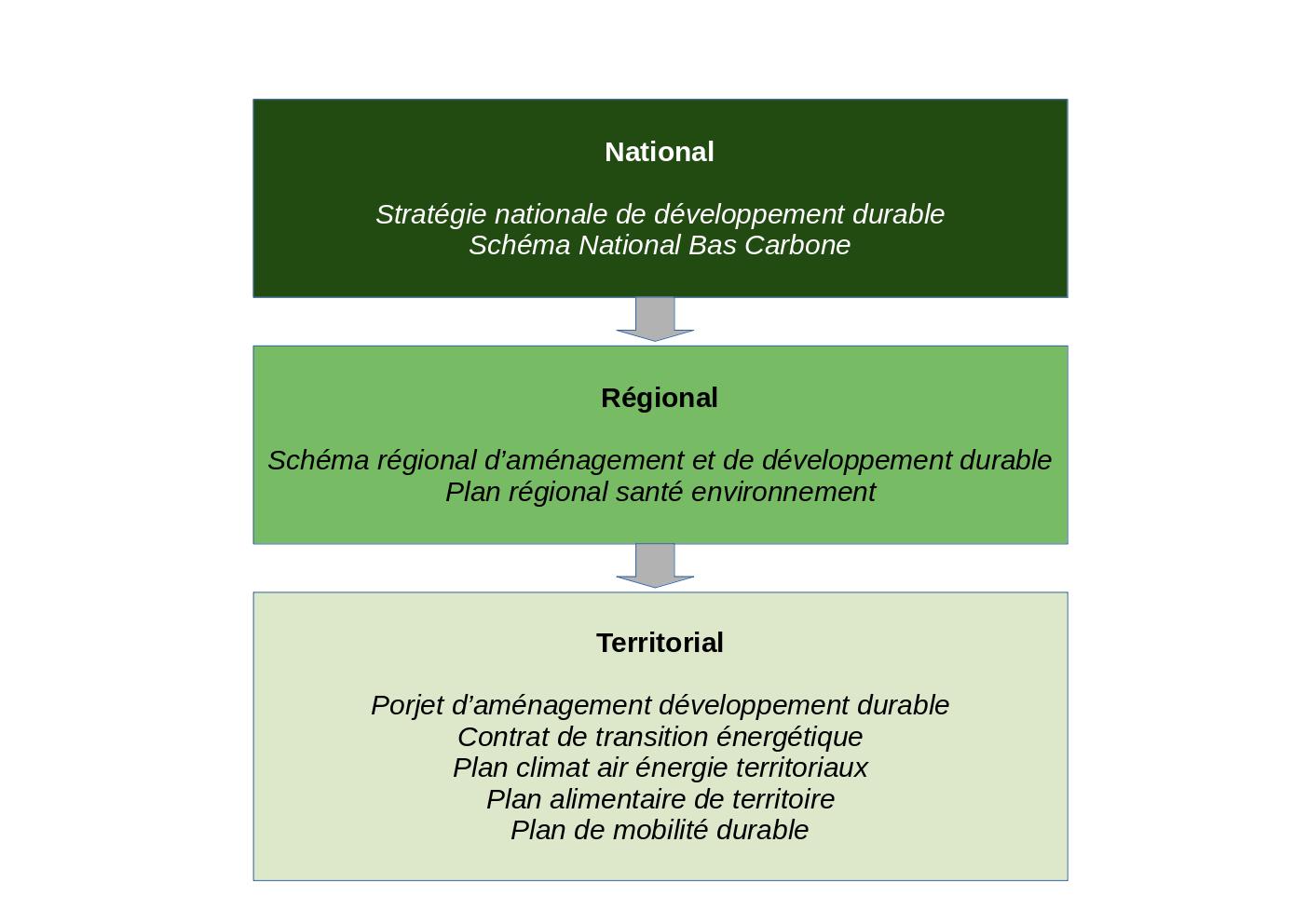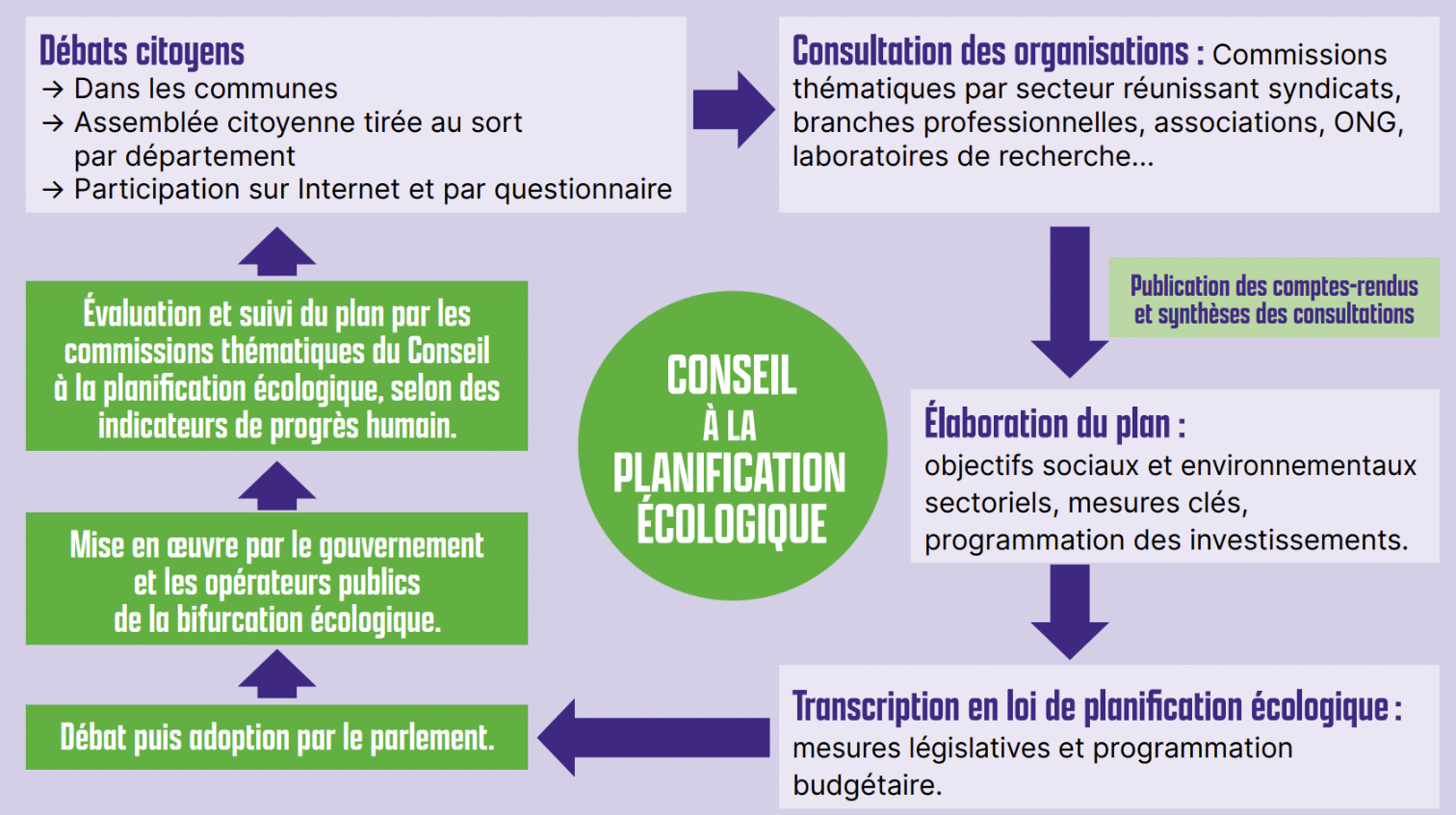En mars dernier, Emmanuel Macron annonçait les grands axes du projet de loi sur la fin de vie, à l’occasion d’un entretien donné à La Croix et Libération. Le texte, préparé par l’exécutif, devait encore être soumis au Conseil d’État, avant d’être présenté en Conseil des ministres, puis examiné par les députés fin mai. Un « cheminement démocratique » et une « réflexion transpartisane » devant aboutir « de manière très pragmatique » à la légalisation de l’aide médicale à mourir (AMM). Présentée comme l’unique solution dans les cas de fin de vie « humainement difficiles », la mesure se veut à la fois progressiste, consensuelle et courageuse. Une rhétorique qui s’avère néanmoins creuse face à l’abandon du système de santé, à l’œuvre depuis une trentaine d’années. Alors que près de 300.000 personnes décèdent chaque année sans avoir eu accès à des soins palliatifs (environ 50% des décès annuels) et que le nombre d’USP (unités de soins palliatifs) continue de diminuer en France, le projet de loi sur la fin de vie risque de fragiliser encore davantage ces unités indispensables à l’accompagnement des personnes malades.
La fabrique d’un consensus autour de la fin de vie
Le projet de loi s’inspirerait de l’avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), publié le 13 septembre 2022. Le document, intitulé « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité », évoque en effet la dépénalisation de l’AMM, tout en précisant « qu’il ne serait pas éthique d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Une précaution sur laquelle Claire Fourcade, médecin et présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) insistait, quelques jours plus tard, en rappelant que, dans l’immédiat, « nous ne manquons pas d’une loi, mais de moyens. » Pourtant, c’est précisément sur la question du « cadre d’accompagnement de la fin de vie » – autrement dit, la législation en vigueur – qu’Emmanuel Macron et sa Première ministre Élisabeth Borne, entendent intervenir, favorisant l’effet d’annonce à l’approfondissement des dispositions déjà existantes.
L’argument de l’exécutif ? Un projet de loi qui ferait consensus dans la société française. Emmanuel Macron assure avoir consulté « les patients, les familles, les équipes soignantes, la société ». Une affirmation contestée par Emmanuel de Larivière, membre du conseil d’administration de la SFAP et médecin en soins palliatifs à Bordeaux. Ce dernier nous raconte : « Il y a un an et demi, nous [la SFAP] avons créé un collectif qui réunit différentes organisations médicales pour parler de la fin de vie. Tous ces gens, qui ont été élus pour représenter les professionnels du soin, viennent apporter une réponse commune. Malgré nos sollicitations, nous n’avons été reçus qu’une seule fois par le gouvernement. La réunion n’avait pas d’ordre du jour et les personnes qui nous recevaient se sont à peine présentées. » Pour lui, « ce sont des gens qui réfléchissent seuls. »
Le 11 mars 2024, le lendemain des premières annonces, quinze associations de professionnels des soins palliatifs publiaient un communiqué commun pour dénoncer le décalage entre le projet de l’exécutif et la réalité de leur métier. Dans son entretien, Emmanuel Macron évoque un délai de deux jours pour « tester la solidité de la détermination du patient », suivis de « quinze jours maximum » pour que le médecin étudie sa demande et accepte, ou non, d’administrer le produit létal. Une proposition jugée invraisemblable par les professionnels, à plusieurs égards.
Dans la grande majorité des cas, les malades qui arrivent en soins palliatifs avec la volonté d’en finir changent d’avis, dès lors qu’ils ont été correctement pris en charge.
D’une part, la rigidité du protocole ne permet pas d’appréhender « l’ambivalence du désir de mort » auquel les soignants sont confrontés au quotidien. Pour eux, la volonté d’un malade de mettre fin à ses jours ne relève jamais d’un choix individuel, clair et définitif. Dans la grande majorité des cas, les malades qui arrivent en soins palliatifs avec la volonté d’en finir changent d’avis, dès lors qu’ils ont été correctement pris en charge. Cela implique la présence et la disponibilité d’une équipe soignante (médecins, infirmiers, aide-soignants, psychologues) pour apaiser les souffrances physiques et psychiques du patient, suivre l’évolution de sa maladie et répondre à ses craintes ainsi qu’à celles de ses proches. Emmanuel de Larivière nous confie que « souvent, derrière les demandes de mort, il y a surtout des demandes de soin et d’accompagnement. La mission des soignants est de répondre à la fois à la douleur physique et aux souffrances existentielles du patient ».
D’autre part, si le projet est adopté, les soignants devront endosser la lourde responsabilité d’accepter ou non de prescrire la mort. Or, selon eux, une telle décision ne pourrait avoir lieu sans une longue phase de prise en charge, de soin, d’observation et de dialogue avec le patient. Elle devrait également être collégiale, en accord avec la loi Leonetti de 2005 qui encadre la pratique des soins palliatifs. Dans le délai prévu par l’actuel projet de loi, ces précautions déontologiques risquent d’être difficiles à respecter, assurent les équipes soignantes.
La méconnaissance des soins palliatifs
En présentant son projet de loi comme « une vraie révolution d’humanité et de fraternité en action », Emmanuel Macron néglige l’engagement et la capacité des soignants à accompagner la fin de vie. La présidente de la SFAP, Claire Fourcade, précise, à ce titre, que « l’aide à mourir est au cœur des soins palliatifs ». Pour elle, aider à mourir consiste à préserver les derniers moments de vie, à l’inverse du projet de loi qui prévoit de les supprimer. Une substance létale serait administrée « par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsque aucune contrainte d’ordre technique n’y fait obstacle, soit par le médecin ou l’infirmier qui l’accompagne ». Ces deux situations prévues dans le texte correspondent, dans la terminologie médicale, à l’euthanasie (lorsque l’intermédiaire est un soignant) et au suicide assisté (lorsque l’intermédiaire est un tiers désigné).
Le refus du chef de l’État d’employer les termes appropriés a pour effet de maintenir le flou sur les pratiques palliatives actuelles et sur les conséquences que le projet pourrait engendrer. Depuis l’adoption de la loi Leonetti de 2005, toute personne majeure a la possibilité de rédiger, à tout moment, une directive anticipée, afin de préciser les soins médicaux qu’elle souhaiterait ou non recevoir dans le cas où elle se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Cette possibilité est souvent méconnue par la population française. D’après un sondage BVA, publié en février 2021 seulement 18% des sondés déclaraient avoir rédigé des directives anticipées. La loi bannit également l’obstination déraisonnable et définit les modalités des « arrêts de traitements ».
La loi Claeys-Leonetti de 2016 rend, quant à elle, possible, dans certains cas très précis et à la demande du patient, le recours à la sédation profonde et continue (SPC). Cette pratique consiste à endormir le malade dont le pronostic vital est engagé à court terme, afin de le soulager entièrement jusqu’à sa mort. Contrairement aux idées reçues, un patient sédaté ne perçoit plus aucun symptôme de sa maladie. Il ne ressent ni douleur, ni faim, ni soif. Il est comme anesthésié.
Un manque de soutien aux équipes soignantes
Il convient donc de se demander quelles sont les lacunes du système de santé français dans l’accompagnement des malades en fin de vie. D’abord, se pose la question de l’accessibilité des soins palliatifs. D’après un rapport sénatorial de 2021, 26 départements français (dont la Guyane et Mayotte) ne disposent d’aucune unité de soins palliatifs (USP) et trois départements ne disposent que d’un lit dédié aux soins palliatifs pour 100 000 habitants. Pourtant, depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, le nombre d’USP sur le territoire a été multiplié par trois (on est passé de 54 USP en 1999 à 164 en 2019).
En 2021, le cinquième plan national pour les soins palliatifs prévoyait d’achever le déploiement des USP afin que « plus un seul département ne soit dépourvu de structure palliative à l’horizon 2024 ». Une promesse qui ne s’est accompagnée d’aucun effort financier, au contraire. Dans son rapport de juillet 2023 consacré à l’offre de soins palliatifs, la Cour des comptes remarque qu’après une « augmentation continue du financement des soins palliatifs » ces dix dernières années, « les crédits du plan 2021-2024 ont enregistré une baisse de 10 millions d’euros ».
Aux besoins financiers s’ajoute un manque de plus en plus grand de personnel soignant. En février dernier, l’unique USP publique des Yvelines, à Houdan, fermait ses portes. Depuis un an et demi, l’unité ne fonctionnait plus qu’avec une chef de service à mi-temps. Dans un entretien au Figaro, cette dernière évoque une situation « prévisible » compte tenu des « problèmes de recrutement » et des « appels à l’aide » pendant plusieurs mois, sans réponse. Désormais, les deux seules USP du département, l’une à Versailles et l’autre à La Verrière, dépendent d’établissements privés et totalisent 22 lits pour 1,4 millions d’habitants.
Le départ massif des soignants et la difficulté de les remplacer sont symptomatiques d’une profession devenue de moins en moins attractive, en raison du manque de moyens et de la déconsidération des responsables politiques. Une fracture qui ne semble pas prête de s’apaiser : d’après une enquête réalisée par la SFAP auprès de plus de 2 000 professionnels (dont les deux tiers ne sont pas adhérents à la SFAP), 83 % des personnes se disent inquiètes face à l’évolution attendue de la loi et plus d’un médecin sur cinq travaillant en soins palliatifs songerait à quitter ses fonctions si l’aide médicale à mourir était mise en place dans son service.
Plus d’un médecin sur cinq travaillant en soins palliatifs songerait à quitter ses fonctions si l’aide médicale à mourir était mise en place dans son service.
Le risque est grand que les compétences palliatives, développées depuis les années 1980 en France, disparaissent petit à petit, faute d’effectifs et de formation suffisante. Dans un article du Monde daté de mars 2023, Elise Perceau-Chambard, professeur en médecin palliative, confirmait qu’en formation initiale, les questions relatives à la fin de vie occupent, selon les facultés « entre six et dix heures en deuxième cycle », tandis qu’elles sont inexistantes en premier cycle. Cette lacune dans la formation des étudiants explique pourquoi de nombreuses structures qui le souhaiteraient, peinent à recruter de nouveaux soignants. Dans une étude de 2020, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie établissait un décalage de 30 % entre les effectifs réels et le nombre de postes à pourvoir. Une donnée structurante pour comprendre la crise du système de santé, que la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, n’a pas évoquée lors de sa présentation du projet de loi en Conseil des ministres, le 10 avril dernier.
Des patients livrés à eux-mêmes
Réduire la question de la fin de vie à celle de la « liberté individuelle » de « choisir sa mort » reviendrait à négliger les conséquences sociales, économiques et sanitaires d’un tel projet de loi à court, moyen et long terme. À court terme, l’adoption du texte ne fera que conforter – voire légitimer – l’abdication du politique face à la dégradation du système de santé. Le volet consacré au développement des soins palliatifs témoigne en effet de l’absence d’ambition du gouvernement macroniste en matière de santé publique. Il prévoit un milliard d’euros supplémentaire dans l’organisation des soins sur dix ans, soit une augmentation de 6% par an. Un effort minime, quand on sait que 50% des malades qui décèdent chaque jour en France, n’ont pas eu accès à des soins palliatifs.
Dans son avis du 10 avril dernier, le Conseil d’État précise que « des dispositions législatives, voire réglementaires, sont insuffisantes, à elles seules, pour combler le retard constaté » et note que le texte, en tant que tel, ne comporte ni obligation de moyen, ni disposition programmatique permettant de « fixer des objectifs clairs à l’action de l’État ». Dès le mois de septembre 2023, pourtant, plusieurs députés de tous bords avaient appelé à distinguer « la criticité du développement des soins palliatifs » qui « fait aujourd’hui consensus » de l’aide à mourir, qui renvoie à des positionnements éthiques et politiques très disparates dans la société. D’après eux, voter dans le même temps pour deux projets « par essence différents » les « priverait collectivement de la liberté d’expression que [leur] confère la Constitution ».
En proposant de « regarder la mort en face », Emmanuel Macron condamne en réalité les plus vulnérables de la société.
À moyen terme, le droit de « choisir sa mort » pourrait bien se transformer en « laisser mourir », notamment pour les malades les plus isolés. Au-delà des souffrances physiques ou psychiques, qui ne peuvent être apaisées sans une prise en charge adaptée, les maladies dégénératives s’accompagnent généralement d’une perte d’autonomie et d’une dégradation des compétences cognitives (mémoire, vision, langage, gestes du quotidien…) Dans ces conditions, la volonté de mourir ne peut s’expliquer à la lumière d’une simple décision individuelle. La capacité du malade à se projeter dans l’avenir, aussi court soit-il, dépend de nombreux facteurs sociaux et économiques (soutien de l’entourage, localisation et qualité du lieu de vie…) Dans une tribune publiée dans Marianne en mai 2023, plusieurs soignants s’interrogeaient ainsi sur la place et le rôle du politique : « Faudrait-il choisir de limiter les soins des personnes lourdement malades et handicapées et leur proposer l’aide à mourir ? Ou bien faudrait-il décider de se donner collectivement les moyens, certes onéreux et exigeants, pour accompagner les personnes vulnérables dans ces périodes difficiles de leur vie ? »
Face à ces questions, la Cour des comptes pointait, deux mois plus tard, un « manque de stratégie globale, à moyen et à long terme » affectant l’efficacité de l’organisation de l’accès aux soins. Au-delà des hôpitaux, le rapport insiste sur la nécessité de mieux coordonner les acteurs (soignants et aides-soignants) au sein des schémas régionaux de santé, de rapprocher les soins des lieux de vie (à domicile et en Ehpad, notamment) et de « renforcer la sensibilisation de l’opinion à notion d’accompagnement palliatif de la fin de vie ». Autant de recommandations qui ne semblent pas avoir été prises en compte dans l’élaboration du projet de loi. En proposant de « regarder la mort en face », Emmanuel Macron condamne en réalité les plus vulnérables de la société.
Vers la normalisation de la mort administrée ?
Sur le long terme, enfin, il semble difficile d’imaginer que les conditions d’accès à l’aide à mourir ne soient pas étendues, au détriment des soins et de la culture palliative. Pour le moment, l’exécutif prévoit l’octroi de l’aide à mourir aux patients « capables d’un discernement plein et entier », atteints d’une « maladie incurable » avec « pronostic vital engagé à court ou moyen terme » et subissant des souffrances « réfractaires », c’est-à-dire qui ne peuvent être soulagées. Mais ces critères reposent en réalité sur une interprétation médicale discrétionnaire. D’après Emmanuel de Larivière, ces derniers ne pourront qu’évoluer avec le temps, puisque « de nombreux cas feront jurisprudence ».
Il suffit pour s’en convaincre d’observer l’exemple du Canada, où l’aide médicale à mourir (AMM) a été autorisée en 2016, dans des conditions proches de celles évoquées par Emmanuel Macron. Depuis 2021, le pronostic vital du demandeur n’a plus besoin d’être engagé à court terme. Désormais, toute personne souffrant d’une maladie ou d’un handicap qui « ne peut être soulagé selon les conditions qu’[elle juge] acceptables » peut demander l’AMM. Depuis 2023, enfin, les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative cognitive, comme l’Alzheimer, peuvent également y avoir accès. Entre 2022 et 2023, le nombre de demandes a augmenté de 31% entre 2021 et 2022.
Au Canada, le nombre de demandes d’AMM a augmenté de 31% entre 2021 et 2022.
En intégrant l’administration de la mort au sein même de la relation de soin, le projet de loi rend possible la normalisation de l’aide à mourir, sur le modèle canadien. Derrière un discours d’humanisme et de fraternité, emprunté au chef de l’État, plusieurs groupes d’intérêt réclament ainsi l’extension du droit à l’AMM au nom du principe de non-discrimination de la loi. Dans une tribune publiée dans Le Monde, le 10 avril dernier, les présidents de l’Association à mourir dans la dignité (ADMD) et de la MGEN réclamaient que la condition de pronostic vital engagé soit retirée du texte, pour « assurer une pleine égalité de tous devant la loi ». Fin janvier, la MGEN avait déjà envoyé une lettre aux députés, pour les convaincre de la nécessité d’une « évolution de la loi qui permette une fin de vie libre et choisie ».
Dans les prochaines années, le vieillissement de la population française et l’augmentation du nombre de maladies graves risquent de peser sur un système de santé publique déjà mal en point. Couplée à la réduction des dépenses publiques, y compris dans le domaine de la santé, la légalisation de l’aide à mourir pourrait bien conduire à la disparition des soins palliatifs au profit d’une solution moins coûteuse, préférant la mort individuelle à la vie collective.