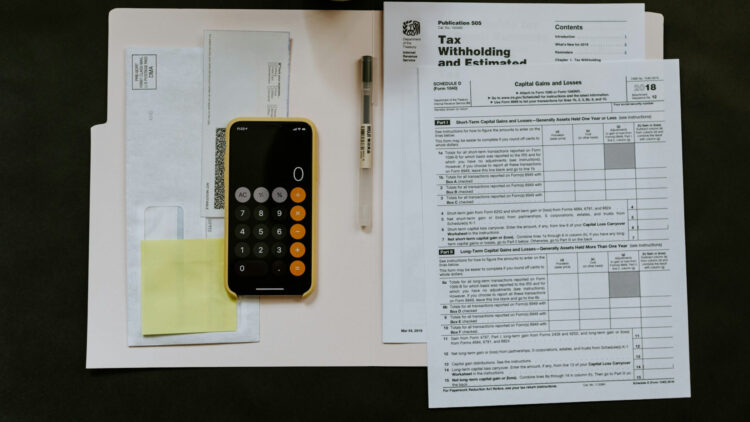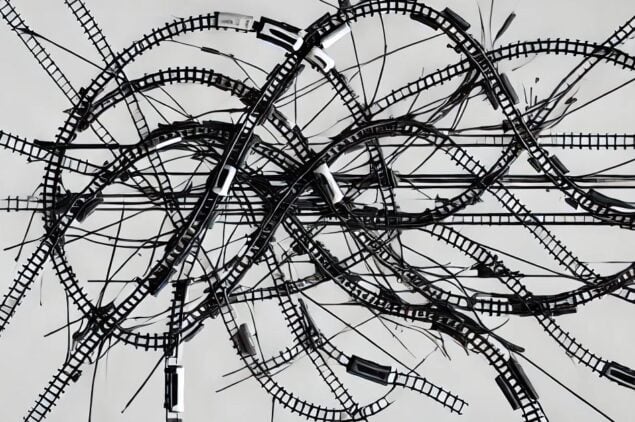Certains voudraient faire de la taxation des multinationales quelque chose d’impossible, du moins sans un certain consensus international. Pourtant, de nombreux économistes nous disent le contraire. Si l’on veut, l’on peut taxer les multinationales, et ce au niveau uniquement français s’il le faut. Ce devient une urgence économique des plus pressantes à l’heure de l’explosion des bénéfices des entreprises multinationales, que l’on se doit d’appréhender pour ce qu’elles sont : des gangsters de la fiscalité.
Le « triomphe de l’injustice fiscale »
Faisons un point sur la situation fiscale des multinationales en France. Depuis 50 ans, une double logique a conduit à une baisse brutale du taux auquel elles sont effectivement imposées. Disons le plus clairement : les multinationales sont au dessus des lois. Cet hold-up fiscal devient extrêmement préoccupant à l’heure où le CAC 40 verse 100 milliards d’euros à ses actionnaires en 2023, via de juteux dividendes ou rachats d’action. Ce manque à gagner fiscal touche en premier lieu le contribuable. Mais il touche aussi, voire surtout, les TPE (Très Petites Entreprises), les PME (Petites et Moyennes Entreprises) et les ETI (Entreprises de taille intermédiaires) qui n’ont pas les mêmes possibilités d’optimisation fiscale. Elles subissent donc une concurrence injuste et déloyale de la part des multinationales.
La première logique, la plus scandaleuse, est tout simplement celle de la fraude fiscale. En 1975, la fraude fiscale des firmes multinationales était quasiment nulle. Aujourd’hui, on estime que c’est plus de 10 % des revenus de l’impôt sur les sociétés qui sont perdus à cause de la fraude fiscale. Cela représente dans le cas de la France un manque à gagner direct de presque 10 milliards d’euros. Ainsi, Apple a dans les faits payé pour ses bénéfices dans l’Union Européenne le taux ruineux de 0,005 % d’impôts en 2014, avec la bénédiction de l’Irlande. Apple n’est qu’un exemple parmi d’autres : « Aujourd’hui, 40% des profits des multinationales sont délocalisés chaque année vers des paradis fiscaux », selon l’économiste Gabriel Zucman, les entreprises américaines étant évidemment les championnes en la matière.
La deuxième logique est plus perverse. Cette fraude fiscale, intrinsèquement liée à la libéralisation financière de la mondialisation, se couple et se recoupe avec une logique de concurrence fiscale internationale particulièrement féroce. Au delà de la fraude pure et dure fondée sur une délocalisation des profits, certains pays (l’Irlande par exemple, qui joue sur tous les tableaux de l’enfumade fiscale) baissent leurs taux d’imposition sur les sociétés (avec un taux marginal d’imposition de 12,5 % -en théorie- pour l’Irlande, avant 2024) afin d’attirer de l’activité réelle. Tout aussi dévastatrice pour l’économie, voire plus car elle correspond à une délocalisation de l’activité économique et pas uniquement des bénéfices, cette concurrence fiscale internationale est toutefois légale et rendue très aisée par la mondialisation financière. C’est encore plus vrai au sein de l’Union Européenne où la libre-circulation des capitaux est défendue bec et ongles par la Cour de Justice de l’Union Européenne. Le prix d’une telle concurrence fiscale est difficile à quantifier, car il n’est pas aisé de construire un contrefactuel permettant d’estimer les mouvements des entreprises en fonction de l’intégration financière. Le bon sens laisse toutefois à penser qu’il est énorme.
Cette concurrence fiscale internationale légale est rendue très aisée par la mondialisation financière. C’est encore plus vrai au sein de l’Union Européenne où la libre-circulation des capitaux est défendue bec et ongles par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Ces deux tendances, qui coûtent déjà très cher, ont conduit la plupart des pays du monde à baisser leurs impôts sur les sociétés, dans une course au moins-disant. Ainsi, le taux marginal de l’impôt sur les sociétés en France, c’est-à-dire la tranche la plus haute, est passé de 50 % dans les années 70 à 25 % depuis le premier quinquennat Macron. Dans tous les pays développés, ce taux marginal a été peu ou prou divisé par 2 en quarante ans. La concurrence fiscale exerce une pression à la baisse sur la fiscalité des entreprises, ce qui constitue un énorme manque à gagner fiscal, nécessairement compensé par de plus forts impôts sur les particuliers. Cela pèse, et lourdement, sur le pouvoir d’achat des ménages. C’est du gâchis, tant les bénéfices pharaoniques des multinationales opérant en France ne demandent qu’à être taxés. De plus, l’impuissance à récolter les impôts remet en cause la notion même d’État-nation, tant la capacité à lever l’impôt est un principe autant caractéristique que fondateur de la souveraineté.
D’aucuns présentent cette émasculation fiscale comme étant inévitable, voire comme étant un mal pour un bien selon le principe religieux du « ruissellement ». La capacité des États à retrouver des capacités de taxation raisonnables est primordiale. En effet, si les multinationales ne paient rien ou presque rien, c’est forcément le contribuable moyen qui hérite de l’addition. Ce n’est évidemment ni juste ni soutenable, et ce d’autant plus que conjointement à cette baisse de l’impôt, les multinationales sont de plus en plus subventionnées, avec le cas extrême de Sanofi qui a touché plus d’un milliard de Crédit Impôt Recherche sur les 10 dernières années.
Il serait pour le moins démagogique d’avancer qu’il est facile de taxer les multinationales. Mais ce n’est pas facile non pas parce que les États sont réellement impuissants à le faire, mais parce qu’ils abandonnent leur puissance à le faire. Pire, dans le cas des États-Unis ou de la Chine par exemple, c’est parce qu’ils utilisent le pouvoir étatique pour favoriser la fraude fiscale de leurs grands groupes. Pour inverser la tendance, deux cas de figure sont à appréhender. Le premier est celui d’une hypothétique coopération internationale quasi-unanime, où tous les États ou presque voudraient de bonne foi plus taxer les multinationales. Le deuxième est unilatéral.
L’échec programmé de la perspective mondiale
Certains libéraux tentent de faire croire, non sans un certain succès, que seul un alignement des planètes permettrait de taxer les multinationales comme on le souhaiterait. Il faudrait dans cette perspective que la quasi totalité des États se mettent d’accord sur cette nécessité, ce qui, évidemment, a peu de chances d’arriver, en témoigne l’accord sur la taxation des multinationales de l’OCDE datant de 2021
Annoncé en grande pompe à l’automne 2021, l’accord multilatéral porté par l’OCDE s’est révélé pour le moins décevant. Il faut dire en premier lieu que l’ambition était modeste. Plus précisément, si Biden avait initialement proposé un taux de 21 % des bénéfices, l’Europe et le Congrès Américain ont fait pression à la baisse (Bruno Le Maire, alors Ministre de l’Économie, proposant même un taux ruineux de 12,5%). Avec un taux finalement très faible (15%), proche de celui de l’Irlande (12,5%), cet accord avait comme principal objectif affiché l’harmonisation, en fixant un taux permettant d’éviter le dumping fiscal le plus outrancier, sans pour autant donner de véritable marge de manœuvre fiscale aux États qui le souhaiteraient. Mais même cet objectif au rabais ne sera jamais concrétisé. En effet, les États-Unis ont, une fois n’est pas coutume, signé un accord qu’ils n’ont pas ratifié (et qu’ils, selon toute vraisemblance, ne ratifieront probablement jamais). Ils ont donc demandé un délai ; l’accord était censé rentrer en vigueur en 2024, les autres États signataires ont accepté de décaler l’application de la plupart de ses dispositions à 2026. La facilité avec laquelle les États-Unis ont obtenu que l’application de l’accord soit décalée met sérieusement en doute la pensée que les États signataires ont vraiment l’intention et la volonté de l’appliquer réellement un jour.
Annoncé en grande pompe à l’automne 2021, l’accord multilatéral porté par l’OCDE s’est révélé pour le moins décevant.
Au delà même de sa non-application probable, l’accord était avant tout esthétique pour ne pas dire cosmétique tant, derrière l’annonce, les astérisques de l’accord prévoyaient, voire programmaient, son inefficacité, au point où des paradis fiscaux comme les îles Caïman l’ont signé. Ainsi, « l’exonération pour substance » (carve-out substance) prévoit que 10 % des activités de chaque multinationale ne soient pas pris en compte dans l’application de l’accord. Plus grave encore, l’accord ne prévoit rien contre les subventions aux entreprises. Autrement dit, les îles Caïman ne devraient plus, si l’accord venait à être appliqué, pouvoir taxer à taux 0 les multinationales américaines. Par contre, elles auraient totalement le droit de les taxer à 15 % puis de redonner les mêmes 15 % aux entreprises d’une manière ou d’une autre. Ce talon d’Achille de l’accord le vide de tout intérêt. En effet, mêmes si les subventions aux entreprises sont en principe interdites par les règles du commerce international, il y a longtemps que l’OMC ne joue plus aucun rôle pour intervenir. Plus coriace historiquement, l’Union Européenne a elle aussi clairement montré son intention d’être plus souple en la matière, après le Inflation Reduction Act agressif des États-Unis de 2022. Toujours est-il que ces deux aspects rendent l’accord inutile. Blague, fiasco, mascarade ? Les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser cet accord qui a eu pour unique objectif et malheureusement pour unique effet de faire croire que les pays de l’OCDE voulaient sérieusement lutter contre la délocalisation fiscale, croyance vite déçue.
L’approche unilatérale de la taxation
L’approche multilatérale mondiale étant à exclure, il reste à appréhender le cas où quelques États (le Brésil, l’Espagne, la Grèce et même le Royaume-Uni peuvent être des alliés intéressants dans cette perspective) souhaiteraient plus taxer les multinationales. Le raisonnement est le même dans le cas où la France seule, ou un quelconque autre pays, déciderait de s’y mettre. Le principe d’une taxation des multinationales est finalement assez simple. Il suffit en fait de revenir à la manière dont elles sont en principe taxées et à comment elles évitent cette manière de payer.
L’impôt sur les sociétés porte sur le bénéfice des entreprises. Or, certaines multinationales ne déclarent aucun bénéfice en France mais la quasi-totalité en Irlande, au Luxembourg ou au Pays-Bas. Évidemment, ce n’est pas parce qu’Apple ou Google ne sont pas rentables en France et extrêmement rentables dans les pays à faible taxation, mais parce qu’ils délocalisent leurs bénéfices. Comment le font ils ? Ils utilisent une arme que seules les multinationales ont dans leur arsenal, celle des prix de transferts. Le principe est simple mais vicieux : lorsque la filiale irlandaise facture la filiale française, elle lui fait payer un prix exorbitant et totalement déconnecté du service effectivement rendu, de manière à équilibrer parfaitement les comptes de la filiale française, qui n’est donc pas redevable de l’impôt sur les bénéfices. La multinationale peut donc déclarer l’intégralité de ses bénéfices dans les pays à faible taxation, comme l’Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas. C’est par ce biais-là que les entreprises transnationales esquivent l’impôt sur les sociétés d’une manière qui n’est pas accessible aux entreprises nationales, qui par définition n’ont pas de filiale dans les pays à faible taxation.
Il suffit donc, dans le cas des multinationales, de prendre un autre critère que le bénéfice pour les taxer, sous réserve que leur bénéfice mondial soit strictement positif. Il s’agit de prendre en compte le nombre d’employés, la quantité de capital ou le chiffre d’affaires (ou une pondération des trois) pour taxer ce qui n’aurait pas été taxé à l’étranger, en fonction de l’activité sur le territoire français. Explicitons le mécanisme par un exemple : imaginons qu’une entreprise américaine réalisant 10 % de son activité en France délocalise ses bénéfices dans un pays où l’impôt sur les sociétés n’est que de 5 % au lieu des 25 % français. La France pourrait lui demander de régler 2 % de ses bénéfices mondiaux en impôts, correspondant aux 10 % (part de la France dans l’activité de la multinationale) du différentiel de 20 points d’imposition que l’entreprise a évité en défiscalisant.
Cet audacieux principe, proposé entre autres par Gabriel Zucman (considéré comme le meilleur jeune économiste du monde), a l’énorme mérite d’éviter aux administrations fiscales de se questionner sur la légitimité des prix de transferts pour sanctionner les abus, qui sont extraordinairement complexes du fait des montages opérés par les avocats fiscalistes des multinationales, exploitant les moindres failles juridiques françaises ou européennes.
Ce nouveau moyen pour taxer les multinationales s’appuie sur le concept d’extraterritorialité du droit, qui consiste à sanctionner en France un délit commis à l’étranger. Ironie du sort, cet outil est un classique de la guerre économique des États-Unis.
Ce nouveau moyen pour taxer les multinationales s’appuie sur le concept d’extraterritorialité du droit, qui consiste à sanctionner en France un délit commis à l’étranger. Ironie du sort, cet outil qui servirait ici à s’attaquer aux abus des multinationales américaines est un classique de la guerre économique agressive des États-Unis. D’ailleurs, le principe est déjà présent dans l’accord de 2021 sur la taxation des multinationales, ce qui le rend, malgré ses énormes limites, novateur.
A quand un 4 août de la taxation des multinationales ?
Les libéraux aimeraient propager l’idée que s’il est en théorie possible de taxer plus les multinationales de manière unilatérale, la mise en pratique est plus délicate. Pourtant, avec la recette préalablement évoquée, le parlement britannique a passé en 2015 ce qui a vite été surnommé une « taxe Google » : un taux à 25 % sur les bénéfices délocalisés des multinationales opérant au Royaume-Uni, ce qui fait jouer tous les mécanismes préalablement décrits pour taxer effectivement les multinationales. La mise en place pratique de cet impôt s’intéressant non plus aux bénéfices mais au montant de l’activité des multinationales n’a toutefois pas vraiment eu lieu, même si elle a poussé Google, par exemple, à trouver un accord à l’amiable avec le fisc britannique quant à ses bénéfices délocalisés. Les conservateurs britanniques n’ont pas voulu pousser la logique jusqu’au bout et ont surtout réalisé cette taxe à des fins d’annonce, pour mettre la pression sur les multinationales et les pousser à négocier d’une part, pour faire croire à l’opinion publique qu’elle s’intéressait à la justice fiscale, en pleine période électorale, d’autre part. Il serait grand temps de s’inspirer de telles mesures, de les généraliser, et surtout de les appliquer ou du moins de les utiliser pour gagner le bras de fer avec les multinationales et récupérer le manque à gagner fiscal.
Évidemment, la mise en place pratique demande beaucoup de finesse diplomatique et de courage politique. La réponse rationnelle des États concernés serait d’augmenter leurs taux d’imposition puisque de fait leurs cadeaux fiscaux ne seraient plus efficaces, engageant une logique de mieux-disant fiscal plutôt que de concurrence acharnée. Il y a fort à parier, toutefois, qu’avec Trump aux manettes, la riposte américaine s’éloigne de cette rationalité et que les États-Unis menacent d’augmenter leurs barrières douanières pour compenser une nouvelle baisse des impôts des super-riches et des multinationales. Cela impacterait les exportations françaises, mais cela ne change en rien le fond du problème et puisque Trump menace déjà de guerre commerciale, la question de la taxation des multinationales peut servir d’outil puissant et convaincant lors des négociations avec la Maison Blanche. Or, la France a les outils pour taxer lesdites multinationales.
La logique peut-être poussée plus loin pour faire face aux moyens détournés de défiscaliser. Interdire l’accès au marché français peut être un levier intéressant, par exemple pour faire face aux subventions publiques, violations flagrantes des règles du commerce international et moyen caché de ne pas pas payer d’impôts. De manière générale, l’expulsion, voire l’expropriation, des multinationales ne respectant pas les règles est un tabou politique qu’il faudrait lever, car correspondant à une potentialité économique. Le cas des multinationales occidentales en Russie, qui ont dû quitter précipitamment le pays suite aux sanctions imposées après l’invasion de l’Ukraine, montre que des entreprises nationales peuvent très vite venir remplacer les groupes étrangers.
En définitive, si la question de la taxation des multinationales pose des défis politiques certains, il est fallacieux de considérer que c’est une impossibilité économique. L’intégration financière mondiale autour d’un hypothétique accord international est quant à elle un vœu pieux, étant donné qu’il y aura toujours suffisamment d’États prêts à jouer le rôle de paradis fiscaux. De la même manière que les États ont fait le choix de ne plus taxer ces entreprises, ils ont de la marge de manœuvre pour les assujettir à l’impôt de nouveau s’ils le souhaitent. À quand un 4 août relatif à la fiscalité des multinationales ?