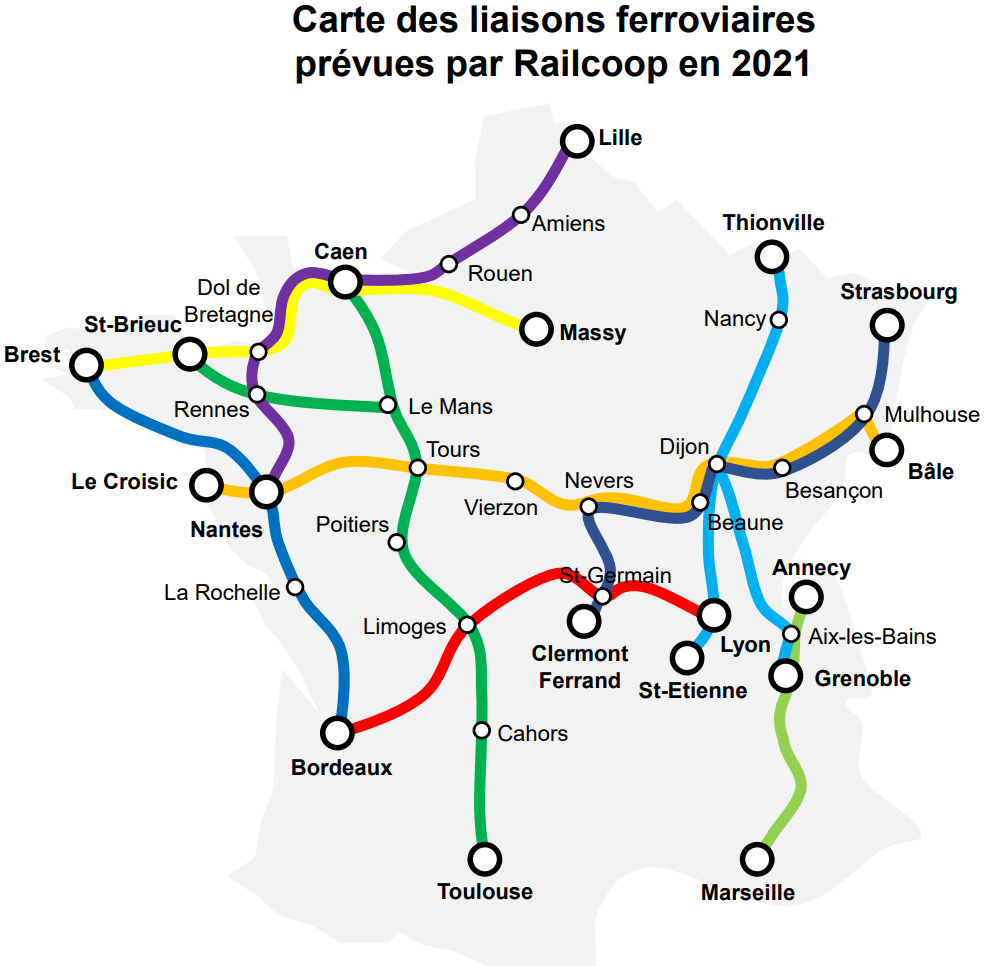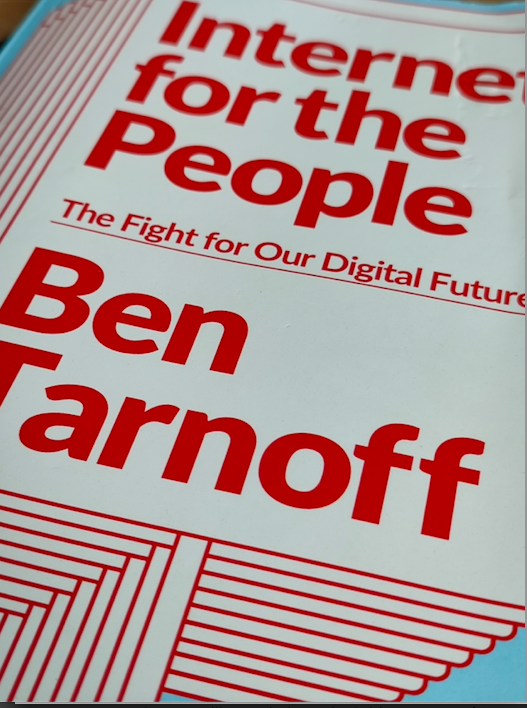Qu’est devenu Jeremy Corbyn ? Pendant près de cinq ans à la tête du Labour, de 2015 à 2020, il a incarné un espoir immense pour la gauche radicale au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Son programme ouvertement socialiste tranchait avec l’adhésion unanime au néolibéralisme et à l’austérité des conservateurs et des apparatchiks blairistes qui contrôlaient le parti d’opposition. Après un excellent résultat en 2017 – 40% des voix – qui prive Theresa May de majorité et le fait presque devenir Premier Ministre, il s’incline face à Boris Johnson deux ans plus tard, notamment en raison du projet de second référendum sur le Brexit décidé par son parti.
Depuis cet échec, on a surtout entendu parler de lui lorsque son successeur Keir Starmer a tenté de l’exclure du parti et que les médias l’ont qualifié d’antisémite – un mensonge, dont il n’est pas difficile de voir qu’il est mobilisé pour écarter la menace qu’il représente pour le statu quo. Malgré ces attaques incessantes, le député continue inlassablement de défendre les services publics, l’État social, les libertés, l’environnement, la paix et la solidarité internationale, comme il l’a toujours fait depuis ses débuts en politique. Le Vent Se Lève l’a rencontré en Belgique, dans le cadre du festival Manifiesta. L’ancien leader travailliste nous a livré son analyse sur le retour en force des syndicats outre-Manche depuis un an et plaidé pour la nationalisation de secteurs stratégiques, ainsi que des négociations de paix plutôt que la surenchère guerrière en Ukraine. Il nous a également présenté l’action du Peace and Justice Project, une structure politique qu’il a créé il y a deux ans, et donné son avis sur la prochaine séquence électorale. Entretien réalisé par William Bouchardon, avec l’aide de Laëtitia Riss et d’Amaury Delvaux.
LVSL – C’est la première fois que vous venez à Manifiesta, qui est un festival à la fois politique et musical, organisé par le Parti du Travail de Belgique (PTB). Quels types de liens entretenez-vous avec ce parti et quels sont vos combats communs ?
Jeremy Corbyn – J’ai été inspiré par l’idée de Manifiesta qui, selon moi, est similaire à la Fête de l’Humanité à Paris, à laquelle j’ai assisté à plusieurs reprises. J’aime l’idée d’un festival inclusif pour les organisations de gauche, les syndicats et les organisations de la classe ouvrière, afin qu’ils se réunissent sans chercher de divisions ou de frontières, mais en cherchant des opportunités de discussions.
Je connais le Parti du Travail de Belgique pour avoir été membre du Conseil de l’Europe, où j’ai rencontré de nombreux membres de la gauche européenne. J’ai rencontré beaucoup de leaders du PTB et je suis très heureux d’être ici. Je représente également le Peace and Justice Project avec Laura (ndlr : Laura Alvarez est la femme de Jeremy Corbyn), qui en est la secrétaire internationale et nous faisons la promotion de notre propre conférence le 18 novembre.
LVSL – Vous êtes intervenu sur scène aux côtés des dirigeants de la FGTB et de la CSC, deux grands syndicats belges, et de Chris Smalls, le fondateur du premier syndicat d’Amazon aux États-Unis. Depuis l’année dernière, le Royaume-Uni connaît une énorme vague de grèves et les syndicats sont au cœur de l’actualité. Un tel niveau de conflit social n’avait pas été observé depuis les premières années au pouvoir de Margaret Thatcher. Pensez-vous que les défaites successives du mouvement syndical ont enfin cessé et qu’une renaissance des syndicats a commencé ?
J. C. – Je connais très bien Chris Smalls et je pense qu’il est emblématique de ce à quoi ressemble la nouvelle génération de dirigeants syndicaux : c’est un jeune homme très courageux, qui travaille dans une atmosphère totalement antisyndicale et qui a pourtant réussi à recruter des gens et à faire reconnaître son syndicat sur certains sites d’Amazon aux États-Unis. Il s’agit véritablement d’une lutte herculéenne et syndiquer les travailleurs des autres sites d’Amazon aux États-Unis sera extrêmement difficile. Au Royaume-Uni, nous avons assisté à des tentatives similaires, notamment au centre Amazon de Coventry, où le syndicat GMB essaie d’organiser les travailleurs.

J’ai moi-même été responsable syndical avant de devenir député. Dans les années 1970, j’étais directement responsable de 40.000 syndiqués, en tant que secrétaire à la négociation pour les employés du Grand Londres. J’ai donc une grande expérience du travail syndical. À l’époque, le Royaume-Uni comptait environ 12 millions de syndiqués et le taux de syndicalisation était très élevé : environ la moitié de la population active était syndiquée. Toutefois, cette présence syndicale était fortement concentrée dans les industries lourdes et anciennes et dans le secteur public, et beaucoup moins dans les petites entreprises privées.
« Dans les années 70, la propriété publique en Grande-Bretagne représentait 52-53 % du PIB. Plus de la moitié de l’économie était entre les mains de l’Etat ! »
Le gouvernement conservateur de 1979 dirigé par Thatcher était radicalement différent de tous les autres gouvernements que la Grande-Bretagne avait connus depuis les années 1930. En fait, à bien des égards, il s’agissait d’un retour aux années 1930. Ses priorités étaient de détruire le pouvoir des syndicats et de privatiser et détruire les grandes industries manufacturières. C’est exactement ce qu’ils ont fait, ils ont privatisé tout ce qu’ils pouvaient : le gaz, l’électricité, l’acier, le charbon, l’industrie automobile, la construction aéronautique et navale, le pétrole, British Telecom, Royal Mail, etc.
À l’époque, la propriété publique en Grande-Bretagne représentait 52-53 % du PIB. Plus de la moitié de l’économie était aux mains de l’Etat ! Cette destruction de l’industrie lourde a entraîné d’énormes pertes d’emplois dans les secteurs de l’acier et du charbon et, par conséquent, le nombre de syndiqués a commencé à diminuer. Cette tendance s’est poursuivie pendant longtemps, mais le nombre de syndiqués a recommencé à augmenter récemment.
LVSL – Diriez-vous que le vent a tourné ?
J. C. – Le vent a tourné car l’austérité mise en place depuis 2008 a conduit beaucoup de gens à ne plus se sentir en sécurité quant à leur niveau de vie. Beaucoup n’ont pas connu d’augmentation réelle de salaire depuis 15 ans. Dans certains cas, ils ont même perdu de l’argent au cours de cette période parce que leurs salaires n’ont pas suivi l’inflation. Ce sont ces revendications de hausses de salaires qui expliquent que le nombre de syndiqués a commencé à augmenter. Par exemple, le syndicat des enseignants a recruté 60.000 nouveaux membres lors de son récent conflit, et la même chose s’est produite dans d’autres secteurs économiques. Il y a donc eu une recrudescence de l’activité syndicale.
La plupart des accords conclus à la suite des récentes grèves ne sont ni des victoires par KO, ni des défaites. Généralement, les travailleurs obtiennent une augmentation de salaire correspondant au taux d’inflation. Une autre bataille importante concernait la tentative de Royal Mail (la Poste britannique, ndlr) de transformer son personnel en travailleurs indépendants, à l’instar d’Amazon ou d’autres. Cela a été complètement bloqué grâce à la mobilisation. Mais repousser quelque chose de vicieux n’est pas vraiment une victoire, donc cela n’a pas donné un énorme coup de pouce aux gens. De nombreuses luttes, comme celle du secteur ferroviaire et de la fonction publique, sont encore en cours et le récent accord pour les enseignants ne résout pas les questions de long terme.
Parallèlement à cette forte augmentation de l’activité syndicale, on observe également une forte augmentation du nombre de personnes adhérant à des syndicats dans le secteur informel. Certains de ces nouveaux syndicats ne sont pas affiliés au TUC (le Trade Union Congress regroupe la grande majorité des organisations syndicales au Royaume-Uni, ndlr). Cela n’en fait pas de mauvais syndicats, c’est juste que ceux qui sont à l’origine de ces nouveaux syndicats cherchent à représenter leurs collègues à leur manière. Il appartient aux syndicats plus anciens et au TUC de travailler avec eux. Personnellement, je suis très heureux de travailler avec tous les types de syndicats.
LVSL – En raison de l’inflation très élevée au Royaume-Uni, l’agenda politique s’est principalement concentré sur les questions sociales ces derniers temps. Mais l’autre grand combat de la gauche est la crise écologique, comme l’a encore démontré un été extrême dans le monde entier. Ici, à Manifiesta, vous avez participé à un débat liant les questions environnementales et la lutte des classes. Dans le monde entier, de nombreux partis de gauche tentent d’articuler ces deux enjeux. Quels conseils leur donneriez-vous ?
J. C. – Durant ce débat, il y a eu une très bonne intervention d’un sidérurgiste néerlandais. Ce dirigeant syndical a réussi à forcer l’entreprise à changer complètement le processus de production, en passant à une production à faible consommation d’énergie qu’on peut qualifier « d’acier vert ». Au lieu de produire dans des hauts-fourneaux ou des fours à foyer ouvert, l’entreprise met en place une production électrique et utilise des déchets plutôt que du minerai de fer pour fabriquer de l’acier neuf. Avoir réussi à obtenir ce changement de mode de production est une incroyable réussite. Pour moi, c’est l’exemple même des syndicats en action, qui parviennent à réduire les niveaux de pollution et les émissions de CO2 tout en protégeant les emplois. Je mentionne cela parce que je suis convaincu que les syndicats doivent utiliser leur pouvoir pour forcer les entreprises à être durables.
« L’échappatoire de la classe moyenne, qui consiste à s’installer dans les banlieues pavillonnaires ou à la campagne et à travailler à domicile, n’est pas une option pour la majorité de la population. »
Ensuite, ce sont les communautés ouvrières qui sont les plus frappées par la crise environnementale. Ce sont les enfants des classes populaires de Glasgow, Londres, Paris, Mumbai, Delhi, New York ou San Paolo qui subissent les pires effets de la pollution de l’air, réduisant la capacité pulmonaire et l’espérance de vie. L’échappatoire de la classe moyenne, qui consiste à s’installer dans les banlieues pavillonnaires ou à la campagne et à travailler à domicile, n’est pas une option pour la majorité de la population. Il faut assainir l’air et faire payer les pollueurs. C’est pourquoi j’aborde cette question sous l’angle de la classe sociale.

En tant que leader du parti travailliste, j’ai promu une révolution industrielle verte. Il ne s’agissait pas de condamner et de culpabiliser les gens qui conduisent un véhicule diesel pour aller au boulot ou qui travaillent dans une aciérie, mais de changer les choses et de protéger les emplois en même temps. La population ne peut pas soutenir la protection du climat si son niveau de vie n’est pas protégé en même temps. J’ai également beaucoup parlé de l’éducation à la biodiversité. Nous devons élever une génération qui comprenne que nous devons vivre avec le monde naturel, et non en opposition avec lui. Je suis très déterminé à atteindre tous ces objectifs.
LVSL – Vous avez dit que les entreprises polluantes doivent payer pour réparer les dommages qu’elles ont causés et que les syndicats sont essentiels pour changer la façon dont la production est organisée. Je ne peux qu’approuver. Mais si on veut changer la façon dont l’économie est gérée, ne devons-nous pas aussi nous battre pour la propriété publique des moyens de production, c’est-à-dire des nationalisations ?
J. C. – La propriété publique est indispensable pour les services essentiels. L’eau est un exemple évident : nous avons tous besoin d’eau, tout au long de la journée, tous les jours. C’est le besoin le plus élémentaire qui soit. Pourtant, elle a été privatisée en Grande-Bretagne par le gouvernement Thatcher pour un prix bien inférieur à la valeur réelle du secteur. Les entreprises privées qui ont racheté ce secteur ont immédiatement fait fructifier les considérables actifs fonciers dont disposaient les entreprises publiques de distribution d’eau en les vendant ou en construisant dessus. Elles ont ensuite versé d’énormes bénéfices et dividendes aux actionnaires au lieu d’investir dans de nouvelles canalisations et dans la protection de la nature. Le résultat, ce sont 300.000 rejets d’eaux usées directement dans les rivières anglaises rien que l’an dernier.
Il n’y a pas d’autre choix que de ramener les compagnies des eaux dans le giron public et de les placer sous contrôle démocratique. Elles doivent être contrôlées au niveau local, par les collectivités, en lien avec les travailleurs, les entreprises locales et les autorités publiques, avec un mandat clair en matière de protection de l’environnement ainsi que de production et de distribution de l’eau.
« La propriété publique est indispensable pour les services essentiels. »
Il en va de même pour l’énergie. Le gouvernement britannique a versé des milliards de subventions aux entreprises énergétiques, à condition qu’elles n’augmentent les prix pour les consommateurs « que » de 100 %. En d’autres termes, toutes nos factures d’électricité ont doublé, les entreprises ont réalisé d’énormes bénéfices et le gouvernement a utilisé l’argent public pour garantir le maintien de ces bénéfices. C’est une situation insensée ! Il n’y a pas d’autre solution que d’en faire une propriété publique, ce que nous soutenons fermement. Nous travaillons d’ailleurs avec We Own It (association agissant pour le retour de nombreux services dans le giron public, ndlr) et organisons une réunion la semaine prochaine pour exiger cela.
LVSL – La réunion que vous mentionnez sera organisée par le Peace and Justice Project, une organisation que vous avez créée récemment. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Quel est l’objectif de cette structure et sur quelles campagnes menez-vous ?
J. C. – Nous avons commencé à bâtir cette structure après les élections générales de 2019 (lors desquelles Jeremy Corbyn est battu par Boris Johnson, ndlr) et l’avons lancé en janvier 2021. Nous avons environ 60.000 personnes inscrites en tant que followers, qui reçoivent régulièrement des vidéos, des courriels et d’autres contenus sur nos différentes activités. Nous avons également un nombre considérable de personnes qui donnent des petites sommes d’argent pour assurer la survie du projet : le don moyen se situe entre 5 et 10 livres par mois. Nous sommes reconnaissants de ce soutien.
« Le Peace and Justice Project se veut un foyer politique pour ceux qui ne savent plus vers où se tourner. »
Le Peace and Justice Project se veut un foyer politique pour ceux qui ne savent plus vers où se tourner. Par conséquent, il ne repose pas sur un ensemble très strict de principes politiques, mais plutôt sur de multiples campagnes thématiques. Tout d’abord, nous avons élaboré une plate-forme de cinq revendications, sur les salaires, la santé, le logement, l’environnement et la politique internationale et la paix. Ces revendications ont été élaborées avec les syndicats : nous travaillons en étroite collaboration avec le CWU (communication), le RMT (transport) et le BFAWU (industrie alimentaire). Nous travaillons ensemble contre les privatisations et sur des campagnes de défense des droits syndicaux des travailleurs de l’économie parallèle, tels que ceux de Starbucks et d’Amazon.

Deuxièmement, nous promouvons l’idée que les arts et la culture font partie du mouvement syndical, ce qui implique deux choses. D’une part, nous organisons des concerts dénommés « Music for the Many » (en référence au slogan de campagne de Jeremy Corbyn, For the Many, not the few, ndlr) dans tout le pays. A cette occasion, nous défendons nos lieux de musique vivante et salles de concert, qui risquent de fermer à cause de l’austérité et de la crise du coût de la vie. Nous avons organisé six de ces concerts jusqu’à présent et beaucoup d’autres sont à venir. À chaque fois, nous donnons l’occasion à des musiciens généralement jeunes et peu connus de jouer et nous promouvons nos différentes campagnes.
Nous écrivons également un livre intitulé Poetry for the Many, qui a déjà fait l’objet de nombreuses commandes en prévente. L’idée est née parce que je reçois beaucoup de poèmes de jeunes. Un jour, Len McCluskey (ancien secrétaire général du syndicat Unite, ndlr) et moi étions dans mon bureau pour parler de politiques et de stratégies économiques et il m’a demandé : « Pourquoi avez-vous ces livres de poésie dans votre bureau ? ». Je me suis senti offensé et lui ai dit « Et pourquoi pas ? », ce à quoi il a répondu « Je n’ai pas celui-là, je peux te l’emprunter ? » Nous avons donc décidé de rédiger ce livre, qui contient des poèmes provenant d’un large éventail de pays, et nous en préparons actuellement un autre, intitulé Poetry from the many, qui contiendra les meilleurs poèmes que nous avons reçus.
Enfin, il y a le travail international que nous effectuons avec l’aide de Laura. Nous travaillons sur des campagnes de reconnaissance syndicale avec des organisations étrangères, comme la Fédération internationale des travailleurs des transports. Nous organisons une grande conférence à Londres en novembre avec des dirigeants syndicaux du monde entier, de l’Amérique latine à l’Europe, en passant par la Russie et le Moyen-Orient. L’objectif est de travailler ensemble sur des sujets majeurs tels que le changement climatique, la justice sociale et de lutter contre les guerres.
LVSL – La lutte contre les guerres est d’ailleurs l’un des principaux thèmes de cette édition de Manifiesta. Vous avez toujours défendu la paix, comme en témoigne, par exemple, votre opposition à la guerre en Irak (Corbyn a voté contre l’entrée en guerre du Royaume-Uni, en opposition au gouvernement de Tony Blair, pourtant issu du même parti que lui, et organisé des rassemblements de plusieurs centaines de milliers de personnes pour la paix, ndlr). Même s’il y a d’autres conflits en cours, les médias occidentaux se concentrent sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Selon vous, à quoi ressemblerait un pacifisme de gauche dans ce conflit ?
J. C. – Tout d’abord, je tiens à souligner à quel point cette guerre est épouvantable et à quel point l’agression russe est une grave erreur. Cela dit, les conflits se terminent tous par des négociations et il en ira de même pour cette guerre un jour. La question, c’est combien de personnes vont encore mourir d’ici-là ? La politique des pays occidentaux et des entreprises d’armement consistant à déverser toujours plus d’armes en Ukraine et à impliquer de plus en plus l’OTAN dans les activités militaires de l’Ukraine ne peut qu’aggraver le conflit. L’ONU et l’Union européenne n’ont, à mon avis, rien tenté pour améliorer l’accord de Minsk afin de maintenir une paix relative. Je dis « relative » parce que le conflit dans le Donbass dure depuis neuf ans déjà.
« L’ONU et l’Union européenne n’ont rien tenté pour améliorer l’accord de Minsk afin de maintenir une paix relative. »
Il doit y avoir des pourparlers de paix. Bravo à l’Union africaine, bravo aux dirigeants latino-américains et bravo au Pape pour avoir tenté d’instaurer des pourparlers de cessez-le-feu. S’ils n’ont pas lieu maintenant, ils auront lieu un jour ou l’autre. Mais combien de vies supplémentaires vont-elles être sacrifiées avant que les armes ne se taisent ? L’Ukraine et la Russie sont capables de se parler au sujet des cargaisons de céréales dans la mer Noire, leurs dirigeants sont donc parfaitement capables de faire de même pour parvenir à un cessez-le-feu. Nous devons faire pression en ce sens jusqu’au bout et soutenir ceux qui, en Ukraine et en Russie, luttent pour la paix. Je voudrais également profiter de cette occasion pour demander la libération de Boris Kagarlitsky (philosophe et sociologue marxiste russe, ancien dissident soviétique et opposant au régime de Poutine, ndlr), un vieil ami, un grand penseur, un grand militant pour la paix, qui ne devrait pas être en prison.
LVSL – Des élections auront lieu l’année prochaine au Royaume-Uni. Quels sont vos pronostics et quel rôle allez-vous jouer dans ce scrutin ?
J. C. – La date la plus tardive possible pour les prochaines élections est janvier 2025, mais j’imagine qu’elles auront lieu plus tôt. Le gouvernement est actuellement extrêmement impopulaire en raison de son incompétence et de la manière dont il a distribué des milliards de livres sterling de contrats pendant la période Covid, dont beaucoup ont été attribués sans grand contrôle aux donateurs et aux amis du parti conservateur. Par conséquent, les Conservateurs perdront très probablement les élections.
Mais les travaillistes doivent proposer une alternative. Se contenter de gérer l’économie de la même manière, refuser d’introduire un impôt sur la fortune, refuser de suivre la politique de propriété publique mise en avant dans les deux derniers programmes travaillistes (lorsque Jeremy Corbyn dirigeait le parti, ndlr) n’encouragera pas les gens à voter pour le Labour. Donc, je souhaite qu’une véritable alternative aux conservateurs soit proposée.
Il y a d’énormes problèmes de démocratie au sein du parti travailliste. Keir Starmer a été élu à la tête du parti en promettant de démocratiser le Labour. Je ne sais pas vraiment ce qu’il a fait à ce sujet, parce que suspendre le débat local et la démocratie, imposer des candidats et utiliser sa majorité au sein du NEC (le National Executive Committee est l’instance dirigeante du parti travailliste, ndlr) pour empêcher les gens d’être candidats, ce n’est clairement pas un processus démocratique.
J’ai été suspendu en tant que membre du groupe parlementaire, mais pas du parti travailliste. Je suis membre de la section locale du Labour d’Islington North (circonscription londonienne de Jeremy Corbyn, ndlr) et j’assiste aux réunions de la section comme n’importe qui d’autre. Je ne vais pas me laisser écarter par ce processus. Il y a une grande soif de voix alternatives et radicales en Grande-Bretagne et je suis heureux d’être l’une de ces nombreuses voix.
LVSL – Outre le Peace and Justice Project, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la forme que pourrait prendre votre engagement ? Vous présenterez-vous aux prochaines élections ?
J. C. – Je suis disponible pour servir les habitants d’Islington North si c’est ce qu’ils souhaitent.