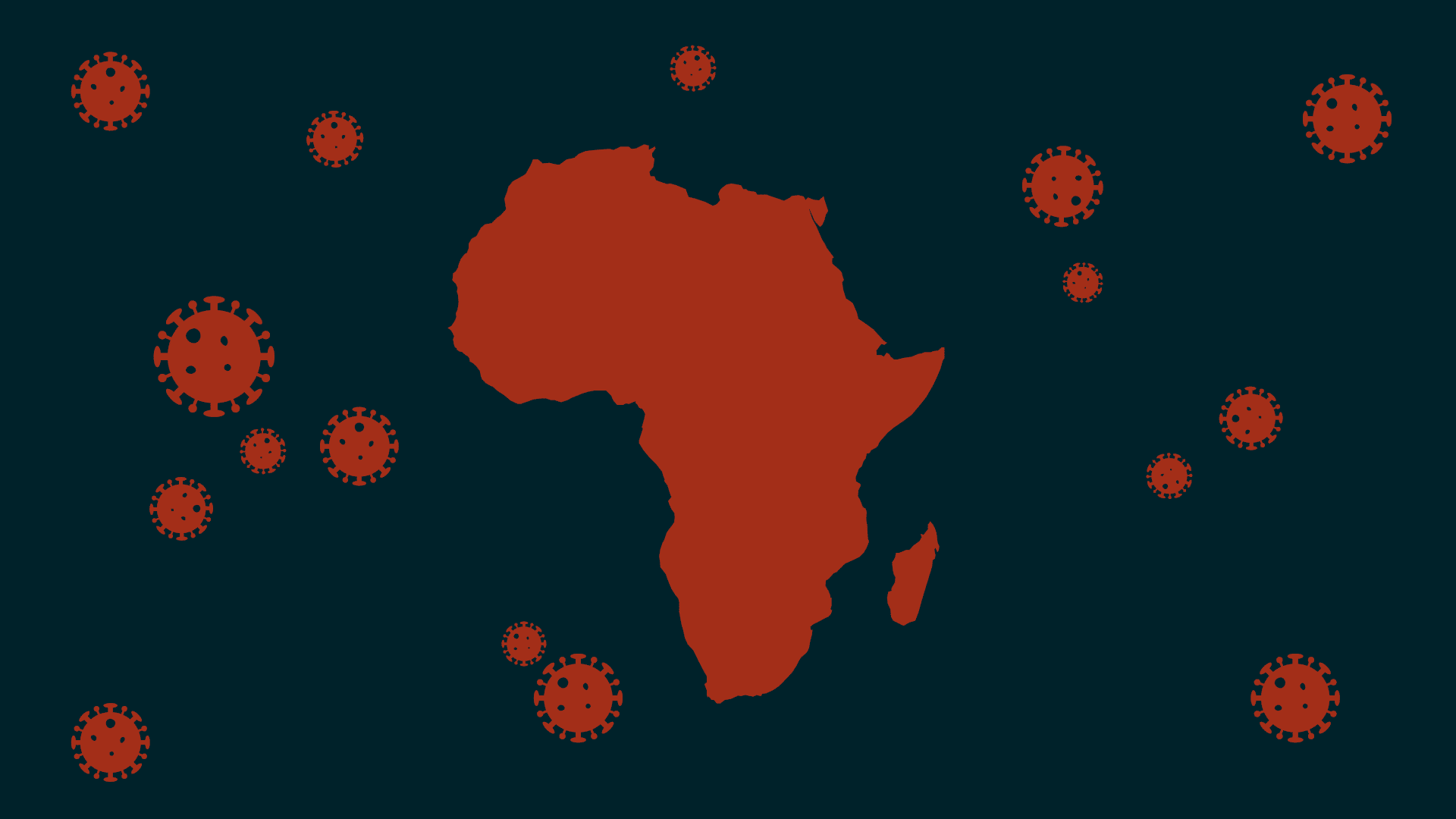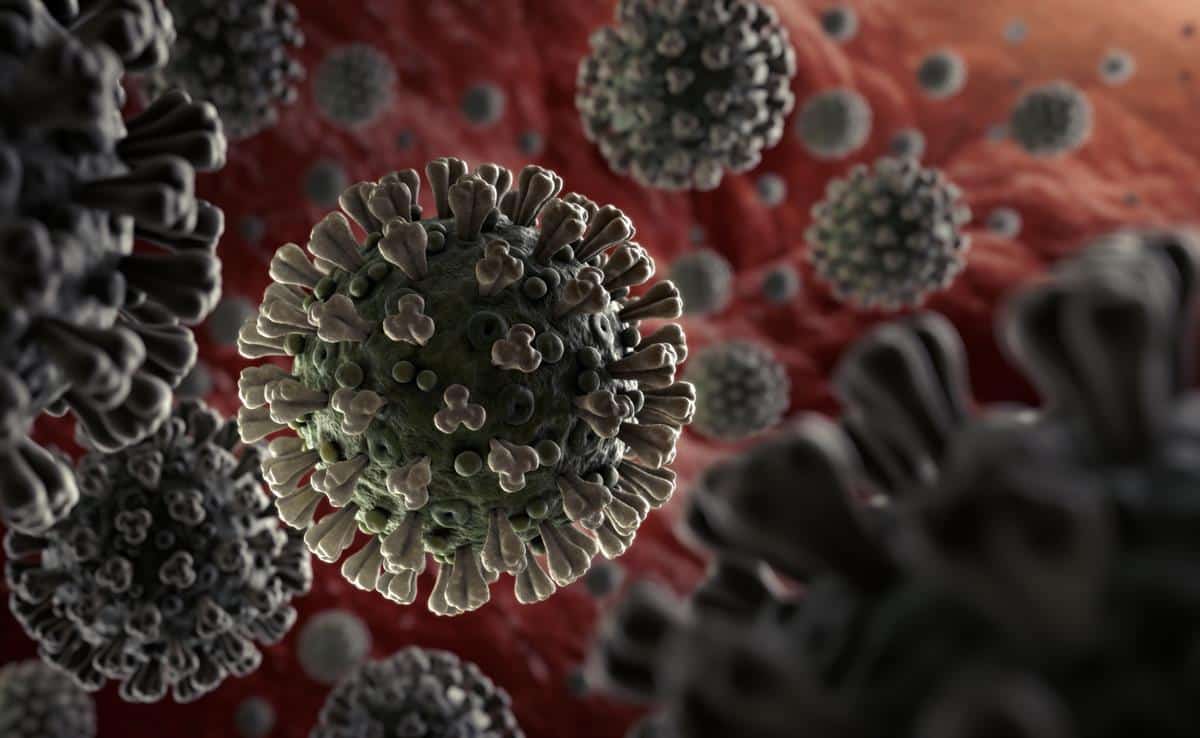Le constat d’après lequel les Français d’Outre-mer sont moins touchés en proportion de cas confirmés que ceux de l’Hexagone est un trompe-l’œil. En l’attente d’un vaccin, tout concourt à redouter une évolution catastrophique de la situation sanitaire dans ces territoires, dont le système de santé est bien plus défaillant qu’ailleurs. Sur fond de vétusté d’infrastructures de première ligne, de problèmes de développement et d’une situation démographique qui est pour plusieurs d’entre eux très propice à ce que le virus atteigne ses plus hauts taux de mortalité, les particularités des Outre-mer en font les territoires français les plus vulnérables face au virus. Le gouvernement se voit contraint d’envisager une politique nationale différenciée selon les territoires pour remédier dans l’urgence à une désertion de longue date de l’État.
Le 31 mars, dans une posture de maîtrise de la situation sanitaire comme l’exige depuis le début de l’épidémie la rhétorique gouvernementale, la ministre des Outre-mer Annick Girardin déclarait qu’ « il n’y a pas d’impréparation dans les Outre-mer ». C’est néanmoins dans le même discours qu’elle annonçait la forte augmentation du nombre de lits en réanimation, devant être triplés pour certains territoires au cours des prochaines semaines. Cette nécessité témoigne d’elle-même de deux grandes préoccupations : d’une part l’important sous-équipement du secteur hospitalier ultramarin et d’autre part, la vulnérabilité supérieure des populations face au Covid-19. L’imprévisibilité de la propagation du virus dans les prochains mois nourrit chez les citoyens ultramarins des inquiétudes bien légitimes.
Depuis le 5 avril, nous en sommes à ce diagnostic : tous les départements et collectivités d’Outre-mer déclarent désormais des cas positifs au SARS-CoV-2 à l’exception de Wallis-et-Futuna. La Réunion est en tête du décompte en passant le 8 avril la barre des 350 cas, et Saint-Pierre-et-Miquelon est pour l’heure le territoire le moins touché avec un seul cas d’infection. Si l’on regroupe l’ensemble des territoires, la barre des 1000 cas est elle aussi passée. La propagation du virus y a été plus lente que dans l’Hexagone, sauf à Mayotte où l’évolution exponentielle des cas dans les deux premières semaines du confinement a surpassé dramatiquement la tendance nationale, et se poursuit. Mais partout aux Outre-mer, le manque d’infrastructures qui assurent les services publics et hospitaliers et les caractéristiques sanitaires et démographiques propres aux territoires exposent les populations à un risque d’hécatombe bien plus grand qu’ailleurs à chaque pandémie de ce type, tant que la négligence des problématiques ultramarines à échelle nationale perdurera. Le Conseil scientifique mandaté par le ministère de la Santé pour suggérer la stratégie à adopter pour les Outre-mer va jusqu’à encourager, dans son rapport du 8 avril, des mesures renforcées dans ces territoires pour pallier les inégalités des risques qu’ils encourent.
Services publics “à la peine”
La casse des services publics par les gouvernements successifs n’a pu qu’avoir des conséquences plus dramatiques encore dans les territoires où ils étaient déjà très défaillants, comme c’est le cas dans l’ensemble des Outre-mer. Les territoires ultramarins accusent un déficit à la fois quantitatif et qualitatif de leurs services publics. Le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de janvier 2020 rend compte de carences en termes d’éducation, d’offres de soins, de logements sociaux, d’accès au numérique, etc. Plus ou moins importantes selon les territoires, ces carences ne sont néanmoins que le symptôme des développements à plusieurs vitesses des territoires d’Outre-mer. Réciproquement, ces mêmes carences continuent d’alimenter leurs retards de développement vis-à-vis de l’Hexagone.
Si dans les départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion), ces services publics doivent prétendre à être les mêmes que dans l’Hexagone, il n’en est pas de même pour les collectivités d’Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna) dont l’autonomie conférée par leur statut crée une distribution complexe des prérogatives. Ce flou dans la responsabilité de la gestion des services publics ne sert pas le bien-être de la population. À titre d’illustration, on relève seulement 21 Maisons des services publics (lieux d’accueil des citoyens afin qu’ils bénéficient d’un service de proximité et d’un accompagnement administratif pour répondre à leurs divers besoins) situées dans les départements d’Outre-mer pour environ 1,9 million d’habitants, contre 1 383 en France hexagonale pour environ 66,7 millions d’habitants. Ramené en pourcentage, cela signifie que 1,5% des Maisons des services publics sont situées dans des départements qui abritent pourtant 3% de la population française. En revanche, les autres territoires statutairement et anciennement moins intégrés au territoire national (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna), ne comptent pas une seule de ces Maisons. Elles sont remplacées par des structures d’initiative locale. Quant à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, alors que leur intégration au département de la Guadeloupe jusqu’en 2007 leur avait permis d’avoir accès à davantage de services publics que les autres collectivités d’Outre-mer, les ravages de l’ouragan Irma en septembre 2017 ont aplani les différences. Ainsi, l’égalité de l’intégration économique et sociale des populations, censée être garantie par l’accès aux services publics, n’est pas atteinte dans les départements d’Outre-mer, et va jusqu’à être rompue dans les collectivités d’Outre-mer, lorsqu’ils manquent de moyens pour financer eux-mêmes les structures locales.
On pourrait croire que la situation des Outre-mer n’est guère différente de celle de zones périurbaines et rurales délaissées dans l’Hexagone. Cependant, l’éclatement géographique aux quatre coins du globe et l’insularité sont des facteurs aggravants. Cet isolement de fait, qui n’est donc pas compensé par un égal accès aux services publics, est rarement compris dans toutes ses implications. Il est pourtant décisif dans la fracture partagée par tous les Outre-mer. En effet, qui peut raisonnablement imaginer qu’un citoyen vivant en Guadeloupe, où le seul Centre hospitalier universitaire (CHU) de l’île est en cours de reconstruction suite à un incendie, et les autres hôpitaux publics de l’île saturés ou n’assurant pas tous les services, doive s’en remettre à des cliniques privées ou à se soigner dans des territoires voisins ? Voire, dans de nombreux cas, devoir partir vers l’Hexagone distant de 7 000 km pour effectuer certains examens, traitements et opérations chirurgicales ? Dans la dernière situation, les frais de déplacement en avion ne sont pas toujours pris en charge par la Sécurité sociale ou ne le sont que partiellement. Or les urgences, par définition, ne peuvent pas attendre les prix de basse saison.
“Le député Gabriel Serville déplorait que les patients guyanais soient “les otages du manque de considération des gouvernements successifs vis-à-vis de la santé”, avant qu’explosent les manifestations qui ont emporté un an plus tard l’ensemble du territoire national.”
En 2014, un rapport cinglant de la Cour des comptes en appelait à la responsabilité républicaine des gouvernements, en révélant pour les Outre-mer des « systèmes de santé à la peine » qui imposaient un rattrapage important à effectuer. Bien qu’au moment de dicter les plans de retour à l’équilibre budgétaire (PRE) pour le secteur de la santé, la dissociation des territoires d’Outre-mer de celui hexagonal leur permettent en général de subir des mesures moins drastiques, ces décisions même pondérées sont toujours plus lourdes de conséquences que dans l’Hexagone. L’état de saturation dans lequel sont ordinairement plongés les hôpitaux aux Outre-mer, aggravé dans certains territoires par la suppression insensée de postes et de lits, avait provoqué à de nombreuses reprises la colère des personnels et des syndicats. Elle s’est exprimée par des grèves en février 2018 à la Réunion suite à la suppression de 155 postes et d’une centaine de lits, ou encore par la démission collective de 17 médecins urgentistes en mai 2018 en Guyane. En soutien à ce mouvement de contestation, le député Gabriel Serville déplorait que les patients guyanais soient « les otages du manque de considération des gouvernements successifs vis-à-vis de la santé », avant qu’explosent les manifestations qui ont emporté un an plus tard l’ensemble du territoire national.
Déserts médicaux et populations désarmées
Alors que la Guadeloupe, la Martinique, et la Réunion ont toujours été plus proches que les autres territoires d’Outre-mer du niveau de qualité de soin hexagonal, l’épisode désastreux de l’incendie du CHU de Guadeloupe fait sortir l’île de ce trio et fragilise dans le même temps le système de santé de la Martinique, qui accuse un afflux de patients supplémentaire en tant que territoire voisin. Déclenché le 28 novembre 2017, cet incendie a débouché sur une grave crise sanitaire conduisant le personnel à soigner des patients dans la partie de l’hôpital épargnée mais dans un état d’insalubrité critique, et à prendre en charge de nombreux autres dans des tentes durant plusieurs mois, pendant que des services de l’ancien CHU étaient progressivement délocalisés vers des communes de l’île. À Mayotte, qui n’a pas connu ce type de drame, la situation n’est pas plus glorieuse. Le seul centre hospitalier du territoire compte 300 lits alors qu’il est estimé qu’il devrait pouvoir accueillir 900 malades pour satisfaire intégralement les demandes de soins de la population.
La situation de Mayotte est souvent reconnue comme la plus préoccupante d’un point de vue structurel, mais n’est pas la seule à prendre en considération. Cet archipel anciennement intégré aux Comores fait partie de la liste des territoires ultramarins qui sont tristement répertoriés comme étant les plus grands déserts médicaux français avec la Guyane, la Polynésie et Wallis-et-Futuna. Ces autres territoires doivent donc également attirer l’attention nationale pour déterminer comment y vaincre le Covid-19 en l’attente d’un vaccin, car les armes n’y sont pas.
Selon une enquête de Statiss de janvier 2016, on comptait en Guyane 55 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 104 en Hexagone, et 27 médecins spécialistes contre 94 en Hexagone. Cette forte inégalité d’accès aux soins en Guyane résulte certes davantage de problèmes de recrutement et de formation que de budget, qui relèvent en majorité des pouvoirs publics locaux, mais elle n’est qu’une conséquence de son retard de développement global que l’État a échoué à réduire. Pour aller plus loin au sujet des retards de développement de la France des Outre-mer, voir l’article paru dans LVSL en janvier 2019 « Les gilets jaunes en Outre-mer : l’insurrection citoyenne à la Réunion, la résignation ailleurs ».
Dans d’autres territoires, des modalités de gestion financière hasardeuses sont cette fois en cause. En Polynésie française, le seul centre hospitalier offre des soins de haute technicité dans des domaines chirurgicaux et obstétricaux mais dispose de services de petite taille et son activité ambulatoire est insuffisamment développée. Malgré une compétence en matière de santé qui revient à la collectivité d’Outre-mer depuis 1984, le centre hospitalier est lui censé être sous la responsabilité du ministère de la Santé. Seulement, l’hôpital a l’étrange particularité de ne pas même posséder le statut officiel d’établissement public de santé malgré ce rattachement, ce qui implique la négociation de ses dotations budgétaires en dehors du cadre légal [1] et contrevient à la transparence de leur usage et à l’expansion des services de l’hôpital.
« À Mayotte, l’après-confinement ne laisse rien présager de bon : parmi les écoles, lieux où le virus se répand le plus rapidement, 80% ne respectent pas les normes de sécurité et d’hygiène minimales »
Comment, dans ces conditions qui préexistaient à la crise, concevoir une prise en charge complète des patients atteints du Covid-19 dans les mois à venir, qui ne laisse pas à l’abandon le reste de la population ultramarine habituellement en demande de soins ? L’état des lieux ne s’arrête pas là. Aux problèmes structurels propres au secteur hospitalier qui réduiront les capacités de résilience en bout de chaîne, s’ajoutent des problèmes infrastructurels en amont qui empêchent d’effectuer tous les gestes-barrière. Plusieurs communes de Guadeloupe ont subi depuis le début du confinement des coupures d’eau durant parfois plus de 24h, qui à l’évidence entravent le lavage régulier des mains. D’autres coupures d’eau devraient se produire fréquemment en Martinique, comme souvent à l’approche de la saison sèche, mais d’une durée bien plus courte. À Mayotte, territoire le moins développé de France du fait de sa départementalisation récente, un tiers des logements n’a pas accès à l’eau courante. Dans ce territoire du canal du Mozambique, l’après-confinement ne laisse rien présager de bon : parmi les écoles, lieux où le virus se répand le plus rapidement, 80% ne respectent pas les normes de sécurité et d’hygiène minimales selon la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
Quelle solidarité avec les Outre-mer ?
Fort de ces inégalités, malgré le décalage épidémique observé dans les Outre-mer du fait du moins grand nombre de cas déclarés, le chef de l’État a annoncé dans son discours du 16 mars que les mêmes mesures de confinement s’y appliqueraient que pour l’Hexagone. Néanmoins, la solidarité nationale appelée de ses vœux n’avait pas prouvé dès le départ qu’elle incluait les Outre-mer, en laissant à la ministre des Outre-mer Annick Girardin le soin de faire de la pédagogie aux habitants d’Outre-mer au sujet des premières mesures (fermeture des écoles, des commerces non essentiels et interdiction des rassemblements). Ce double-discours avait laissé croire à une politique différenciée dans le mauvais sens et amplifiait l’inquiétude des populations ultramarines qui craignent que le virus ne se propage massivement. L’inquiétude tournait à la psychose lorsque les Martiniquais et les Réunionnais voyaient jusqu’au début du mois de mars atterrir dans leurs aéroports des avions en provenance de régions italiennes où les cas étaient en constante hausse, et arriver jusqu’à la mi-mars sur leurs côtes des bateaux de croisière faisant voyager dans la plus grande proximité des touristes internationaux. Cette irresponsabilité criante avait même lancé des appels à manifester de la part des populations.

À la Réunion, alors qu’aucun cas de Covid-19 n’avait encore été déclaré, des heurts ont éclaté à l’arrivée d’un paquebot le premier mars, sans que des mesures sérieuses ne soient décidées pour encadrer la circulation des touristes dans l’île. Deux semaines plus tard, la crise sanitaire avait pris une ampleur grave : les préfets des régions Martinique et Guadeloupe ont alors pris des mesures pour encadrer le débarquement des passagers à l’accostage du paquebot Costa Magica, transportant 2 300 personnes. L’interdiction du rassemblement de plus de 100 personnes sera déclarée le même jour par le Premier ministre… À bord, de nombreux passagers antillais devaient être rapatriés, mais avaient été potentiellement au contact de croisiéristes déclarés positifs au SARS-CoV-2. Ce laxisme, en fin de compte national, aux frontières maritimes et aériennes, nourrit dans les territoires ultramarins les plus isolés l’amère impression que le virus a été importé là où il aurait pu n’avoir jamais mis les pieds.
“La solidarité nationale montre la limite de ses capacités envers des territoires négligés médicalement et infrastructurellement depuis des décennies.”
La frustration est d’autant plus grande que le matériel de première ligne a parfois plus de difficultés à franchir les mers et les océans que le virus. Même si l’État a sorti l’artillerie lourde le premier avril pour faire acheminer du matériel médical aux territoires des océans Atlantique et Indien grâce aux porte-hélicoptères Mistral et Dixmude, cette aide fera difficilement oublier la réception par les soignants réunionnais d’une livraison de 30 000 masques FFP2 moisis, datant de l’épisode de la grippe H1N1. Alors que la Réunion était à ce moment et demeure encore le département d’Outre-mer le plus touché en nombre de cas infectés, cette dangereuse négligence avait achevé de susciter l’indignation des ultramarins et de provoquer une levée de boucliers contre l’Agence régionale de santé (l’ARS) et le gouvernement.
Le renfort humain n’est pas non plus au rendez-vous dans les Outre-mer. Du fait de leur distance, ces territoires ne pourront pas être soulagés aussi régulièrement que des régions comme le Grand Est grâce à l’évacuation des patients vers des centres hospitaliers voisins en cas de saturation. Ils ont donc d’ores et déjà besoin d’un personnel suffisamment nombreux et compétent sur place, et qui regroupe surtout l’ensemble des spécialités médicales de première ligne pour lutter contre le virus, spécialités qui font défaut dans de nombreux territoires. À cette fin, mais par un moyen ironique, le Premier ministre s’est résolu dès le 31 mars à accepter l’aide de médecins en provenance de Cuba, en donnant aux territoires de la zone Atlantique la possibilité de recourir à des médecins diplômés hors de l’Union européenne. Cette aide est indispensable pour le désert médical qu’est la Guyane, et l’occasion pour certains élus de faire valoir une entraide caribéenne, souvent encouragée pour pallier les manquements des gouvernements français. La solidarité nationale montre la limite de ses capacités envers des territoires négligés médicalement et sur le plan infrastructurel depuis des décennies.
Antilles et Mayotte : des poudrières démographiques faisant craindre l’explosion des taux de mortalité
Le 26 mars, Jérôme Viguier, directeur de l’ARS Martinique, livrait à l’oral les résultats très alarmants des modélisations statistiques pour l’île : 180 000 à 190 000 personnes sont susceptibles de contracter le Covid-19, soit la moitié de la population martiniquaise [2]. Il poursuit en estimant à 5% le nombre de malades qui iraient en réanimation, soit près de 9500 personnes. La temporalité sur laquelle s’étalerait le nombre de cas n’est pas précisée et il est évidemment difficile de connaître la fiabilité de la modélisation elle-même, car l’évolution de la propagation du virus, mais aussi de sa capacité à s’aggraver dans les infections qu’il déclenche, comporte encore plusieurs inconnues. Au moment de cette annonce, après la mise en place de lits et d’équipements supplémentaires commandée par la ministre Annick Girardin, le CHU de l’île possédait seulement 85 lits de réanimation et 76 respirateurs, sans compter la pénurie nationale de masques qui touche encore plus durement les Outre-mer.
“Le scandale sanitaire du pesticide chlordécone a fait exploser le taux de cancer de la prostate aux Antilles, porté au rang de plus élevé au monde.”
Malgré de nombreuses inconnues sur l’avenir de la pandémie, ces capacités d’accueil semblent largement dérisoires si le virus venait à s’accélérer dans les prochains mois, au regard d’un facteur essentiel : le nombre de personnes identifiées comme « fragiles », et donc plus exposées à contracter une forme grave du virus, est très élevé aux Antilles. La Martinique, comme la Guadeloupe, sont les départements-régions les plus vieux de France : en 2014 selon l’Insee, près de 25% de la population avait plus de 60 ans. En 2020, ce chiffre est encore plus élevé car le phénomène de vieillissement est identifié aux Antilles comme rapide et massif, devant porter le pourcentage à 35% à l’horizon 2030. Ces territoires sont aussi gravement sujets aux maladies chroniques, avec en tête le diabète, l’hypertension, les insuffisances cardiaques et les cancers, dont le scandale sanitaire du pesticide chlordécone – au cœur duquel la liquidation des stocks de ce pesticide cancérogène dans les champs de bananes antillais, alors que celui-ci était déjà interdit dans l’Hexagone, et depuis plus longtemps dans un pays comme les États-Unis ! – a fait exploser le taux de cancer de la prostate, porté au rang de plus élevé au monde. Ainsi, plus de 35% des Guadeloupéens et 38% des Martiniquais déclaraient en 2018 souffrir de maladies chroniques selon le rapport de la Direction de la recherche statistique affiliée au ministère de la santé (DREES).

Afin de protéger ces populations qui sont à l’évidence plus vulnérables, c’est en toute lucidité que des députés martiniquais ont adressé le 30 mars une lettre ouverte au président de la République pour appeler à un renforcement de l’aide matérielle, à la reconversion de sites pour accueillir des malades à placer en quarantaine, et veulent obtenir l’autorisation de pratiquer le dépistage généralisé de la population à l’appui des laboratoires locaux. Si ces demandes sont restées sans réponse de la part du gouvernement, elles reçoivent cependant l’assentiment indirect du Conseil scientifique qui a rendu ses conclusions sur les Outre-mer le 8 avril. Il y recommande des mesures « différenciées selon les territoires et élaborées avec les autorités et les acteurs impliqués ». Une utilisation plus large de tests est envisagée, ainsi qu’une nouvelle augmentation du nombre de lits, en plus de l’annonce qui avait déjà été faite par Annick Girardin.
Le second facteur démographique qui tend à faire craindre une propagation plus mortelle du virus que dans le reste de la France est la surpopulation, entraînant la promiscuité : la Guyane dans une certaine mesure, mais surtout Mayotte, en feront les frais. La pression démographique mahoraise, qui fait stagner l’ancien territoire de l’archipel des Comores dans un état de sous-développement, entraîne la mise en confinement de la population dans des conditions très précaires. Les logements sont délabrés et insuffisants pour confiner dignement toute la population, une grande partie de la population n’a pas accès à l’eau courante, et, pour terminer, le territoire est frappé en ce moment par une épidémie de dengue, alors qu’il dispose pour l’instant de moins de 20 lits en réanimation. Si les autres territoires d’Outre-mer venaient à se sortir de cette crise malgré leur grande vulnérabilité, Mayotte aura définitivement plus de mal à s’en relever. Pour contenir autant que possible le risque élevé d’hécatombe, le Conseil scientifique préconise vivement un « confinement aménagé » pour Mayotte qui relève selon lui d’une « catégorie à part ». Cet aménagement se traduirait notamment par la mise en quatorzaine préventive de tous les arrivants sur le territoire pour un temps à définir et le placement des cas avérés dans des structures extra-hospitalières qu’il reste à installer.
Mener ou non une politique différenciée : un faux dilemme ?
À l’issue de ces propositions du Conseil scientifique, la ministre des Outre-mer rappelle par une formule pour le moins tautologique que « le Conseil scientifique conseille, mais ne décide pas », même si elle semble poursuivre son discours en donnant son accord de principe à des mesures renforcées pour les Outre-mer. Pourquoi cette prudence dans le saut décisionnel à effectuer pour protéger comme il se doit les populations ? Par ailleurs, ces propositions sont les mêmes que celles ordinairement souhaitées par les citoyens quel que soit le territoire : contrôle des flux entrant, tests massifs, expansion des capacités d’accueil hospitalières. En réalité, si l’État venait à passer outre les recommandations du Conseil scientifique et donc à refuser les exigences particulières des citoyens et élus d’Outre-mer, ce ne serait pas à déplorer. Les accepter reviendrait à appliquer une politique différenciée sur le territoire national ; choix épineux pour un État républicain que de mieux protéger certains citoyens que d’autres selon leur région de résidence. L’ennui est plutôt que l’État ait justement à considérer ces exigences comme des privilèges, alors que l’ensemble de la nation devrait avoir droit à des mesures à la hauteur de la crise sanitaire en cours, plutôt qu’à quémander chaque jour des masques pour équiper dignement ne serait-ce qu’1% de la population.
“La mortalité qui s’annonce plus grande serait donc à la fois le résultat sinistre de la négligence des Outre-mer par les gouvernements successifs, et le dommage collatéral de choix dangereux et de politiques irresponsables à échelle nationale.”
À chaque épidémie de ce type, plus les armes sont insuffisantes dans l’ensemble de la France, plus les facteurs aggravants dans des territoires comme les Outre-mer auront de l’espace pour s’exprimer. Et de ces facteurs, la plupart auraient pu être éradiqués préventivement par une politique plus volontariste de développement. La mortalité qui s’annonce plus grande aux Outre-mer serait donc à la fois le résultat sinistre de la négligence des Outre-mer par les gouvernements successifs, et le dommage collatéral de choix dangereux et de politiques irresponsables à échelle nationale : le refus de tester massivement la population, l’imprévision et les délocalisations ayant causée la pénurie de masques et de médicaments et, la gestion managériale en flux-tendu des services publics de santé. Les populations subissent avec une inégalité flagrante les risques encourus par des politiques sacrificielles, qu’il est impossible de conjurer en quelques mois.
[1] Rapport de la Cour des comptes, p.77 : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140612_rapport_thematique_sante_outre_mer.pdf
[2] https://www.rci.fm/martinique/infos/Politique/Les-parlementaires-martiniquais-exigent-le-depistage-generalise-de-la-populationhttp:/ ; /www.fxgpariscaraibe.com/2020/03/190-000-cas-potentiels-de-coronavirus-en-martinique-selon-le-directeur-de-l-ars.html