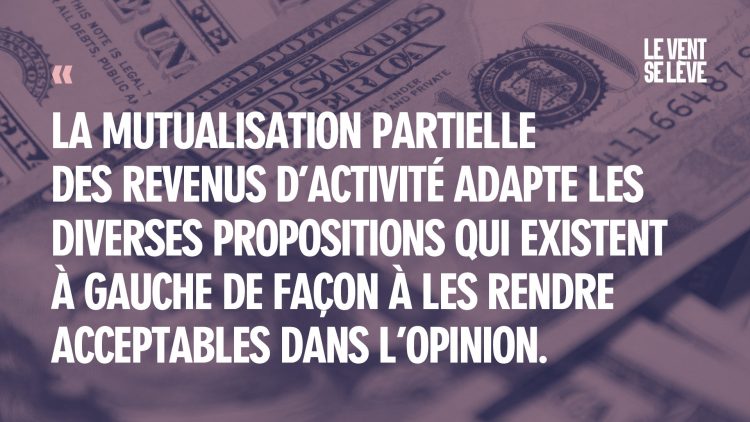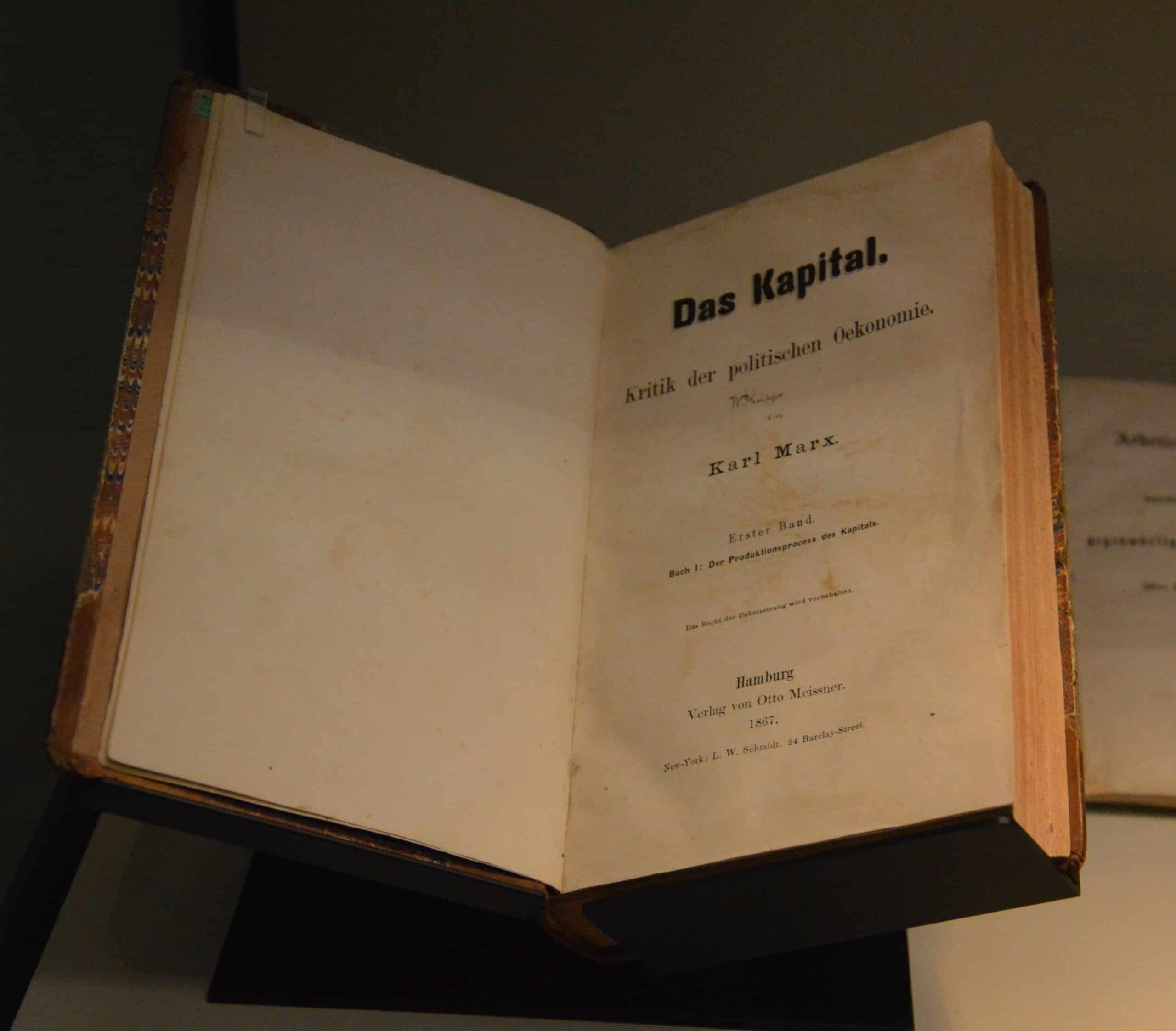« Nous devrions explorer l’idée d’un revenu universel : non pas en défendant l’extension des protections sociales, comme l’entendent les progressistes ; mais d’un point de vue conservateur, celui de l’État minimal. » Ces mots ont été prononcés par Mark Zuckerberg au Forum économique mondial en 2017, mais c’est une large partie du secteur de la tech qui s’est rallié à l’idée d’un « revenu de base » universel. A priori, cette proposition n’a rien à voir avec celle que défend une partie de la gauche. Pourtant, militants « progressistes » favorables au revenu universel et géants de la tech communient autour d’une vision partagée de l’économie et de la société. Ils avalisent l’idée selon laquelle, à l’ère « post-industrielle » marquée par le délitement des solidarités syndicales, la disparition de l’éthique du travail salarié et la généralisation des modes de sociabilité « informels » et « fluides », les transferts monétaires directs s’avèrent plus efficients que les services publics ou les assurances sociales pour combattre la pauvreté. Au prix du renoncement à toute vision transformatrice du politique. Une alliance politique analysée par Anton Jäger et Daniel Zamora, auteurs de Welfare for Markets: A Global History of Basic Income. Traduction Albane le Cabec [1].
En décembre 2020, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, annonçait un don de 15 millions de dollars pour un projet-pilote dans plusieurs villes américaines, après des mois d’une pandémie mondiale qui avait durement frappé les travailleurs. Les réponses offertes par la puissance publique avaient été, au mieux, erratiques. À titre d’exemple, c’est seulement récemment qu’un maigre programme de secours de 1.200 dollars a pu être versé sur le compte des Américains, bloqué par une obstruction parlementaire. C’est dans ce contexte que la start-up « philanthropique » de Jack Dorsey, GiveDirectly, connue pour avoir versé des millions de dollars à des Kényans en situation d’extrême pauvreté, commençait à étendre son activité aux États-Unis – une promesse à la clef : « ce dont les gens ont besoin maintenant, plus que jamais, c’est d’argent liquide ».
Avec le fondateur de Facebook, Chris Hughes, Dorsey se donnait alors comme mission de « combler les écarts de richesse et de revenus, de gommer les inégalités systémiques de race et de genre et créer un climat économique prospère pour les familles », réalisant ainsi « le vieux rêve de Martin Luther King et du mouvement des droits civiques ». Le moyen pour y parvenir ? Un revenu de base universel. Après un silence de vingt ans, c’était le grand retour des transferts en espèces.
Le soutien à cette idée surprend par son œcuménisme. Même le Forum économique mondial, notoirement conservateur, s’y est rallié après la pandémie. Comme le relevait une note pour l’organisation de Guy Standing [professeur britannique d’économie, membre fondateur du Réseau mondial pour un revenu de base NDLR], « le capitalisme de rente, combiné aux révolutions technologiques et à la mondialisation galopante, a donné naissance aux huit géants de notre temps : les inégalités, l’insécurité, la dette, le stress, la précarité, l’automatisation, les extinctions de masse et le populisme néofasciste. » Le coronavirus a rejoint ces cavaliers de l’Apocalypse comme un sinistre « neuvième géant », ou une « étincelle sur la poudrière d’un système mondial croulant ».
De la même manière que le cash était accompagné de conditions d’utilisations très larges, les algorithmes de Facebook étaient d’une parfaite neutralité quant aux normes individuelles.
L’État social dans l’idéologie californienne
Dorsey et Hughes étaient loin d’être les seuls à s’enthousiasmer pour le retour des solutions fondées sur les transferts en espèces dans le secteur de la tech. Au cours des dix dernières années, financiers et entrepreneurs de tous secteurs s’étaient régulièrement prononcés en faveur du revenu universel. Autour de la proposition communient désormais rien de moins que le PDG de Tesla, Elon Musk, le fondateur de Virgin, Richard Branson, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos et le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg.
À première vue, il est difficile de voir ce qui unit ces magnats de la tech aux partisans de longue date du revenu de base, eux-mêmes d’horizons très divers – Philippe van Parijs, Charles Murray, David Graeber, Greg Mankiw, Mark Zuckerberg, Chris Hughes, John McDonnell, Yannis Varoufakis, Kathi Weeks, Jim O’Neill, Nick Srnicek, Anne Lowrey, Andrew Yang, etc. Un bref retour historique, cependant, permet de rappeler que gauche et droite ont fréquemment défendu les transferts en espèces comme un moyen de pallier les dynamiques qui caractérisent le capitalisme contemporain depuis des décennies : privatisation croissante des besoins, perte d’une identité sociale structurée par le travail, atomisation de la société, etc.
Une vaste littérature issue du secteur de la tech, dans les années 1990, allait apporter sa contribution au débat. Ce sont le gourou du management Peter Drucker et le politologue libertarien Charles Murray qui ont été les principales figures d’inspiration du mouvement pour un revenu de base. Murray s’inspirait des stratégies anti-pauvreté que Daniel Patrick Moynihan [adjoint du secrétaire d’État au travail sous la présidence de Gerald Ford NDLR] avait conçu pour la première fois à la fin des années 1960 – alors que les inquiétudes naissantes concernant les familles noires ont poussé les dirigeants à expérimenter des transferts en espèces. Pour Murray, l’extension des crédits d’impôt de Nixon dans les années 1970 et 1980 offrait une opportunité de taille pour transformer en profondeur l’État-providence américain. Sa configuration serait simplifiée : la redistribution s’effectuerait directement en espèces plutôt que par l’entremise de services publics.
« Puisque le gouvernement américain [allait] continuer à dépenser une énorme somme d’argent en transferts de revenus », déclarait Murray, il serait préférable de « prendre tout cet argent et de le restituer directement au peuple américain sous forme de subventions en espèces ». Le livre de Murray attachait de fortes conditionnalités aux subventions, dans l’espoir de revitaliser un paysage civique atomisé : l’aide serait conditionnée par l’adhésion à un organisme bénévole, qui verserait les subventions et imposerait des normes de comportement aux bénéficiaires. Couplé à un programme plus large de réductions d’impôts, la proposition de Murray entendait à la fois assouplir la rigidité du marché du travail et remédier à la crise des chefs de famille américains. Cette proposition a gagné en popularité dans le secteur de la tech, de l’institut Cato jusqu’à Stanford.
Bien sûr, la situation post-2008 rendait les débats sur le revenu de base moins perméables aux considérations de Murray sur les chefs de famille. Avec la faillite des dotcoms de 2001, Google, Facebook et Twitter cherchaient à apparaître comme l’avant-garde d’une nouvelle ère d’internet – plus attentive aux enjeux « sociaux ». Focalisées sur les possibilités offertes du commerce de détail, elles ont encouragé une culture du profit de court-terme et du travail à la tâche. Cette économie de plateforme ne présupposait plus une unité familiale stable, fondée autour du chef de famille. L’apocalypse de l’automatisation ne s’était également pas concrétisée : plutôt que d’être remplacée par des robots, la main-d’œuvre de l’économie de services était de plus en plus supervisée et médiatisée par des plateformes numériques – un contrôle par des algorithmes qui, malgré ses promesses, peinait à accroître la productivité. « L’automatisation complète », comme l’analysait Hughes, semblait principalement concerner une couche de cadres intermédiaires qui était de toutes manières conduite à décroître.
Cette nouvelle économie était cependant fondée sur autre chose que la corvée. Les interactions sociales suivaient une évolution similaire à celle du monde du travail : à l’ère post-industrielle, elles devenaient plus informelles et liquides. En net contraste avec les médias, organisations et partis traditionnels, les réseaux sociaux permettaient des échanges plus ouverts et moins hiérarchiques entre citoyens. Les transferts en espèce étaient un complément naturel à cette nouvelle donne.
De la même manière que le cash était accompagné de conditions d’utilisations très larges, les algorithmes de Facebook étaient d’une parfaite neutralité quant aux normes individuelles. Ils permettaient aux utilisateurs de se rassembler spontanément, puis de se disperser avec des coûts de sortie plus faibles que dans les organisations traditionnelles. Pour Chris Hughes en particulier, le fondateur de Facebook, l’histoire américaine offre de nombreuses alternatives pour révolutionner le fonctionnement de l’État-providence.
Il fallait chercher « la cause profonde de la pauvreté », selon les responsables du projet, dans « un manque d’argent ». Un chèque suffirait pour offrir « la dignité et le libre arbitre que tout le monde mérite ».
Les États-Unis « pratiquent déjà les plus importants transferts en espèces de la planète, procurant des dizaines de milliards de dollars sans conditions aux familles pauvres ». Citant les précédents de Moynihan et de Nixon, Hughes dressait une ligne directe entre les années 1960 et 2010 : de la même manière que des plateformes comme Facebook, Twitter et Reddit, le plan Earned Income Tax Credit de Nixon reposait sur l’idée que financer des services publics pilotés par l’État était d’une efficacité moindre que de mettre de l’argent entre les mains des salariés. Sur internet comme dans la vraie vie, les utilisateurs pourraient déterminer leurs propres besoins et préférences.
Le « quantitative easing pour le peuple » promu par Hughes avait des racines anciennes – notamment dans les écrits de Milton Friedman. Comme celui-ci l’indiquait lui-même dans les années 1930, le New Deal avait mis fin à l’ère du laissez-faire : il devenait admis que le devoir de l’État était de stabiliser l’économie de marché. Mais Friedman avait une idée bien précise de la forme que devait revêtir cette stabilisation de l’économie par l’État – aux antipodes de toute forme de contrôle des prix, de services publics ou de planification d’État. L’action économique devait être tout entière déléguée à la Banque centrale, dont l’expertise technique pourrait alimenter le pouvoir d’achat des citoyens par l’entremise de la « monnaie-hélicoptère ». On a là une apologie précoce des transferts monétaires – de type « techno-populiste » – préconisant la distribution directe de cash aux citoyens par la Banque centrale, afin de relancer la consommation.
Pour Hughes et les autres « techno-populistes », cet agenda était viable tant pour les États-Unis que le reste du monde. Après sa rencontre avec GiveDirectly en 2012, l’actionnaire de Facebook s’est persuadé que l’État-providence américain trouverait son salut dans un tel cadre. En 2019, il posait déjà les enjeux en ces termes : « Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas besoin d’hôpitaux et d’écoles. Il faut cependant poser la question suivante : est-il préférable de verser un dollar dans un hôpital, ou un dollar en espèces, directement dans la poche des gens, pour qu’ils puissent aller trouver directement les ressources de santé dont ils ont besoin ? ». Une manière, selon un journaliste de l’époque, de « rendre la vie plus facile et plus épanouissante pour les pauvres ». Dans le contexte du tournant philanthropique de la tech, ajoutait-il, l’initiative s’inscrivait ouvertement contre ceux qui estimaient « que les bénéficiaires ne sont pas toujours les mieux placés pour utiliser l’argent versé de façon optimale ».
Ce scepticisme des barons de la tech à l’égard des approches top–down allait être renforcé par l’échec absolu de la tentative – à hauteur de 100 millions de dollars – de Mark Zuckerberg visant à révolutionner l’éducation dans le New Jersey. Inauguré en 2010 avec une armée de consultants, ce projet aux accents paternalistes semblait issu d’un autre temps. Le désastre qui a résulté de cette initiative, censée ouvrir la voie à un système éducatif entièrement neuf, n’était pas sans rappeler l’échec des projets de Jeffrey Sachs en Afrique, destinés à mettre fin à la pauvreté sur le continent – grâce au financement massif de services publics par des fortunes privées. Il a conduit les magnats de la tech vers davantage de prudence.
En 2016, « l’incubateur » de start-ups Y Combinator – qui finançait AirBnb, Dropbox et Twitch – devait mettre en place sa propre expérience-pilote de revenu universel dans l’Oakland. Modeste à l’origine, elle allait progressivement être étendue, alors que des financements considérables affluaient vers les géants de la tech avec la pandémie.
Bientôt rebaptisé Open Research Lab, il allait être renforcé par des financements supplémentaires issus des fonds de Jack Dorsey et de Chris Hughes. Ces projets-pilotes consistaient en des « essais randomisés contrôlés » (ECR), sélectionnant au hasard mille bénéficiaires destinés à recevoir 1.000 dollars par mois pendant trois ans. Le cadre expérimental était explicitement inspiré par les pilotes subsahariens dirigés par GiveDirectly – qui exportaient eux-mêmes le modèle des ECR dans l’hémisphère Sud. En 2018, et par l’intermédiaire de sa propre organisation, l’Economic Security Project, Hughes a financé le projet Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED), une expérience de vingt-quatre mois dans la ville de Stockton, en Californie, qui consistait à envoyer un chèque de 500 dollars chaque mois à 125 habitants de la ville sélectionnés au hasard.
Pour la gauche favorable au revenu de base, celui-ci offre un soulagement au « précariat » croissant et se montre plus efficient que les modèles d’assurance classiques – fondés sur une éthique du travail industriel jugée désuète.
Il fallait chercher « la cause profonde de la pauvreté », selon les responsables du projet, dans « un manque d’argent ». Un chèque suffirait pour offrir « la dignité et le libre arbitre que tout le monde mérite », ajoutaient-ils. On pouvait lire sur le site du projet : « en lieu et place d’une approche paternaliste consistant à dicter comment, où et à quelles conditions les individus peuvent construire leur vie, le versement direct d’argent offre la dignité et l’autodétermination aux citoyens, révélant à quel point la première approche est désuète et enracinée dans la méfiance ».
Les partis politiques devaient progressivement leur emboîter le pas. En 2020, le pilote devenait la pièce-maîtresse du candidat à la primaire démocrate Andrew Yang, qui le qualifiait de « dividende de la liberté » dans sa campagne présidentielle. Le maire de Stockton, Michael Tubbs, a même fondé sa propre organisation, Mayors for Guaranteed Income, pour renforcer cette politique à travers le pays. Soutenue par plus de cinquante maires, la coalition de Tubbs s’est déployée en lançant des pilotes du New Jersey à l’Indiana en passant par New York.
Après le crash de la pandémie, Jack Dorsey a fourni un montant sans précédent pour financer des expériences et des recherches sur le revenu de base. En avril 2020, il a annoncé la création d’une nouvelle initiative philanthropique, #startsmall, qui, grâce à un don personnel d’un milliard de dollars – environ un tiers de la richesse de Dorsey –, est probablement le plus grand bailleur de fonds des initiatives de la sorte. Le fonds a été conçu pour promouvoir la santé et l’éducation des jeunes filles par le biais d’un revenu de base. Pour accélérer le passage aux transferts en espèces, Dorsey a notamment fait don de 18 millions de dollars à la coalition des maires de Tubbs, un autre de 15 millions à l’expérience Y Combinator à Oakland, de 10 millions à la fondation d’Andrew Yang, de 5 millions à la One Family Foundation à Philadelphie et, enfin, de 3,5 millions au Cash Transfer Lab de l’Université de New York, où Dorsey avait fait ses études supérieures.
Si elles sont nées de l’engouement numérique des années 2010, ces initiatives ont aussi une histoire particulière. Elles sont appuyées par un arsenal d’arguments développé par deux générations de militants du revenu de base et renforcées par l’obsolescence des solutions auparavant mobilisées contre la dépendance au marché. Le revenu de base était à la fois un indice de recul – la disparition d’un ancien étatisme social – et un accélérateur du processus en cours. La proposition a fleuri dans le sillage d’une double désorganisation : l’affaiblissement d’un mouvement syndical dense capable de s’ériger en contre-pouvoir et celui des partis de masse qui agissaient en toile de fond. Dans son sillage, une nouvelle politique « techno-populiste » est apparue, axée sur les relations publiques et la sensibilisation des médias, dans laquelle les militants prétendent parler au nom d’une majorité silencieuse. Contrairement aux groupes d’intérêts plus anciens, ceux-ci expriment principalement des demandes abstraites d’amélioration de leur bien-être : verser de l’argent plutôt que consolider l’allocation de ressources spécifiques.
Les Occidentaux « ont besoin de définir un nouveau contrat social pour notre génération » et « d’explorer des idées telles que le revenu de base universel » déclarait Mark Zuckerberg en 2017. Cela implique de redessiner le contrat social conformément aux « principes d’un gouvernement restreint, plutôt que conformément à l’idée progressiste d’un filet de sécurité sociale élargi ». Pour la gauche favorable au revenu de base, il offre un soulagement au « précariat » croissant et se montre plus efficient que les modèles d’assurance classiques – fondés sur une éthique du travail industriel jugée désuète. Dans les années 2000, la proposition s’est imposée comme la condition du bien-être des pays du Nord et du Sud : non plus comme la « voie capitaliste vers le communisme » qu’avait présagée Philippe van Parijs dans les années 1980 ou la nouvelle économie du développement des années 2000, mais comme l’« utopie pour les réalistes ». Au prix d’un renoncement complet à une conception radicale et transformatrice du politique.
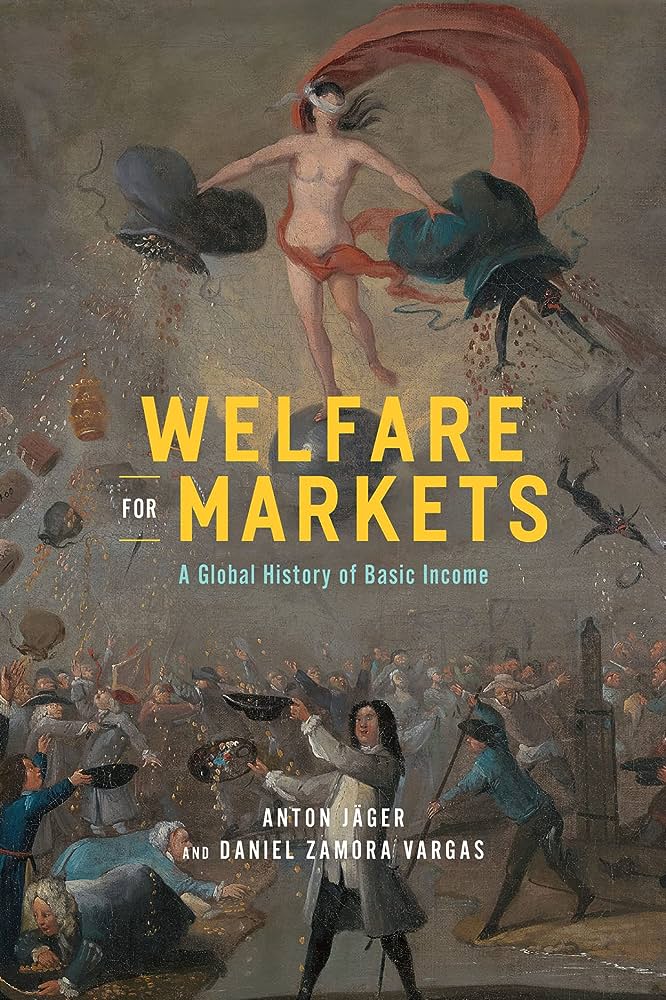
Welfare for markets. A global history of basic income.
Anton Jäger et Daniel Zamora Vargas, University of Chicago Press, 2023.
Note :
[1] Cet article constitue une version remaniée et traduite des premières pages de l’épilogue de l’ouvrage.