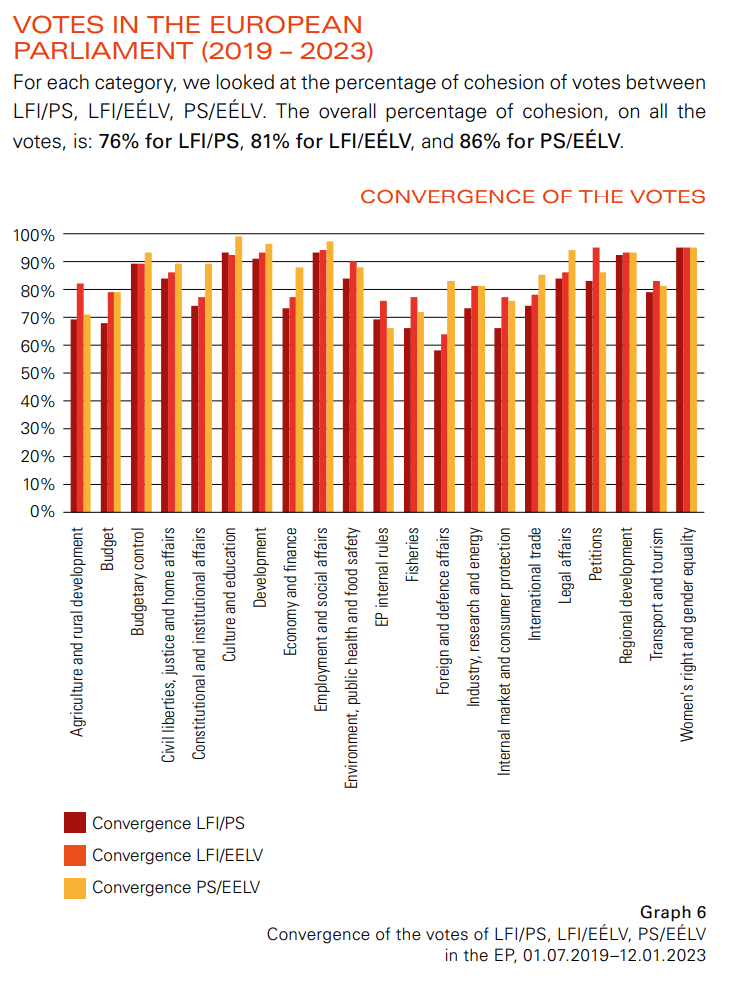Malgré la performance de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, la gauche française demeure affaiblie. Les racines de cette faiblesse remontent aux années 1980, lorsque le gouvernement de François Mitterrand déçoit très vite les espoirs suscités en 1981, en choisissant d’approfondir la construction européenne plutôt que de mener une politique socialiste. Un moment en particulier est passé à la postérité : le « tournant de la rigueur » de mars 1983, suite au choix de rester dans le Système monétaire européen plutôt que de dévaluer le franc. Mais ce choix fut-il aussi décisif qu’il le semble ? Pour Neil Warner, doctorant à la London School of Economics, ce résumé est trop simpliste et cache d’autres mécanismes expliquant la conversion du PS du socialisme au néolibéralisme. Traduit par Alexandra Knez et édité par William Bouchardon.
La France sort encore une fois d’une élection présidentielle dominée par le néolibéralisme débridé d’Emmanuel Macron et la politique d’extrême-droite de Marine Le Pen. Avec une abstention presque record au premier tour, des millions de citoyens se sont de nouveau sentis forcés de voter Macron pour faire un ultime barrage à l’extrême-droite, tout en sachant que celui-ci continuerait sa destruction du système social français, son attitude autoritaire envers les minorités ethniques et en matière de maintien de l’ordre.
Certes, la très bonne performance de Jean-Luc Mélenchon au premier tour a bien démontré que la gauche résistait en tant que troisième bloc politique en France, et les négociations pour une union des gauches aux prochaines législatives offrent une chance importante à ce pôle de s’affirmer. Mais tant en termes électoraux que sur des questions fondamentales de programme et d’organisation, la gauche française demeure une force affaiblie et troublée.
L’histoire courante : la trahison en une décision
L’histoire de la faiblesse de la gauche française est longue et jalonnée de moments charnières sur les quarante dernières années. Pourtant, une date est constamment évoquée : mars 1983, quand le gouvernement de gauche du président François Mitterrand décida de rester au sein du Système monétaire européen (SME) et d’implémenter des mesures d’austérité. Cet événement est en effet très souvent convoqué par les historiens et commentateurs divers pour raconter l’histoire récente de la gauche française, ses rêves brisés et son désarroi croissant. Selon ce narratif, les réformes radicales amorcées par le gouvernement Mitterrand au début du septennat en 1981 ont été mises en pièces par une conversion dramatique au néolibéralisme, le fameux virage à 180 degrés de 1983.
Cette histoire n’intéresse d’ailleurs pas que les Français. Arrivé au pouvoir peu de temps après Ronald Reagan et Margaret Thatcher, le nouveau gouvernement français représentait bel et bien une réelle alternative aux politiques alors menées aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ainsi, le fameux « tournant de la rigueur » apparaît donc souvent comme un moment clé du triomphe international du néolibéralisme, venant confirmer le célèbre « There is no alternative » de Thatcher.
Dès lors, examiner cette période sous un nouvel angle est indispensable. Loin d’être un débat d’historiens, l’étude de la gauche française au début des années 1980 permet de mieux comprendre l’état actuel de la scène politique actuelle. Or, il se trouve que la version couramment évoquée, assez simpliste, souffre de plusieurs faiblesses majeures.
L’histoire habituelle est celle-ci : en mai 1981, la gauche française accédait enfin au pouvoir après en avoir été écartée depuis le début de la Ve République, en 1958. Dans cette atmosphère d’euphorie post-électorale, le nouveau gouvernement déploya un agenda radical visant à stimuler la croissance économique et l’emploi grâce à une hausse de la consommation, des dépenses publiques, des politiques de redistribution, en offrant plus de droits aux salariés et à travers une politique industrielle plus interventionniste.
Cependant, cette politique budgétaire expansionniste eut lieu alors que l’économie mondiale se contractait. De plus, le coup de pouce à la consommation locale n’a pas adressé les problèmes structurels profonds de l’industrie française. Le pays faisait face à une inflation élevée et à une détérioration de son déficit commercial. Dans ce contexte, le gouvernement pouvait pallier la crise de la balance des paiements en procédant à une importante dévaluation du franc, augmentant ainsi sa compétitivité. Mais la France était membre du système monétaire européen (le SME encadrait les marges de fluctuation des taux de change dans le but de faire converger les monnaies des pays membres, ndlr). Une dévaluation sans l’aval des autres membres aurait donc signifié, pour le gouvernement, une sortie du mécanisme de change et l’obligation de laisser la valeur du franc fluctuer avec les marchés internationaux.
En mars 1983, cette situation finit par devenir intenable. Dans une décision qui s’avérera définitive, le gouvernement opta finalement pour rester au sein du SME. Un nouveau « plan de rigueur » s’attela à corriger l’équilibre commercial, en réduisant cette fois drastiquement la consommation et le déficit budgétaire.
Il est devenu commun de présenter ce choix comme clair et historique. Si la France avait quitté le SME, son gouvernement aurait sûrement poursuivi son programme de politiques de gauche, priorisant la croissance et l’emploi, tout en érigeant un mur protectionniste pour se protéger des contraintes d’une économie mondialisée. En restant dans le SME, il choisit au contraire délibérément de s’aligner sur les politiques néolibérales d’austérité, de désinflation et de libéralisation de l’économie, et donc d’abandonner la vision socialiste mise en œuvre à partir de 1981.
De nouvelles interprétations
Un nombre croissant d’historiens français – notamment Michel Margairaz, Jean-Charles Asselain, Mathieu Fulla, Matthieu Tracol, Laure Quennouëlle–Corre et Florence Descamps – remettent cependant ce récit en question. S’ils se focalisent sur des domaines différents, tous présentent des arguments complémentaires les uns des autres, remettant en cause l’idée selon laquelle le mois de mars 1983 serait décisif.
Ainsi, les politiques mises en place entre 1981 et 1983, mais aussi avant 1981, tant dans la pensée du parti socialiste français en tant que parti d’opposition que dans les politiques des gouvernements de droite antérieurs sont marquées par d’importantes continuités. Par ailleurs, de nombreux changements clés intervenus entre 1981 et 1983 n’ont pas coïncidé avec le fameux « tournant de la rigueur ». De toute évidence, le tournant vers la «rigueur» a vraiment commencé au plus tard en juin 1982, lorsque le gouvernement introduit un gel des prix et des revenus, fixe une limite de 3 % de déficit et choisit de focaliser son attention sur la lutte contre l’inflation plutôt que sur la lutte pour le plein-emploi. Plus largement, d’autres décisions majeures en faveur du néolibéralisme eurent lieu avant 1982 et beaucoup d’autres après 1983.
En outre, le récit courant du « tournant de la rigueur » met dans le même sac des politiques certes étroitement liées, mais qui ont néanmoins leur propre logique. Ainsi, il est important de faire la distinction entre A) la mesure dans laquelle les politiques budgétaires étaient expansionnistes ou restrictives, B) les objectifs redistributifs et l’impact des différentes politiques et C) la nature des réformes structurelles mises en œuvre par le gouvernement. En y regardant de plus près, la décision de quitter ou non le SME ne fut pas décisive dans un seul de ces domaines.
Les premières années Mitterrand furent-elles radicales ?
Le récit autour de 1983 a surtout mis l’accent sur la première de ces décisions politiques : le passage d’une politique expansionniste à une politique restrictive. Pourtant, les budgets déployés par la gauche sont en réalité assez peu en rupture avec la politique menée précédemment. Ainsi, la relance de 1981-1982 était plus faible en pourcentage du PIB que celle précédemment poursuivie par le gouvernement de Jacques Chirac en 1975. En effet, à peine Pierre Mauroy était-il nommé nouveau Premier ministre par François Mitterrand, qu’il avait déjà insisté sur l’importance de la « rigueur ».
Les ruptures les plus claires entre les politiques d’avant 1981 et celles d’après l’arrivée du PS au pouvoir se trouvent plutôt dans les domaines de la redistribution et des réformes structurelles. Le gouvernement cherchait avant tout à stimuler les revenus et la consommation des personnes aux revenus les plus faibles, notamment à travers un rehaussement des prestations sociales et du salaire minimum, tout en imposant plus fortement les revenus et patrimoines aisés.
On pouvait déjà voir une esquisse de cette nouvelle orientation dans la gamme de réformes structurelles poursuivies par le gouvernement : la retraite à 60 ans, passage aux 39 heures hebdomadaires, lois Auroux accordant de nouveaux droits aux salariés… Outre ces réformes, le gouvernement nationalisa douze grands groupes industriels et la majeure partie du système bancaire privé, ce qui constitue un transfert de propriété majeur. Nombre de ces programmes politiques furent certes très marqués par l’arrivée de la « rigueur », mais ils avaient néanmoins des logiques propres et suivaient des chronologies différentes.
NDLR : Pour en savoir plus sur les nationalisations de 1981, la façon dont elles furent conduites et leur relatif échec, lire sur LVSL l’interview de l’économiste François Morin, conseiller auprès du secrétaire d’État à l’extension du service public, par William Bouchardon : « Si on nationalise, alors allons vers la démocratie économique ».
Par ailleurs, contrairement à une théorie souvent entendue, la gauche de 1981 ne méconnaissait pas les problématiques de l’offre ou les contraintes internationales. Bien au contraire, les différents courants de gauche étaient profondément conscients de ces contraintes. Ces préoccupations étaient d’ailleurs une justification majeure du programme de nationalisations, dont l’enjeu principal était de stimuler la productivité et la compétitivité de l’industrie française par le biais d’investissements et de restructurations menés par l’État.
L’accélération de la mondialisation était d’ailleurs prise en compte dans ce raisonnement. Comme Mitterrand l’a soutenu lors de sa première conférence de presse en tant que Président : « Ces nationalisations nous donneront les outils du siècle prochain », avertissant au passage que, si cette mesure n’était pas prise, les entreprises françaises en question « seraient rapidement internationalisées ».
La décision en faveur du SME
Contrairement à la version souvent entendue, la décision de rester dans le SME n’était pas non plus un choix clair entre politique budgétaire expansionniste et austérité. En effet, étant donné qu’un tournant vers l’austérité avait déjà été amorcé en 1982, la plupart des partisans de la sortie du SME défendaient aussi de nouvelles mesures d’austérité. Pour ces derniers, le gouvernement devait contenir l’inflation et empêcher une trop grande dévaluation du franc. Ils estimaient cependant qu’en sortant du SME, la France pourrait sortir plus rapidement de l’austérité en rééquilibrant plus vite sa balance commerciale. Ainsi, le « tournant de la rigueur » aurait tout de même eu lieu.
Etant donné qu’un tournant vers l’austérité avait déjà été amorcé en 1982, la plupart des partisans de la sortie du SME défendaient aussi de nouvelles mesures d’austérité.
D’ailleurs, ni le choix de rester dans le SME ni les mesures d’austérité ne constituaient une adhésion du gouvernement Mitterrand à la libéralisation économique. Au contraire, le gouvernement de l’époque combina des mesures d’austérité en 1982 et 1983 avec un resserrement des contrôles sur le crédit. Les mesures les plus controversées de mars 1983 furent d’ailleurs de nouveaux contrôles des changes draconiens, qui visaient à décourager la population de prendre des vacances à l’étranger, afin d’encourager l’activité économique en France.
Enfin, laisser la valeur du franc « flotter » sur les marchés internationaux, en dehors du SME n’impliquait pas forcément la mise en place de mesures plus protectionnistes. À bien des égards, ces deux solutions auraient d’ailleurs pu se substituer l’une à l’autre pour parvenir au même objectif : rétablir un certain équilibre de la balance des paiements.
Derrière mars 1983, une multitude de décisions en faveur du capital
Après les mesures de juin 1982, Mitterrand demanda d’ailleurs à son gouvernement de protéger les taux d’intérêt domestiques des marchés extérieurs et d’accélérer la « réforme bancaire », c’est-à-dire une gestion accrue de l’État sur la distribution du crédit dans un système bancaire désormais presque entièrement nationalisé. Selon les mémoires de son conseiller Jacques Attali, il aurait réclamé de façon irrégulière des actions en ce sens à son ministre des Finances Jacques Delors, et ce, au moins jusqu’à l’été 1983.
Mitterrand n’était pas très impliqué dans les détails de la politique financière du gouvernement, et sa principale préoccupation semble avoir été de faire baisser les taux d’intérêt de quelque manière que ce soit. Cependant, le secteur bancaire français et Jacques Delors étaient profondément hostiles à de telles idées. Delors sut résister à ces demandes occasionnelles de Mitterrand et à d’autres, poursuivant plutôt une voie de réformes bancaires plus limitée.
NDLR : Pour une analyse des choix économiques effectués à l’époque, qui ont entraîné une forte hausse du chômage, lire sur LVSL l’entretien de Jules Brion avec le journaliste Benoît Collombat : « Le choix du chômage est la conséquence de décisions néolibérales ».
Pierre Bérégovoy, son successeur au poste de ministre des Finances, promeut ensuite une vaste déréglementation du secteur avec le même objectif fondamental de réduire les taux d’intérêt. À partir de 1984, lorsque les socialistes forment un nouveau gouvernement – sans le parti communiste français (PCF), partenaire minoritaire mécontent et marginalisé – sous la houlette de Laurent Fabius, la « rigueur » s’installe durablement. Elle se fonde notamment sur une désinflation compétitive – c’est-à-dire une baisse de l’inflation qui permette de se rapprocher des taux en vigueur dans les autres pays européens – et un franc fort. Concrètement, cette politique se traduit entre autres par la fin de l’indexation des salaires sur l’inflation.
En matière de politique industrielle, après le premier virage vers la « rigueur » en juin 1982, le gouvernement adopte – brièvement – une politique encore plus interventionniste, en déversant d’importantes sommes dans les industries d’État. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l’Industrie de l’époque et chef de la faction du CERES (le centre d’études, de recherches et d’éducation socialiste, une aile de gauche « gaullo-marxiste » du Parti socialiste, ndlr) voulait en effet plus d’investissements dans les entreprises publiques, éventuellement par le biais d’une grande banque nationale d’investissement qui serait créée grâce à une réorganisation du système bancaire.
Chevènement prônait essentiellement sa propre forme de « rigueur ». Il admettait que l’augmentation des investissements se ferait au détriment de la consommation. Tout en cherchant à protéger l’emploi, il prévoyait également des baisses de salaire. Il visait dans le même temps à accroître le rôle de son ministère dans la gestion des industries d’État.
Cette courte phase de la politique industrielle prit fin avant la décision de rester dans le SME. En février 1983, Chevènement était déjà proche de la démission, suite aux réprimandes de Mitterrand après la remontée de plaintes de différents dirigeants d’entreprises publiques. A ce moment-là, l’option de la sortie du SME est toujours envisagée par Mitterrand selon de nombreux témoignages, dont celui de Chevènement.
Anesthésie sociale
En termes de politique redistributive et d’attitude de l’État vis-à-vis du capital et du travail, un changement clé a lieu avant même le tournant de juin 1982 : une baisse de l’impôt sur les sociétés est décidée au printemps 1982. En parallèle, le gouvernement assura les organisations patronales – en privé – qu’il n’y aurait plus de nouvelle augmentation des cotisations sociales ni de réduction du temps de travail.
Comme l’explique l’historien Matthieu Tracol, cette décision fait du printemps 1982 un moment aussi significatif que ceux de juin 1982 ou mars 1983 : la réduction de la semaine de travail était un levier clé pour ce que le gouvernement déclarait être son objectif premier : réduire le chômage. Alors que la seule croissance économique se révèle insuffisante pour parvenir à cet objectif, la réduction du temps de travail était en effet au cœur du programme économique alors défendu par le PS.
Certains partisans influents d’une sortie française du SME, comme l’homme d’affaires socialiste Jean Riboud, ont fait valoir que le gouvernement devrait combiner cette réforme avec une réduction substantielle des cotisations d’entreprise. Mitterrand reviendra plus tard sur ce programme en 1983, lorsqu’il insistera pour réduire ces cotisations, menant une politique qui allait à l’encontre de la logique générale et des contraintes de « rigueur », et qui se heurta par ailleurs aux protestations de Jacques Delors.
Toutefois, certaines des politiques adoptées au début du premier quinquennat de François Mitterrand ne furent pas abandonnées et sont restées comme un héritage. Les prestations sociales se sont maintenues à un niveau élevé et l’âge de la retraite fut maintenu à 60 ans. Des choix qui permirent au gouvernement d’obtenir ce que le politiste Jonah Levy appelle une « anesthésie sociale », faisant mieux accepter la pilule d’un chômage en augmentation.
L’héritage de mars 1983
Si le « tournant de la rigueur » de mars 1983 n’est donc pas aussi décisif qu’il est souvent décrit, il n’est pas pour autant insignifiant. Il s’inscrit dans une chronologie de décisions par lesquelles le gouvernement français choisit de se détourner de la question du chômage pour donner plutôt la priorité aux questions d’inflation et d’équilibre commercial.
Par ailleurs, le tournant de mars 1983 a peut-être aussi eu des conséquences plus indirectes, justement car ce récit d’un revirement décisif s’est vite imposé, donnant naissance à une prophétie auto-réalisatrice. En effet, le gouvernement ayant perdu en popularité et étant perçu comme ayant trahi ses promesses, les socialistes se sont mis à chercher une nouvelle raison à donner aux électeurs de voter pour eux. Ils la trouvèrent dans le renouveau de la construction européenne à partir du milieu des années 1980 : à travers celle-ci ils pourraient exprimer leur engagement en faveur de la « modernisation ».
Pour en savoir plus sur l’obsession européiste de François Mitterrand et les choix réalisés en ce sens au détriment du socialisme, lire sur LVSL l’interview d’Aquilino Morelle par William Bouchardon : « La construction européenne s’est faite contre le peuple français ».
Ce tournant européiste voit le jour sous la direction du nouveau président de la Commission européenne, Jacques Delors, qui obtient le plein soutien de Mitterrand pour relancer l’intégration européenne. Le tournant vers « l’européanisation » fournit ensuite une motivation pour de nombreuses mesures de déréglementation promues par les socialistes pendant le reste de leur mandat. Mais les événements de mars 1983 n’étaient qu’une partie d’un processus beaucoup plus long et plus complexe.
De plus, il serait erroné de voir la décision de rester au sein du SME comme une victoire pour la soi-disant « deuxième gauche », antiétatique et internationaliste, souvent associée à des personnalités comme Michel Rocard, un rival de Mitterrand qui sera finalement son Premier ministre. Le narratif convenu présente en effet souvent mars 1983 comme le moment où cette « deuxième gauche » l’aurait emporté sur une gauche plus interventionniste, souverainiste et « jacobine », qui aurait influencé la politique avant 1983.
Certes, il est vrai que Jacques Delors, l’un des représentants de la deuxième gauche, était le principal défenseur du maintien au SME. Mais Michel Rocard défendait la solution d’un franc flottant (donc en dehors du SME) à partir de 1981. En réalité, la plupart des dirigeants du parti socialiste ne faisaient partie ni de la deuxième gauche, ni ne s’alignaient sur les positions du CERES, ayant une approche plus pragmatique de la politique. Cela n’a cependant pas empêché Rocard et d’autres membres de sa faction de rétrospectivement présenter le virage de mars 1983 comme une victoire de leur propre « réalisme » et « internationalisme ». De son côté, le CERES a également contribué à renforcer ce récit, blâmant la deuxième gauche et la Communauté économique européenne pour l’austérité.
Un mythe utile
Finalement, si le mythe de mars 1983 est resté autant gravé dans les mémoires, c’est sans doute car il a quelque chose à offrir à presque tout le monde. Pour la droite, le centre ou la « deuxième gauche », il permet d’affirmer que les réalités économiques ont contraint le gouvernement socialiste à abandonner son programme politique imprudent et naïf.
Finalement, si le mythe de mars 1983 est resté autant gravé dans les mémoires, c’est sans doute car il a quelque chose à offrir à presque tout le monde.
Selon ce point de vue, la seule alternative était un protectionnisme extrême, coupant la France du reste du monde. Delors lui-même a qualifié de manière assez risible ceux qui voulaient quitter le SME d’ « Albanais », suggérant que la voie qu’ils souhaitaient rangerait la France dans le même camp que l’État stalinien isolé d’Enver Hoxha. En réalité, les choses étaient bien plus complexes et tout un éventail de choix étaient disponibles pour un pays comme la France.
En face, les critiques de gauche sur le bilan du gouvernement socialiste ont sans doute jugé séduisant de mettre l’accent sur mars 1983, car cela donne l’impression que le tournant néolibéral français se résume à ce choix. De ce point de vue, si Mitterrand et ses alliés avaient décidé de quitter le SME, ils auraient pu entraîner la France (et peut-être le reste de l’Europe) sur une voie socio-économique très différente.
Or, cette version des événements est bien trop simpliste. Bien sûr, les socialistes auraient pu faire un certain nombre d’autres choix au début des années 1980, mais tout ne s’est pas joué en mars 1983. Ce mois-là, une politique de « rigueur » était déjà en place, et les socialistes l’auraient encore approfondie par la suite, que la France soit restée ou non dans le SME. Cette période d’austérité aurait cependant pu être plus courte, dans les deux scénarios.
Il faut aussi distinguer le virage vers la « rigueur » des autres choix économiques du gouvernement Mitterrand. Ce tournant n’a pas en lui-même déterminé l’abandon plus large des politiques de redistribution avant et après mars 1983. Le choix de rester dans le SME n’était par ailleurs pas incompatible avec la poursuite de réformes structurelles envisagées en 1981. Surtout, cela n’obligeait pas les socialistes à commencer à promouvoir un programme de libéralisation économique à partir de 1984.
Le PS voulait-il le socialisme ?
En réalité, dès son arrivée au pouvoir, le parti socialiste faisait face à de nombreuses tensions internes. D’une part, il se concevait comme un parti radical, appelant à une rupture avec le système existant. En outre, le PS avait également construit sa stratégie électorale sur l’alliance avec le parti communiste français, la négociation du Programme commun et la conquête des électeurs communistes.
Il y avait, de plus, une profonde frustration dans la gauche française du fait que le pouvoir gouvernemental lui avait échappé pendant des décennies depuis le début de la Ve République en 1958. Tout ceci a donné une écrasante impulsion aux mesures introduites en 1981. Venant d’une longue culture d’opposition, inhabituellement détachée du mouvement ouvrier, la plupart des socialistes avaient également une conception beaucoup trop vague de la façon de mettre en pratique un programme de réformes.
NDLR : Lire à ce sujet l’article d’Antoine Cargoet pour LVSL : « Comment le PS s’est technocratisé pour conquérir le pouvoir ».
Le cas des nationalisations constitue un bon exemple des contradictions alors à l’œuvre. Le gouvernement de l’époque réussit à vaincre des oppositions parfois féroces pour les mener à bien, comme l’attendaient ses sympathisants. En revanche, et de manière assez étonnante, il y eut beaucoup moins d’intérêt, de la part du gouvernement comme de ses sympathisants, pour déterminer ce qu’on allait bien pouvoir faire avec les entreprises désormais détenues par l’État. Dès lors, lorsque les oppositions aux socialistes se firent plus fortes, le gouvernement trouva peu de soutiens derrière lui.
Par ailleurs, derrière la rhétorique et les premières mesures phares au début du premier quinquennat Mitterrand, il y avait aussi toujours une bonne dose de pragmatisme dissimulé. L’objectif économique prioritaire pour de nombreux socialistes était bien une « modernisation » qui provoquerait un renouveau national. En 1981, ce but semblait pouvoir être atteint par un programme de gauche transformateur. Mais par la suite, ce programme s’est heurté à certain nombre de résistances de la part du Capital. Le gouvernement socialiste a alors souvent préféré suivre la voie de la moindre résistance, en fonction du degré d’attention et de combativité qu’il trouvait dans son propre camp. À partir de 1984, cela s’est traduit dans l’adoption d’une vision entièrement nouvelle de leur programme, résolument néolibérale.
A propos de l’auteur :
Neil Warner est doctorant à la London School of Economics. Ses recherches portent sur l’échec des plans de socialisation de l’investissement en Grande-Bretagne, en France et en Suède dans les années 1970 et 1980.