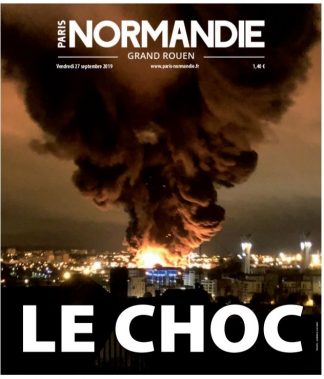En 1989, Margaret Thatcher privatise la gestion de l’eau au Royaume-Uni. Depuis, les compagnies des eaux du royaume se sont considérablement endettées, tout en versant d’énormes dividendes à leurs actionnaires. Les usagers, dont les factures explosent, et l’environnement, avec des rejets d’eaux usées dans les cours d’eau, en font les frais. Plus que jamais, il est urgent que le gouvernement renationalise le secteur et mette fin à ces excès. Par Prem Sikka, originellement publié par notre partenaire Jacobin, traduit et édité par William Bouchardon.
L’obsession néolibérale de la privatisation des industries et des services essentiels hante le Royaume-Uni. La forte inflation – 8% en juin sur un an – et la misère qui touche des millions de personnes sont directement liées aux profits réalisés dans les secteurs du gaz, du pétrole, des chemins de fer ou de la poste. Mais un autre secteur clé est moins évoqué : celui de la gestion de l’eau. La rapacité des entreprises qui domine ce marché est telle que Thames Water, la plus grande entreprise de distribution d’eau et d’assainissement d’Angleterre, est désormais au bord du gouffre.
Les graines de la destruction ont été semées par la privatisation de 1989, lorsque le gouvernement Thatcher a vendu les sociétés de distribution d’eau d’Angleterre et du Pays de Galles pour seulement 6,1 milliards de livres sterling. Mais étant donné qu’il n’existe qu’un seul réseau de distribution et d’égouts, la concurrence est impossible et les clients se retrouvent piégés.Le secteur a adopté le modèle classique de sociétés de capital-investissement : ses prix sont élevés, les investissements faibles et les montages financiers permettent d’obtenir des rendements élevés. Au lieu de demander aux actionnaires d’investir à long terme par le biais de leurs fonds propres, ce modèle a recours à l’endettement car le paiement des intérêts bénéficie d’un allègement fiscal, ce qui constitue, de fait, une subvention publique. Cela permet de réduire le coût du capital et d’augmenter les rendements pour les actionnaires, mais a pour effet d’accroître la vulnérabilité de ces entreprises aux hausses de taux d’intérêt.
Investissements minimaux, profits maximaux
Depuis 1989, en décomptant les effets de l’inflation, les redevances d’eau ont augmenté de 40 %. Les entreprises du secteur ont une rentabilité exceptionnelle : leur marge bénéficiaire est de 38 %, un pourcentage très élevé pour une activité sans concurrence, à faible risque et dont la matière première tombe littéralement du ciel.
Dans le même temps, quelque 2,4 milliards de litres d’eau sont perdus chaque jour à cause des fuites liées au mauvais état des infrastructures. En effet, bien que la population ait augmenté de près de dix millions d’habitants depuis la privatisation, aucun nouveau réservoir n’a été construit. Si les compagnies des eaux sont tenues de fournir de l’eau propre, elles ont en revanche augmenté la pollution de cette ressource vitale en déversant des eaux usées dans les rivières. Les fuites non colmatées et le déversement des eaux usées en pleine nature sont en effet autant de sources d’économies qui permettent d’augmenter les bénéfices, les dividendes et les intéressements des dirigeants.
Les fuites non colmatées et le déversement des eaux usées en pleine nature sont en effet autant de sources d’économies qui permettent d’augmenter les bénéfices, les dividendes et les intéressements des dirigeants.
Ces tuyauteries en mauvais état et ces rejets sauvages nécessitent des investissements considérables pour être corrigés. Selon un rapport de la Chambre des Lords, le secteur a besoin de 240 à 260 milliards de livres de nouveaux investissements d’ici à 2050, bien plus que les 56 milliards de livres suggérés par le gouvernement. Mais les entreprises en question rechignent à investir, préférant profiter de leur rente pour extraire le maximum de liquidités. Depuis la privatisation, ce sont 72 milliards de livres de dividendes qui ont été versés aux actionnaires. 15 autres milliards devraient s’y ajouter d’ici à 2030. Des chiffres à mettre en regard des dettes accumulées par ces entreprises, qui s’élèvent à environ 60 milliards de livres. Pour chaque livre payée par les clients, 38 centimes vont aux profits. Sur ces 38 centimes, 20 vont au service de la dette, 15 aux dividendes et 3 à d’autres postes comme les impôts. Si l’investissement et l’efficacité ont été autant négligés, c’est que les entreprises du secteur ont considéré qu’elles pourraient toujours emprunter à faible coût. Pour couvrir le coût de ces emprunts, les factures des ménages ont bondi.
Bien sûr, il aurait pu en être autrement si l’Autorité de régulation des services d’eau, Ofwat, avait imposé des pratiques plus prudentes. Mais comme souvent, le régulateur obéit en réalité aux intérêts qu’il est censé contrôler : environ deux tiers des plus grandes compagnies de distribution d’eau d’Angleterre emploient des cadres supérieurs qui travaillaient auparavant à l’Ofwat. Six des neuf compagnies d’eau et d’assainissement d’Angleterre ont comme directeur de la stratégie ou comme responsable de la réglementation d’anciens fonctionnaires de l’Ofwat.Les signaux d’alarme au sujet des montages financiers au sein des entreprises de distribution d’eau n’ont pourtant pas manqué. En 2018, l’Ofwat a ainsi suggéré de fixer un plafond au ratio d’endettement à 60 % de la valeur des actifs de ces entreprises, selon des modes de calculs complexes. Mais cette timide volonté de limiter les risques s’est heurtée à un mur : les entreprises en question s’y sont opposées.
Thames Water noyée par ses dettes
Mais ces années de gabegie et d’indulgence des régulateurs ont fini par éclater au grand jour avec la crise de Thames Water. Plus grande entreprise de l’eau outre-Manche, opérant notamment dans le secteur de Londres, Thames Water perd environ 630 millions de litres d’eau par jour à cause de fuites et déverse régulièrement des tonnes d’eaux usées dans les rivières. Depuis 2010, elle a été sanctionnée quatre-vingt-douze fois pour des manquements et s’est vue infliger une amende de 163 millions de livres. Pourtant, le salaire de son directeur général, qui a récemment démissionné, a doublé au cours des trois dernières années.
Depuis sa privatisation, elle a versé 7,2 milliards de livres de dividendes à ses actionnaires, qui sont aujourd’hui principalement des fonds souverains chinois et émiratis. En parallèle, ses dettes s’élèvent à 14,3 milliards de livres, soit presque autant que la valeur totale de tous ses actifs d’exploitation, dont la valeur est estimée à 17,9 milliards de livres. Le ratio d’endettement de l’entreprise avoisine donc les 80 %, bien plus que les 60% recommandés par l’Ofwat.
La détresse de Thames Water est un cas d’école de l’échec de la privatisation, qui cherche le profit à tout prix, en rackettant les clients captifs et en créant des montages financiers intenables.
Comme d’autres compagnies des eaux, elle a emprunté à des taux indexés, ce qui signifie que les intérêts de la dette suivent les évolutions du taux directeur, un pari très risqué. Pendant des années, les audits menés par le cabinet PricewaterhouseCoopers affirmaient pourtant régulièrement que l’entreprise était en bonne santé, alors qu’il était évident qu’elle manquait de résilience financière. Tandis que les auditeurs restaient silencieux, la City de Londres, satisfaite des taux de rentabilité, n’est guère préoccupée de la situation et l’Ofwat n’a presque rien fait. Une passivité qui s’explique aisément : Cathryn Ross, l’actuelle directrice générale adjointe de Thames Water, est une ancienne directrice de l’Ofwat et que son directeur de la politique réglementaire et des enquêtes et son directeur de la stratégie réglementaire et de l’innovation sont également d’anciens cadres de l’Ofwat.
La supercherie a fini par éclater lorsque la Banque d’Angleterre a augmenté les taux d’intérêt depuis environ un an : Thames Water s’est vite retrouvée dans l’impossibilité de réaliser les investissements minimaux requis et d’assurer le service de sa dette. La détresse de Thames Water est un cas d’école de l’échec de la privatisation, qui cherche le profit à tout prix, en rackettant les clients captifs et en créant des montages financiers intenables.
Mettre fin au scandale
Face aux rejets massifs d’eaux polluées et à l’échec complet de la privatisation, les usagers réclament très majoritairement la renationalisation de l’eau. Mais aura-t-elle lieu ? Le parti conservateur, actuellement au pouvoir, est peu enclin à mener ce chantier, tant il est acquis aux intérêts des grands groupes. Le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, en tête dans les sondages, avait certes promis durant sa campagne en 2020 de nationaliser le secteur. Mais, comme d’innombrables d’autres promesses conçues pour plaire à la base militante bâtie par Jeremy Corbyn, cet engagement a été renié. Selon des échanges mails ayant fuité dans la presse, les dirigeants du Parti travailliste et les compagnies des eaux se sont concertés en secret pour créer des « sociétés à but social » qui resteraient privées mais accorderaient une plus grande place aux besoins des clients, du personnel et de l’environnement.
Vaste fumisterie, ce statut d’entreprise ne signifie rien de concret. L’article 172 de la loi britannique sur les sociétés de 2006 impose en effet déjà aux directeurs de sociétés de tenir compte des intérêts des « employés », des « clients », de la « communauté et de l’environnement » lorsqu’ils prennent des décisions. Les résultats sont sous nos yeux… Le concept flou de « but social » ne permettra donc pas de freiner les pratiques prédatrices.
Pour remettre en état le réseau et purger les montagnes de dettes, les vrais coupables doivent être désignés : l’influence toxique des actionnaires et de la course aux rendements financiers. Le seul moyen d’empêcher que ces facteurs continuent à détruire ces entreprises est de revenir à une propriété publique et d’impliquer davantage les usagers. Or, ces entreprises peuvent être rachetées pour une bouchée de pain. Si les normes de protection de l’environnement et des usagers étaient rigoureusement appliquées, les actions des compagnies des eaux ne vaudraient pratiquement plus rien. En cas de défaillance, les créanciers n’obtiendraient probablement pas grand-chose, et le gouvernement pourrait alors racheter les actifs à bas prix. Le coût de ce rachat pourrait être financé par l’émission d’obligations publiques auprès de la population locale avec l’incitation qu’en plus du paiements d’intérêts, les détenteurs d’obligations obtiendront des réductions sur leurs factures d’eau. En outre, les usagers devraient pouvoir voter la rémunération des dirigeants, afin d’empêcher que ces derniers ne soient récompensés pour des pratiques abusives.
Peu coûteux et relativement rapide à mettre en place, le retour à une propriété publique du réseau d’eau et d’assainissement britannique est une priorité absolue étant donné la crise environnementale et sociale qui frappe le pays. Seul manque la volonté politique. Faudra-t-il attendre que les Anglais n’aient plus d’eau ou se retrouvent noyés sous leurs égouts pour que les politiques se décident à réagir ?





















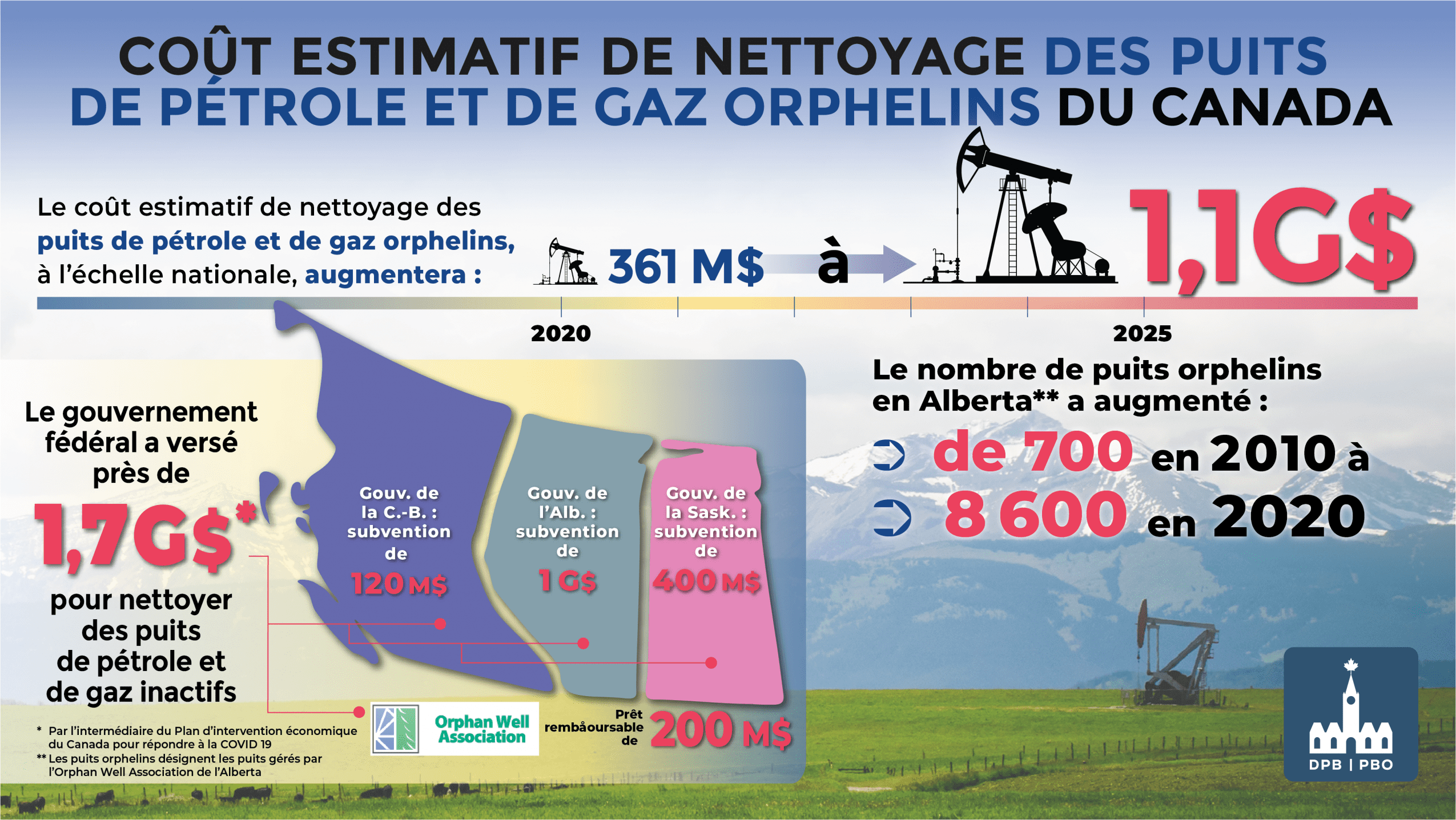


















 Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.
Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.