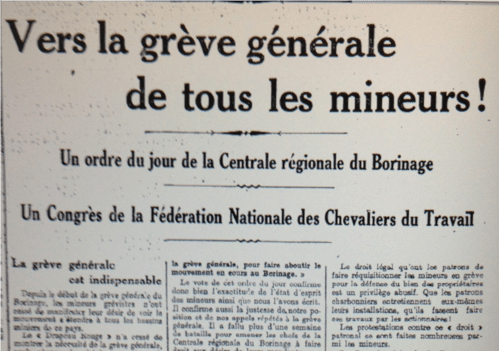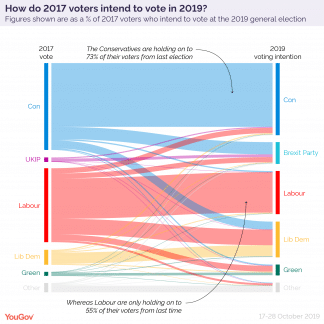Potere al Popolo est un jeune mouvement qui a éclos en Italie à partir d’une convergence entre les centres sociaux et le Parti de la Refondation Communiste. Allié de Jean-Luc Mélenchon, le tout jeune parti a récolté 1,1% des voix aux dernières élections générales. Nous avons pu rencontrer Viola Carofalo à l’ex-OPG Je so pazzo de Naples et nous entretenir avec elle sur l’émergence du mouvement dont elle est porte-parole, et sur l’analyse plus générale qu’elle fait de la situation politique italienne. L’entretien a eu lieu le dimanche 22 avril, avant la formation du gouvernement Lega-M5S.
LVSL – Nous sommes venus hier au centre social observer les activités de l’ex-OPG. Nous voulions savoir comment vous êtes passés d’activités mutualistes à une activité électorale. Comment s’est opéré ce changement qualitatif ?
Pour nous, les activités mutualistes sont des activités politiques, dans le sens où nous ne comprenons pas le mutualisme simplement comme un geste de solidarité, mais comme la possibilité de développer une activité politique. Le foyer pour les migrants et les étrangers, par exemple, constitue un geste de solidarité, mais cela permet aussi de contribuer à la naissance d’un mouvement de revendication des droits des migrants.
Cela vaut pour toutes nos activités comme la médecine ambulatoire. Le mutualisme n’est donc pas une activité sociale séparée du politique : nous les concevons ensemble. Le passage à l’étape électorale a été naturel pour nous puisque c’était un moyen supplémentaire de continuer nos activités.
Mais surtout, c’était un moyen de nous mettre en réseau avec toutes les personnes en Italie qui travaillaient sur ces questions et sur d’autres. Cela nous a permis de mettre en commun ce travail et ces réalités politiques diverses.
LVSL – Comment avez-vous fait pour convaincre ces autres groupes de faire ce saut qualitatif?
Nous avons fait quelque chose de très simple. En novembre, nous nous sommes rendus compte qu’il n’y avait personne pour qui voter, qu’il n’y avait aucun parti ou mouvement qui se reconnaissait dans les valeurs de solidarité, d’antiracisme, et de la centralité du travail. L’offre politique était très à droite en Italie.
Nous avons fait une vidéo dans laquelle nous disions : “Essayons de nous organiser nous-mêmes pour les élections”. Nous l’avons postée sur internet en proposant de se retrouver à un théâtre à Rome pour évoquer cette question. Nous l’avons fait à partir des thèmes de la solidarité sociale, du travail, et de l’antiracisme.
Cette réunion a très bien fonctionné : près de 1 000 personnes sont venues de toute l’Italie. Nous avons alors compris que nous avions les bases suffisantes pour démarrer.
LVSL – Nous aimerions savoir comment s’est déroulée la politisation de ces groupes. Ce mouvement est un peu neuf en Italie. S’est-il construit sur des bases générationnelles, altermondialistes, ou est-il simplement lié à la crise économique ?
Au niveau italien ou au niveau de Naples ?
LVSL – Au niveau italien.
Chaque groupe a son histoire. Dans Potere al Popolo coexistent des subjectivités, des organisations, et des partis qui ont chacun leur histoire. Ce n’est pas nous qui les avons politisés. Nous sommes le produit d’une histoire plus longue. En ce qui nous concerne, l’inspiration initiale est venue de la Grèce, de Podemos, de La France insoumise, puisqu’il nous a semblé que ces mouvements avaient réussi à fournir une réponse à la crise économique et à la crise des modèles sociaux de leurs pays, en agrégeant de façon très large.
Le but était de commencer à former un ample mouvement d’opposition aux politiques néolibérales qui frappent l’Italie, qui était l’un des seuls pays dans lequel il n’y avait pas eu ce type de réponse à la crise.
LVSL – En France nous connaissons peu Potere al Popolo. Pouvez-vous nous parler des différents groupes, des différentes traditions du mouvement ?
Certains groupes comme le nôtre sont issus de centres sociaux [des centres auto-gérés qui accueillent, aident et soignent chômeurs, précaires et migrants en Italie] et de l’espoir qu’ils ont suscité à travers leur expérience et leur histoire. Il y a beaucoup d’expériences similaires à celle de l’OPG, par exemple en Toscane ou en Sicile.
Il y a également des groupes issus de partis : le Parti de la Refondation Communiste et le Parti Communiste, qui sont issus de la tradition du Parti Communiste Italien [longtemps un parti majeur de la politique italienne, avant d’exploser au début des années 1990], mais qui ont sensiblement évolué ces vingt dernières années.
Il y a également de nombreux comités et associations, qui s’occupent par exemple d’environnement et d’écologie, de la transformation et de la défense du territoire. Il y a par exemple “No TAV”, qui est similaire aux mouvements d’opposition aux lignes à grande vitesse en France. D’autres associations s’occupent de questions liées à la pauvreté, à l’immigration et au féminisme.
C’est donc une coalition très hétérogène, du point de vue des mouvements, des militants ou des thématiques. Mais il y a surtout des histoires diverses, avec des personnes qui ont toujours été dans des partis, tandis que d’autres, comme moi, n’en n’ont jamais été membre. C’est la même chose du point de vue générationnel avec d’importantes différences liées à l’âge.
LVSL – Vous avez étudié la philosophie. Comment s’articulent selon vous ces deux activités, la politique et la philosophie ? Quelles sont vos références intellectuelles ?
Notre mouvement est collectif, donc mes références individuelles valent ce qu’elles valent ! Nous sommes évidemment marxistes, donc sur le plan philosophique je pense à Marx. Dans ma formation Franz Fanon a également beaucoup compté, ainsi qu’un certain nombre d’auteurs qui revisitent le marxisme et l’extirpent du contexte du XIXème siècle en essayant d’intégrer des dimensions plus complexes et variées.
“Étudier la philosophie me sert ainsi à juger ce que je fais quotidiennement, à évaluer les directions que je prends. Il y a aussi le risque inverse de se figer dans la pensée et de rester perdu dans les nuages, ce que je refuse.”
Fanon, comme Mao Zedong, a tenté de réactualiser le marxisme à partir d’un contexte différent. On dit souvent que l’activité militante prend le risque de la trahison du penseur, ce qui crée de la polarisation politique. Mais cette opposition est pour moi une trahison du marxisme car ce n’est que dans la dialectique entre l’action et la pensée qu’il est possible de trouver un chemin. Étudier la philosophie me sert ainsi à juger ce que je fais quotidiennement, à évaluer les directions que je prends. Il y a aussi le risque inverse de se figer dans la pensée et de rester perdu dans les nuages, ce que je refuse.
Ceci dit, nous avons des formations théoriques très hétérogènes, et c’est selon moi quelque chose de positif. Quand on effectue des actions politiques concrètes (à Naples, par exemple), nous n’évoquons quasiment jamais des aspects théoriques de manière négative : le fait que l’un soit trotskyste et que l’autre ne le soit pas n’a aucune importance. Nous avons des discussions transversales et sans a priori sur les références qui peuvent nous être utiles, sur celles qui sont actuelles, et qui ont de la valeur dans la conjoncture.
LVSL – On parle beaucoup, ces temps-ci, du populisme issu des théories de Laclau et de Mouffe, eux-même inspirés par Gramsci. Comment vous positionnez-vous sur ces questions ?
En Italie, le populisme a pris deux visages, tous deux néfastes : celui de M5S et celui de la Ligue. Nous avons un nom qui évoque à la fois le peuple et le populisme. Personnellement je crois la chose suivante : il y a une profonde différence entre être populistes et être populaires, qui est ce que nous essayons de faire.
Il existe un populisme que nous jugeons positif et que nous soutenons : celui de l’Amérique latine. Mais il existe également un populisme qui parle au ventre, aux sentiments les plus bas, au racisme, au nationalisme dans le sens négatif du terme, qui fleurit sur le culte du chef …
Si par “populisme” vous entendez la possibilité de parler au plus grand nombre avec des mots simples de manière à être compris, de faire autre chose que de répéter des slogans de gauche déconnectés du peuple – comme la gauche a eu tendance à le faire en Italie ces dernières années –, alors nous jugeons le populisme comme quelque chose de positif.
“Nous parlons de “peuple” car c’est un concept qui parle à beaucoup de monde, c’est un mot qui englobe plusieurs figures : le travailleur et le non-travailleur, l’étranger et l’Italien.”
Mais il y a une différence de taille qui tient au fait que nous sommes antiracistes, et cela n’est pas quelque chose de populiste. Car le populisme se fonde souvent sur une forme de pureté nationale, sur une démarcation entre le “dedans” et le “dehors”, entre ceux dans la nation et ceux qui sont étrangers. C’est ce que font la Lega et le M5S. À l’inverse, nous faisons un raisonnement de classe, et traçons une ligne de fracture entre le peuple d’un côté, les patrons de l’autre. Ce qui n’est pas un raisonnement transversal.
Nous parlons de “peuple” car c’est un concept qui parle à beaucoup de monde, c’est un mot qui englobe plusieurs figures : le travailleur et le non-travailleur, l’étranger et l’Italien. Ce terme reflète des aspects différents de la “classe” et il nous semble donc efficace, mais il n’a rien à voir avec le populisme de droite et la construction de la figure d’un chef qui transcende les masses. Le but est d’être parmi les masses, pas au-dessus d’elles.
LVSL – Pour la France insoumise et Podemos, Chantal Mouffe et Ernesto Laclau sont des références intéressantes pour leur stratégie …
Nous sommes inspirés par Gramsci, pas par Laclau, je vais vous expliquer pourquoi. Ce dernier porte un discours trop subjectiviste. Et cela se ressent dans certains secteurs de Podemos. Il existe bien sûr une conscience de l’être-peuple, et donc une dimension subjective. Mais Il faut conserver une grille de lecture en termes de classes sociales – c’est la raison pour laquelle, en simplifiant, je préfère Gramsci à Laclau. Sinon, on prend le risque de glisser vers un mécanisme purement idéologique, qui fonctionne uniquement en ayant les outils d’information de son côté, et en ayant les outils de production du consensus avec soi sur le plan médiatique et hégémonique.
Cela risque d’être politiquement pauvre, et je crois que nous devons surtout faire en sorte que les gens parviennent à comprendre leur positionnement dans cette société, non du point de vue subjectif mais du point de vue objectif, c’est-à-dire à l’intérieur du rapport d’exploitation. Cette question est laissée en arrière-plan chez Laclau, tandis que pour Gramsci elle se trouve au premier plan.
LVSL – Podemos et la FI doivent aussi leur succès au rôle du leader, du porte-parole, et en dernière instance à une forme de verticalité. À Potere al Popolo, vous semblez rejeter la figure du leader. Quel rôle lui conférez-vous ?
Nous n’avons pas de leader, je suis porte-parole. Nous aurons prochainement plusieurs assemblées, où ces questions seront débattues, notamment lors de l’assemblée constituante en septembre, au cours de laquelle nous revoterons sur tous les sujets, et nous déciderons donc de la personne qui doit exercer le rôle de porte-parole.
Il est nécessaire d’avoir un porte-parole afin d’avoir un représentant qui s’exprime à la télévision et lors des interviews. Le problème réside dans la part que l’on attribue à la dimension collective et à la dimension personnelle de ce porte-parole. Nous vivons une époque où il y a une forte personnalisation de la politique partout, à droite comme à gauche. C’est donc en partie inévitable. Mais compter uniquement sur la figure d’un leader serait en contradiction avec la construction d’un mouvement pluriel basé sur des processus horizontaux.
Il est donc important d’avoir un porte-parole qui soit identifiable, mais il est également important que son rôle reste celui de porte-parole et que les décisions soient prises par les assemblées territoriales, de façon horizontale. Cela vaut aussi pour Podemos et pour la FI. Le problème n’est pas de savoir s’il vaut mieux laisser parler une seule personne ou dix. Le problème reste que la décision doit être une décision collective.
Quand on parlait du populisme, je vous disais que nous refusions le fait que les décisions émanent des chefs. Moi je ne décide rien et je n’ai jamais rien décidé. Ce sont les participants aux assemblées qui prennent les décisions et qui me disent : « Regarde ce qui a été décidé ». J’applique les décisions prises par d’autres, et je pense que c’est une bonne chose.
LVSL – Dans le populisme, on trouve aussi une prise de distance par rapport au clivage droite-gauche. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
Nous n’utilisons que rarement le terme « gauche ». Mais nous ne croyons pas que les idéologies soient dépassées. C’est une question de communication de ce qu’on veut transmettre, et qui vient du besoin d’utiliser des termes qui sont audibles au-delà des gens qui sont d’accord entre eux. Il faut faire attention aux mots utilisés. Pourquoi l’emploi du mot « gauche » est-il délicat ?
“Parler de “gauche” en Italie fait tout de suite penser au PD, et donc aussi à Renzi, lesquels ont fait beaucoup de dégâts. Ils sont restés loin des gens et sont détestés pour cette raison. […] C’est pourquoi je préfère paradoxalement utiliser le terme de “communiste”.”
Pas par rapport aux « valeurs de gauche », car je ne pense pas qu’elles soient dépassées. Au contraire, à chaque fois qu’on me l’a demandé, je n’ai pas eu de problème à dire que je suis communiste. Tout le monde ne l’est pas au sein de PaP, mais moi je le suis et il y en a beaucoup d’autres. Je n’ai pas de problème à m’identifier idéologiquement.
Il faut cependant faire attention, parce que parler de “gauche” en Italie fait tout de suite penser au PD, et donc aussi à Renzi, lesquels ont fait beaucoup de dégâts. Ils sont restés loin des gens et sont détestés pour cette raison. Les dernières élections en ont produit une démonstration éclatante : ils se sont effondrés et on a pu voir qui a voté pour la soi-disant « gauche », qui n’est pas de gauche, mais qui se définit comme « centre-gauche ». La majorité des voix du centre-gauche provient des classes aisées et des retraités. Les votes des prolétaires, des travailleurs et des chômeurs sont allés ailleurs.
Dans la communication politique, il faut faire attention, et c’est pourquoi je préfère paradoxalement utiliser le terme de “communiste”, qui est plus fort que le terme de “gauche”. Je préfère parler d’égalité sociale et d’antiracisme. Nous avons malheureusement beaucoup parlé d’antifascisme durant cette campagne électorale. Je dis « malheureusement » car, vu la quantité de petits partis fascistes, il fallait aborder le sujet. Pour nous cela ne représente pas une question fondamentale mais cela l’est devenu à partir du moment où ces partis ont eu la possibilité de se présenter – ce qui était normalement illégal du point de vue constitutionnel, et qui devrait être impossible.
Je préfère donc parler de tout cela que de “gauche” car, même si je peux m’y identifier, la plupart des gens ordinaires l’associent à une expérience, une histoire, dans lesquelles je ne me retrouve pas du tout. Je n’ai pas peur de dire que pour moi le « centre-gauche » [le Parti Démocrate] est identique au centre-droit. Cela ressemble à ce qui s’est passé en France après le quinquennat de François Hollande, y compris sur le plan électoral.
LVSL – Le Mouvement 5 Étoiles a connu un succès électoral considérable durant ces dernières élections, y compris au sein des couches populaires. Comment analysez-vous ce succès ?
C’est lié à ce que nous venons de dire. Il y a beaucoup de gens de gauche, pas de gauche modérée, mais d’extrême gauche et de gauche radicale, qui ont voté pour le M5S, et même pour la Lega dans certains cas au Nord. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls qui ont voté pour le M5S. Ce parti a récolté 53% des voix à Naples, ce qu’aucun parti n’a jamais réussi à obtenir dans toute l’histoire de la République Italienne, pas même la Démocratie Chrétienne [la Démocratie Chrétienne, parti de centre-droit, a longtemps été le principal parti politique italien entre 1945 et 1992, concurrencé seulement par le Parti Communiste]. Il faut donc avoir un peu de subtilité lorsqu’on analyse ce résultat.
“Il y a en tout cas un désir populaire, qui s’exprime peut-être de manière irrationnelle : l’envie d’envoyer un message, de dire à tous ceux qui ont voté le Jobs Act, qui ont détruit le système scolaire et les retraites, qu’ils doivent dégager.”
J’aime à dire pour plaisanter que c’est un « vote par procuration », dans le sens où je pense que la part des électeurs qui a vraiment été convaincu par les propositions du Mouvement 5 Étoiles existe, mais qu’ils sont une minorité. Je crois que la plupart des voix du M5S sont dues à un désir, dont je ne partage pas les modalités mais dont l’intention est légitime, de rompre avec la vieille classe politique. Quand je tractais, tout le monde me disait la même chose : « on n’en peut plus de Berlusconi et de Renzi, on ne veut plus les voir ». Nous répondions que voter pour le M5S ne signifiait pas que l’on allait en finir avec la vieille classe politique, en montrant concrètement ce que le M5S faisait, et en expliquant que ce n’était pas comme ça que la vieille classe politique pourrait être balayée.
D’ailleurs, l’actuelle loi électorale est faite pour éviter cela, mais aussi pour permettre la victoire de la Lega, ou la victoire des cinquestelle. Il y a en tout cas un désir populaire, qui s’exprime peut-être de manière irrationnelle : l’envie d’envoyer un message, de dire à tous ceux qui ont voté le Jobs Act [une loi portant sur la dérégulation du droit du travail], qui ont détruit le système scolaire et les retraites, qu’ils doivent dégager. Et pour les faire dégager, les gens votent pour le seul parti qui semble, pour le moment, porter cette discontinuité, entre autres parce qu’il a le poids électoral nécessaire pour le faire. Cela m’est arrivé de me faire arrêter par des gens qui me reconnaissaient, me félicitaient, et qui avaient voté M5S. Ils disaient : « je me reconnais dans vos valeurs, dans votre langage, dans tout ce que vous faites, mais pour ces élections j’avais besoin d’avoir la garantie que Renzi ne revienne pas ».
C’est le cas à Naples où ils ont fait 53%, mais c’est pareil dans le reste du sud du pays : en Sicile, dans les Pouilles, en Calabre, etc. Les résultats ont été similaires, et ils s’expliquent en grande partie par cette volonté de discontinuité. Les gens ne se sont pas convertis à l’idéologie du M5S de façon improvisée. Mais comme je vous l’ai dit, ils ne représentent pas une réelle rupture pour moi, malgré l’interprétation faite par les gens.
LVSL – Leur succès vient du fait qu’ils ont été capables de parler à différents secteurs de la population. Par exemple, ils se servent de deux figures complémentaires que sont Alessandro Di Battista et Luigi Di Maio. Comment analysez-vous cette stratégie ?
Voilà ce que je crois : ils ont une stratégie de marketing exceptionnelle qui est très adaptée à la période. Néanmoins, les stratégies de marketing ont une limite. Le M5S se présente avant tout comme un parti interclassiste. Di Maio représente la stabilité et Di Battista l’électron libre. Ils ressemblent un peu à Brandon et Dylan de Beverly Hills : il y a le bon gars et le rebelle. Cela peut fonctionner. Mais je pense qu’un parti, surtout un parti qui réussit à obtenir 30% des voix, doit être jugé par ses actes politiques. La question qui se pose donc est la suivante : quelles politiques vont-ils mettre en œuvre, au-delà de cette stratégie marketing du bon gars et du rebelle ?
“Le problème qui se pose, c’est ce que le M5S va réaliser concrètement. Il n’est pas prêt à rompre avec le néolibéralisme et avec les politiques racistes mises en place. “
Sur le sujet du jus soli, le droit d’obtenir la citoyenneté italienne par le droit du sol, le M5S s’est abstenu, faisant un choix objectivement de droite. Sur les questions des politiques de l’emploi, et notamment sur leur mesure phare qu’est le revenu de citoyenneté, ils font un raisonnement qui va dans la direction d’un modèle très libéral. Au-delà du charme que ces deux figures peuvent avoir, une très grande partie de leur succès est due au fait qu’ils passent pour des personnes normales, et pas pour des politiques professionnels. Tous les deux, même Di Maio, qui joue un rôle plus institutionnel, ne cachent pas leurs origines sociales.
Di Maio ne cache pas le fait qu’il en est passé par des petits boulots et qu’il n’a pas toujours vécu dans le monde de la politique. Je crois que c’était ce qu’attendaient les gens. Le problème qui se pose, c’est ce que le M5S va réaliser concrètement. Il n’est pas prêt à rompre avec le néolibéralisme et avec les politiques racistes mises en place. Ils ont le nombre de députés suffisant pour abolir la réforme des retraites. Le M5S et la Lega ont promis l’abolition de la réforme Fornero [réforme historique du droit du travail et des retraites italiennes, qui a considérablement assoupli les normes sociales et reculé l’âge de départ à la retraite] : aujourd’hui, ils n’en parlent plus.
C’est la même chose pour le revenu universel, une promesse qui a si souvent été répétée durant la campagne électorale : ils n’en parlent plus. Il s’agit donc d’un excellent produit de marketing avant toute chose. Après tout, ils ont avec eux la Casaleggio associati, qui est la plus grande agence marketing du pays. Ce serait presque grave qu’ils ne soient pas en pointe dans ce domaine.
LVSL – Cela peut paraître bizarre, mais quand on regarde les votes du M5S au Parlement européen, ils sont très proches de ceux des partis de « gauche radicale ». Comment expliquez-vous cela ?
Il y a deux explications à fournir. La première concerne le caractère hétérogène et post-idéologique du M5S, ce qui se traduit au niveau des personnes. En l’occurrence, il faut voir quelle génération a été élue au Parlement européen en 2014. On a assisté à une profonde transformation des électeurs du M5S ces dernières années. Le parti a évolué vers une forme plus institutionnelle, et une orientation plus droitière.
Les élus M5S au Parlement Européen sont issus d’une phase antérieure du M5S, lorsque celui-ci était moins ancré à droite. Il s’agissait d’une phase que je ne partageais pas non plus à cent pour cent, mais qui était différente de ce qu’est désormais ce mouvement. Dans un parti post-idéologique comme le M5S, les électeurs sont déterminants dans l’orientation politique. Ce qui compte, c’est qui et à quel moment est allé voter.
“[Le M5S] n’a pas de véritable orientation politique. Ce parti s’adapte aux opportunités et change selon l’image qu’il cherche à donner.”
La seconde concerne l’échelle politique : le M5S s’est adapté à la droitisation de la politique italienne. Ce glissement doit nous faire réfléchir. Au départ, il y a 8 ou 10 ans, le M5S était très eurosceptique, c’était l’un de ses thèmes de prédilection et cela faisait partie de ses racines. Ils étaient très fermes sur le sujet. Mais lorsque le M5S a commencé à avoir un certain succès, cette position a été reniée. Ils pensaient qu’elle pouvait apparaître comme peu crédible et donner une image d’instabilité. La première chose faite par Di Maio pendant la campagne électorale a été de se rendre à la City de Londres pour rassurer les investisseurs quant à son euroscepticisme supposé.
Le M5S a donc totalement changé de registre et d’approche. Quel est le véritable M5S ? Celui qui, huit ans plus tôt, critiquait les institutions européennes ? Celui qui, aujourd’hui, se rend chez les investisseurs pour les rassurer ? Je l’ignore. Mais le seul fait que l’on puisse se poser cette question démontre une chose : il n’a pas de véritable orientation politique. Ce parti s’adapte aux opportunités et change selon l’image qu’il cherche à donner. Cela est dangereux parce que cela veut dire qu’on vote pour quelqu’un en signant un chèque en blanc. Demain, ce sont les élus du M5S qui vont décider s’ils seront eurosceptiques ou pas, s’ils seront racistes ou antiracistes. Le vote devrait, au contraire, investir nos représentants d’un mandat précis et déterminé.
Le M5S a donc évolué vers la droite, vers l’establishment, en partie parce qu’il était utile pour lui de s’adapter au discours dominant en Italie. C’est une contradiction qui n’en est pas une pour un mouvement qui ne possède pas d’identité. C’est inquiétant. La Lega tient paradoxalement un discours plus cohérent même si je ne le partage pas du tout. Du début à la fin, ils vous disent : « Nous sommes pour la souveraineté nationale et le rétablissement des frontières. Nous sommes eurosceptiques et nous critiquons fortement l’euro ». C’est discutable, mais il y a une continuité qui n’existe pas dans le M5S. Pour qui vote-t-on ? Pour quel type de parti ? Sur des questions aussi importantes que les politiques d’accueil, l’Union européenne, le travail et l’éducation, il faut avoir une position claire. Il ne s’agit pas de questions secondaires. Sans cette clarté nécessaire, il s’agit d’un vote à l’aveugle.
LVSL – Puisqu’on parle de l’Europe, Pablo Iglesias, Caterina Martins et Jean-Luc Mélenchon ont signé un document, l’Appel de Lisbonne. Quelle relation entretenez-vous avec ces mouvements, et pourquoi avez-vous signé cet appel ?
Nous n’avons pas signé cet appel parce qu’ils ne nous l’ont pas demandé. Je plaisante, nous avons été très heureux de voir cet appel quand nous l’avons découvert. Nous avons des convergences avec Podemos et la France insoumise en particulier, que nous connaissons mieux et que nous apprécions beaucoup. C’est un bel espoir pour nous. Le risque était qu’il y ait des choix différents à faire pour les prochaines élections européennes. Nous avons immédiatement publié un communiqué pour soutenir l’Appel de Lisbonne.
“Les élections ne sont pas une priorité pour nous, donc la représentation ne l’est pas non plus. Mais s’il est possible de dépasser le seuil de 4% nécessaire à la représentation, pourquoi ne pas le faire ?”
S’ils nous demandent de le signer, nous le ferons. Ils ne l’ont pas encore fait pour le moment. Je pense qu’il faut créer des mouvements semblables en Italie, même si je ne sais pas dans quelle mesure ce sera possible. Reste que cette convergence entre Podemos et la France insoumise nous facilite les choses. Parce qu’il est évident que les choix effectués par les grands partis de la gauche radicale européenne affectent ceux des autres nations. L’absence d’unité nous aurait impactés.
Potere al Popolo participera aux élections européennes. Il faudra tenter de former une coalition plus ample que Potere al Popolo. L’objectif est de participer en essayant d’en faire un réel succès, même si le seuil est plus élevé pour la représentation que pour les élections générales, puisqu’il est fixé à 4% des suffrages. Nous allons devoir y réfléchir. Comme je vous le disais, les élections ne sont pas une priorité pour nous, donc la représentation ne l’est pas non plus. Mais s’il est possible de dépasser le seuil de 4% nécessaire à la représentation, pourquoi ne pas le faire ? Nous considérons donc favorablement toute possibilité d’élargir notre front. Beaucoup d’exemples ont germé ici et là.
Il y a par exemple le maire de Naples Luigi De Magistris, qui est une figure importante de la politique italienne, et qui s’intéresse aux prochaines élections européennes. Il a en effet organisé une rencontre à Naples avec Varoufakis et Guilhem. De Magistris semblait donc parti pour ce type rapprochement, mais je ne sais pas si cela va changer grâce à la convergence Podemos-France insoumise. Je souhaite qu’on puisse faire quelque chose de plus grand tous ensemble, à partir de principes clairs et bien définis.
Mais si cela ne s’avérait pas possible, je pense que nous participerions aux élections en tant que Potere al Popolo. Nous sommes en hausse, et pourrions dépasser le seuil nécessaire à la représentation : les derniers sondages nous placent à 2,4%, ce qui représente le double des résultats obtenus aux dernières élections. Par ailleurs, les élections européennes obéissent à une logique différente, le vote se fait différemment. En plus, nous avons déjà une députée européenne, qui est Eleonora Forenza, issue de la Rifondazione Comunista.
LVSL – Mais elle est plus proche de la Gauche Unitaire Européenne et du PGE non ?
Elle oui, mais je crois que la décision prise par Pablo Iglesias et Jean-Luc Mélenchon change beaucoup de choses. Il faut voir comment la réflexion va évoluer à l’intérieur des différents groupes au Parlement européen. C’est quelque chose que je ne peux pas prévoir. Je dis simplement que d’une façon ou d’une autre, quelle que soit la forme, c’est un rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer, rien que pour pouvoir parler à nouveau d’Europe, afin de fixer un thème central dans l’agenda. Rien que pour cela, nous participerons. Nous serons donc présents, et si possible, à l’intérieur d’un front plus large.
LVSL – Quelles sont précisément vos positions sur l’Europe ? Seriez-vous prêts à sortir de l’Union européenne si elle ne s’avérait pas réformable ?
Nous sommes en accord avec la logique de Plan A – Plan B de Jean-Luc Mélenchon. L’idée n’est pas n’est pas de prévoir une sortie a priori. Il est possible que l’on puisse assister à une transformation des équilibres au sein de l’UE. Mais si ce n’est pas le cas, comme les contraintes européennes s’avèrent mortelles et le deviennent de plus en plus pour les classes populaires – entre autres à cause de l’équilibre budgétaire –, nous devons envisager un plan B, un plan de sortie.
Nous acceptons l’UE tant qu’elle n’impose pas de politiques excessivement dures à l’encontre des classes populaires. Mais vu que c’est ce qu’elle a fait jusqu’à présent, nous avons été très critiques à son égard. La sortie n’est donc pas la première option, mais si les circonstances l’imposent et qu’elle devient inévitable, ce ne sera pas un problème pour nous de l’envisager, même s’il s’agit d’un choix compliqué.
Entretien réalisé par Vincent Dain, Léo Rosell et Lenny Benbara. Retranscrit par Sonia Matino. Traduit par Rocco Marseglia, Francesco Scandaglini et Lenny Benbara.
Crédits photos : Potere al Popolo