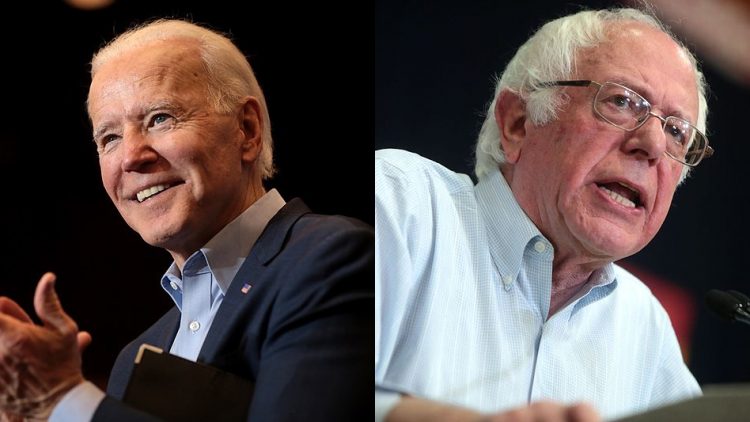« Changement de régime », « armes de destruction massive », « guerre contre le terrorisme »… la rhétorique de l’ère Bush, longtemps taboue, retrouve droit de cité dans la Maison Blanche. Les néoconservateurs, conspués par Donald Trump un mois plus tôt seulement, ont remporté une victoire éclatante : le conflit avec la République islamique d’Iran débute enfin. Le tournant du chef d’État a surpris nombre d’observateurs, le candidat Trump ayant fait campagne sur la critique des « guerres sans fin » de ses prédécesseurs. L’analyse de ses soutiens financiers permet d’y apporter un éclairage : si les marchés semblent frileux à l’idée d’une guerre, une partie des grandes fortunes a intérêt à un conflit avec l’Iran.
« Tout le monde » sait que l’Iran est sur le point d’obtenir la bombe
La République islamique « est bien est bien plus proche du développement de l’arme nucléaire que ce que nous pensions ». En 1995, le New York Times tire la sonnette d’alarme : les services américains observent une « accélération du programme nucléaire iranien » et affirment que Téhéran « pourrait être capable de développer une bombe atomique en cinq ans ». Cinq ans passés, les mollahs étaient toujours dépourvus de l’arme nucléaire, mais « tout le monde [savait] que l’Iran serait le prochain pays à proliférer – à entrer en possession de l’arme nucléaire ».
L’attaque israélienne permet de pousser « un soupir de soulagement » après des mois de baisse du dollar, peut-on lire dans le Wall Street Journal.
« Tout le monde » était peut-être excessif, mais c’est un « analyste américain spécialisé en renseignement nucléaire » qui l’affirmait au New Yorker. Une nouvelle échéance était prévue : « de nombreux officiers de renseignement américains et israéliens estiment que l’Iran est seulement à trois ou cinq ans de posséder des ogives prêtes au lancement ».
À mesure que le délai approchait, l’alarmisme des journaux américains s’intensifiait : « l’Iran se rapproche de la capacité à construire une bombe nucléaire », titrait le Los Angeles Times en 2003, tandis qu’à lire CNN, l’Iran possédait un programme « extrêmement avancé ». Mais d’ogives, toujours aucune trace.
Avec la signature des accords de Vienne sur le nucléaire, l’Iran devait ouvrir sa porte à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2015. L’institut était formel : rien n’indiquait que l’Iran avait cherché à se doter de l’arme atomique, ou violé le traité de non-prolifération. Deux décennies de rapports alarmistes, de titres de presse enflammés et de commissions parlementaires anxieuses étaient réduites à néant.
Les plus sceptiques n’avaient pas attendu les accords de Vienne pour questionner les appréhensions d’Israël et des États-Unis. Ainsi, Jacques Chirac avait qualifié en off le scénario d’un Iran nucléarisé de « pas très dangereux » : « il va l’envoyer où, cette bombe ? Sur Israël ? Elle n’aura pas fait 200 mètres dans l’atmosphère que Téhéran sera rasée ».
À l’inverse, depuis le retrait américain des accords de Vienne, les craintes exprimées à l’égard de l’Iran se passent souvent de toute argumentation : « tout le monde sait » que le pays est sur le point d’obtenir la bombe, devait répéter le sénateur républicain Ted Cruz ce 18 juin.
« La guerre fait ressortir le meilleur du dollar »
Développer aurait été difficile, puisque la cheffe du renseignement américain Tulsi Gabbard déclarait sobrement en mars dernier : « l’analyse de nos services est que l’Iran n’est pas en train de construire l’arme nucléaire ». Avant de se dédire sous la pression de Donald Trump, qui avait vertement contesté ses propos lors d’une interview.
Comment expliquer son soutien à l’attaque israélienne et ses menaces de « changement de régime » adressées à l’Iran, après une campagne centrée sur la dénonciation des « guerres sans fin » et des néoconservateurs ? Ses palinodies sur le dossier iranien ont semé la confusion au sein de son propre camp. En réalité, elles découlent des soutiens contradictoires du « trumpisme ». Isolationniste, sa base rejette les interventions militaires ; selon un sondage commandité par The Economist, une large majorité d’Américains demeure hostile à une guerre avec l’Iran.
Mais au sein du Parti républicain, les groupes de pression favorables à un conflit n’ont pas désarmé. L’American Israel Public Affairs Comittee (AIPAC), lié au gouvernement israélien, aura ainsi versé 2 millions de dollars dans la campagne de candidats républicains en 2023 et 2024. Le secteur militaro-industriel aura quant à lui injecté pas moins de 22 millions de dollars en faveur du Parti républicain pour la seule année 2024 – quatre de plus que pour les démocrates. Et dès son élection, Donald Trump laissait entendre qu’il se montrerait reconnaissant à l’égard de ces bailleurs par la nomination du « faucon » Marco Rubio comme secrétaire d’État. Plus discret que le tonitruant (et isolationniste) J. D. Vance, mais à la tête d’un poste plus stratégique en politique étrangère, Rubio incarne une aile néoconservatrice qui n’a jamais été écartée par Donald Trump.
Plus indirectement, d’autres secteurs économiques pourraient bénéficier d’un conflit avec l’Iran. Une montée en flèche des prix de l’or noir induirait des profits records pour le secteur des énergies fossiles. Depuis l’attaque israélienne, le prix du baril de Brent a augmenté de 10 %. Cette « prime de guerre » – ainsi que la nomme la presse financière – pourrait être rapidement être accrue par la fermeture du détroit d’Ormuz, dont la République islamique menace l’Occident. Et quand bien même elle ne serait pas mise à exécution, une pérennisation du conflit générerait une panique sur les marchés à même de prolonger la hausse des prix.
Si l’État hébreu aime à se dépeindre en citadelle assiégée, il peut en réalité compter sur de nombreux alliés objectifs.
Le lobby pétrolier, soutien actif de Donald Trump, a de quoi être déçu : la faiblesse des cours compromet la ruée vers le pétrole et gaz de schiste promise par le candidat républicain. Derrière le sulfureux slogan Drill-Baby-Drill (« creuse bébé, creuse ») martelé durant sa campagne, celui-ci défend en réalité un agenda de souveraineté énergétique guère différent de celui des démocrates, consistant à exploiter un sous-sol riche en sources fossiles non-conventionnelles. Or, les producteurs de pétrole de schiste ont besoin d’un prix d’au moins 40 dollars par baril pour couvrir les coûts d’un nouveau puits ; une somme à mettre en regard du seuil de rentabilité de l’entreprise Saudi Aramco, à 10 dollars par baril.
Une note de l’Institut Rousseau interroge : « Trump a-t-il autorisé Israël à attaquer l’Iran pour sauver ses producteurs de pétrole ? ». Elle rapporte les propos de D. Kirk Edwards, ancien président de l’Association pétrolière du bassin permien : « Je pense que nous allons assister d’ici trente à soixante jours à l’arrêt de nombreuses plateformes actuellement en activité… La plupart des gens sont sous le choc de voir comment cela peut arriver sous une administration républicaine ». Les pétroliers américains risquent donc gros… « à moins qu’un événement majeur ne survienne », continue l’auteur de la note. Il ajoute : « les guerres constituent un moyen classique [de] parvenir » à une flambée des prix.
Mais cette hausse des cours ne menace-t-elle pas les marchés financiers, ainsi que de nombreux analystes l’ont suggéré ? Les marchés ne sont pas tout à fait de cet avis. Une guerre régionale ralentirait bien l’activité et les investissements, mais induirait des contre-tendance vertueuses pour la finance américaine. Dans un article au titre évocateur – « War Brings Out the Best in the Dollar » –, le Wall Street Journal observe : après une chute du dollar depuis févier, consécutive aux menaces tarifaires de Donald Trump, l’attaque israélienne permet de pousser « un soupir de soulagement ». « L’indice du dollar s’est accru de 1 % depuis le premier bombardement », développe-t-il, « et la monnaie américaine se comporte comme elle le devrait, en s’appréciant lors des jours de panique ».
Valeur-refuge, le dollar pourrait bénéficier des turbulences financière provoquées par le conflit. « Une fuite vers la sûreté [fly to safety : ruée des capitaux vers des valeurs-refuge en temps de crise, parmi lesquelles ont trouve l’or et le dollar NDLR] induirait des taux plus bas », indique un analyste interrogé par Reuters. Un moyen de contrecarrer la récession que provoquerait une hausse des prix du pétrole ?
Il faut ajouter que l’incertitude géopolitique génère une floraison des produits dérivés. Au plus grand bénéfice de ceux qui les émettent : au premier semestre 2025, les cinq plus grandes banques de Wall Street avaient effectué un gain record de 37 milliards de dollars en produits dérivés grâce aux fluctuations des marchés provoquées par la guerre commerciale de Donald Trump. Après une politique tarifaire chaotique, quoi de mieux qu’une guerre erratique pour les accroître ?
Attentisme moyen-oriental, soumission européenne
Avec de tels alliés, pourquoi les dirigeants israéliens se restreindraient-ils ? En un an et demi, Israël aura mené un pilonnage génocidaire ininterrompu sur la bande de Gaza, envahi le Liban et bombardé la Syrie avec le blanc-seing des Occidentaux. Malgré quelques protestations pour la forme, l’afflux d’armes vers Tel-Aviv n’aura jamais diminué. Avec l’élimination des dirigeants du Hezbollah et la chute de Bachar al-Assad, la voie vers Téhéran est plus ouverte que jamais. Si l’État hébreu aime à se dépeindre en citadelle assiégée, il peut en réalité compter sur de nombreux alliés objectifs.
À l’évidence, de nombreux acteurs régionaux craignent un conflit de grande envergure avec l’Iran. Les monarchies du Golfe, en particulier l’Arabie Saoudite, ont dénoncé l’agression israélienne contre un « pays frère ». Elles appréhendent une fermeture du détroit d’Ormuz, qui tarirait leurs exportations pétrolières, et un renversement de la République islamique, qui aurait des effets déstabilisateurs incalculables pour la région.
Mais hypothèses maximalistes mises à part, les gouvernements du Moyen-Orient ont-ils intérêt à une résolution pacifique du conflit ? Une hausse des cours de l’or noir viendrait gonfler le revenu des pays pétroliers. Il faut ajouter que la perspective de prendre un ascendant décisif sur le principal concurrent régional de l’Arabie Saoudite n’est pas pour déplaire à ses dirigeants. Du reste, la destruction par Israël des infrastructures du Liban a permis aux capitaux du Golfe d’y affluer, contrats en or à la clef – la prolongation du conflit en Iran ne fait-elle pas miroiter des débouchés semblables ?
Pour la Turquie, Israël constitue bien une menace. Mais jusqu’à présent, les deux puissances expansionnistes ont su étendre leur zone d’influence sans heurts. Et même en se procurant un appui indirect : les bombardements israéliens sur le Hezbollah n’ont-ils pas contribué au succès de l’assaut du Hayat Tahrir al-Sham (« Front de libération du Levant », HTS) sur Damas, soutenu par la Turquie ?
En apparence, l’arrivée au pouvoir en Syrie de cette milice originellement anti-sioniste n’est pas une bonne nouvelle pour l’État hébreu. Mais en réalité, si la base du HTS demeure pro-palestinienne, sa direction est prête à toutes les concessions pour un rapprochement avec les Occidentaux. Y compris à une normalisation avec Israël, qui a dernièrement pu survoler le territoire syrien pour bombarder l’Iran. « Certes, la Syrie est loin de disposer d’un système de défense performant lui permettant de contrôler son espace aérien » précise un article de L’Orient-le-Jour, ajoutant que « tout indique que le président de transition syrien, Ahmed al-Charaa, ne voit aucun inconvénient à ces “violations” israéliennes […] et semble se réjouir de la perspective d’un effondrement du régime des mollahs ».
La précision est d’importance. En cas d’enlisement du conflit, doit-on exclure un engagement direct du HTS contre les forces iraniennes présentes en Irak ? Nés dans la contestation de l’impérialisme mais contraints à un rapprochement-éclair avec Washington – l’ancien ambassadeur américain à Damas ayant clandestinement rencontré le chef d’État Ahmed al-Charaa dès 2023 –, ces islamistes sunnites semblent désormais canaliser leur furie vengeresse vers Téhéran, et non Tel-Aviv.
L’Azerbaïdjan constitue une autre puissance régionale sur laquelle Israël pourrait s’appuyer. Allié discret mais actif de l’État hébreu, le chef d’État Ilham Aliev ne fait pas mystère de ses vues irrédentistes sur l’Iran. En cas de conflit au sol, les trois provinces le plus au nord de l’Iran (Azerbaïdjan ouest, Azerbaïdjan est et Ardabil) constitueraient un point de tension majeur, rendant le pays vulnérable à l’ingérence de l’Azerbaïdjan – mais aussi de son parrain turc.
Attentisme ou alliance objective, chaque États moyen-oriental semble tirer son épingle du jeu. À l’inverse, l’alignement de l’Union européenne sur la position américaine révèle toujours plus crûment sa dépendance à l’égard des États-Unis – et la vassalité de ses chefs d’État à l’égard de Washington. Les Européens seraient en effet les grands perdants d’un choc pétrolier et d’une déstabilisation de l’Iran. Celle-ci était un partenaire commercial important du Vieux continent jusqu’à ce que les sanctions américaines le contraignent à s’en retirer.
L’Allemagne, laminée par la crise énergétique, a ainsi remercié Israël de « faire le sale boulot » quand Emmanuel Macron a repris à son compte le récit néoconservateur d’un Iran au bord de l’arme nucléaire. Sans crainte du ridicule : « certains programmes de missiles iraniens sont en théorie capables d’emporter un engin nucléaire et d’autres ont la portée permettant d’atteindre certaines parties de notre territoire national ». Un réalignement destiné à faire pardonner son initiative visant à reconnaître un État palestinien, à présent indéfiniment ajournée ?