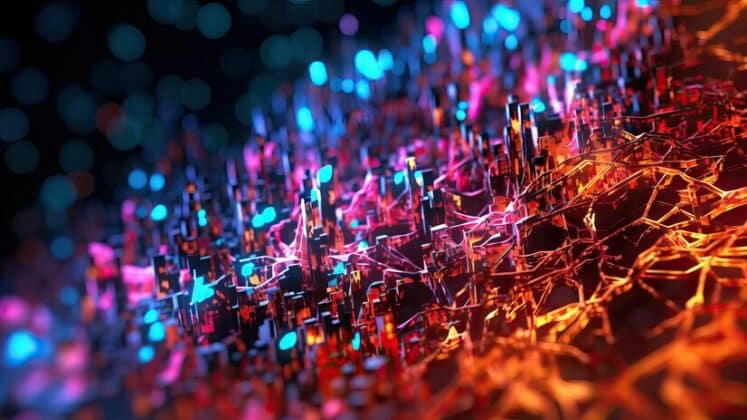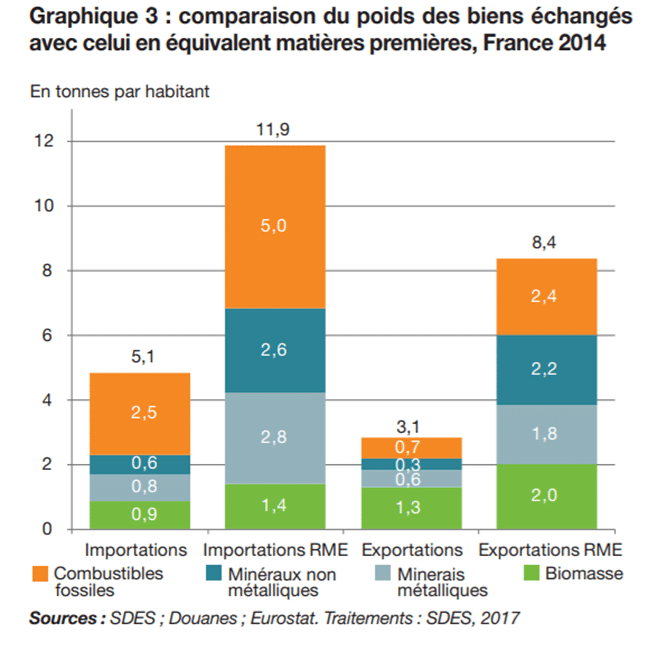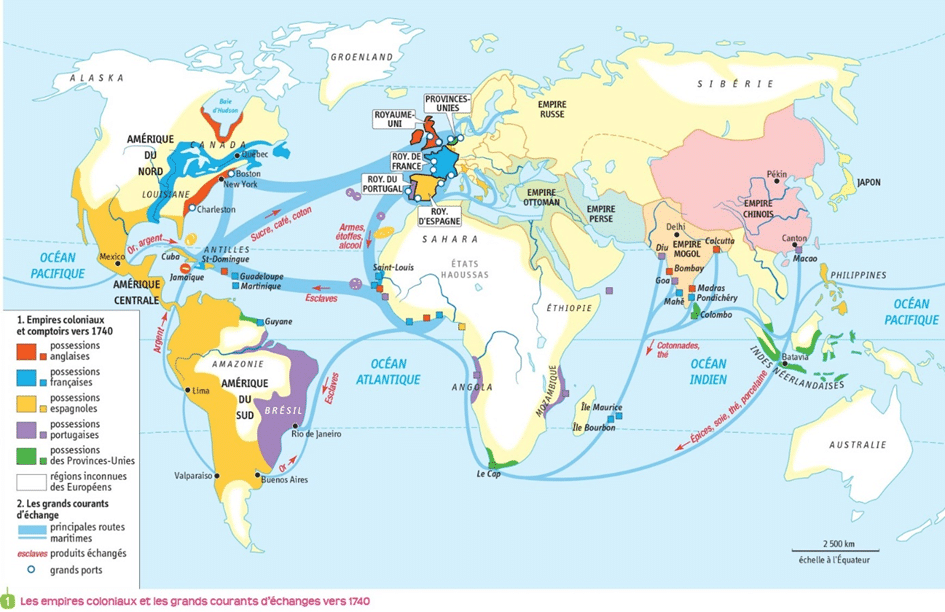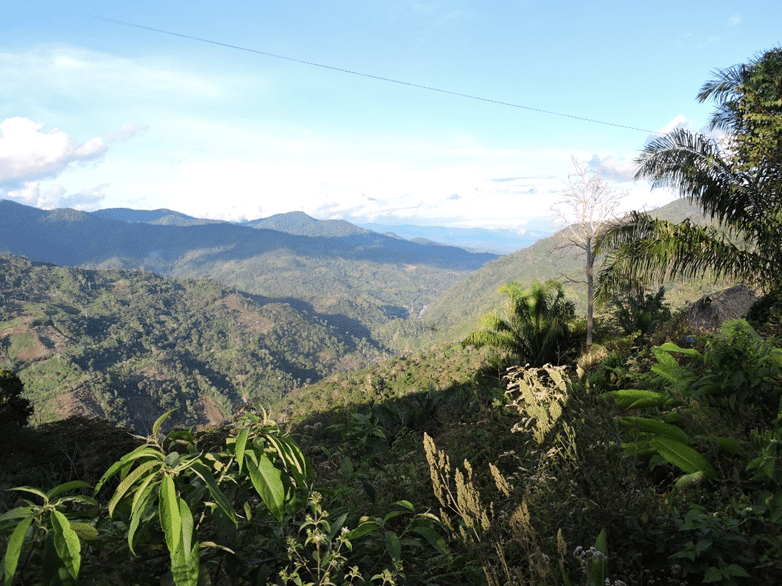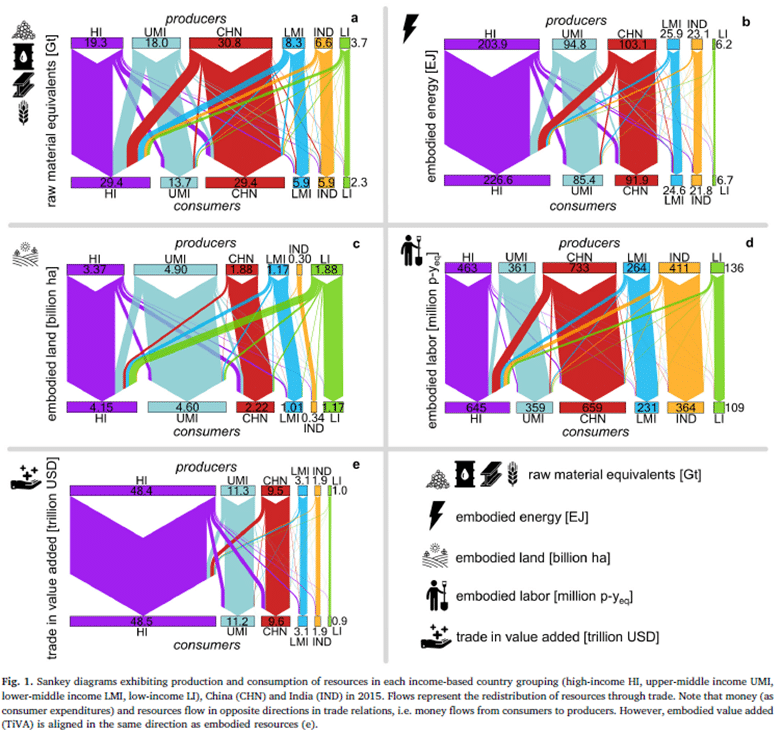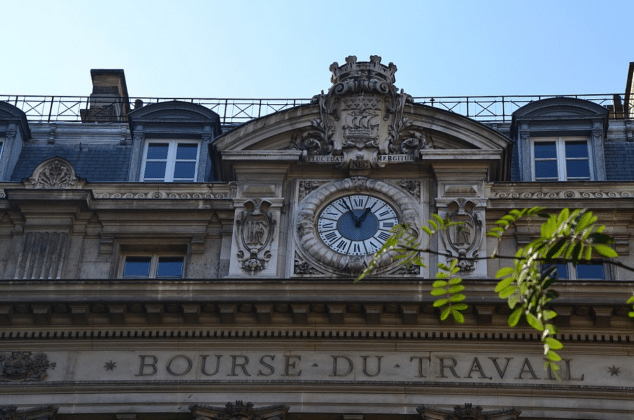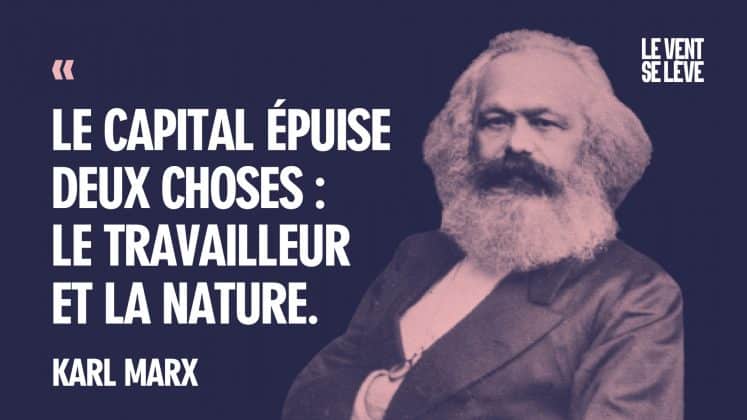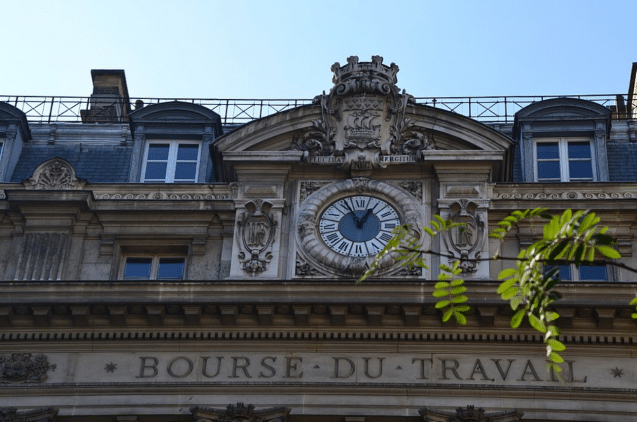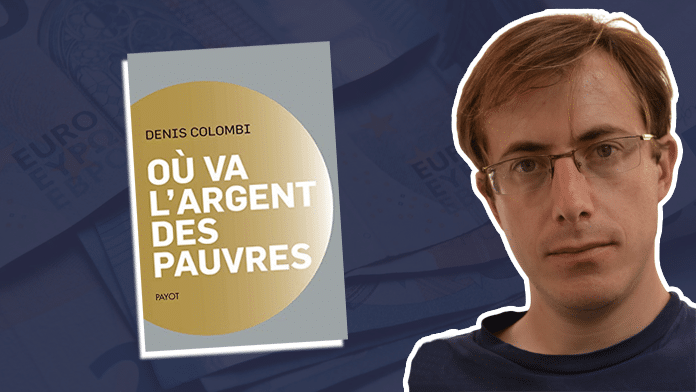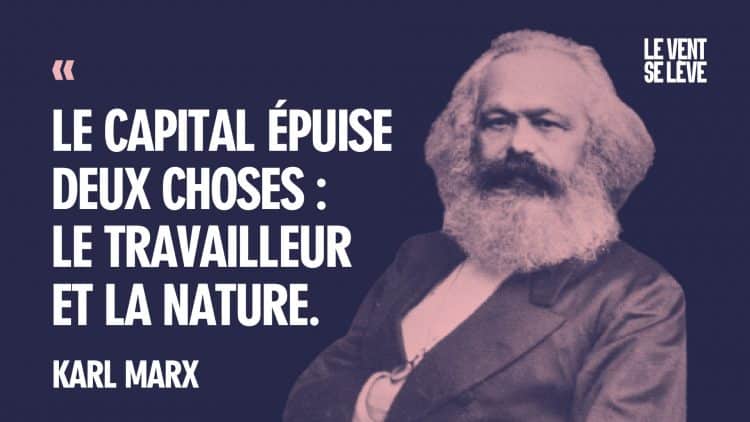Auteur d’ouvrages influents sur la Silicon Valley, Evgeny Morozov analyse les conséquences de la mainmise des géants américains de la tech sur les sociétés occidentales [1]. Il met en garde contre les critiques qu’il estime superficielles de cette hégémonie, focalisées sur la défense de la vie privée ou de la souveraineté du consommateur, tout en restant silencieuses sur les déterminants économiques et géopolitiques de la domination des Big Tech américaines. Nous l’avons interrogé dans le cadre de sa venue à Paris pour une intervention lors de la journée de conférences organisée par Le Vent Se Lève le 25 juin dernier. Entretien réalisé par Maud Barret Bertelloni, Simon Woillet et Vincent Ortiz, retranscrit par Alexandra Knez et Marc Lerenard.
Le Vent Se Lève – En 2021, l’annonce par Joe Biden du démantèlement des Big Tech et la plainte contre Facebook intentée par la procureure démocrate Letitia James avaient suscité un important engouement médiatique. Cette volonté de briser le pouvoir des géants de la tech semble cependant appartenir au passé, en particulier depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Comment faut-il comprendre l’agenda de Biden sur les Big Tech ? Était-il une simple annonce médiatique, ou le symptôme de tensions grandissantes entre l’État américain et les entreprises de la tech ?
Evgeny Morozv – Le débat sur les Big Tech aux États-Unis – tout comme en Europe – est fonction de nombreux intérêts divergents et concurrents. Il résulte des conflits entre différentes factions du capital : certaines appartiennent au capital financier, d’autres au capital de type entrepreneurial (start-ups, capital-risque) ou à des industries qui ont un intérêt dans les données, comme le secteur pharmaceutique. La deuxième dimension du débat est géopolitique : elle tient à la volonté de maintenir le statut hégémonique des Etats-Unis dans le système financier international. Après 4-5 années de politiques incohérentes de l’administration Trump, il faut d’une part comprendre ce que l’on fait de la libéralisation des échanges, des traités bilatéraux ou encore des pactes commerciaux, et de l’autre ménager la puissance chinoise qui se profile à l’horizon, comme rivale possible à cette hégémonie.
Au vu des forces en présence, je ne m’attendais personnellement à aucune cohérence quant à l’agenda Biden sur les Big Tech – une farce progressiste, qui renouvelle une critique libérale éculée du capitalisme dominé par les grandes sociétés. Les différences factions du capital, nationales et internationales, tirent dans des directions opposées. La faction qui souhaite maintenir l’hégémonie américaine s’oppose à toute forme d’affaiblissement des Etats-Unis et de renforcement conséquent de la Chine ; cela n’a rien de nouveau. Quand Mark Zuckerberg se rend au Congrès avec une note qui dit déclare en substance : « ne nous démantelez pas, sinon la Chine gagnera », il ne fait que reconduire une vieille stratégie. Pendant les audiences du Congrès de l’ITT, dans les années 1973-74, les cadres de cette entreprise utilisaient la même rhétorique, déclarant que si l’on affaiblissait ITT, Erickson allait arriver et dominer les marchés américains [2].
LVSL – Par rapport au contexte des années 1970, comment caractériseriez-vous la relation actuelle entre l’État américain et les entreprises de la tech ? On a aujourd’hui une idée assez claire des contours du complexe militaire-industriel de l’époque, avec l’investissement de l’État dans la R&D (recherche et développement) et un important financement académique. Quelle est la nature de ce soutien aujourd’hui ?
EM – Il y a toujours d’important financements à travers la National Science Foundation, quoique bien inférieurs aux dépenses de Guerre froide. Walter Lippmann, l’un des penseurs les plus lucides de l’hégémonie américaine, soulignait dans un essai au début des années 1960 à quel point ce n’est que grâce à la Guerre froide que les États-Unis ont véritablement innové et développé la recherche et l’industrie nationales dans le domaine de la science et des technologies. D’une certaine manière, il trouvait ce contexte de Guerre froide bienvenu : une fois terminée, aucun de ces efforts de R&D ne survivrait. La Chine prend aujourd’hui le relai. Des individus comme Peter Thiel ont parfaitement compris que la menace chinoise est l’argument le plus simple pour mobiliser de l’argent pour le financement des entreprises privées. Elle est nécessaire pour maintenir artificiellement en vie les projets bancals du capital-risque – et la valorisation qui leur est associée – ainsi que pour soutenir la Silicon Valley ou la bulle du Bitcoin, qui risqueraient autrement de s’effondrer.
Je ne pense pas que l’Europe ait un quelconque pouvoir face à l’agenda des Big Tech. Il n’y a aucun lobby qui pèse en ce sens, si l’on met à part quelques militants à Bruxelles.
Évidemment, il n’y a pas de compétition nucléaire. Les Chinois ne font pas le poids en termes de capacités militaires. Ils pourraient envahir Taiwan, mais cela n’a rien à voir avec le niveau de compétition que l’Union soviétique imposait aux États-Unis. J’ajoute qu’avec le contexte actuel, les Big Tech elles-mêmes subventionnent la recherche dans les universités sur des thématiques telles que le respect de la vie privée ou la lutte contre les trusts !
LVSL – Nous observons une augmentation des taux d’intérêts, après deux décennies de taux très bas, qui permettaient à l’Etat américain de soutenir les Big Tech dans leur financement. Comme analyser la décision de la FED, après des années de contexte économique qui a permis aux Big Tech prospérer ?
EM : Je ne pense pas que la FED conçoive sa politique de taux d’intérêt en ayant les Big Tech à l’esprit. Les raisons qui la conduisent à relever ses taux ont trait au prix de l’énergie et à la guerre en Ukraine. Leur remontée aura évidemment des conséquences sur l’industrie de la tech : observez la manière dont la bulle des cryptos a explosé ! Cela va certainement engendrer de la pression sur les liquidités, et de nombreuses banques (celles à taux subventionné) vont en souffrir, ainsi que les acteurs qui dont la rentabilité reposait sur la capacité à emprunter de la monnaie à taux faible, investir et satisfaire les investisseurs avec une période d’attente de 5 à 10 ans.

À plus petite échelle, la plupart des acteurs du capital-risque suivent la même logique. Lorsque l’argent coûte plus cher, il est plus difficile de justifier le financement d’une start-up en état de mort cérébrale, alors qu’il est au contraire aisé d’acheter des obligations. Nous avons traversé une période d’accélération massive de cycles de développement technologique associée à un environnement de taux d’intérêt faibles de long terme, ce qui a fait oublier à beaucoup de personnes que l’argent que ces projets attiraient n’avait rien à voir avec leurs mérites ou ceux de leur industrie. On n’avait simplement nulle part ailleurs où investir cet argent. Quand le fonds souverain qatari devait décider où placer son argent, il n’avait pas beaucoup d’autres d’options que de le donner à des banques à taux subventionnés, qui ensuite le réinvestissaient. Il y désormais de nombreuses autres voies pour l’investir. Je m’attends à ce que ce que l’on entre dans une période très dur, avec de nombreux licenciements. Les start-ups n’auront plus d’argent, et celles qui auront besoin de se refinancer ne vont pouvoir le faire qu’à une valorisation plus faible…
LVSL – On peut conjecturer qu’un effet de concentration dans le secteur va en résulter, comme au moment du crash de la bulle internet en 2001. Quelles seront ses conséquences sur le développement technologique ?
EM – Les Big Tech sont toujours assises sur une montagne de cash. Ils continuaient jusqu’à présent d’emprunter parce que ce n’était pas cher. Maintenant ils vont emprunter beaucoup moins et réinvestir leurs bénéfices non distribués au lieu de réinvestir l’argent qu’ils empruntent. Les petites et moyennes entreprises et les start-ups seront les plus affectées, mais ce n’est pas forcément pour le pire : il y aura moins d’idiots en concurrence pour des fonds et les fonds pourront être investis dans des projets qui comptent. C’est difficile de juger de l’impact que cela aura.
LVSL – Mais qu’en est-il de la concentration de données, d’infrastructures de calcul et de travailleurs qualifiés dans ces rares entreprises ?
EM : Cela n’a rien avoir avec la profitabilité du secteur. Du point de vue d’une start-up, la concentration pourrait engendrer un accès bon marché à des biens d’équipement. Plutôt que de les développer, elles pourront emprunter à bas coût des capacités de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale de base, d’analyse d’image, etc. La concentration pourrait aussi permettre de réduire les coûts de transaction, avec un fournisseur unique pour tous ces services. Je n’ai à ce jour trouvé aucun argument convaincant pour dire que la concentration des données dans les mains de ces sociétés technologiques réduit les possibilités de développement technique.
LVSL – Mais l’effet de concentration dans le développement technologique revient à mettre tout acteur extérieur aux Big Tech dans une position d’utilisateur final, comme c’est le cas avec les modèles pré-entrainés dans le domaine du machine learning…
EM – On se trouve en position d’utilisateur final à chaque fois que l’on emploie des biens d’équipement. Lorsque, dans une usine, j’utilise une machine, lorsque dans une mine j’utilise un camion, je me trouve dans une position d’utilisateur final. Pourquoi ce fétiche de tout vouloir construire soi-même ? Je ne vois pas pourquoi réduire les coûts d’accès aux biens d’équipement aurait, en soi, des conséquences négatives pour l’économie. Ce serait le cas si l’on pensait à un modèle de conglomérat gigantesque, où certaines sociétés sont présentes dans chaque industrie. On croyait autour de 2012 que ce serait le cas, mais la plupart des entrées des Big Tech dans la santé, l’éducation ou le transport n’ont pas été un succès. Où est cette Google car que tout le monde attend depuis 12 ans ?
LVSL – L’Europe et les États-Unis ont récemment signé un nouvel accord sur les transferts transatlantiques de données, après la révocation de l’accord Privacy Shield l’an dernier en raison du manque de garanties en matière de protection des données. Comment comprenez-vous la situation actuelle ?
EM – Je ne pense pas que l’Europe ait un quelconque pouvoir en la matière. Il n’y a aucun lobby qui pèse dans ce sens, si l’on met à part quelques militants à Bruxelles et peut-être quelques juges allemands attachés la question. L’Europe a cherché à sauver la face en affichant une forme d’exceptionnalisme européen. Poussée dans ses derniers retranchements – c’est ce qui est arrivé il y a quelques mois au moment de ce nouveau compromis – elle a capitulé. Cela est lié à l’existence d’une faction qui essaye de pousser pour une renaissance des traités commerciaux comme le TTIP, le TPP, etc. La libre circulation des données a été mentionnée dans ces traités, peut-être pas de manière très sophistiquée, mais ils pourraient à présent permettre de relancer le sujet de manière beaucoup plus forte.
Au-delà de cela… La vie est trop courte pour y penser : c’est un combat perdu d’avance et je ne sais pas que faire de cette information, pour être honnête.
LVSL – Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne (BCE), affirmait récemment que « les cryptos ne valent rien ». Comment analysez-vous l’explosion de la bulle des cryptos après des années d’enthousiasme en la matière ?
EM – Peu importe à quel point vous comptez sur les crypto-monnaies ou sur la monnaie numérique d’une banque centrale… tant que vous avez une mauvaise banque centrale. Peu importe si c’est 100% cash, ou 50% cash et 50% crypto, ou 40% crypto et 10% de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), tant que la politique monétaire reste orientée vers la stabilité et la stabilisation des prix.
Le débat sur les crypto-monnaies en ce moment, à gauche, substitue un débat sur les imaginaires à un débat de substance. La question est de savoir quelle politique monétaire nous voulons. Qu’est-il possible de faire avec l’euro ? Comment allons-nous le mobiliser pour la reconstruction de l’État-providence ? C’est cette vision plus large qui manque actuellement. Une fois qu’on aura la réponse, alors là, oui, cela deviendra presque un problème technique : compte tenu de la quantité d’émissions de CO2 sur laquelle nous voulons nous engager, compte tenu de l’argent dont nous disposons, compte tenu de l’état de notre pénétration technologique – nous pourrons déterminer les outils techniques appropriés.
Je ne vois pas ce que la gauche gagne à présenter certaines parties du capitalisme actuel comme rétrogrades et impures, comme « féodales ». Dans la théorie marxiste, le féodalisme a une dynamique très particulière que l’on peut étudier et comprendre : ce n’est pas la dynamique que nous vivons.
LVSL : Mais les crypto-monnaies ne sont-elles pas actuellement dans une position critique ? La déclaration de Christine Lagarde risque-t-elle de fragiliser les efforts de stabilisation et de marketing des crypto-activistes avec les grandes entreprises financières ?
EM – Cela dépend de jusqu’où cela va chuter, mais cela, je ne peux pas le prédire. À l’heure actuelle, on trouve encore beaucoup d’acteurs pour les défendre, ainsi que des institutions qui y ont un intérêt direct. Il reste encore beaucoup de résilience institutionnelle et elle n’est pas près de s’estomper. Il y a aussi probablement des hordes de lobbyistes pour cette industrie qui est, ne l’oublions pas, toujours aussi riche qu’auparavant. Andressen Horowitz a encore un fonds de crypto à 3 milliards – avec 3 milliards, vous pouvez acheter beaucoup de lobbyistes [3]. Une fois que vous possédez ces lobbyistes, vous pouvez alors agir par la voix des politiciens.
LVSL – Dans un récent article pour la New Left Review, vous critiquez le recours à gauche au terme de « techno-féodalisme » pour décrire l’économie numérique et le système politique qui lui est associé [4]. Pourquoi estimez-vous qu’il ne rend pas compte de la réalité ?
EM – Je ne vois pas ce que la gauche gagne à présenter certaines parties du capitalisme actuel comme rétrogrades et impures, comme « féodales ». Comme si rendre le capitalisme plus évolué et plus pur pouvait changer quelque chose ! Cela ne me semble pas être une position défendable pour la gauche.
La conclusion principale qui découle de l’analyse en termes de techno-féodalisme est que nous devons combattre les rentiers et les monopoles, faire respecter la concurrence et nous assurer que les données constituent un terrain de jeu équitable. C’est ce que l’on retrouve par exemple dans les essais de Cédric Durand – auteur de Techno-féodalisme – : il fait allusion à de nouvelles formes de planification et ne veut pas démanteler les GAFAM – même s’il veut en quelque sorte faire quelque chose avec eux, mais quoi, il ne nous le dit pas… Si c’est à cela que doit nous amener le diagnostic du techno-féodalisme, je ne vois pas ce que l’on gagne à légitimer cette critique à gauche.

LVSL – On retrouve le concept de féodalisation sous la plume d’Alain Supiot. Dans La gouvernance par les nombres, il soutient que la numérisation relie les individus à des structures d’allégeance variables, sur un mode féodal…
EM – Des critiques intéressantes du pouvoir peuvent découler de positions comme celle de Supiot. Elles offrent un antidote à des positions comme celles de Fukuyama ou de Steven Pinker, qui pensent que le monde avance de manière téléologique et que tout s’améliore obligatoirement.
Elles peuvent être utiles pour leur rappeler au contraire que la répartition du pouvoir dans la société est moins démocratique aujourd’hui qu’il y a 30 ou 40 ans, et qu’en ce sens il s’agit d’un retour en arrière. Mais c’est un retour en arrière dont on s’aperçoit en analysant les effets du capitalisme ; ce n’est pas un nouveau mode de production qui serait féodal dans son fonctionnement. Dans la théorie marxiste, le féodalisme a une dynamique très particulière que l’on peut étudier et comprendre : ce n’est pas la dynamique que nous vivons.
LVSL – En quoi consisterait un programme de gauche en matière de technologie ?
EM – La gauche est prisonnière d’une vision étriquée de l’action sociale, d’inspiration wébérienne : elle croit passionnément que l’action est rationnelle et que l’action économique consiste à maximiser cette action, par le biais d’une planification centrale. Cela revient à s’assurer que tous les besoins sont satisfaits… et ce n’est que par la suite que l’on pourra retirer la raison instrumentale de l’ordre du jour. Les gens seront ces types créatifs, buvant du vin l’après-midi et écrivant de la poésie, tout en chassant. Mais en attendant, il faut d’abord s’occuper des besoins. Cette vision est profondément étriquée. Elle ne correspond en rien à la manière dont les gens rationnels agissent : je n’agis pas en ayant un objectif et en analysant le meilleur moyen de l’atteindre. Non, je commence quelque chose pour atteindre cet objectif et je me rends compte ce faisant que c’est le mauvais objectif, je passe alors à un autre objectif, je reviens en arrière… L’expérience humaine typique est marquée par le jeu, la créativité, l’ingéniosité.
Cette façon naturelle d’agir devrait être soutenue par la technologie et le big data. Si vous parvenez à permettre aux gens de s’engager dans une forme de collaboration, vous produirez bien plus de valeur et bien plus d’innovation qu’avec une planification centrale. Pour moi, ça devrait être cela le programme économique de la gauche ! Les technologies pourraient permettre à chacun d’agir, de se réaliser. L’approche actuelle les aliène les uns des autres, de la technologie et de l’infrastructure.
LVSL – Comment expliquez-vous dans ce cadre que la souveraineté numérique ne soit pas défendue par la gauche ?
EM – Quand on parle de souveraineté technologique, on désigne le plus souvent la capacité d’une nation à avoir accès aux technologies les plus avancées, pour la production industrielle. Mais si vous quittez le jeu de la compétition industrielle, pourquoi en auriez-vous besoin ? Si les services sont la seule chose qui vous intéresse, quel besoin de souveraineté numérique ? Prenez le cas de la Lettonie : ils ont une industrie bancaire, ils ont des touristes et ils ne prévoient pas d’avoir une industrie lourde. Quel est leur besoin de souveraineté numérique ? Ce genre de chose est plus facile à expliquer en Amérique latine. Ils ont essayé l’industrialisation dans les années 50 et 60 – avec la CEPAL et autres – mais ils ont été bloqués dans cette voie par de nombreux coups d’État militaires. Pourtant ils ont essayé de relancer tout le processus. Vous avez encore des gens là-bas – des personnes de 95 ans aujourd’hui – qui se souviennent de cette tradition, des gens qui ont travaillé dans les bureaux de la CEPAL à Santiago en 1965, des gens comme Calcagno et d’autres, qui savent ce que cela représentait dans le temps.
En Europe ce débat n’a pas eu la même ampleur, il a toujours été mené par les corporatistes, des gens comme François Perroux et d’autres. On ne peut plus y faire grand-chose maintenant. La vraie question en la matière est de savoir – et j’utiliserai une expression très populaire en Amérique latine dans les années 70 – quel style de développement souhaitons-nous ? Or, je ne pense pas que la gauche en Europe ait du tout pensé à un style de développement. Elle a un style de défense, oui : défendre le droit que les travailleurs ont acquis et l’État-providence, mais à part ça, les gauches ne savent pas ce qu’elles veulent.
Si vous allez demander aux gauches du monde entier : quel genre de nouvelles industries voulons-nous développer ? Elles vous diront ce dont elles ont besoin dans leur économie – d’informatique quantique par exemple – mais si vous leur demandez sur le fond, si vous interrogez comment cela se relie au développement économique et social, elles n’ont aucune réponse. Elles ne se demandent plus : faut-il des industries qui emploient plus de monde, ou moins de monde, etc. ? En Europe, ce débat a été gagné par les néolibéraux, tout le contraire de ce qui se passe en Amérique Latine. Le débat n’a pas été complètement gagné en Chine. Mais, franchement, en Europe, je pense que c’est une cause perdue.
Notes :
[1] L’aberration du solutionnisme technologique : pour tout résoudre, cliquez ici, Fyp, 2014 et Le mirage numérique : pour une politique du Big Data, Fyp, 2015.
[2] ITT (International Telephone and Telegraph), entreprise américaine de télécommunications, a permis aux États-Unis d’asseoir leur hégémonie dans une partie importante du monde non soviétique au cours de la Guerre froide.
[3] Entreprise américaine de capital-risque fondée en 2009.
[4] La thèse du techno-féodalisme, telle que défendue notamment par Cédric Durand, présente les géants de la tech comme le symptôme d’une régression féodale des économies contemporaines. Par opposition à des entreprises capitalistes plus traditionnelles, qui croîtraient par l’innovation, les tenants du techno-féodalisme estiment que les géants de la tech s’enrichissent par la rente, comme les propriétaires terriens d’antan.