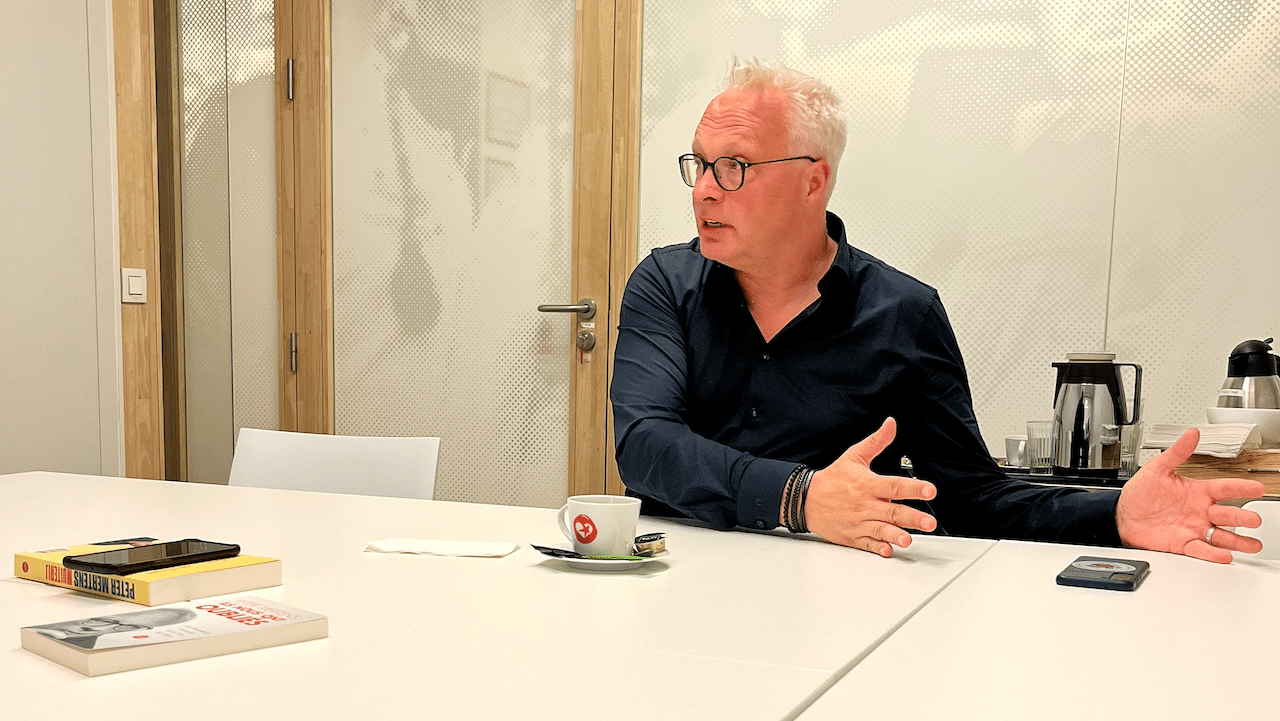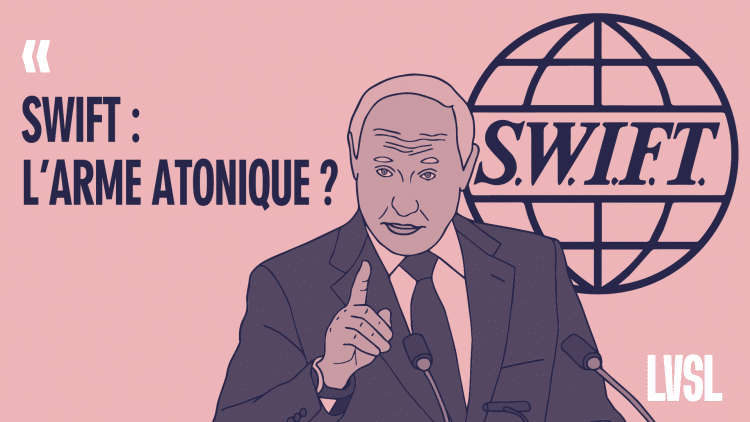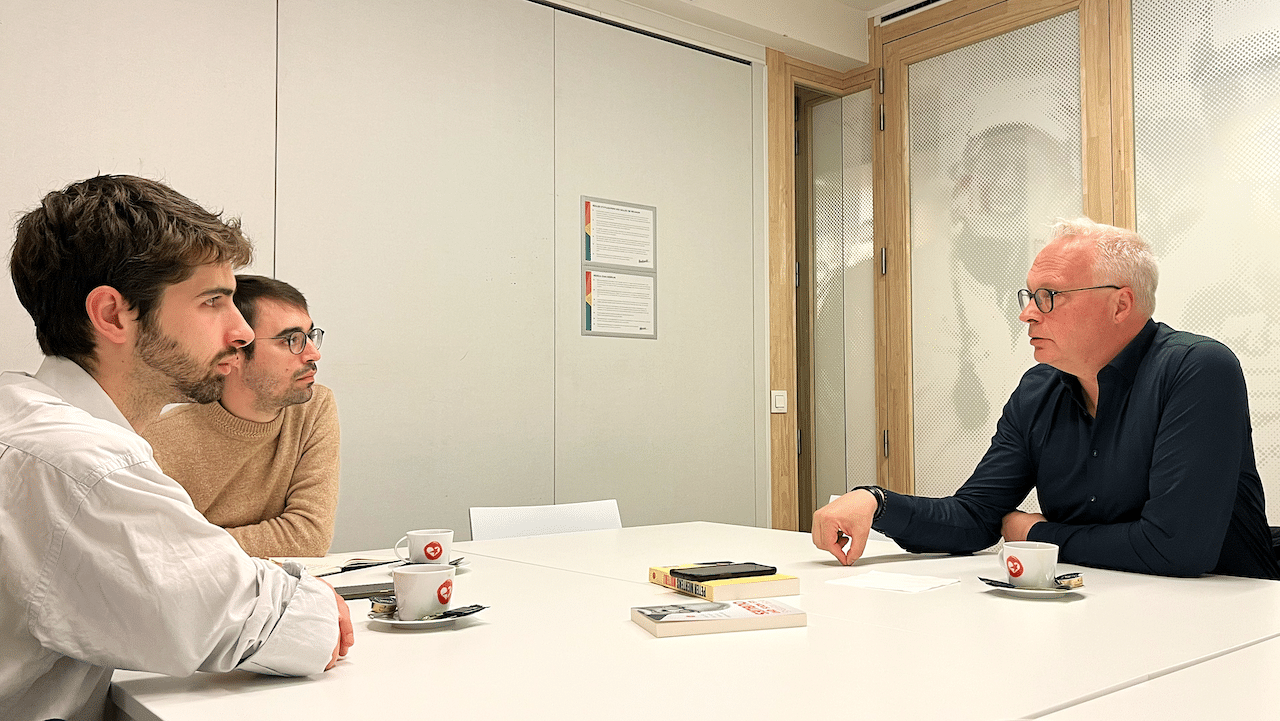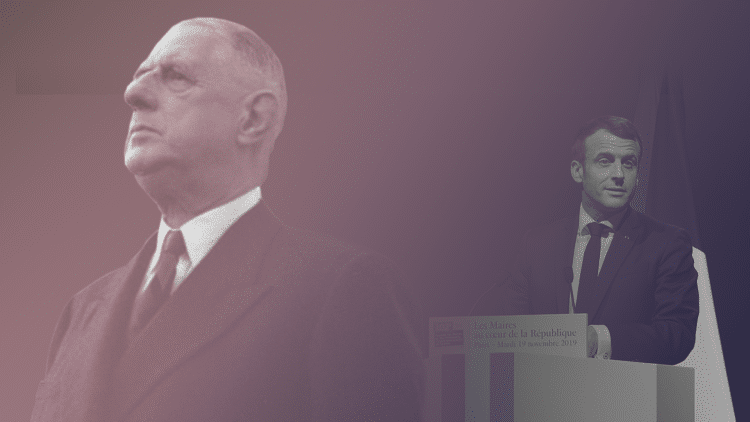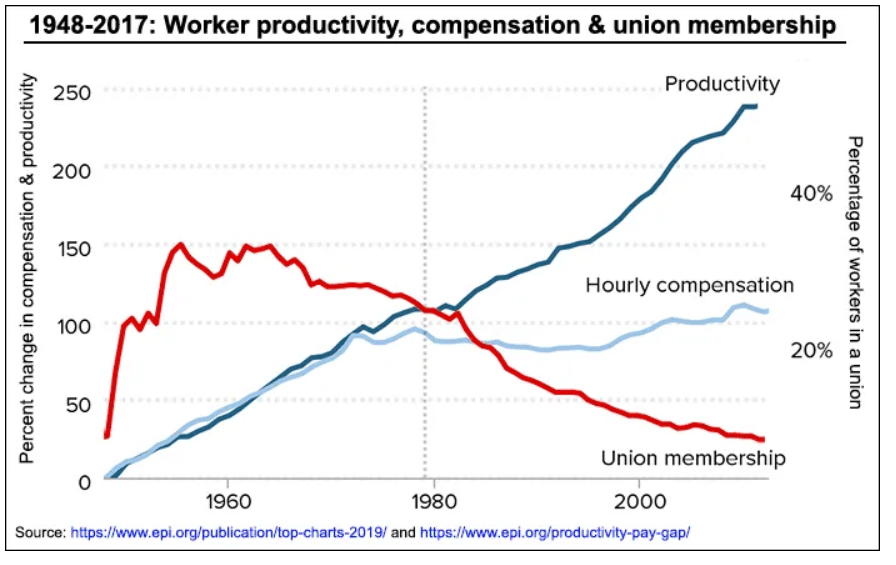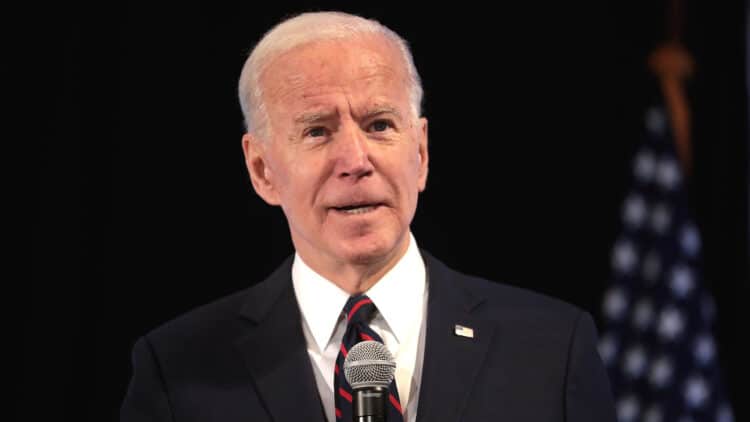À défaut de faire pression sur Israël pour interrompre le carnage mené à Gaza, Joe Biden a préféré ouvrir un nouveau front au Yémen et bombarder les Houthis, qui prennent pour cible les navires de commerce d’Israël et de ses alliés dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Une escalade peu susceptible de mettre fin aux attaques en mer Rouge et qui pourrait saboter le processus de paix engagé pour résoudre la guerre civile qui ravage le Yémen depuis presque dix ans. Par Helen Lackner, autrice de l’ouvrage Yemen in Crisis: autocracy, neo-liberalism and the disintegration of a state, traduction par Camil Mokadem [1].
Le 11 janvier, après plusieurs semaines de procrastination, les forces américaines et britanniques ont déclenché pas moins de 60 frappes aériennes visant des positions du mouvement Ansar Allah (ou Houthi), au Yémen. Cette opération, ainsi que les suivantes menées par les États-Unis, a pour objectif officiel de protéger le trafic maritime contre les attaques des rebelles Houthis en mer Rouge. Cette escalade militaire amorce une nouvelle étape dans la crise actuelle au Moyen-Orient, dont le cœur demeure l’offensive israélienne potentiellement génocidaire menée sur la population de Gaza.
D’abord annoncés comme des mesures « exceptionnelles », les bombardements se sont répétés presque quotidiennement et sont amenés à se poursuivre. Les gouvernements américain et britannique ont annoncé que cette campagne visait à assurer le respect de la liberté de navigation, principe reconnu à l’international. La menace houthie est également brandie devant l’opinion publique européenne comme un facteur potentiel d’inflation. Le mouvement séparatiste est en effet tenu responsable des retards de livraison de marchandises, provoqués par les détours que les navires prennent désormais pour éviter la mer Rouge.
Les États-Unis ont d’autre part déclaré que ces frappes n’entrent pas dans le cadre de l’opération Gardien de la prospérité, annoncée mi-décembre, qui brille par son insignifiance. Aucun pays frontalier de la mer Rouge n’a en effet rejoint la force opérationnelle américaine, pas même l’Égypte, pourtant durement touchée par les pertes de revenus liés aux droits de passage par le canal de Suez. La majorité des principales compagnies maritimes contournent désormais l’Afrique, ce qui augmente les coûts et les délais.
Que veulent les Houthis ?
Les États-Unis et le Royaume-Uni refusent de reconnaître officiellement les revendications des Houthis. Ces derniers ont pourtant clairement affirmé agir en soutien des Palestiniens à Gaza et ont déclaré que leurs actions prendraient fin dès qu’Israël cessera ses opérations militaires dans l’enclave et lèvera le blocus des biens essentiels. Ansar Allah a également déclaré ne cibler que les navires ayant des liens avec Israël, bien qu’au lendemain des représailles récentes, le mouvement vise désormais les transporteurs américains et britanniques. Les Houthis ne souhaitent toutefois pas imposer un blocage généralisé en mer Rouge.
Les médias occidentaux présentent volontiers les Houthis comme des marionnettes iraniennes aux mains de Téhéran.
Ces derniers sont régulièrement présentés dans les médias occidentaux comme de vulgaires marionnettes de Téhéran, au même titre que d’autres mouvements locaux. « Soutenus par l’Iran » est la désignation standard accolée à toute mention des rebelles Houthis, une formulation éculée, à double fonction.
D’abord, cette désignation donne du grain à moudre aux « faucons » de Washington, qui souhaitent étendre le conflit pour mener une guerre à grande échelle à l’Iran, un scénario qui aurait des conséquences épouvantables dans la région. Ce projet s’accorde toutefois avec les objectifs des franges les plus radicales du gouvernement israélien d’extrême droite, lesquelles s’activent à faire entrer les États-Unis dans un conflit ouvert. L’avènement d’une guerre serait particulièrement inquiétant pour la sécurité des pays membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar), situés entre Israël et l’Iran géographiquement (et dans une moindre mesure, politiquement).
Désigner Ansar Allah comme un mouvement fantoche aux mains de Téhéran sert également à dénigrer les motivations et le positionnement des Houthis. Répété quotidiennement, leur slogan révèle une idéologie explicite : « Dieu est le plus grand ! Mort à l’Amérique, mort à Israël, malédiction aux juifs et victoire à l’islam ! »
En réaction aux massacres commis à Gaza, les rebelles yéménites ont d’abord déclenché des tirs de missiles et de drones en direction du sud d’Israël, des frappes interceptées avant qu’elles n’aient pu toucher leur cible. À l’inverse, leurs opérations en mer Rouge ont eu un impact bien réel, le port d’Eilat (unique porte d’entrée israélienne dans la mer Rouge) a vu son activité chuter de 85 %, et l’état hébreu a subi des pertes de 3 milliards de dollars fin décembre 2023.
Ces interventions en pleine mer ont fait passer les Houthis de l’ombre à la lumière, le mouvement est désormais célébré par des milliers de personnes qui l’ignoraient encore quelques mois auparavant. La perception est toute autre aux États-Unis et au Royaume-Uni, tous deux déterminés à soutenir de manière inconditionnelle l’assaut mené sur Gaza, où le bilan s’élève à plus de 25 000 morts palestiniens.
Contrairement à la plupart des pays arabes, les Houthis se sont mobilisés pour aider les Palestiniens et jouissent ainsi d’un soutien inédit au sein de la population yéménite, très largement propalestinienne. D’immenses foules se sont en effet rassemblées chaque semaine dans la capitale, Sanaa, et dans d’autres villes du pays pour manifester leur soutien à la Palestine.
Les opérations en mer Rouge aident également Ansar Allah à recruter parmi la jeunesse. La vigueur des Houthis tranche avec l’inertie du gouvernement yéménite internationalement reconnu et ses factions, qui soutiennent timidement la cause palestinienne. Une inertie qui, en comparaison, accroît la popularité d’Ansar Allah.
Quelles conséquences sur le Yémen ?
Les frappes de la coalition anglo-américaine et la désignation par Washington des Houthis comme organisation considérée comme terroriste, annoncée le 17 janvier dernier, auront de lourdes conséquences sur le Yémen. Bien qu’ils renforceront sans doute l’image populaire d’Ansar Allah à l’échelle locale et internationale, ces événements risquent d’aggraver la crise humanitaire dans le pays, même si les communiqués américains jurent du contraire.
En dépit des affirmations américaines, désigner les Houthis comme un mouvement terroriste risque d’aggraver la crise humanitaire au Yémen.
Ces opérations militaires aériennes ont un impact catastrophique sur les populations civiles. Les risques sont notamment élevés chez les plus précaires, souffrant déjà de l’accès limité aux ressources alimentaires et qui pourraient à présent subir la restriction des envois de fonds vers le Yémen, une manne financière absolument vitale pour des milliers de foyers.
Par ailleurs, ces frappes remettent en cause le timide processus de paix au Yémen, débuté en avril 2022. Une trêve de six mois avait alors été initiée sous l’égide de l’ONU entre les Houthis et leurs adversaires du Conseil de direction présidentiel. Celui-ci se compose de 8 membres représentant différentes régions et factions du pays, ainsi que les intérêts rivaux de l’Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis, qui ont eux-mêmes créé cette instance. Vu sa composition, rien d’étonnant à voir ce groupe rongé par des dissensions internes et des rivalités entre puissances tutélaires extérieures. Ces divisions ont pris le pas sur la lutte contre les Houthis.
À l’inverse, ces derniers présentent un front uni. Du fait de leur organisation structurelle, leur gouvernement central a su limiter les désaccords internes, et depuis 2015, Ansar Allah contrôle à peu près les deux tiers de la population yéménite et un tiers du territoire national.
Depuis 2015, Ansar Allah exerce son pouvoir sur environ deux tiers de la population et un tiers du territoire du Yémen.
Le système de gouvernement des Houthis est extrêmement autoritaire et répressif, et le respect des droits humains, à commencer par la liberté d’expression et les droits des femmes, n’est pas un principe fondateur pour le mouvement. D’un point de vue financier, Ansar Allah dépend largement d’une forte taxation de tout ce qui transite dans sa zone de contrôle. Les revenus portuaires et douaniers des ports d’Al Hodeïda ont augmenté au cours de l’année dernière, grâce à la levée partielle du blocus maritime, ce qui leur a permis de détourner les navires du port d’Aden.
Pour les civils, l’effondrement de l’économie et l’apport famélique d’aide humanitaire n’ont fait qu’aggraver davantage les niveaux de pauvreté à travers le pays, alors que le Yémen était déjà l’état le plus pauvre de la région. Au cours d’une guerre civile longue de presque dix ans, le mouvement Houthi a quant à lui gagné en vigueur et renforcé ses capacités sur le plan militaire, et s’il n’avait pas essuyé les assauts aériens de la coalition menée par l’Arabie Saoudite, il aurait sûrement élargi son emprise territoriale, notamment dans la région de Marib, zone clé de production de pétrole et de gaz.
De fragiles négociations de paix
Pour compléter cet épineux tableau, il faut mentionner les négociations directes amorcées fin 2022 entre l’Arabie Saoudite et le mouvement Houthi, des tractations qui représentent le principal espoir de mettre fin à la guerre au Yémen.
Depuis la fin de l’année 2022, des négociations ont été engagées entre l’Arabie Saoudite et les Houthis.
Le prince héritier et principal dirigeant saoudien Mohamed Ben Salmane a depuis longtemps abandonné l’espoir d’une victoire rapide contre les Houthis, et cherche depuis quelques années à sortir son pays de l’impasse yéménite. Pour sa part, Ansar Allah désigne clairement l’Arabie Saoudite comme son adversaire et perçoit le Conseil de direction présidentiel (Internationaly recognized government, ou IRG) comme un vulgaire prolongement du royaume. Les négociations directes sont donc un élément crucial pour mettre un terme à l’engagement saoudien.
Tout au long de l’année 2023, un accord semblait sur le point de se dessiner. Ce dernier devait proposer de multiples solutions, notamment le versement par l’Arabie Saoudite du salaire des fonctionnaires pendant un an, la fin du blocage des ports, et l’élargissement des destinations depuis l’aéroport de Sanaa. En tout premier lieu, cet accord devait inclure un cessez-le-feu permanent et la sécurisation des frontières.
Le statut officiel de l’Arabie Saoudite dans ces négociations demeure toutefois un point de désaccord majeur. Les Houthis insistent sur le fait que Riyad signe en tant que « participant », terme qui exposerait les autorités saoudiennes à des accusations de crimes de guerre, et placerait le royaume face à ses responsabilités pour leurs actions militaires passées. Les Saoudiens souhaitaient donc signer l’accord en tant que « médiateurs » pour éviter ce risque afin de ne pas écorner leur image. En décembre dernier, ce point d’achoppement semblait pouvoir être levé, les houthis ayant modéré leurs exigences et étant prêts à mentionner l’Arabie Saoudite comme médiatrice.
Ces efforts n’ont toutefois débouché que sur une déclaration de l’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, pourtant externe aux négociations entre les Houthis et l’Arabie Saoudite. Ce dernier a annoncé la préparation d’une feuille de route pour des négociations internes entre les parties yéménites, censées déboucher sur un accord de paix qui mettrait fin à la guerre civile.
Les Saoudiens se sont contentés de notifier le Conseil de direction présidentiel du contenu de l’accord, ce qui démontre à quel point il ne s’agit que du relai de pouvoir de puissances étrangères. À l’instar de l’envoyé spécial de l’ONU, ils n’ont pas été consultés et n’ont jamais eu l’occasion de donner leur avis. Si cet accord avait abouti, les pays membres du Conseil de coopération du Golfe auraient été formellement libérés de leur implication dans la guerre civile au Yémen. Il y a toutefois fort à parier que le Conseil aurait continué à soutenir les factions qui dépendent de lui financièrement et politiquement.
Un nouveau bourbier ?
Cet accord n’aurait certes pas mis fin à la guerre civile au Yémen, mais il aurait constitué une avancée notable vers une solution. Les négociations visant à établir un état démocratique auraient été extrêmement difficiles si les Houthis avaient eu l’ascendant dans le rapport de force. Au sein du gouvernement internationalement reconnu, on retrouve des éléments politiques comme le Conseil de transition du Sud, et les forces de la Résistance Nationale de Tarek Saleh, deux organisations tout aussi brutales et répressives qu’Ansar Allah, d’autres mouvements comme Al-Islah défendent, eux, une idéologie islamiste rivale.
S’opposer au soutien populaire pro-palestinien est un jeu dangereux pour n’importe quel gouvernement au Moyen-Orient.
L’engagement des Houthis dans le contexte de la guerre à Gaza a constitué un défi complexe pour le processus de négociations. L’Arabie Saoudite et les États-Unis espéraient voir l’accord se concrétiser avant que la situation n’atteigne un point critique. C’est ce qui explique le silence de Riyad par rapport aux interventions des Houthis en mer Rouge. En outre, pour n’importe quel état du Moyen-Orient, s’opposer au soutien populaire en faveur de la Palestine est un jeu dangereux étant donné le possible génocide en cours, surtout quand on connait l’inaction du royaume des Saoud à ce sujet. En réponse aux frappes américaines sur le Yémen, Riyad s’est donc contenté d’appeler à la « retenue et à empêcher toute recrudescence ».
Du côté des États-Unis, mettre fin à la guerre au Yémen était l’un des objectifs affichés de l’administration Biden au début de son mandat. En désignant les Houthis comme terroristes et en les attaquant, le Président américain a probablement enterré cette promesse.
Si la perspective de la paix d’une paix entre les Houthis et le camp saoudien s’éloigne, l’intervention américaine et britannique n’est pas pour déplaire à d’autres factions du Conseil de direction présidentiel. Le Conseil de transition du Sud (STC), dirigé par Aïdarous al-Zoubaïdi et défendant une sécession du Sud-Yémen, a ainsi appelé ouvertement à cette implication militaire occidentale. Marionnette du gouvernement des Emirats Arabes Unis, cette faction espère que la désignation des Houthis comme terroristes aidera à mieux criminaliser leurs adversaires sur la scène internationale et que les frappes militaires affaibliront Ansar Allah. Quoi qu’il en soit, les soutiens de cette nouvelle escalade guerrière n’ont visiblement retenu aucune leçon des multiples conflits dans la région, qui n’aboutissent toujours qu’au désastre.
Notes :
[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin, paru sous le titre de « Joe Biden’s Air Strikes on Yemen Are Reckless and Wrong ».