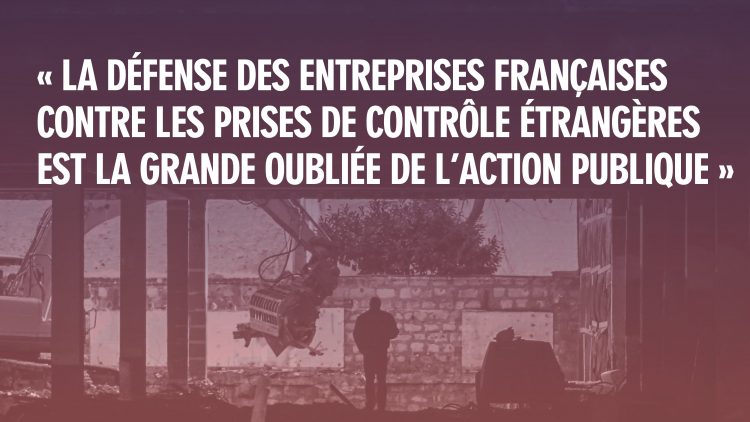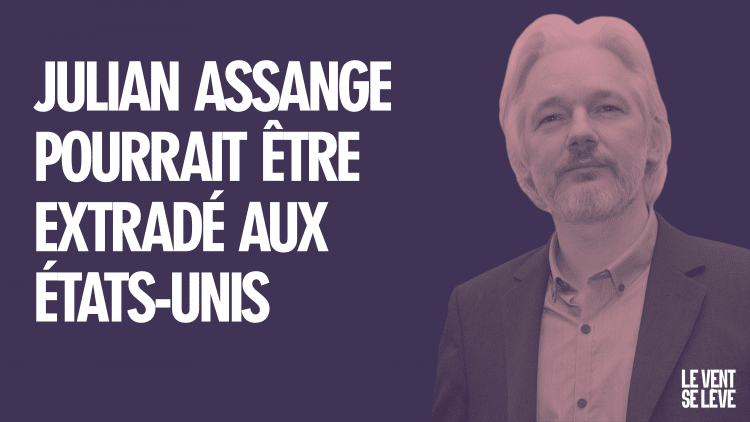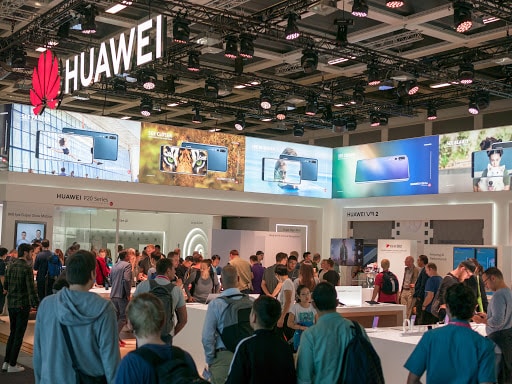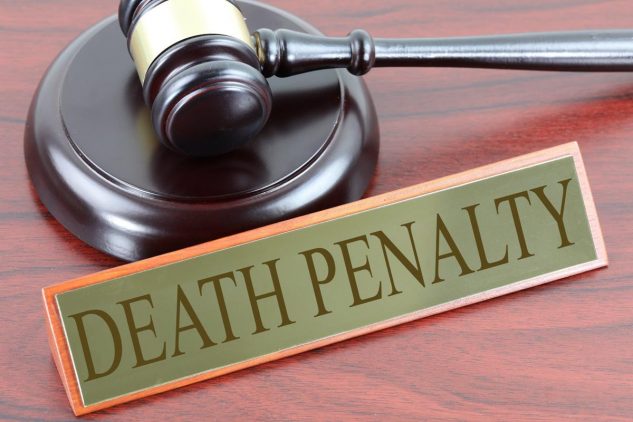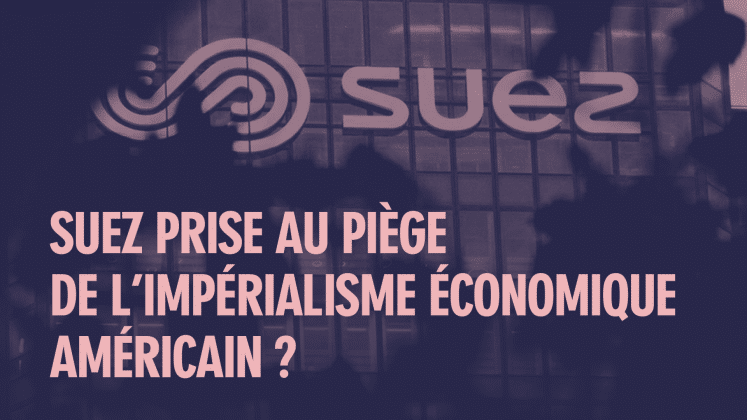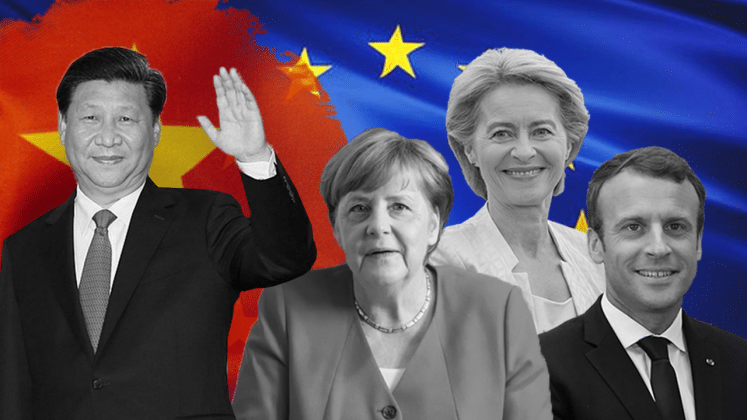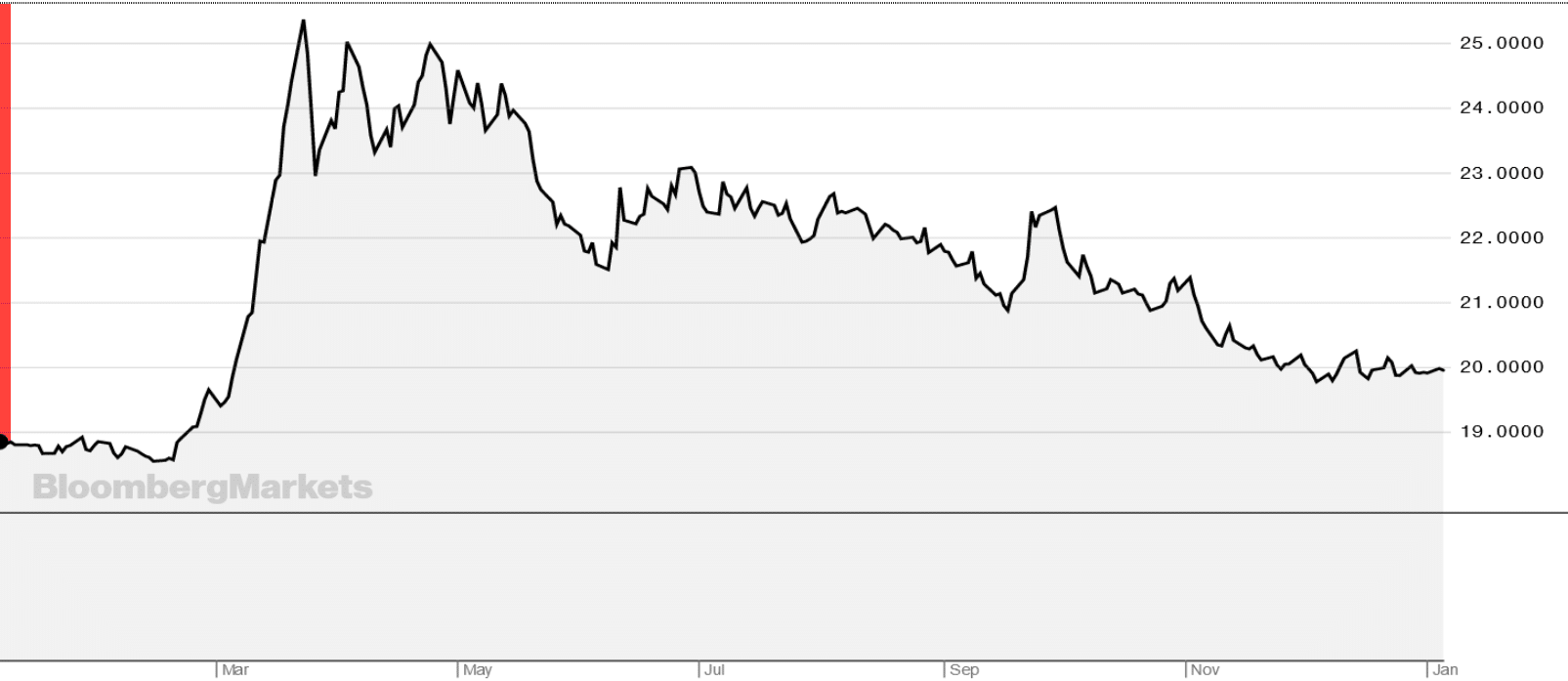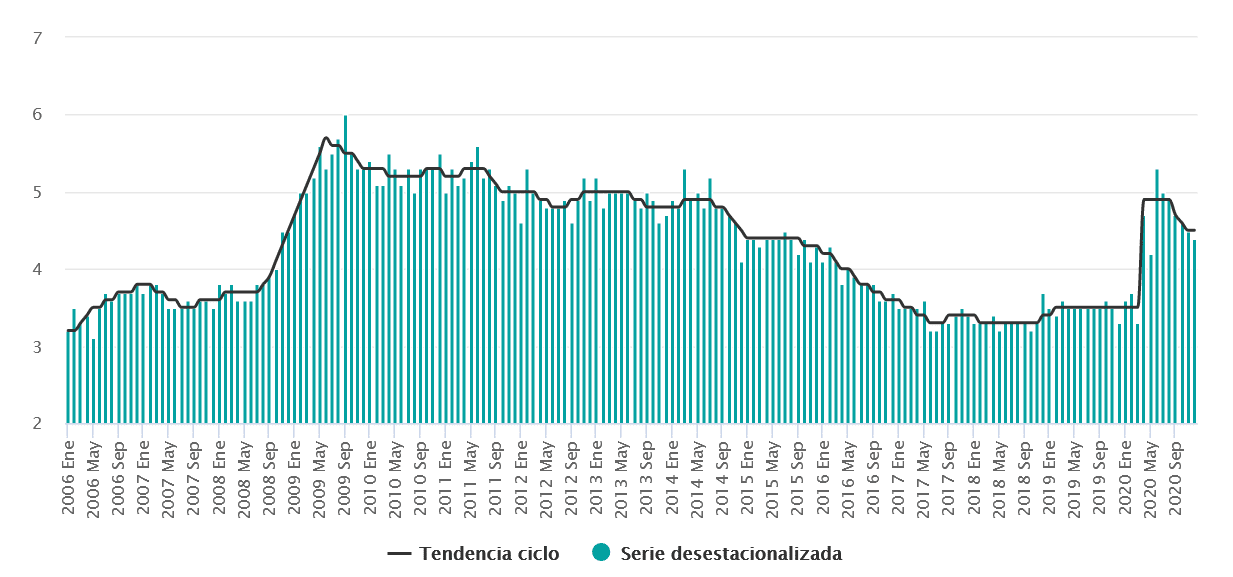En dépit de nombreux rapports et travaux sur la question ainsi que de rachats d’actifs stratégiques, l’intelligence économique ne semble toujours pas être une priorité pour Emmanuel Macron. Alors que la domination des GAFAM et du droit américain se renforce et que la Chine commence à racheter des entreprises stratégiques, l’enjeu est considérable pour la France. La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann ainsi que ses collègues du groupe CRCE ont déposé une proposition de loi début avril portant création d’un programme d’intelligence économique. Nous avons souhaité revenir avec elle sur la genèse de cette loi, la capacité de la France à disposer d’une telle organisation et les limites qu’elle rencontre au vu du laissez-faire de l’Union européenne. Entretien réalisé par Valentin Chevallier. Retranscrit par Dany Meyniel.
LVSL – Vous avez déposé avec vos collègues du groupe du CRCE une proposition de loi portant création d’un programme national d’intelligence économique. Quelle est la genèse de cette loi ?
Marie-Noëlle Lienemann – La question de l’intelligence économique m’est apparue depuis de nombreuses années comme un enjeu majeur parce que, dans la mondialisation et l’Europe libérale actuelle, nous ne défendons pas sérieusement et suffisamment l’intérêt de la France et des Français, nos emplois et nos entreprises. Évidemment j’estime urgent et indispensable de transformer les règles des échanges mondiaux et le cadre de la construction européenne. D’ailleurs je crois que s’ouvre un nouveau cycle, après ces quarante années de domination du néolibéralisme, qui offre des opportunités, mais aussi conforte des risques à savoir la financiarisation, la domination des GAFAM etc. Il faut saisir cette opportunité historique. Mais surtout quel que soit le cadre qui nous entoure et en attendant d’avoir pu le modifier, nous ne devons pas rester l’arme au pied. Il faut prendre la mesure de la guerre économique que nous devons affronter. En France, nous sommes forts pour dire que nous ne sommes pas d’accord avec les règles, sans pour autant créer un rapport de force sérieux dans le but de les modifier. Mais plus encore, cette posture est souvent le prétexte à une grave paralysie pour agir dans le cadre existant, à sous-estimation de nos marges de manœuvre.
Pendant de nombreuses années, comme députée européenne, j’ai hélas vu comment les gouvernements français laissaient s’installer une construction européenne déséquilibrée en sa défaveur, ne réagissaient pas aux graves menaces sur son industrie, ses emplois et tombaient dans une sorte de fatalisme et d’impuissance redoutables. J’ai observé que les autres pays, plus organisés et déterminés comme l’Allemagne, savaient mieux, notamment quand il s’agissait de défendre leurs industries, agir de concert entre toutes les forces pour porter dans les institutions européennes des normes, des politiques qui leur étaient favorables. Ils avaient anticipé, construit des choix en amont des décisions. Hélas en France, nous sommes souvent mal préparés, pas offensifs, on ne voit pas venir les problèmes où on refuse de les voir. Je l’ai vécu s’agissant de l’édiction des normes environnementales. Nous sommes insuffisamment en veille, insuffisamment pro-actifs et coordonnés pour pouvoir, tout en défendant des causes justes comme la question environnementale ou sociale, peser réellement et préparer les entreprises françaises à des mutations, notamment les PME qui sont moins informées. Tout cela m’avait mis en colère.
Je citerai un exemple : alors que nous avions voté en Europe l’interdiction du cadmium – très polluant –, qu’une PME française avait mis eu point une batterie nickel-zinc pouvant en partie se substituer à celle du nickel-cadmium, elle n’a pu trouver, après de nombreuses démarches, les soutiens capitalistiques et industriels en France pour sa production dans l’Hexagone. Elle a pu le faire dans le Land de Sarre en Allemagne, où le coût du travail n’est pas plus bas qu’en France. Cela a manifesté de manière concrète qu’il nous manque des outils permettant d’agir, indépendamment des contraintes dans lesquelles nous vivons.
Mais plus encore, des affaires comme Alstom, Technip ou Nokia montrent à quel point les pouvoirs publics ont failli, laissé notre pays abandonné des pans entiers de sa souveraineté économique, perdu des emplois et des entreprises majeures. Si nous avions une stratégie sérieuse d’intelligence économique, nous aurions pu décoder la stratégie américaine pour prendre le contrôle d’activités d’Alstom ou de Technip que les Américains convoitaient, ne pas être tributaire de décisions de chefs d’entreprises sous pression ou peu motivés par les intérêts de la France. L’intelligence économique permet d’anticiper mais aussi d’agir très vite. En rencontrant les organisations syndicales, j’ai mesuré que ces désastres étaient évitables, que l’on pouvait réagir pour veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent pas et j’ai découvert le travail important qui était fait autour de l’École de pensée de guerre économique, avec Christian Harbulot, Nicolas Moinet, Ali Laïdi et Nicolas Ravailhe que je connais depuis longtemps.
Lire sur LVSL l’entretien de Nicolas Moinet : « Nous sommes en guerre économique. On ne peut pas répondre aux dynamiques de réseaux par une simple logique de bureau. »
Voilà ce qui m’a amené à préparer et déposer cette proposition de loi. Pourquoi une loi ? Depuis de nombreuses années, se sont multipliés des rapports sur l’intelligence économique souvent très intéressants mais qui n’ont pas été suivi d’effets, et en tout cas ni d’initiatives suffisantes, ni de structures et de politiques globales, pérennes nous mettant à hauteur de ce que font les grands pays développés. La France n’a pas engagé un travail de longue haleine qui, quel que soit le gouvernement, mobilise largement les forces économiques et sociales du pays de manière concertée, opérationnelle pour être suffisamment efficace. Bien sûr, fort heureusement il y a quand même eu des success stories dans certains domaines. Trop peu et c’est cela qu’il faut changer. Il fallait donc aller au-delà d’un énième rapport, du dépôt de questions parlementaires au gouvernement ou des protestations. C’en est assez de voir les syndicalistes, les élus, constatant une prédation ou une fermeture d’entreprise, revenir bredouille d’un rendez-vous avec les services de Bercy où ils se sont entendu dire que tout cela est terrible, qu’ils regrettent, alors qu’ils laissent faire, n’ont pas voulu agir, ou n’ont pas pu agir car c’était trop tard.
Pour que les choses avancent, il faut donc une politique publique inscrite dans la loi, pérenniser une ou des structures qui auront la charge de la mettre en œuvre. C’est une condition essentielle pour s’inscrire dans la durée et atteindre nos objectifs. Il nous faut assurer que l’intelligence économique, l’attention à la défense de notre intérêt national et territorial devienne une véritable culture collective. C’est pourquoi la proposition de loi instaure le principe d’un programme national de l’intelligence économique associant largement les différents ministères, les collectivités territoriales, les forces économiques et syndicales, les chercheurs etc. Ce programme national doit faire l’objet d’une évaluation, d’un suivi parlementaire afin que le sujet ne soit mis sous l’édredon en fonction des circonstances.
J’ai hélas vu comment les gouvernements français laissaient s’installer une construction européenne déséquilibrée en sa défaveur, ne réagissaient pas aux graves menaces sur son industrie, ses emplois.
Bien sûr, le concept d’intelligence économique peut paraître assez flou et allie plusieurs domaines. Elle ne se confond pas avec la seule sécurité économique et dépasse cette idée avec la veille, la collecte et le traitement d’informations, l’anticipation, l’organisation de notre réactivité et les capacités d’influence de la France. Le soft power, dans les sociétés contemporaines, notamment au niveau international, est quelque chose de fondamental, qu’on ne peut pas laisser aux seules multinationales françaises. C’est même parfois contre-performant si on s’en tient à cela. Il y a un problème d’éducation, d’agriculture, etc. C’est un champ large. Et comme c’est un champ large, on ne peut pas le déléguer à un seul département ministériel.
LVSL – Vous proposez la création d’un Secrétariat général à l’intelligence économique (SGIE) qui serait rattaché directement au Premier ministre. N’avez-vous pas une crainte que les nombreux autres services existants comme le SISSE, que vous ne proposez de pas de supprimer, viennent à nouveau ralentir l’aspect offensif de la France en matière d’intelligence économique ? De plus, ce ne devrait pas être à l’Élysée de piloter le SGIE ?
M-N. L. – L’Élysée, ce n’est pas l’exécutif, l’exécutif c’est le gouvernement. L’Élysée n’est pas contrôlé par le parlement. Or, il est fondamental que ce soit sous le regard et avec la coopération du parlement. Aussi, c’est une structure qui relève de l’administration. Ce n’est pas une énième structure de prospective, de pensée théorique qui va phosphorer. On est très bon lorsqu’il s’agit de phosphorer, de faire des textes, etc. Au contraire, lorsqu’il s’agit de mettre en mouvement des acteurs qui peuvent agir, et au bon moment, coordonner les informations et analyses pour établir des stratégies, ce n’est pas le cas. Le SGIE ne doit pas se substituer aux autres administrations quand on doit mener des actions du ressort de tel ou tel ministère, par exemple lorsqu’il s’agit de faire évoluer des éléments de notre fiscalité, nos textes juridiques, afin de réagir face aux menaces sur notre tissu productif. En revanche, ce service doit veiller à la bonne exécution des décisions prises. Nous le voyons avec le Covid-19 : la France est en crise de savoir-faire. Nous savons inventer des dispositifs. En revanche, veiller à ce que les gens le concrétisent, zéro – j’exagère un peu.
Est-ce un service de plus ou pas ? Je n’arbitre pas pour savoir s’il faut faire disparaître le SISSE ou s’il faut l’intégrer sous l’égide de ce service. La loi n’organise pas l’administration en détail. Elle crée une structure qui a vocation à ne pas nous enfermer dans un seul volet de l’intelligence économique, dans un silo de pensée, à savoir celui de Bercy et du Trésor dont je doute de l’efficacité. Il n’y a pas seulement un manque de moyens, il y a une vision trop étroite et un vrai problème culturel. Les élites bercyennes ont accompagné pour ne pas dire provoqué la désindustrialisation de la France, en zélateurs aveugles de la prétendue libre concurrence, en refusant l’intervention de l’État dans le cadre d’une économie mixte, en étant plus royaliste que le roi sur les directives libérales de l’Union européenne. Sans compter la lourde influence des banques et multinationales françaises sur leurs choix et parfois leurs carrières. Même lorsque les politiques le prônaient, Ils n’ont jamais soutenu l’idée de la souveraineté économique, ce qui ne veut en rien dire le repli sur soi, le protectionnisme généralisé. Idem pour la réindustrialisation de la France et de nos territoires. Alors pour le SGIE doit rassembler des gens qui portent une culture nouvelle, sur la manière de concevoir notre réindustrialisation, notre développement économique. Lorsque je dis « nouvelle », c’est être tout à la fois conscients de cette guerre économique, des grandes mutations dans le monde, lucides, voyant loin et volontaires.
Il y a bien sûr ce qui se passe en Asie, en Chine et qui doit être observé et traité avec beaucoup de constance et en se projetant dans l’avenir, car les Chinois eux ont des programmes et visées à long terme qu’il faut bien décoder. Mais, il y a des sujets plus immédiats. J’ai en mémoire le cas d’une PME française d’instruments utilisés dans le secteur du champagne, innovante, bien gérée, dans un domaine qui ne connaît pas la crise, qui en moins de six mois a dû fermer car son concurrent est allé en Pologne grâce à 85 % de cofinancement de fonds européens, a augmenté son volume de production, a bénéficié un peu du dumping social – mais en l’occurrence, là, ce n’était pas décisif – et ensuite sans barrière douanière a pu revenir sur nos marchés.
Avec les entreprises, la collectivité publique aurait dû surveiller les concurrents, voir les risques de délocalisations selon les activités, anticiper, prévoir d’investir à l’Est pour sauver l’emploi chez nous, avoir des relais de croissance pas pour délocaliser mais contrer ce que d’autres pourraient faire. On peut même dans un tel cas envisager d’acheter le concurrent. On peut dans ce genre de situation, mobiliser des fonds européens et même des fonds publics français. Bref, là où d’autres savent trouver des stratégies – en particulier les Allemands – sachons nous aussi définir les nôtres et ne pas laisser disparaitre des emplois, les activités que l’on pouvait sauver voire même les développer.
Devant de tous ces enjeux, il faut qu’il y ait non seulement de l’interministériel, raison pour laquelle je propose qu’il y ait un représentant dans chaque ministère, mais aussi des liens étroits avec les partenaires sociaux, patronat et syndicats, ainsi qu’avec les collectivités territoriales.
LVSL – Un ressentiment demeure entre les acteurs économiques et syndicaux avec les acteurs de l’État en matière d’intelligence économique. Pensez-vous que le pilotage au plus près du terrain par le préfet du département sera suffisant pour créer des synergies et à la fois se défendre et être offensifs ?
M-N. L. – Le travail dans les communes, départements et régions doit se faire à travers la déconcentration mais aussi par un mouvement de bas en haut, avec des fonctionnaires affectés aux préfectures qui se consacrent à bien connaitre le tissu économique local, les acteurs concernés et pouvoir avec eux, anticiper regarder les activités qui pourraient être menacées, celles qui pourraient saisir des opportunités nouvelles, etc. Je peux donner un exemple étranger : la filière italienne de production de raisins. Le libre-échange s’est ouvert entre l’Europe et l’Égypte dans ce secteur et cela a engendré d’importants volume d’importation de raisins égyptiens. On a pu observer qu’un importateur des Pays-Bas a pu, après avoir recruté un ancien salarié de la filière italienne ou éventuellement pirater des fichiers clients, couler une grande partie de production de la filière italienne sans qu’elle ne voit venir le coup. Entre dumping sur les coûts et démarchage sur sa clientèle, la filière italienne s’est retrouvée en extrême difficulté. La leçon que l’on peut en tirer pour la France est de suivre les accords de libre-échange, mesurer les risques concrets, simuler ceux-ci, dialoguer avec les entreprises locales sur tout cela et créer un réflexe de vigilance et d’action. Beaucoup doit partir du terrain mais il faut aussi regarder ce qui, au niveau national, peut avoir un impact local. L’État déconcentré en la matière doit entretenir un double mouvement de bas en haut et de haut en bas. Mais il faut aussi soutenir les initiatives des collectivités locales, assurer une bonne complémentarité avec elles et avec l’État. Car les collectivités territoriales ont un rôle éminent à jouer. Elles sont très attachées au maintien des activités industrielles locales. Elles voient des choses que d’autres ne voient pas. Il faut leur laisser leur autonomie d’action, il faut qu’elles puissent y être associées et avoir accès aux informations, faire monter les informations qu’elles souhaitent, etc. Le rôle de ce Secrétariat général à l’Intelligence économique est donc différent des fonctions du SISSE.
Les élites bercyennes ont accompagné pour ne pas dire provoqué la désindustrialisation de la France, en zélateurs aveugles de la prétendue libre concurrence.
Prévue dans la proposition de loi, la création du Conseil national de l’intelligence économique associant partenaires sociaux, représentants des collectivités territoriales, universitaires et des chercheurs, différents services concernés de l’État, branches industrielles etc, permettra aussi de rétablir une confiance mutuelle entre État et collectivités territoriales, car si nous avançons ensemble, si nous marquons des progrès, le travail en commun et les convergences seront plus évidents.
LVSL – La France est très en retard, même par rapport à d’autres pays européens comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni. L’idée d’associer directement les préfets de départements, tout comme chaque ministère, ainsi que de nombreux fonctionnaires dédiés nécessitent un investissement important de l’État. Avez-vous réfléchi avec votre groupe à la dimension budgétaire de la loi et pensez-vous que le gouvernement sera favorable à votre proposition de loi ?
M-N. L. – A minima, je pense qu’il faut 200 à 300 personnes dans ces services, entre les services déconcentrés et les services centraux. Un des grands enjeux, outre l’enjeu budgétaire, est de savoir quel type de profil il faut former et/ou recruter. Il faut des gens, pas tous mais une partie, qui aient déjà mis les mains dans le cambouis : il faut des avocats, des syndicalistes – notamment ceux d’Alstom, Technip, Nokia qui ont vu des choses et savent bien agir en la matière – mais aussi une grande diversité : des gens qui travaillent ou ont travaillé à l’étranger dans ces domaines, des gens qui viennent des collectivités territoriales, etc. Le changement culturel des fonctionnaires ou futurs fonctionnaires doit être net. Mais il faut garantir la neutralité, l’indépendance de ces fonctionnaires, et veiller à ce qu’ils aient chevillé au corps le sens de l’État et de l’intérêt national. La proposition de loi comprend tout un chapitre sur l’anti-pantouflage, le refus des allers-retours vers le privé et tout ce qui favorise des liens d’intérêts. Il faut des gens prêts à défendre un patriotisme économique, avec une diversité de compétences acquises.
Je prends le chiffre de 200-300 personnes car il faut au moins une personne par département, ainsi qu’un réseau de cadres. Des redéploiements de postes sont aussi possibles en formant les agents. Ce n’est pas insurmontable pour la République française. Il pourrait aussi être opportun de faire des économies en réduisant la sous-traitance en millions d’euros confiée par l’État à des cabinets anglo-saxons, – cela a été particulièrement le cas à l’apogée de la crise pandémique avec McKinsey à titre d’exemple – pour renforcer les capacités d’action de la puissance publique. L’Allemagne, afin d’éviter les appels d’offres internationaux en matière d’expertise, internalise dans la fonction publique ces savoir-faire et fractionne avec ses territoires.
Une proposition de loi ne doit pas comprendre d’inscriptions budgétaires. Mais c’est une bataille à mener lors des lois de finances et en parallèle avec cette PPL je déposerai lors de l’examen du budget 2022 des amendements pour renforcer notre action dans le domaine de l’IE.
J’insiste sur la proposition prévue dans la PPL de création d’une délégation parlementaire comprenant 10 députés et 10 sénateurs, comme cela existe pour le renseignement afin que le parlement joue pleinement son pouvoir de contrôle de l’exécutif et de l’application des lois. Plus encore depuis la crise du Covid, on se rend compte que ce qui pose problème aujourd’hui en France n’est pas toujours les textes législatifs mais très souvent la mise en œuvre effective des politiques, et ce dans de très nombreux domaine. L’exécutif considère qu’il a les pleins-pouvoirs, les mains libres en la matière, ce qui me paraît aberrant et s’avère trop fréquemment défaillant. Il faut sortir de cette ornière. Néanmoins, le parlement peut contrôler, être mieux informé, porter des préconisations. D’où l’importance de cette structure parlementaire.
Je vais donner un exemple qui en dit long sur la nature patriotique des Allemands : quand vous prenez les cantines françaises, il y a un nombre important de produits, qui viennent de l’étranger : en Allemagne, tout, ou presque, vient d’Allemagne.
La loi 4D peut aussi être l’occasion d’avancer à travers des amendements en particulier pour bien mettre l’intelligence économique comme compétence à différents niveaux et dans l’action déconcentrée. Par ailleurs je soutiendrai la restauration de la compétence économique aux départements car même si la région a des compétences en la matière et que la strate départementale est intéressante, le lien entre des PME très locales et l’instance régionale, notamment depuis qu’on a fait des plus grandes régions, est plus compliqué à mettre en œuvre. Mes collègues sénateurs m’ont fait observer que certains départements qui s’engageaient fortement et apportaient suivi à des secteurs d’avenir – je pense à la chimie du bois dans la Nièvre par exemple – avait bien des difficultés pour mobiliser la région, car celle-ci est trop vaste et se limite aux gros enjeux industriels. Or, en France, on a besoin de consolider l’émergence d’ETI. La force de l’Allemagne c’est tout de même ses ETI. Nous on a misé stratégiquement sur des multinationales – qui d’ailleurs ont été privatisées, et sont souvent passées sous contrôle étranger – et pas assez sur les ETI. Les départements sont le premier échelon où l’entreprise potentiellement capable de devenir ETI peut être repérée.
Concernant le gouvernement, je ne suis pas sûre qu’il y ait une réelle hostilité à cette proposition de loi. À Bercy sans doute, j’en veux pour preuve la réponse de la ministre Agnès Panier-Runacher lors du débat au Sénat sur la souveraineté économique. C’était du genre : on a le SISSE, tout va bien, circulez il n’y a rien à dire. En réalité, l’avis de l’exécutif en privé est beaucoup plus nuancé et moins homogène. Au sein du gouvernement, les propos et intentions sont très contradictoires. Le discours du Bruno Le Maire reste quand même très libéral et dans le même temps, on y trouve des accents de patriotisme économique, un peu à géométrie variable, sans qu’il y ait une vraie stratégie. Chez Le Maire, ce concept parait plutôt défensif, justifie le « sauve-qui-peut » en période de crise, avant de revenir au « bon libéralisme » qui serait salvateur. C’est plutôt une notion de transition face à la crise qu’une pensée économique nouvelle fondée sur une nouvelle organisation entre le privé, le public et le champ de l’économie sociale, qui je crois est plus apte à répondre aux enjeux de la période et de notre réindustrialisation.
Lire sur LVSL l’entretien avec Ali Laïdi : « Le but de la réflexion sur la guerre économique, c’est un objectif d’écologie humaine ».
Il faut retrouver une articulation intelligente entre le capital public ou l’intervention publique et les initiatives privées. Notre programme de relance par des investissements publics est très insuffisant en comparaison des États-Unis. Chez Emmanuel Macron, on entend des propos volontiers plus volontaristes sans qu’on en voit réellement les concrétisations en regardant les dossiers les uns après les autres. C’est plus souvent l’inverse. Il a été l’homme du dépeçage d’Alstom et de Technip ! Heureusement, Photonis a évité la prédation américaine, même si est impliqué un fond du Luxembourg et que la vigilance s’impose. La vente des chantiers de l’Atlantique à Fincantieri a été de justesse refusée. Il y a beaucoup de laisser-faire là où on pourrait réagir. En tout cas, je ne désespère pas de trouver des parlementaires LREM favorables à une stratégie française d’intelligence économique. Mais je souhaite vivement qu’un très grand nombre de parlementaires au-delà des désaccords politiques nécessaires en démocratie s’investissent pour faire aboutir une loi structurante pour l’intelligence en France, car il en va de l’intérêt national. Je travaille à ces convergences.
LVSL – L’Union européenne, dont les traités favorisent la libre concurrence questionne pourtant depuis quelques mois sa capacité d’autonomie sur le plan stratégique. La France n’aurait-elle pas intérêt d’avancer seule sur ce sujet pour se prémunir des attaques de certains États membres et des carences des traités européens ?
M-N. L. – L’un des freins chez Macron c’est aussi l’eurobéatitude. Rien ne saurait se faire sans l’Europe et la France seule ne pourrait rien ! Grave erreur. Agir au niveau européen c’est mieux mais cela ne saurait suffire. Loin de là. Car si l’on parle beaucoup de la menace chinoise, c’est au sein du marché européen que la France a le plus perdu de parts de marché et cela se poursuit d’années en années. Et ce pour différentes raisons. Évidemment, pour les libéraux et le patronat français l’alpha et l’oméga serait la baisse du « coût du travail » et de la fiscalité. Je ne vais pas polémiquer sur ce point car j’observe que ces baisses ne sont jamais suffisantes depuis 30 ans, qu’on nous promet des millions d’emplois avec le CICE mais que la désindustrialisation, inexorablement, continue. En revanche, quoi qu’on pense de la compétitivité dite coût, force est de constater que s’agissant du hors coût, des politiques de modernisation de l’outil productif, la montée en gamme de nos produits, des politiques de filières, des stratégies industrielles nous sommes très défaillants. Il faut que cela change et c’est très important. Le gouvernement sous-estime notre vulnérabilité intra-européenne.
Le discours, selon lequel la France ne peut pas agir seule et que le salut ne vient que de l’Union européenne ne permet pas d’avancer ; car comme l’Europe n’agit pas, on n’agit pas en France non plus. Disons plutôt qu’on va se battre en Europe, mais que dans le même temps, on prend des initiatives françaises et même des partenariats ou des coopérations avec d’autres États et entreprises européennes. Ces partenariats peuvent être intra-européens mais sans s’obliger à prendre toute l’Europe dans son ensemble. L’intelligence économique doit nous aider aussi à voir comment ces partenariats peuvent être menés. Cela ne doit pas forcément être toujours des partenariats franco-allemands car, jusqu’à aujourd’hui, c’est tout de même l’Allemagne qui a été le grand bénéficiaire de la désindustrialisation française. Je ne dis pas qu’il faut être anti-allemand. Je vais donner un exemple qui en dit long sur la nature patriotique des Allemands : quand vous prenez les cantines françaises, il y a un nombre important de produits, qui viennent de l’étranger : en Allemagne, tout, ou presque, vient d’Allemagne. La France est le pays de la bonne nourriture, le pays de l’agriculture et on trouve le moyen d’importer pour manger dans nos cantines… Il y a quand même un problème ! D’autant que l’Allemagne a les mêmes règles européennes que nous : donc le problème dans ce cas-là ne vient pas de là.
Ce n’est pas un hasard que la présidence allemande de l’Union européenne se conclue le 23 décembre 2020 par la signature d’un traité d’investissements avec la Chine !
Bercy a un dogmatisme : le marché public doit être ouvert, sans critère de localisation. Je ne sais pas comment font les Allemands, mais en tout cas ils y arrivent. Il faut donc qu’on trouve nous aussi les moyens d’y arriver. Cet exemple permet de montrer qu’il n’y a pas de fatalisme à notre déclin. Certes, cela va être long de remonter la pente. C’est pour cela qu’il faut une structure pérenne. Ce qui me déprime c’est l’esprit munichois des élites françaises quant à la possible réindustrialisation de la France et leur inertie, leur manque de volontarisme. Évidemment, tout ce qui sera entrepris ne marchera pas à 100%. Mais les mêmes qui vante la culture du risque dans les entreprises et se refusent à imaginer qu’on pourrait prendre pour notre pays des risques collectifs sur un certain nombre de terrains. Évidemment il faut des choix raisonnés et le plus partagés possibles, ça évite mieux les déboires. De toute façon, leur immobilisme, leur choix libéraux, la désindustrialisation qu’ils ont provoquée, nous coûtent très cher ! C’est pour cela qu’il faut un changement culturel et dans l’État, la stratégie nationale de l’intelligence économique peut constituer un levier.
Bien sûr, la question de la révisions des traités, du rééquilibrage au sein de l’Europe où les inégalités ne cessent de s’accroitre, le refus des dumpings sociaux et fiscaux au sein de l’Union européenne sans compter les paradis fiscaux intra européens comme les Pays-Bas, l’Irlande ou le Luxembourg, la révision de la doctrine sur les aides d’État constituent des enjeux politiques de premier ordre et sont pour moi très importants mais cette PPL n’embrasse pas tous les changements nécessaires et avec pragmatisme nous arme dans cette guerre économique et nous permet de prendre l’offensive.
Lire sur LVSL l’article de Valentin Chevallier : « L’autonomie géopolitique de l’Union européenne : une fable à l’épreuve de l’accord avec la Chine. »
Oui l’Europe affirme sa volonté d’autonomie stratégique mais quand je vois que l’Allemagne a un excédent commercial annuel de plus de 70 milliards de dollars avec les États-Unis, j’ai les plus grands doutes sur son intention de tenir tête aux États-Unis au sujet des GAFAM ou de l’extra territorialité du droit américain. Idem côté Chinois. Ce n’est pas un hasard que la présidence allemande de l’Union européenne se conclue le 23 décembre 2020 par la signature d’un traité d’investissements avec la Chine ! Alors, oui, menons des combats en Europe, trouvons des alliés parmi les Vingt-Sept pour sortir de cette complaisance en faveur de la concurrence prétendument libre et non faussée mais n’entretenons pas des chimères, ne nous berçons pas de fausses illusions et prenons le plus souvent possible notre destin en main.
LVSL – Vous faites une proposition audacieuse, à savoir la création d’un module pour l’ensemble des étudiants de l’enseignement supérieur. Justement, davantage que des pratiques, la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle ne passe-t-elle par un changement des consciences ? Ce module ne devrait-il pas être envisagé comme une des épreuves aux concours de la fonction publique ?
M-N. L. – La première étape, c’est de former les gens. Ainsi la PPL prévoit que les établissements d’enseignement supérieur créent un module d’enseignement en matière d’intelligence économique à destination de l’ensemble des formations, sans préjudice d’approche spécifique inhérente à chaque type de formation. Évidemment il va falloir adapter ce module en fonction des spécialités. Mais cela doit concerner aussi bien les scientifiques que les juristes ou la plupart des cursus. Par ailleurs nous proposons de créer un institut national d’études de l’intelligence économique. Il a pour but de former les partenaires sociaux et les différents milieux économiques et sociaux issus des secteurs publics et privés au service de l’influence de la France. Oui je pense que la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle passe par une prise de conscience, un regard lucide, une culture partagée. Mais j’insiste, il ne s’agit pas de fermer ni le pays, ni les esprits. À titre personnel j’ai toujours pensé que la France n’était grande que lorsqu’elle se préoccupait du monde, y prenait toute sa part et défendait les valeurs républicaines et l’universalisme. C’est d’ailleurs particulièrement d’actualité avec l’urgence climatique. Mais cela n’est pas possible si nous subissons et si nous déclinons. Je crois que les jeunes générations peuvent s’enthousiasmer pour ces deux perspectives.
Ne nous leurrons pas ! La France subit des attaques sous forme de guerre de l’information, notamment contre son modèle républicain. Les impacts sont importants pour notre pacte social et notre efficacité économique. Le pays se divise dangereusement au lieu d’œuvrer collectivement aux enjeux actuels comme celui des transitions numériques et écologiques. L’intelligence économique permet d’avoir des grilles de lecture pour étudier la guerre de l’information, analyser les risques et organiser des contre-offensives.
LVSL – La coopération entre les services du renseignement, de la justice et de la veille économique et stratégique sont l’une des clefs du succès des États-Unis. Ne devrait-on pas renforcer cette synergie y compris en France ? Quels freins voyez-vous ?
M-N. L. – C’est également pour cela que notre proposition prévoit un « Monsieur ou une Madame Intelligence économique » dans chaque ministère. Oui la question judiciaire est très importante, d’où la nécessité de sensibiliser et former les magistrats. Bien penser et utiliser le droit est une des clefs. Sachant par ailleurs que le droit américain permet davantage d’agir que le droit européen et français en la matière. Le lien entre le SGIE et le ministère de la Justice doit être permanent pour aussi mieux outiller juridiquement les entreprises et singulièrement les petites.
Je pense qu’il y a déjà beaucoup de travail effectué par nos services de renseignements. Les services de renseignements français, sur un certain nombre de sujets, voient venir les choses. Et si parfois, dans certains cas, ils ne font pas de recherches complémentaires, c’est peut-être parce qu’on ne leur demande pas et qu’ils n’ont pas le sentiment que notre pays pourrait agir. Quand les services de renseignement voient qu’il y a des lieux où ils peuvent expliquer ce qu’ils observent, que cela peut être utile pour agir, que peuvent leur être demandé des informations complémentaires, je pense qu’ils seront plus valorisés dans ce qu’ils font. Il ne s’agit pas de le claironner tous les matins. Il faut qu’il y ait des gens, dans ces services de l’IE, qui sachent avoir l’indispensable discrétion qui s’impose, si on veut être efficace. Je ne l’ai pas mis dans la loi parce que je pense que le côté espionnage intelligent, échange d’information de l’espionnage, de l’information recueillie, est potentiellement déjà existante en France. C’est plus la valorisation de ce qu’ils ont recueilli qui doit être amélioré. Je ne veux pas que les gens pensent que l’intelligence économique se limite à avoir de l’espionnage.
De la même manière, la cybersécurité est très importante. La manière dont on va chercher les informations, dont les gens qui ont ces informations savent que cela peut être utile à l’action, c’est déterminant. On verra à ce moment s’il y a des coordinations à structurer davantage. Parfois, les structures trop rigides empêchent des transmissions d’informations qui sont parfois meilleures quand il s’agit d’échanges informels. Il faut se méfier de vouloir tout codifier. Ce que je veux, c’est qu’il y ait un lieu où on échange et où on sait qu’on peut échanger, où non seulement on échange mais où l’on réfléchit comment changer les comportements, anticiper, faire valoir une vision française dans certains domaines, etc.
Pour conclure, j’insiste sur le caractère opératif de cette proposition de loi. La France est est un pays qui a de grandes ressources, à commencer par le talent de ses citoyens mais qui s’est appauvri et affaibli en Europe. Le PIB par habitant a chuté par rapport à la moyenne européenne. Il est en dessous dans toutes nos régions sauf en Île-de-France. En Europe, les pays qui s’en sortent le mieux ne sont pas ceux qui pratiquent le moins-disant social. Depuis des années, nos gouvernants ont failli là où on nous promettait l’essor économique. Notre pays oscille maintenant entre colères, sentiments d’humiliation et d’impuissance face aux problèmes. Soutenir une politique d’intelligence économique, c’est un des moyens du redressement, et cela sera aussi utile pour financer la santé, l’éducation, la sécurité, la justice, la défense, pour ne citer que ces sujets.