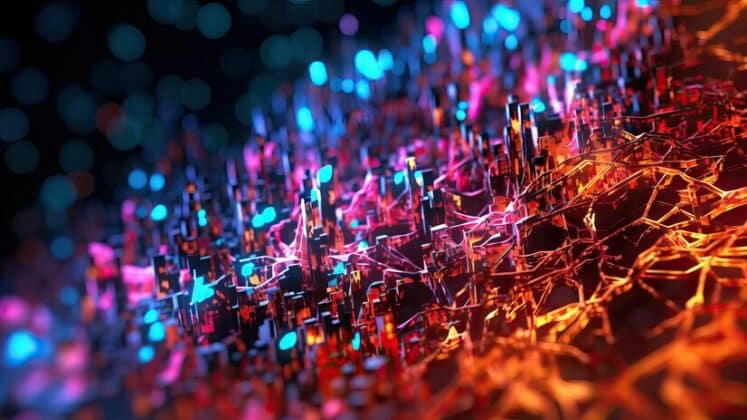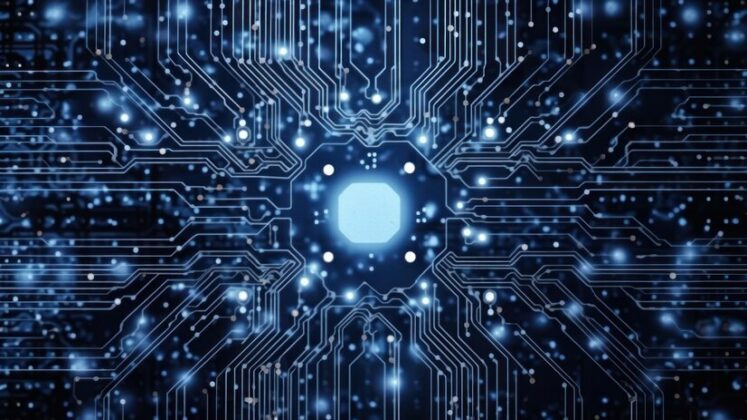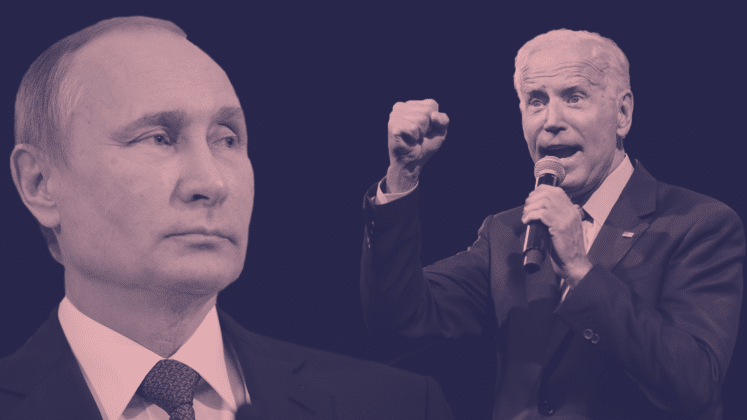Le vote pour le RN est-il motivé par le racisme ou par le rejet de « l’assistanat » ? Alors que l’électorat de Marine Le Pen s’élargit à chaque élection et que le parti d’extrême-droite a abandonné toute remise en cause du système néolibéral (fin du projet de sortie de l’euro, opposition à la hausse du SMIC, abandon de la défense de la retraite à 60 ans…) pour séduire l’ancien électorat LR, on peut se demander ce qui réunit les électeurs frontistes… et ce qui serait susceptible de les diviser. Pour les économistes Bruno Amable et Stefano Palombarini, l’explication par le seul racisme est trop simpliste et néglige d’autres facteurs. D’après eux, il est possible pour la gauche de faire éclater la coalition électorale du RN en pointant l’imposture du discours social de Marine Le Pen, mais arrimer les couches populaires de la France périphérique à la NUPES sera néanmoins compliqué. Dans Où va le bloc bourgeois ? (Editions la Dispute), ils analysent la séquence électorale de 2022 et les évolutions par rapport à 2017 et esquissent des hypothèses sur les recompositions à venir. Extraits.
Amélie Jeammet : Au moment des résultats du second tour de l’élection présidentielle, une vidéo tournée à la mairie de Hénin-Beaumont a a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, montrant des habitants de la ville protester avec beaucoup de colère et de brutalité verbale contre l’annonce de l’élection d’Emmanuel Macron. Usul et Ostpolitik ont fait une chronique sur Mediapart à propos des commentaires qu’a suscités cette vidéo sur Twitter. On peut les classer en deux grandes tendances : d’un côté, ce qu’on pourrait appeler un racisme de classe, qui passe par l’expression d’un mépris pour ces classes populaires « vulgaires » et « basses du front » et, de l’autre, des commentaires qui soulignent le mépris des premiers, et qui font appel à la souffrance sociale dans laquelle vivraient ces personnes filmées, laquelle rendrait leur colère compréhensible. Pour ce second groupe de commentaires, le vote Le Pen s’expliquerait donc par cette souffrance sociale, et non par une adhésion à une idéologie raciste.
La chronique d’Usul et d’Ostpolitik renvoie alors ces deux groupes de commentaires dos à dos en expliquant qu’ils dénient ce qui unifie les électeurs de Le Pen, à savoir le racisme, la xénophobie, la peur et la haine de l’islam, tout ce qui peut évoquer les Arabes ou les musulmans, et qui constituerait le véritable ciment de ce bloc d’extrême-droite. Bien sûr, la macronie n’est pas exempte de dérives idéologiques racistes de ce type, elle nous en a donné des exemples avec certaines lois plus ou moins explicitement dirigées contre les musulmans et leur présence dans l’espace public. Alors, effectivement, l’électorat de Le Pen est disparate, et il y a ce malentendu socio-économique entre les classes populaires qui votent pour elle et la base néolibérale de son programme économique, mais n’y a-t-il pas cette unité de haine ou de peur de la figure du musulman ?
Bruno Amable : Je crois que, lorsqu’on essaie de trouver des éléments communs à cette base sociale, c’est effectivement cela qui ressort. C’est finalement le seul point commun qu’ont ces groupes disparates. Mais pour l’analyser, il faut interroger la hiérarchie des attentes.
Stefano Palombarini : Oui, il y a de ça. Mais c’est réducteur de dire que c’est un électorat unifié autour du racisme. Un élément qui montre que cette façon de voir les choses est trop simple est le résultat de Zemmour, qui en termes de racisme a essayé, si l’on peut dire, de doubler Le Pen sur sa droite. Si le seul facteur qui attire le vote vers Le Pen était le racisme, Zemmour aurait été pour elle un vrai concurrent. Et il ne l’a pas été, notamment en ce qui concerne le vote des catégories populaires. C’est donc plus compliqué que ça. À mon sens, si on veut expliquer le paradoxe de classes pénalisées par les réformes néolibérales qui votent pour une candidate qui de fait les valide, il faut considérer trois éléments différents.
Le premier, c’est que le RN profite d’une rente en quelque sorte. Il n’a jamais gouverné, et il profite ainsi du profil d’un parti anti-système. Il n’est pas le seul dans cette situation, car LFI par exemple n’a jamais été au pouvoir non plus, mais Mélenchon a été ministre, il était au PS, il a été soutenu dans deux campagnes présidentielles par le PCF, qui a été un parti de gouvernement. Quarante années d’alternances dans la continuité des réformes incitent à identifier le néolibéralisme au « système », et donc rapprochent ceux qui souffrent de ses conséquences du seul parti perçu comme anti-système.
Le deuxième élément est constitutif de la stratégie de l’extrême-droite, et il revient à dire : vos difficultés ne sont pas liées à l’organisation économique et productive, ce sont d’autres menaces qui pèsent sur vous. Il y a clairement une composante au minimum xénophobe là-dedans, et sur ce détournement des thèmes du débat, qui fait que dans les médias on discute beaucoup plus de burkini que de retraites, d’identité française que de pouvoir d’achat, il y a une convergence d’intérêts objective avec le pouvoir macroniste. Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer et compagnie n’ont pas été sur ce terrain par hasard. Si les thèmes économiques et sociaux ont eu un peu de visibilité au cours des deux derniers mois de la campagne présidentielle, c’est uniquement grâce à la percée de Mélenchon dans les sondages. Mais il ne faut pas oublier qu’avant, le débat médiatique était tout entier consacré à l’immigration, l’insécurité, l’islam, la laïcité, etc., et cela a laissé bien sûr une trace dans les résultats électoraux. Je ne sais pas si Macron a voulu aider Le Pen à se qualifier, mais il avait certainement intérêt à orienter le débat dans cette direction pour invisibiliser les effets de son action sur le terrain social et économique. Cela profite à l’extrême-droite car des gens qui se sentent fragilisés, menacés ou directement en souffrance sociale ont eu tendance à se positionner par rapport à des thématiques sur lesquelles l’extrême-droite se propose comme protectrice.
« Sur ce détournement des thèmes du débat, qui fait que dans les médias on discute beaucoup plus de burkini que de retraites, d’identité française que de pouvoir d’achat, il y a une convergence d’intérêts objective avec le pouvoir macroniste. »
Le troisième élément découle de la croyance dans le TINA (There is no alternative), c’est-à-dire de l’idée que les réformes néolibérales sont nécessaires et inéluctables, et il est directement relié au racisme. L’extrême-droite propose de répartir de manière inégalitaire les conséquences de réformes auxquelles il serait impensable de s’opposer, mais qui vont faire mal aux classes populaires. C’est la préférence nationale mais pas seulement. Il faut de la main-d’œuvre flexible ? D’accord, laissons les immigrés dans la plus grande précarité, avec des CDD qu’il faut renouveler, sinon on les renvoie « à la maison». Il faut réduire la protection sociale ? Réservons-la exclusivement aux Français. L’objectif est une segmentation des classes populaires et ouvrières fondée sur des critères ethniques ou religieux, avec la promesse aux «Français de souche » de faire retomber sur les autres le coût social des réformes. Cet élément identitaire est central pour l’extrême-droite et se combine avec les deux autres dans le vote RN. C’est plus compliqué que de dire que ce sont des racistes qui se rassemblent, même si le racisme joue un rôle-clé. Mais si le RN était simplement le parti des racistes, on y trouverait une présence bourgeoise bien plus forte, car le racisme en France est très loin d’être l’exclusive des classes populaires.
Bruno Amable : C’est un paradoxe. On pourrait affirmer que la société française est probablement moins « raciste » qu’elle ne l’était il y a quatre ou cinq décennies. Les politistes ont des indicateurs pour le montrer. C’est aussi l’impression qu’on peut avoir de façon anecdotique. Le paradoxe étant qu’il y a quatre ou cinq décennies, les partis d’extrême-droite ne dominaient pas la vie politique. Si on voulait expliquer par le racisme la montée de l’extrême-droite, on devrait dire que la société est devenue plus raciste, ce qui n’est pas le cas. On peut même affirmer l’inverse.
C’est pour cela qu’il faut prendre en compte la hiérarchie des attentes. Les électeurs étaient en moyenne plus « racistes » il y a plusieurs décennies, mais cette préoccupation était relativement bas dans la hiérarchie de leurs attentes, ce n’était pas leur préoccupation principale. Je pense que, même parmi les électeurs de gauche qui ont porté Mitterrand au pouvoir, il y avait probablement plein de gens qui pensaient qu’il y avait trop d’immigrés, mais ce n’était pas ça qui leur importait principalement, c’était autre chose. Dans les 110 propositions de Mitterrand, comme dans le Programme commun, il devait y avoir le droit de vote aux élections locales pour les immigrés. Je suis bien persuadé que dans tout l’électorat, y compris populaire, il y avait des gens qui n’en voulaient pas. Comme la suppression de la peine de mort et peut-être d’autres propositions. Mais ce qui importait dans leur décision de vote ou de soutien politique était les mesures qui figuraient plus haut dans leur hiérarchie des attentes. Donc la question est de savoir pourquoi la hiérarchie des attentes d’une certaine partie des classes populaires s’est bouleversée à ce point et que les questions autour de l’immigration semblent avoir été considérées comme plus importantes qu’elles ne l’étaient par le passé. On revient à ce que disait Stefano : la restriction de l’espace du compromis est telle que, fatalement, on se tourne vers d’autres choses.
Il y a aussi, dans certaines fractions des classes populaires, des attentes qui ne sont pas nécessairement sympathiques. Des attentes alimentées par le ressentiment social à l’égard des gens plus diplômés, perçus comme plus protégés ou plus aisés, et évidemment, un ressentiment à l’égard des immigrés ou de leurs descendants. Donc, tout ce qui peut gêner ces groupes sociaux à l’égard desquels s’exprime ce ressentiment peut provoquer une sorte de joie maligne fondée sur l’espérance de la mise en œuvre de mesures pénalisantes. L’électorat de Le Pen, Zemmour ou même en partie de LR serait très content si on parlait de couper les budgets de la culture, voire de la recherche ou de certaines aides sociales. Le ressentiment à l’égard des fonctionnaires est bien connu. Vu comme une catégorie privilégiée par certains segments de la population, tout ce qui peut leur nuire peut être jugé positif. On pourrait aussi évoquer ceux qu’on désigne sous l’appellation de « cas soc’ ». On retrouve au sein d’une partie des classes populaires la volonté de ne pas être des « cas soc’ ».
Au-delà du ressentiment individuel, on voit bien que c’est un problème politique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de proposition politique qui unifierait des groupes autour d’attentes communes qui ne seraient pas ces attentes-là, mais d’autres attentes qui permettraient de satisfaire l’ensemble des classes populaires ou une fraction des classes populaires et moyennes. Ce problème politique est celui de trouver une stratégie politique fondée sur des attentes plus positives. Je me souviens d’une question qui m’avait été posée en interview: qu’est-ce qui pourrait permettre d’unir à la fois le 93 et le nord-est de la France ? La réponse se trouve probablement du côté des politiques qui amélioreraient la situation matérielle de ces populations qui ont en commun de vouloir des écoles ou des hôpitaux de bonne qualité, des services publics de proximité, etc. C’est autour de ce genre de choses qu’on peut tenter de les réunir, plutôt que de jouer sur les différences de ces catégories de population en les exacerbant.
Stefano Palombarini : La réunification politique des classes populaires passe par l’idée qu’on peut avoir des avancées communes. Ce que tu disais sur le fait qu’il y a, dans ces classes, des attentes qui ne sont pas forcément sympathiques, c’est aussi une conséquence de la conviction que tout ce qu’on peut demander, c’est un partage plus favorable de ce qui existe. Donc pour obtenir quelque chose de plus, il faut le retirer aux fonctionnaires par exemple, ou aux immigrés. On pourrait le retirer aussi aux capitalistes, remarque, mais penser cela supposerait d’être déjà sortis de l’hégémonie néolibérale. Sur la fragmentation des classes populaires, un aspect intéressant réside dans la montée du vote RN dans le monde rural. Dans le débat, on mélange des choses très différentes, on qualifie par exemple de rurales les zones anciennement industrialisées et en voie de désertification, alors que les problèmes politiques qui les caractérisent n’ont rien à voir et les raisons du vote à l’extrême-droite non plus.
« La réunification politique des classes populaires passe par l’idée qu’on peut avoir des avancées communes. »
Mais si on reste à la ruralité au sens strict, et qu’on se pose la question de comment amener les classes populaires qui l’habitent dans une perspective, disons, de gauche, on voit immédiatement la complexité du problème. Ces catégories étaient largement intégrées au bloc de droite, et depuis toujours, elles vivent dans un compromis avec la bourgeoisie de droite. Ce n’est pas si simple alors de les convaincre que, s’il y a quelque chose à prendre, c’est aux classes qui ont toujours été alliées, qui ont toujours voté comme elles, y compris pour désigner les maires et les conseillers municipaux. Les fonctionnaires qui votent à gauche ou les immigrés qui viennent de débarquer sont plus spontanément perçus comme des adversaires. Dans les petits villages ruraux, il y a aussi un aspect directement lié au vécu quotidien: la bourgeoisie de droite à laquelle il faudrait s’opposer, c’est le voisin. Et les immigrés et les classes populaires du 93 avec lesquelles on devrait s’allier, on ne les a jamais vus. Je prends cet exemple pour montrer qu’il y a des héritages culturels, politiques, idéologiques, de plusieurs dizaines d’années, qui pèsent et qui font obstacle à l’unité des classes populaires. Il ne s’agit pas d’obstacles indépassables, mais il n’y a pas non plus de solution disponible et immédiate pour remplacer un travail politique de longue haleine.
Amélie Jeammet : Je lance une hypothèse sur les résultats des législatives. Imaginons qu’il n’y ait pas de majorité absolue qui se dégage, mais qu’on se retrouve avec trois blocs : la NUPES, un bloc Macron et un bloc RN. Devrait-on alors s’attendre, sur quelques dossiers, à des alliances entre le bloc macroniste et le bloc RN?
Bruno Amable : J’ai du mal à l’imaginer, parce que du point de vue de l’extrême-droite, ce ne serait pas très habile. Ils ont au contraire intérêt à rester une force d’opposition ou au moins ne pas apparaître comme des soutiens d’une majorité macroniste. On peut imaginer des alliances ponctuelles, sur des lois ultra-sécuritaires par exemple, mais ils n’auraient pas intérêt à voter la réforme des retraites de Macron. Même s’ils n’y sont pas fondamentalement opposés. Et ils ont aussi intérêt à jouer les maximalistes. Dans le registre des thèmes absurdes des campagnes électorales, il y a cette histoire des « impôts de production». Il y avait une course de Macron à l’extrême-droite pour déterminer qui allait baisser le plus possible ces fameux impôts. Quoi que Macron puisse faire dans cette direction, ils ont toujours intérêt à dire que ce n’est pas assez. Donc je n’imagine pas une alliance explicite parce que je pense que ce ne serait pas rationnel.
Amélie Jeammet : Irrationnel par rapport à l’idée que le RN se donne l’image du parti antisystème, et que cela lui imposerait d’y renoncer ?
Bruno Amable : Si j’étais à leur place, je me dirais qu’on a un avantage à être anti-système parce qu’on n’a jamais gouverné. Si on se met en position de perdre cet avantage parce qu’on vote les lois sans même gouverner, on perd sur tous les côtés. À mon avis, ils n’ont pas intérêt à faire ça. S’il y avait simplement une majorité relative pour Macron, ce serait une situation très instable. S’il y avait une majorité relative pour la gauche, il y aurait intérêt, du point de vue de l’extrême-droite, à s’opposer, mais il y aurait un risque pour les macronistes, qui serait de voter avec l’extrême-droite contre la gauche. Et là, c’est la partie de leur argumentaire qui consiste à dire qu’ils ne sont pas avec les extrêmes qui disparaîtrait.
Stefano Palombarini : Il faut raisonner sur cette structure en trois pôles pour la période qui vient, tout en sachant que cela ne va pas durer très longtemps. Mais dans cette phase, il va y avoir une compétition entre le pôle d’extrême-droite et le pôle de la gauche de rupture pour déterminer qui est le véritable opposant au bloc bourgeois. Et tant que cette compétition est ouverte, ni l’un ni l’autre n’ont intérêt à s’allier à Macron. Le discours est différent pour LR, voire pour la fraction dissidente du PS, qui sont désormais des forces minoritaires. Mais pour ce qui est de l’extrême-droite et de la gauche de rupture, leur objectif est de se légitimer comme l’alternative au pouvoir macroniste, auquel ils ont donc tout intérêt à s’opposer. Après quoi, cette compétition, à un moment donné, va se terminer. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, mais dans la campagne des législatives, la gauche semble avoir pris un petit avantage. En tout cas, je pense que les choses deviendront claires au cours du quinquennat. Et il y a donc deux scénarios possibles.
« Il va y avoir une compétition entre le pôle d’extrême-droite et le pôle de la gauche de rupture pour déterminer qui est le véritable opposant au bloc bourgeois. Et tant que cette compétition est ouverte, ni l’un ni l’autre n’ont intérêt à s’allier à Macron. »
Le premier passe par l’échec de la gauche, qui deviendrait plus probable si la Nupes se révélait un simple accord électoral sans avenir. Dans ce cas, on irait vers un bipolarisme à l’anglo-saxonne, qu’on retrouve en réalité aussi dans plusieurs pays d’Europe continentale, avec un bloc qui se prétend progressiste et démocrate, opposé à une alliance identitaire et traditionaliste. Il faut voir que, dans ce type de bipolarisme, les réformes néolibérales ne rencontreraient plus d’obstacle au niveau de la représentation démocratique. Bien sûr, elles susciteraient une opposition sociale, qui cependant ne trouverait plus d’interlocuteurs parmi les élus. On peut même dire que la transition néolibérale implique une série de réformes qui portent sur les institutions économiques, et qu’elle implique aussi une telle reconfiguration du système politique. Évidemment, ce scénario correspondrait à l’échec total de la stratégie de Mélenchon, qui, depuis sa sortie du PS, travaille à la construction d’une alternative politique au néolibéralisme. Et ce n’est pas du tout étonnant de constater que Mélenchon est considéré comme l’ennemi à abattre non seulement par Macron et Le Pen, mais par le système médiatique dans son ensemble. Ce n’est pas certain qu’ils y arriveront, car la souffrance sociale engendrée par les réformes est telle que la gauche de rupture dispose, potentiellement, d’un vrai socle social.
Il y a aussi un second scénario, celui dans lequel cette gauche s’affirmerait comme une vraie prétendante au pouvoir. On aurait alors un conflit politique de tout autre nature, qui porterait sur les questions sociales et économiques, et même sur les modalités d’organisation de la production, de l’échange et de la consommation. Une telle situation produirait presque mécaniquement un rapprochement entre le bloc bourgeois et l’extrême-droite, qui sur ces enjeux ont des positions absolument compatibles. Je ne crois pas que cela irait jusqu’à un parti unique de la droite, même s’il est intéressant de noter qu’un tel rapprochement se produirait alors que la succession de Macron sera certainement ouverte du côté de LREM, et celle de Le Pen possiblement au RN. Mais socialement, il n’y aurait pas de fusion complète entre le bloc bourgeois et celui d’extrême-droite. D’une certaine façon, le double jeu du RN ne serait plus tenable, et une partie des classes populaires qui votent pour ce parti ne suivraient pas le mouvement. Si donc le bloc de la gauche de rupture se consolidait et s’affirmait, il se retrouverait confronté à un nouveau bloc qui s’agrégerait autour du soutien au modèle néolibéral, avec une composante autoritaire importante, probablement aussi avec une composante identitaire et xénophobe. Mais bon, ces deux scénarios hypothétiques concernent l’avenir. Pour l’instant, nous sommes dans une configuration tripolaire, et pour revenir à ta question, il n’y a pas dans une telle configuration d’alliance envisageable avec Macron, ni pour la gauche de rupture ni pour l’extrême-droite.

Bruno Amable : Pepper D. Culpepper, un politiste américain, fait une différence entre ce qu’il appelle la noisy politics et la quiet politics. En gros, ce qui est lisible dans le débat public, et ce qui échappe au grand public, aux médias… Typiquement, la noisy politics, c’est par exemple la déchéance de la nationalité, et la quiet politics, c’est tout un tas de mesures de libéralisation financière que personne ne remarque parce que c’est trop compliqué, et dont on ne comprend qu’après les conséquences. Macron et l’extrême-droite n’ont pas du tout intérêt à se rapprocher sur la noisy politics. Mais sur la quiet politics, je ne suis pas sûr. Ils pourraient très bien s’entendre sur des choses qui échappent au débat public.
Où va le bloc bourgeois ?, par Bruno Amable et Stefano Palombarini, Editions La Dispute, 2022.