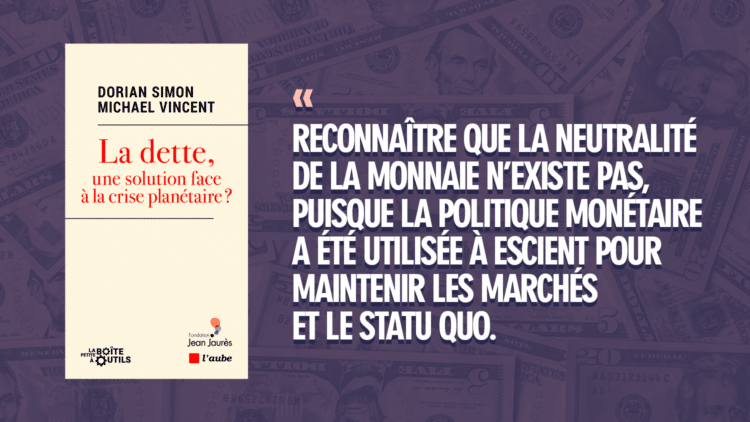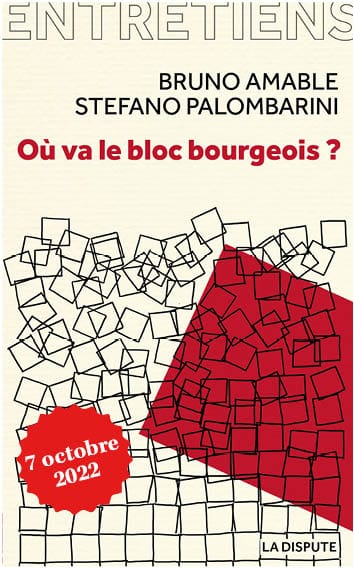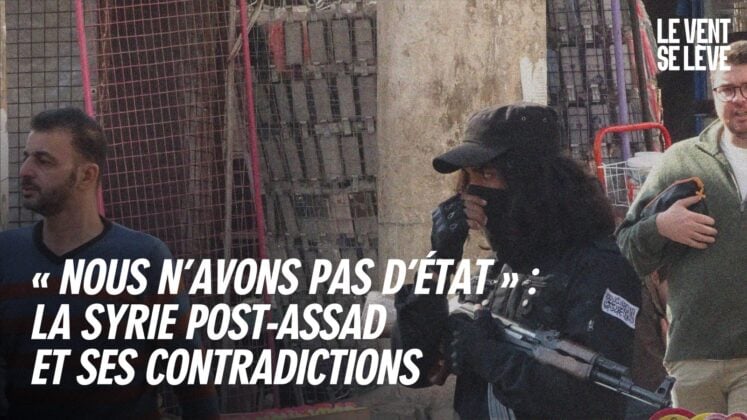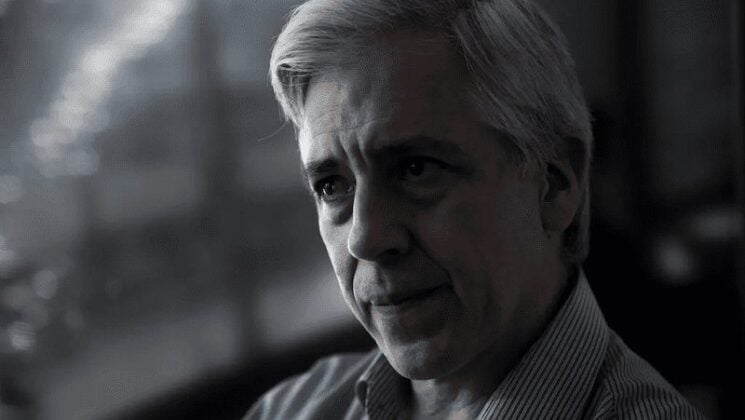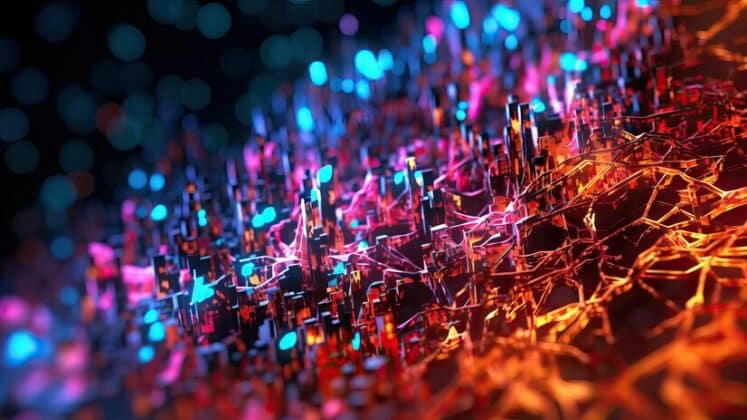Notre modèle économique menace gravement l’environnement. Tout problème ayant une solution, les marchés carbone ont aujourd’hui le vent en poupe : 21,5% des émissions carbonées du globe sont couvertes par un tel instrument. En revanche, l’inverse de cet adage est également vrai : toute solution apporte son lot de problèmes. Si les marchés carbone apportent théoriquement une garantie de performance, rares sont ceux qui ont déjà prouvé leur efficacité.
La conquête de l’hégémonie
S’ils sont actuellement sur les lèvres de tous les commentateurs politiques, les marchés carbone n’en restent pas moins ésotériques pour le commun des mortels. Réputés être d’une complexité barbare, les systèmes de plafonnement et d’échange – cap and trade (C & T) en anglais – ont une architecture assez simple et sont d’une redoutable efficacité théorique. L’État, ou une institution missionnée pour ce faire, doit premièrement fixer une limite maximale aux émissions annuelles (plafonnement ou cap), divisée en de multiples permis. Libre à lui d’ensuite distribuer comme bon lui semble ces précieux quotas à chaque entreprise qui pourront se les échanger entre elles (échange ou trade). A la fin de l’année, les sociétés doivent restituer à l’autorité publique le nombre de quotas correspondant aux émissions dont elles sont (légalement) responsables.
« Cela a toujours été l’avantage d’un système de plafonnement et d’échange par rapport à une taxe sur le carbone : le plafond est une garantie d’un niveau spécifique de réduction des émissions. »
Knut Einar Rosendahl
Contrairement à ce que beaucoup affirment aujourd’hui, le marché carbone ne permet pas à l’État de fixer un prix sur la nature, comme c’est le cas avec une taxe carbone. Bien au contraire, le prix de la tonne de carbone est fluctuant et déterminé par la loi du marché. La merveilleuse danse – toujours théorique – de l’offre et de la demande garantit une atteinte des objectifs climatiques à moindre coût. Le prix de la tonne de carbone est standardisé et une entreprise a alors le choix, en fonction d’un calcul économique rationnel, d’acheter des quotas ou d’effectuer une transition énergétique en achetant de nouveaux équipements. Le dispositif focalise in fine les efforts de réduction sur les opportunités les moins onéreuses. Les marchés carbone C & T sont alors non seulement loués pour leur garantie d’efficacité écologique – il existe une limite maximale aux émissions qu’il n’est pas possible de dépasser – mais économiques – les objectifs sont atteints de la manière la moins onéreuse possible.
Le succès des marchés carbone n’est pas étranger à la vague néolibérale opérée dès les années 1960 aux États-Unis. Auparavant, beaucoup considéraient qu’il existait deux solutions crédibles face au changement climatique. Les politiques environnementales avaient recours à un mélange subtile de régulations étatiques et de taxes pigouviennes, plus connue sous le nom de taxe carbone. Un tel dispositif doit son nom à l’économiste britannique orthodoxe Arthur Cecil Pigou (1877-1959) qui fut l’un des premiers à avoir défendu une taxation correctrice des externalités négatives dans les années 1920. Dès les années 1960, un économiste va bousculer cette approche sans pour autant remettre en cause l’hypothétique nécessité de conférer à la nature un prix.
Dans The problem of social cost (1960), Ronald Coase propose une révolution théorique. Selon ce dernier, l’État ne doit pas décider du prix du carbone mais mettre en place des droits de propriétés privés solides pour favoriser l’émergence d’un marché. L’approche de Coase donnera lieu à une littérature abondante d’économistes néoclassiques, à l’image du Canadien John Dales, considérant que les droits de propriétés doivent être exclusifs et transférables pour permettre un échange marchand optimal. En clair : ce n’est plus à l’État de décider du prix de la nature mais bien au marché.
« L’inexistence d’un marché découle de la mauvaise allocation des droits de propriété. »
Coase, The problem of social cost (1960)
« L’introduction des marchés carbone prends ses origines dans le débat américain, au moment de la création et de la montée en puissance de l’agence environnementale américaine » explique Stefan Aykut, professeur à l’université de Hambourg et auteur de Gouverner le climat ? « Il y a alors une critique qui émerge qui taxe la méthode de régulation d’inefficace car l’État ne connaitrait pas bien le processus industriel. Il faudrait, pour les tenants d’une telle critique, introduire des instruments liés aux marchés » explique le spécialiste de la gouvernance climatique.
Aux États-Unis, l’introduction des bubble concepts par l’agence de l’environnement en 1975 permet à une entreprise de compenser les retards environnementaux de certaines unités de production en effectuant des efforts dans d’autres installations. Comme le note justement un article sur le sujet, « un bubble concept traite une installation polluante comme si elle était entourée d’une bulle en plastique avec une seule sortie pour les émissions totales [d’un groupe industriel] plutôt que de limiter les émissions à chaque sortie ». Les bubble concepts pavent alors la voie à de nombreuses initiatives. Le projet 88, porté par l’économiste américain Robert Stavins et deux sénateurs, conclut que les incitations basées sur le marché sont les plus à mêmes de produire une réponse peu onéreuse et moins intrusive au changement climatique. Présenté à la convention des Républicains en 1988, il aboutit à la mise en place du Clean Air Act de 1990 qui pose les jalons d’un marché de permis américain. Ce programme met en place un système de permis pour contrôler les émissions de sulfure de dioxyde responsables de pluies acides.
Cette révolution néolibérale ne tarde pas à produire ses effets au Royaume-Uni, où les travaux de l’économiste libéral David Pearce ont reçu une grande attention. Chris Patten, ancien ministre de l’environnement, ainsi que Margaret Thatcher, ont largement repris ses idées. Pearce aura par ailleurs une influence considérable sur les débats politiques à l’international.
Il n’y a alors rien d’étonnant à ce que certains pays emboitent le pas au pays de l’oncle Sam en mettant en place des programmes basés sur le marché, à l’image de l’Australie ou du Canada. En 2005, c’est au tour des institutions européennes de se plier à cette nouvelle hégémonie : un marché carbone est mis en place et restera longtemps le plus important du monde. Il convient de préciser que les règles des institutions européennes ne sont pas étrangères à cette décision : la mise en place d’une écotaxe commune nécessitait l’accord unanime des membres de l’Union contrairement à l’instauration d’un marché.
Les néolibéraux au secours du marché
Les marchés carbone n’ont rencontré que très peu de fervents adversaires lors de leur mise en place. S’il pourrait sembler logique et légitime que le secteur des affaires voue aux gémonies une telle initiative, accusée de provoquer des hausses de coûts, la réalité est bien différente.
Le marché québécois a ainsi obtenu « un appui considérable » de la part du secteur privé selon le Gouvernement du Québec. Ce dernier présentait le mécanisme comme « la meilleure garantie » de réduction des émissions, tout en étant « flexible » et permettant « la croissance, l’efficacité, la modernisation et la compétitivité ».
On comprend mieux cet engouement lorsque l’on sait que le développement des marchés carbone s’accompagne souvent d’une injonction à diminuer les réglementations environnementales des entreprises.
On retrouve ce même soutien pour le SEQE-UE de l’ association patronale européenne, Business Europe. La commission européenne a ainsi souvent vanté les qualités des marchés, mécanisme « innovant », « efficient », qui privilégie un « système ouvert d’incitations » et qui favorise « l’implication de tous les secteurs de la société et un partage entier des responsabilités ». On comprends mieux cet engouement lorsque l’on sait que le développement des marchés carbone s’accompagne souvent d’une injonction à diminuer les réglementations environnementales des entreprises. Lors d’une conférence internationale il y a un an, le directeur exécutif de Shell, David Hone, a ainsi estimé que « l’idéal pour un système de plafonnement et d’échange est de ne pas avoir de politique réglementaire qui le chevauche ».
Pour autant, ce phénomène n’est pas l’apanage des marchés carbone puisqu’il concerne également les taxes pigouviennes. Exxon Mobil, BP et Shell ont ainsi souhaité, sans y parvenir, mettre en place une taxe carbone à 40 dollars la tonne pour supprimer toutes les autres lois fédérales sur le climat. Ce Zeitgeist « libéral environnemental », comme aime l’appeler Steven Berstein, s’oppose ainsi radicalement aux méthodes de command and control (normes, interdictions, etc.).
Les entreprises empochent, les consommateurs trinquent
Si les marchés carbone permettent bien de fixer une limite maximale aux émissions, encore faut-il que cet objectif soit ambitieux… En Australie, le marché carbone a été supprimé en 2014 et n’a jamais fait ses preuves : le cap était basé sur un modèle douteux du Trésor fédéral australien. Les émissions autorisées augmentaient jusqu’en 2028 et se réduisaient petit à petit jusqu’en 2050.
Si le bilan du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) est plus défendable, il est loin d’être la panacée. Certes, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE ont diminué de 33% par rapport à 2005. Là aussi, difficile d’attribuer ces résultats positifs au marché carbone qui ne couvre que 45% des émissions de l’UE. Un récent rapport parlementaire conclut que le système n’a « à ce jour contribué qu’à la marge à l’atteinte des objectifs climatiques européens ». Pourquoi un constat si cruel ?
Il est premièrement difficile d’imputer la diminution des émissions communautaires au seul marché carbone. D’autres paramètres sont à prendre en compte comme… les crises économiques. Ces dernières font en effet mécaniquement baisser les émissions carbonées puisque la production est alors moindre. Pour autant, cela ne nous explique pas pourquoi le prix de la tonne de CO² a rarement dépassé les 10€.
La méthode d’allocation de quotas, plutôt favorable aux entreprises, n’est pas étrangère à ce phénomène. Lors des deux premières phases du marché (2005-2012), les quotas distribués aux industriels étaient ainsi fondés principalement sur leurs émissions passées et non sur des objectifs à atteindre. Parfois même, certains groupes recevaient plus de quotas que ce dont ils avaient besoin. Dans une telle situation, le marché ne rémunère pas les bonnes pratiques mais l’absence d’action. Se voir attribuer plus de quotas que ses émissions est un problème majeur puisque le prix du carbone est mécaniquement tiré à la baisse, l’offre étant plus grande que la demande.
Plus inquiétant encore, les quotas distribués sur le marché primaire ont longtemps été attribués gratuitement aux entreprises. Le rapport parlementaire sur le SEQE-UE précédemment évoqué estime ainsi que « le cadre actuel est manifestement insuffisant pour atteindre le nouvel objectif européen de réduction de 55 % des émissions carbone d’ici 2030 par rapport à 1990 ». Les sénateurs analysent en effet que « le maintien de quotas gratuits […] constitue en particulier un obstacle évident à ce relèvement de l’ambition [climatique] du fait de cette distribution gratuite de quotas ». Un rapport au vitriol de la Cour des comptes européenne considère quant à lui qu’un meilleur ciblage des allocations gratuites « aurait apporté de multiples avantages aux fins de la décarbonation, aux finances publiques et au fonctionnement du marché unique ». Si les économistes s’accordent en effet pour considérer que l’allocation gratuite des permis est un manque à gagner pour les finances publiques, force est de constater qu’elles ont également permis à des entreprises d’engranger d’indécents bénéfices.
Beaucoup pensaient en effet que, si les entreprises recevaient des quotas gratuits, elles ne les considéreraient alors pas comme des actifs. Or, cette intuition s’est révélée complètement fausse. Comme le soulève une étude, « il est incorrect de supposer que si tous les quotas de CO² sont fournis gratuitement à l’opérateur, le prix au comptant du CO² n’influencera pas par la suite la tarification de l’électricité. En effet, le prix du CO² devient un coût d’opportunité pour le producteur, dont il doit tenir compte lorsqu’il décide de produire ». De fait, les entreprises ont majoritairement répercuté ces « coûts » imaginaires aux consommateurs et ont pu engranger des bénéfices de plus de 14 milliards d’euros entre 2005 et 2008. Lors de la deuxième phase (2013-2020), les producteurs d’électricité ont profité du marché pour augmenter les prix de l’électricité et engranger des bénéfices compris entre 23 et 71 milliards d’euros.
Depuis 2013, la vente aux enchères est privilégiée, sauf pour les secteurs souffrent d’une large concurrence internationale. Mais la pratique est loin d’avoir pris fin : entre 2021 et 2030, ce seront 6 milliards de quotas qui seront distribués gratuitement aux secteurs qui souffrent de « fuite de carbone ». Comprendre : les industries les plus soumises à la concurrence internationale. Et la définition est assez large car on y retrouve le secteur de l’acier, de l’extraction de la houille en passant par la fabrication de vêtements en cuir. L’arrêt de la distribution gratuite de quotas ne prendra fin qu’en 2036 lorsque le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières sera complètement mis en place.
Cette surallocation des quotas se combine avec un deuxième problème majeur des systèmes cap and trade : la possibilité de stocker les quotas sur de longues durées. Dans le système californien, le stockage illimité permet de mettre en réserve ses permis indéfiniment. Les entreprises peuvent acheter plus de quotas qu’elles n’en ont besoin au cours d’une année, les conserver et les utiliser pour couvrir leurs futures obligations environnementales. Au total, pas moins de 200 millions de permis seraient stockés, soit presque l’équivalent de l’effort d’atténuation des émissions que la Californie attend du programme de plafonnement et d’échange… jusqu’en 2030. Le vieux continent ne fait pas exception à la règle puisque 970 millions de quotas issus du problème de surallocation ont pu être stockés par les entreprises jusqu’à la phase III (2013-2020).
En réalité, les plafonds d’émissions ne sont bien souvent pas aussi inflexibles qu’ils en ont l’air. Les entreprises peuvent, dans certaines conditions, acheter des crédits carbone sur les marchés internationaux. L’action des entreprises n’est alors plus confinée à l’Union Européenne, zone pourtant déjà très large, et s’étend sur tout le globe. Cette subtilité permet aux entreprises de tirer le prix du carbone à la baisse puisque le prix du carbone n’est alors plus unifié. Pendant la phase 2 (2008-2012) du marché carbone européen, plus d’un milliard de quotas internationaux ont été achetés puis, lorsqu’ils n’étaient pas utilisés, transférés à la phase 3 (2013-2020). On retrouve le même schéma derrière le système australien qui permettait aux entreprises d’acheter jusqu’à 50% de leurs quotas sur les marchés internationaux.
Le marché nivelle les efforts climatiques par le bas
Pour qu’un marché carbone soit pleinement efficace, il faut qu’il oriente les investissements dans la bonne direction. Or, plusieurs observations peuvent nous faire douter du contraire.
Premièrement, il ne faut pas oublier qu’un marché carbone standardise, bien qu’il soit fluctuant, le prix de la tonne de CO² sur toute une zone. Or, les financements nécessaires pour qu’une entreprise rentabilise ses investissements environnementaux diffèrent grandement en fonction des situations. Les besoins vont de 37 $ à 220 $ la tonne en fonction des études. En réalité, il paraît assez absurde de n’avoir qu’un seul prix carbone pour toute une région et pour tous les secteurs économiques. D’autant plus que le marché oriente structurellement les investissements vers les options les moins onéreuses (que l’on pourrait résumer par le calcul argent dépensé/tonne de CO² réduite). Les entreprises sont alors incitées à réaliser les investissements les plus faciles à réaliser, ce que l’on appelle parfois les low hanging fruits, les fruits faciles à récolter. Il y a pourtant fort à douter que le seul critère d’efficacité économique puisse garantir une efficacité écologique sur le long terme.
Un dirigeant d’entreprise entamera-t-il une transition, souvent onéreuse, s’il ne peut savoir à quel prix il sera rémunéré ?
Face à la surallocation des quotas carbone, l’UE a mis en place une réserve de stabilité (MSR) capable de retirer des quotas du marché. Une telle initiative, dont les intentions sont louables, a provoqué une hausse drastique des prix sur le marché. Si les dirigeants européens sont confiants que le prix du carbone ne va faire que croître dans les prochaines années, certaines études semblent douter de ce phénomène. Certains chercheurs pensent que cette réforme a poussé les entreprises présentes sur le marché à spéculer sur le prix du carbone. En réalité, que ces fluctuations soient provoquées par de la spéculation ou par la seule rencontre de l’offre et de la demande n’a que peu d’intérêt. Le plus inquiétant est que n’importe quelle intervention étatique censée améliorer le système – la réforme MSR n’en est qu’un exemple – agitera forcément les marchés. Comme le note justement le rapport sénatorial : « le système d’échange de quotas peut […] être particulièrement sensible aux chocs exogènes ainsi qu’aux autres régulations environnementales et économiques, le rendant difficilement pilotable par la puissance publique ».
Or, il ne faut pas oublier que l’un des objectifs principaux d’un marché carbone est de récompenser les investissements vertueux. Pourtant, un dirigeant d’entreprise entamera-t-il une transition, souvent onéreuse, s’il ne peut savoir à quel prix il sera rémunéré ? C’est là tout le paradoxe d’un tel système. Longtemps considéré par les industriels comme indolore voire bénéfique, le marché carbone n’a pas permis de bien récompenser les pratiques vertueuses. L’intervention de l’État a donc été nécessaire pour assurer son bon fonctionnement. Il y a fort à parier que le prix de la tonne de CO² n’aurait jamais augmenté d’une telle ampleur sans la mise en place du MSR en 2019. Or, c’est cette même intervention étatique qui rend le marché totalement fluctuant et peu prévisible. Et l’on revient ici au dilemme cornélien qui agite depuis des dizaines années les experts environnementaux : assurer une efficacité écologique avec une incertitude sur les prix dommageables à long terme (marché C&T) ou bien conserver un contrôle sur ces prix au risque de ne pas atteindre les objectifs fixés (taxe carbone) ? On voit très bien ici comment cette logique peut nous conduire dans l’impasse. Dès lors, les réglementations environnementales ambitieuses et contraignantes semblent constituer une solution crédible. Stefan Aykut estime ainsi que l’on assiste actuellement à « un retour des approches par la régulation, sur les questions de renouvelable, d’isolation des bâtiments… Les questions de régulation ne sont plus taboues, elles reviennent sur le devant de la scène internationale. »