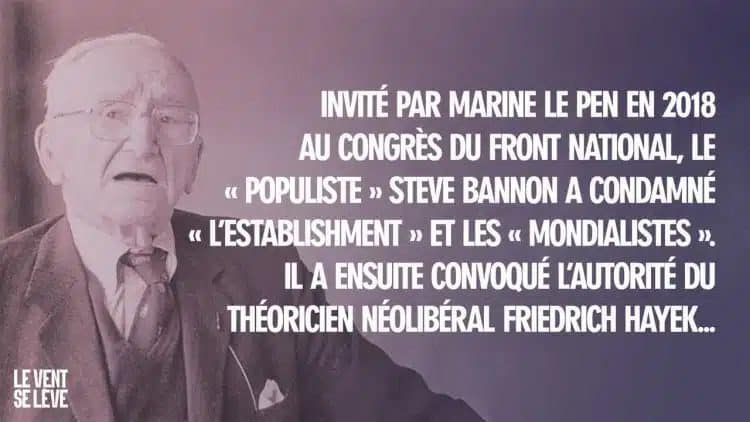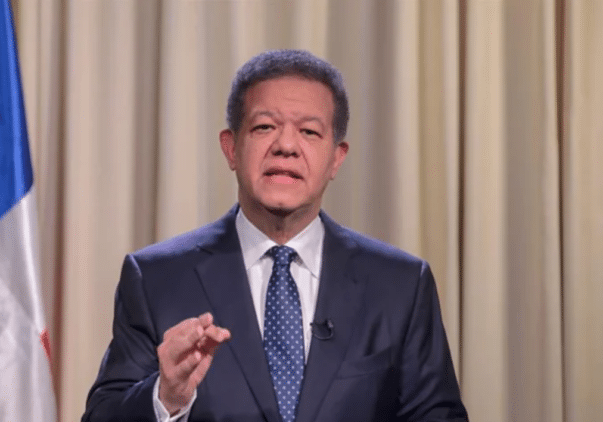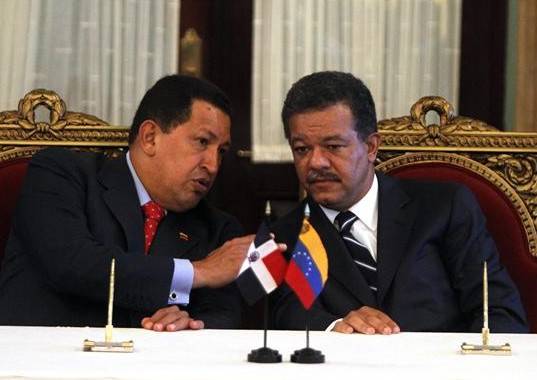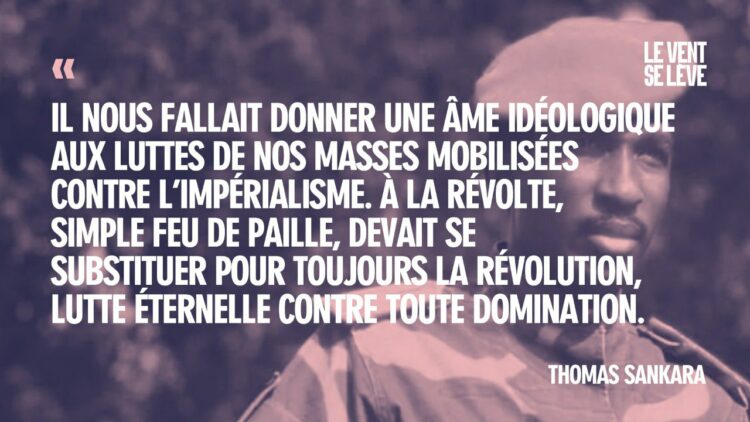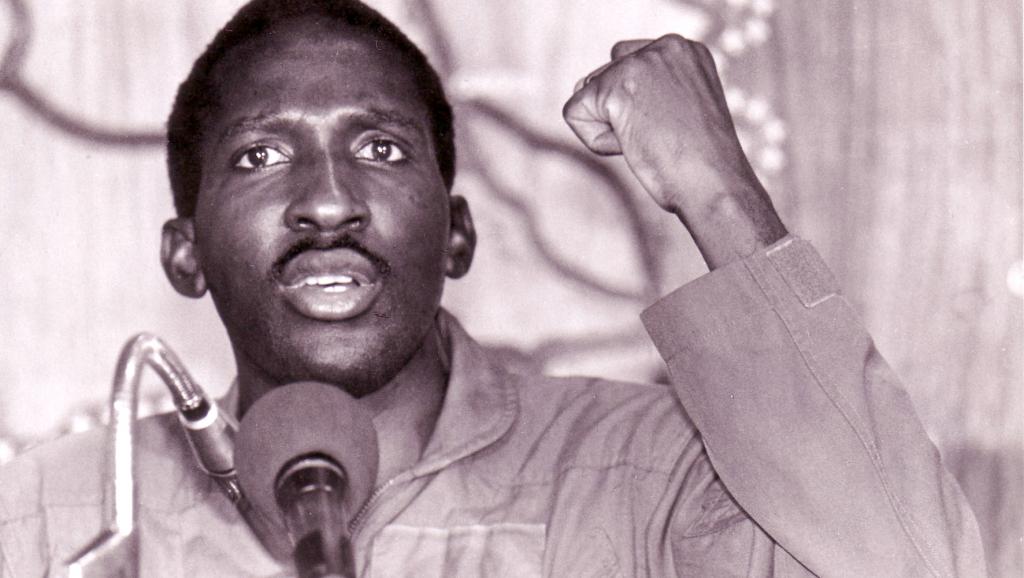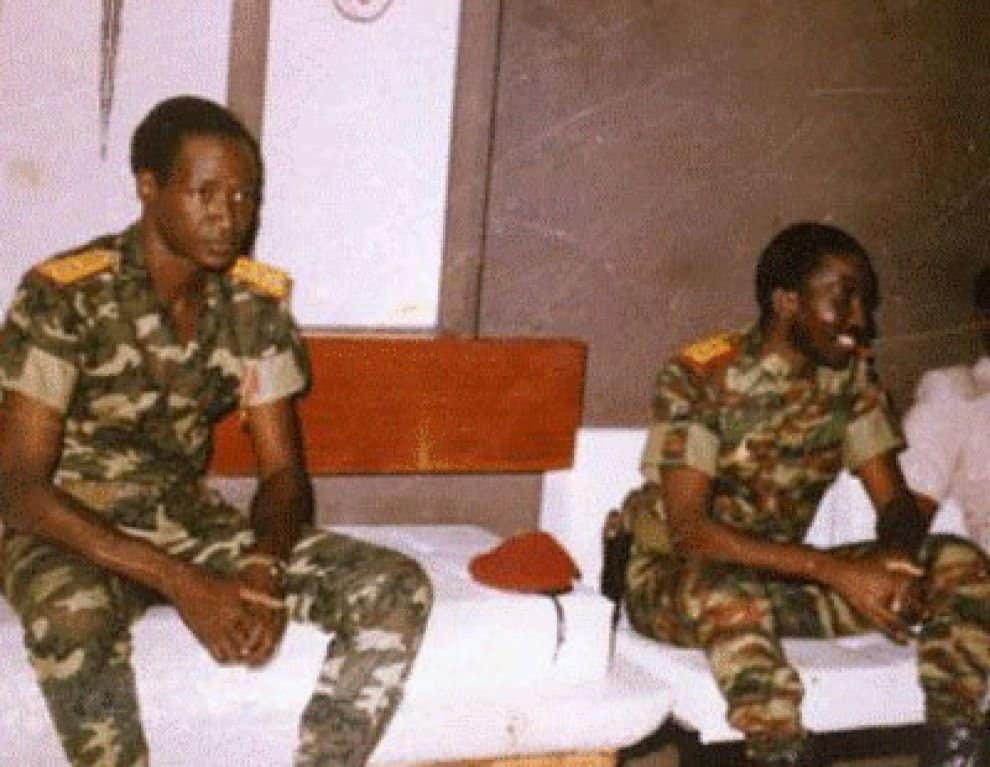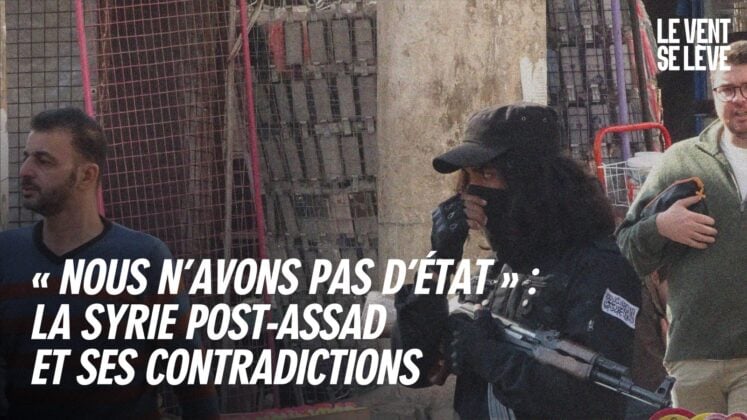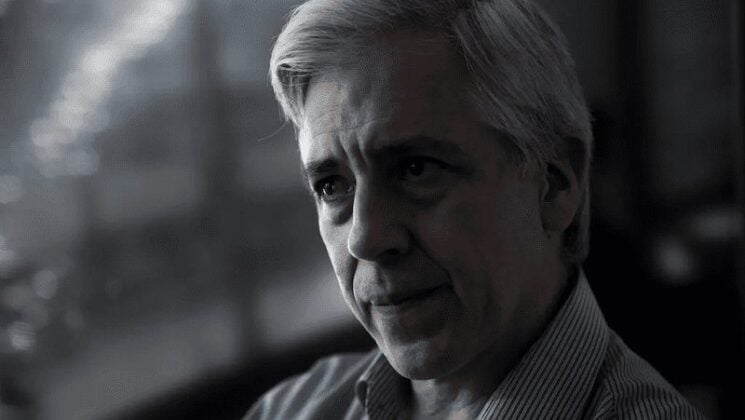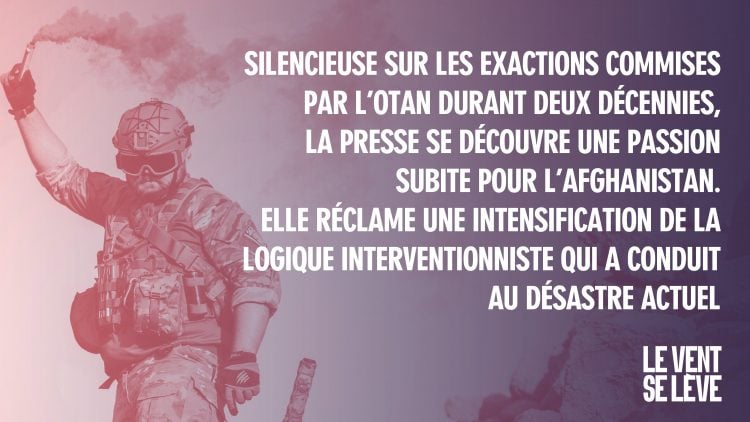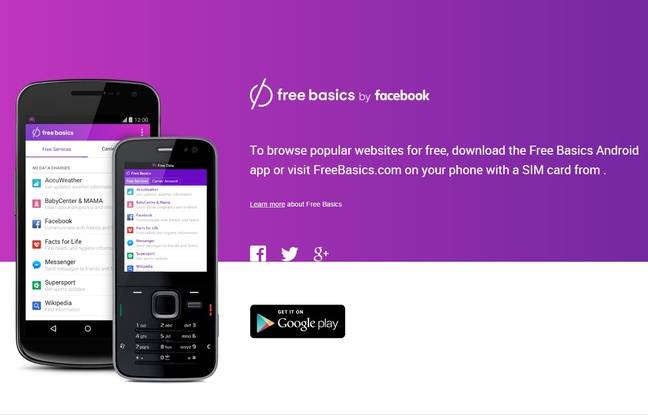« Préoccupations sécuritaires », « autodétermination », « choix civilisationnel », « projet impérial », « impérialisme » ou « anti-impérialisme » : ces notions fleurissent depuis le commencement du conflit. La plupart des commentateurs, de gauche ou de droite, hostiles ou favorables à l’OTAN, évoquent « la Russie » comme un acteur monolithique, qui agirait pour défendre ses intérêts et sa vision du monde – que ce soit pour protéger ses frontières, dans un accès de paranoïa, ou pour réaliser un sinistre dessein expansionniste. Les dynamiques internes de la société russe sont laissées de côté. Comprendre la nature de la classe oligarchique russe, de son régime d’accumulation et de ses contradictions est pourtant riche d’enseignements quant aux raisons de l’invasion ukrainienne. Par Volodymyr Ischenko, chercheur à l’Université libre de Berlin et auteur de Towards the Abyss: Ukraine from Maidan to War (Verso, 2023). Traduction par Albane le Cabec [1].
Le débat portant sur les « intérêts » russes dans ce conflit est particulièrement pauvre. D’un côté, certains assimilent le positionnement de Vladimir Poutine à celui de la société russe, sans questionner les raisons de son insistance sur l’appartenance des Ukrainiens et des Russes à un peuple unique. D’autres tiennent au contraire ses déclarations pour systématiquement mensongères – ou simplement stratégiques -, et ne reflétant pas les « vrais » objectifs poursuivis en Ukraine.
À leur manière, ces deux postures jettent un écran de brouillard sur les motivations du Kremlin. Comprendre « ce que veut vraiment Poutine » requiert d’aller au-delà de quelques citations sélectionnées dans ses grands discours. Une analyse des intérêts financiers en jeu – fût-ce pour ensuite les rattacher à un discours – est autrement plus éclairante.
Le concept d’impérialisme a été brandi – souvent à tort et à travers -, y compris par certains analystes, marxistes, pour désigner les intérêts et la démarche du Kremlin. Le contexte post-soviétique diffère pourtant de celui où il a été théorisé, notamment par Lénine. Sa génération avait analysé l’impérialisme de sociétés capitalistes en voie d’expansion et de modernisation, tandis que les sociétés post-soviétiques connaissent des phases de crises, de dé-modernisation et de périphérisation : des différences de taille, qui exigent à tout le moins quelques précisions.
En Russie, le rôle de l’État est plus important qu’ailleurs dans la reproduction de la classe dirigeante, en raison de la nature de la transformation post-soviétique.
Si l’on s’en tient au prisme « marxiste » classique, la situation russe échappe aux explications traditionnelles. L’expansion du capital financier russe ne fournit pas un motif évident pour cette agression – que l’on songe simplement aux sanctions occidentales sur une économie russe fortement mondialisée. Pas davantage que la conquête de nouveaux marchés – l’Ukraine n’attire pratiquement pas d’investissement direct étranger. Pas plus que le contrôle des ressources stratégiques – quels que soient les gisements miniers se trouvant sur le sol ukrainien, la Russie aurait besoin d’une industrie en expansion pour les absorber, ce que les sanctions économiques limitent fortement…
Face à cette difficulté, certains ont alors prétendu que la guerre pouvait procéder une forme « politique » ou « culturelle » d’impérialisme. Une explication peu convaincante – elle impliquerait que la classe dirigeante russe soit prise en otage par un maniaque nationaliste avide de pouvoir, obsédé par une « mission historique » de restauration de la grandeur nationale…
Or, Vladimir Poutine n’est ni un idéologue fanatisé (des politiques de cette nature se sont révélées marginales dans tout l’espace post-soviétique depuis deux décennies), ni un fou. Et il faut bien admettre qu’il ne s’est pas outre mesure émancipé de l’agenda de la classe dominante russe. Alors, de quoi est-il le nom ?
Le capitalisme politique – en Russie et ailleurs
Qui dirige la Russie ? Un marxiste répondrait que « la classe capitaliste » est aux commandes. Un quidam de l’espace post-soviétique s’en prendrait simplement aux « voleurs, aux « escrocs », aux « mafieux ». Une réponse plus médiatique consisterait à faire référence aux « oligarques » – terme qui met en évidence l’interdépendance entre les entreprises privées et l’État.
Historiquement, « l’accumulation primitive » du capital des pays de l’ex-bloc soviétiques s’est produite grâce à la désintégration de l’État et de l’économie soviétiques. Le politologue Steven Solnick qualifie de « pillage de l’État » le processus par lequel les membres de la nouvelle classe dirigeante ont privatisé ce qui appartenait aux entités publiques – souvent pour quelques dollars. Ils ont bien sûr tiré profit de leurs relations informelles avec les dirigeants du nouvel l’État, et des lacunes d’un système juridique intentionnellement conçu pour faciliter l’évasion fiscale et la fuite des capitaux.
L’économiste marxiste russe Ruslan Dzarasov désigne cette accumulation initiale comme une « rente d’initiés ». On retrouve bien sûr ces pratiques dans d’autres parties du monde, mais le rôle de l’État est ici bien plus important dans la création et la reproduction de la classe dirigeante russe, en raison de la nature de la transformation post-soviétique.
Ces phénomènes sont plus généralement subsumés par le concept de « capitalisme politique » – ou « capitalisme d’État », dans ses variantes. De nombreux penseurs, comme le sociologue Hongrois Ivan Szelenyi, ont développé ce concept traditionnellement défini par Max Weber comme l’exploitation de la fonction politique par la classe capitaliste, visant à maximiser l’accumulation de richesses. Partant, les « capitalistes d’État » – que l’on nommera ici, par commodité de langage, oligarques – désignent la fraction des détenteurs de capitaux dont le principal avantage concurrentiel provient de leur mainmise sur les institutions publiques – contrairement à ceux qui tirent leur pouvoir d’une main-d’œuvre bon marché ou d’innovations. Les oligarques n’existent pas seulement dans les pays post-soviétiques : ils tendent à bourgeonner sur les ruines des États qui ont joué un rôle structurant dans l’économie, accumulé d’importants capitaux, puis se sont brutalement ouverts au secteur privé.
Il est possible, sur ces fondements, d’aller au-delà des déclarations du Kremlin portant sur sa « souveraineté » ou ses « sphères d’influence ». Si les avantages que procure l’État aux oligarques sont fondamentaux pour l’accumulation de leur richesse, ils n’ont d’autre choix que de défendre le territoire sur lequel ils exercent un tel contrôle.
Ce besoin de « marquer le territoire » est moins fondamental pour les autres catégories de détenteurs de capitaux. Les classes dominantes « traditionnelles » ne dirigent pas l’État directement : en Occident, les institutions étatiques jouissent d’une autonomie substantielle par rapport à la classe dominante, qu’elles servent indirectement en établissant des règles qui permettent l’accumulation. Les oligarques, en revanche, n’exigent pas de l’État la simple mise en place de règles : ils souhaitent un contrôle beaucoup plus immédiat sur les décideurs politiques – lorsqu’ils n’en sont pas eux-mêmes.
Bien sûr, de nombreuses icônes du capitalisme entrepreneurial classique ont bénéficié de subventions de l’État, de régimes fiscaux préférentiels ou de diverses mesures protectionnistes. Mais, contrairement aux oligarques, leur survie et leur expansion sur le marché ne dépendent que rarement des partis au pouvoir ou des régimes politiques en place. Le capital transnational survivrait sans les États-nations dans lesquels son siège social est situé – comme en témoigne les projets de villes entrepreneuriales flottantes, « indépendantes » de tout État-nation, rêvés par les magnats de la Silicon Valley comme Peter Thiel. Les oligarques, à l’inverse, ne peuvent survivre dans la concurrence mondiale sans le territoire duquel ils tirent une rente.
Les conflits de classe à l’ère post-soviétique
Un tel « capitalisme politique » est-il viable sur la longue durée ? Après tout, l’État doit bien puiser ses ressources quelque part pour pérenniser cette redistribution ascendante… Comme le note Branko Milanovic, la corruption demeure un problème endémique du « capitalisme politique » – que l’on songe simplement à la Chine, modèle le plus abouti en la matière, où les institutions du Parti communiste ont été fragmentées par de multiples réseaux clientélaires. De telles réalités freinent les tendances à la modernisation de l’économie. Pour le dire autrement, il n’est pas possible de puiser éternellement à la même source : le « capitalisme politique » doit muer en une forme qui lui permette de maintenir un taux de profit élevé via des investissements en capital ou une exploitation intensive du travail – sans quoi la source des rentes finira par se tarir.
L’alliance entre le capital transnational et les classes moyennes des pays voisins de la Russie, représentées par des sociétés civiles pro-occidentales, traçait les contours d’un projet post-soviétique plus menaçant pour le Kremlin. Cette alliance, davantage que les oligarques traditionnels, obérait les projets d’intégration régionale.
Or, le réinvestissement et l’exploitation de la force de travail se heurtent à des obstacles structurels dans le capitalisme post-soviétique. D’une part, les oligarques eux-mêmes hésitent à s’engager dans des investissements à long terme, ayant à l’esprit que la prospérité de leur modèle dépend de la présence au pouvoir d’un certain clan. Aussi, il est généralement plus opportun pour eux de transférer leurs bénéfices vers des comptes offshore, dans une logique de profit immédiat. D’autre part, la main-d’œuvre post-soviétique, urbanisée et qualifiée, n’est pas bon marché. Les salaires relativement bas de la région n’ont été rendus possibles qu’en raison de la vaste infrastructure matérielle et des institutions de protection sociale que l’Union soviétique a laissé en héritage. Cet héritage représente un fardeau énorme pour l’État, mais il n’est pas si facile de l’abandonner sans provoquer un grognement populaire immédiat.
Dans une logique que l’on peut qualifier de « bonapartiste », Vladimir Poutine et son entourage ont cherché à mettre fin à cette guerre de « tous contre tous » qui a caractérisé les années 1990, équilibrer les intérêts de certaines fractions de l’élite, et en réprimer d’autres. Ce, sans altérer les fondements de ce « capitalisme politique ».
Alors que cette expansion prédatrice du capitalisme russe commençait à se heurter à ses limites internes, les élites ont cherché à l’externaliser pour soutenir leur taux de rente, en augmentant le bassin d’extraction. C’est ainsi que l’on peut comprendre l’intensification des projets d’intégration menés par la Russie, à l’instar de l’Union économique eurasiatique. Ils se sont heurtés à deux obstacles.
Le premier, relativement mineur, réside dans la résistance des classes dominantes locales. En Ukraine, les oligarques comptaient bien conserver leur propre droit souverain à récolter des rentes d’initiés sur leur territoire. Ils ont alors instrumentalisé le nationalisme anti-russe pour légitimer leur revendication sur la partie ukrainienne de l’État soviétique en désintégration – sans réussir à développer un projet national fondé sur le développement.
Le célèbre titre du livre du second président ukrainien Leonid Koutchma – L’Ukraine n’est pas la Russie – illustre bien ce problème. Si l’Ukraine n’est pas la Russie, alors qu’est-elle ? L’échec des oligarques post-soviétiques non-russes à surmonter la crise de l’hégémonie qu’ils traversaient a fragilisé leur pouvoir, in fine dépendant du soutien russe, comme en Biélorussie ou au Kazakhstan.
L’alliance entre le capital transnational et les classes moyennes, représentées par des sociétés civiles pro-occidentales, traçait les contours d’un projet post-soviétique plus menaçant pour le Kremlin. Cette alliance, davantage que les oligarques traditionnels, obérait les projets d’intégration de la Russie. Une telle configuration offre une première réponse pour comprendre les raisons de l’invasion de l’Ukraine.
Il faut également rappeler que la stabilisation toute « bonapartiste » des institutions, imposée par Poutine, a favorisé la croissance d’une classe moyenne. Si une partie de celle-ci était financièrement liée au régime, la grande majorité était exclue de ce « capitalisme politique ». Les principales opportunités de revenus et de carrière pour ses membres résidaient donc dans une intensification des liens politiques, économiques et culturels avec l’Occident. On ne s’étonnera donc pas que cette classe moyenne ait été au premier poste de propagation du softpower occidental.
Ce contre-projet, profondément élitaire par nature, explique son peu de succès en Russie et dans le reste de l’espace post-soviétique – bien qu’une alliance avec les factions nationalistes anti-russes aient pu, en Ukraine et ailleurs, lui fournir une audience non négligeable. Aujourd’hui encore, la mobilisation des Ukrainiens contre l’agression russe n’implique pas qu’ils soient unis autour d’un tel projet.
La discussion sur le rôle de l’Occident dans l’invasion russe est généralement centrée sur la menace que représenterait l’OTAN pour la Russie. C’est un élément mis en avant par la classe dirigeante russe. Il est aisé de comprendre pourquoi : la classe oligarchique russe ne survivrait pas dans un modèle économique « à l’occidentale ». Les programmes « anti-corruption » mis en avant par les institutions européennes et nord-américaines constituent une pièce fondamentale dans leur agenda de lutte contre le « capitalisme politique » : pour les oligarques russes, le succès de ce programme signifierait la fin de la poule aux oeufs d’or.
La classe dirigeante russe est fracturée. Si certains segments subissent de lourdes pertes du fait des sanctions occidentales, l’autonomie partielle du régime russe par rapport à ceux-ci lui permet de poursuivre des « intérêts collectifs » de long terme.
En public, le Kremlin tente de présenter la guerre comme une bataille pour la survie de la Russie. L’enjeu sous-jacent est cependant la survie de la classe dirigeante russe et de son modèle oligarchique. La restructuration « multipolaire » de l’ordre mondial lui fournirait un certain répit. On comprend donc la rhétorique tiers-mondiste du Kremlin, qui tente de populariser sa vision géopolitique auprès des élites du « Sud global ». Celles-ci, à leur tour, obtiendraient le droit à leur propre « sphère d’influence ».
Crises du bonapartisme post-soviétique
Il faut garder à l’esprit les intérêts contradictoires des classes oligarchiques post-soviétiques, des classes moyennes et du capital transnational pour comprendre la genèse du conflit actuel. La crise de l’organisation politique aux fondements du « capitalisme politique » a servi de catalyseur.
Les régimes « bonapartistes », comme ceux de Vladimir Poutine ou d’Alexandre Loukachenko, se nourrissent d’un soutien passif et dépolitisé de la population. Ils tirent leur légitimité de leur capacité à surmonter le désastre de l’effondrement post-soviétique – une matrice hégémonique bien faible. De tels régimes, fortement personnalisés, sont fragiles en raison des problèmes de succession. Aucune règle n’émerge pour la passation du pouvoir, pas davantage qu’une idéologie à laquelle le nouveau dirigeant devrait se raccrocher. Aussi la succession constitue-t-elle l’un des talons d’Achille de l’oligarchie post-soviétique. Ces phases constituent des moments de fragilité, durant lesquels les soulèvements populaires ont de meilleures chances de réussir.
De tels soulèvements se sont accélérés à la périphérie de la Russie ces dernières années : le mouvement « Euro-Maïdan » en Ukraine (2014), les soulèvements arméniens, la troisième révolution au Kirghizistan, le soulèvement raté en Biélorussie (2020) et plus récemment l’insurrection au Kazakhstan. Dans les deux derniers cas, le soutien russe s’est avéré structurant pour assurer la survie du régime. En Russie même, les rassemblements « pour des élections équitables » organisés en 2011 et 2012, ainsi que les mobilisations ultérieures inspirées par Alexeï Navalny, soutenus pas la classe moyenne pro-occidentale, ne sont pas anodins. À la veille de l’invasion, l’agitation populaire était en hausse, tandis que les sondages établissaient une baisse de confiance en Vladimir Poutine – et une hausse de ceux qui souhaitaient sa mise à la retraite.
Aucun de ces soulèvements n’a pourtant représenté une menace vitale pour l’ordre oligarchique post-soviétique. Ils n’ont fait que substituer une fraction de la classe dominante à une autre, aggravant la crise de la représentation contre laquelle ils étaient précisément apparus – raison de leur caractère endémique.
Comme le souligne le politologue Mark Beissinger, les phénomènes de type « Maïdan » constituent des soulèvements civiques et urbains qui, contrairement aux révolutions sociales du passé, n’affaiblissent que temporairement le régime en cours, par un renforcement conjoncturel de la « société civile » issue de la classe moyenne. Ils ne parviennent à instaurer un ordre politique alternatif, pas davantage que des mutations démocratiques durables, encore moins un infléchissement égalitaire des structures économiques. Dans les pays post-soviétiques, ces soulèvements n’ont fait qu’affaiblir l’État – et rendre les oligarques locaux plus vulnérables aux assauts du capital transnational, à la fois directement et indirectement, notamment via les ONG pro-occidentales.
L’Ukraine constitue un cas d’école. Une série d’agences « anti-corruption » ont été obstinément promues par le FMI, le G7 et la « société civile » ukrainienne suite au soulèvement « Euro-Maïdan ». Ils n’ont pourtant mis fin à aucun cas majeur de corruption au cours des huit dernières années. Leur principale réussite réside dans l’institutionnalisation de la surveillance des principales entreprises d’État par des ressortissants étrangers et des militants anti-corruption, réduisant ainsi les opportunités de récolter des rentes d’initiés pour les oligarques locaux. Aussi les élites russes ont-elles des raisons objectives de craindre les institutions occidentales…
Consolidation de la classe dirigeante russe
Divers facteurs conjoncturels permettraient de comprendre pourquoi l’invasion a été enclenchée à ce moment précis – et les raisons de son caractère désastreux : avantage temporaire de la Russie dans les armes hypersoniques, dépendance de l’Europe en énergie russe, répression de l’opposition – « pro-russe » – en Ukraine, enlisement des accords de Minsk de 2015, échec des services secrets russes en Ukraine, etc. Il s’agit ici d’esquisser à grands traits le conflit de classe à l’origine de l’invasion : celui qui oppose des oligarques souhaitant soutenir leur taux de rente par une expansion territoriale, et un capital transnational allié aux classes moyennes exclues de ce « capitalisme politique ».
Ce conflit ne se manifeste pas seulement par cette facette impérialiste. La répression qui s’abat sur les manifestants en Biélorussie et en Russie même en découle également. L’intensification de la crise d’hégémonie post-soviétique et l’incapacité de la classe dirigeante à développer un leadership politique, moral et intellectuel constituent des causes déterminantes dans l’escalade de la violence.
La classe dirigeante russe est fracturée. Si certains segments subissent de lourdes pertes du fait des sanctions occidentales, l’autonomie partielle du régime russe à leur égard lui permet de poursuivre des « intérêts collectifs » de long terme. Dans le même temps, la crise des régimes périphériques exacerbe la menace qui pèse sur la classe dirigeante russe. Les fractions les plus « souverainistes » des oligarques russes ont la main haute par rapport aux plus « compradores », – même si celles-ci comprennent qu’avec la chute du régime, ils seraient également perdants.
En déclenchant la guerre, le Kremlin a cherché à contrecarrer cette menace – et à tendre vers l’horizon d’une restructuration « multipolaire » de l’ordre mondial. Comme le suggère Branko Milanovic, la guerre confère une légitimité au découplage entre la Russie et l’Occident malgré ses coûts extraordinairement élevés – et plus le temps passe, plus la machine arrière paraît improbable. Elle permet également à la classe dirigeante russe de renforcer son organisation politique et sa légitimité idéologique. Ne voit-on pas poindre les signes d’une transformation vers un régime politique autoritaire, idéologisé et mobilisateur ?
Pour Vladimir Poutine, il s’agit essentiellement d’une autre étape dans le processus de consolidation post-soviétique entamé au début des années 2000, consistant à apprivoiser les oligarques russes. Le récit de la prévention des catastrophes et de la restauration de la « stabilité » constituait une première étape. Un nationalisme conservateur plus articulé lui emboîte le pas, dirigé à l’encontre d’acteurs extérieurs – comme les Ukrainiens et l’Occident – ou intérieurs – les « traîtres » cosmopolites.
Note :
[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre « Behind Russia’s War Is Thirty Years of Post-Soviet Class Conflict »